Fontes Hist Oriæ Africanæ
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MBANDAKA Hier Et Aujourd'hui
t C,ntre lEquatorial B.~ o~ f fi ~30H I ;, \. • 'J. - Etudes lEquatoria- 10 Etudes lEquatoria- 10 MBANDAKA Hier et auJourd'hui Eléments d'historiographie locale Centre JEquatoria B.P. 276 Bamanya - Mbandaka - Zaïre 1990 5 Présentation Le présent ouvrage sur Mbandaka est une reprise partielle des Annales Aequatoria 7 (1986). Epuisée après quelques semaines, que cette ébauche d'une histoire de Mbandaka répondait manifestement à un réel besoin. Aussi l'avons-nous reprise en y insérant des éléments nouveaux et quelques amendements. Il est toutefois cer tain que seulement un fragment de la réalité historique de la vitle a été abordé. Il est tout aussi vrai que l'historiogra phie de Mbandaka n'est qu'à son début. La rédaction de ce livre nous en a donné la preuve. Il reste donc évident qu'it contient beaucoup de lacunes. Qu'on veuille nous envoyer des addenda et corrigenda, car nous pensons déjà à une réédition. Que tous ceux qui ont contribué financièrement à la réalisation de cette édition en soient ici remerciés. La Rédaction Bamanya, le 13 mars 1990 6 Ont collaboré à ce livre 1. BOELAERT Edmond (posthume) 11. MEINERTS Eva 2. ELEMA Maleka Préfet Lycée Nsang'ea Ndotsi Professeur Lycée Nsang'ea Ndotsi B.P. 453 Mbandaka B.P. 453 Mbandaka 12. MOLA Motia Bikopo 3. ESSALO Lofele dj'Essalo Chef de Travaux ISP, Documentaliste Aequatoria B.P.1I6 Mbandaka 4. HULSTAERT Gustaaf(posthume) 13. MUZURI Feruzi 5. IBOLA Yende Chef de Travaux ISP Assistant ISP B.P.1I6 Mbandaka B.P.1I6 Mbandaka 14. NABINDI Guatili Dena 6. -
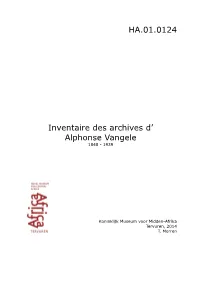
Vangele, Alphonse
HA.01.0124 Inventaire des archives d’ Alphonse Vangele 1848 - 1939 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren, 2014 T. Morren Description des archives Nom: Archives Alphonse Vangele Référence: HA.01.0124 Dates extrêmes: 1882 - 1940 Importance matérielle: 0,8 m.l. Langues des pièces: Les documents sont rédigés en Français pour la majeure partie Lieu de conservation: Musée royal de l'Afrique Centrale 2 Consultation et utilisation Conditions d’accès L’ensemble des archives de ce fonds peuvent être consultées librement au Musée royal de l’Afrique centrale selon les règles générales de consultation. Vous trouverez plus d’information à ce sujet sur le site du Musée royal de l’Afrique central: httpp://www.africamuseum.be. Conditions de reproduction La reproduction de ces archives est autorisée pour autant qu’elle soit réalisée à des fins privées et qu’elle se conforme aux règles générales de reproduction. Vous trouverez plus d’information à ce sujet sur le site du Musée royal de l’Afrique centrale: http://www.africamuseum.be. Citation Pour citer cet inventaire, il est nécessaire d’en donner d’abord la référence complète. Par la suite, la référence abrégée suffit. Référence complète: Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, Archives Alphonse Vangele, HA.01.00124, numéro dans l’inventaire. Référence abrégée: MRAC, Alphonse Vangele, HA.01.00124, numéro dans l’inventaire. 3 TOM MORREN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF ALPHONSE VANGELE (1848-1939) 4 Inhoudstafel Inhoudstafel .............................................................................................................................. -

Private Security Companies and Political Order in Congo
Private security companies and political order in Congo A HISTORY OF EXTRAVERSION Peer Schouten Private security companies and political order in Congo A history of extraversion Peer Schouten Doctoral Dissertation in Peace and Development Research School of Global Studies University of Gothenburg (June 5, 2014) © Peer Schouten Cover layout & illustration: Socrates Schouten Photo sources: private security guards and police officer against Goma background. (Peer Schouten, 2010/2012) Printing: Ineko, Gothenburg, 2014 ISBN: 978-91-628-9093-1 http://hdl.handle.net/2077/35683 ‘Un scorpion se promène sur les rives du fleuve Zaïre à Kinshasa et aperçoit un crocodile prenant un bain de soleil. Eh, dit le scorpion au crocodile, peux-tu me prendre sur ton dos et m'amener sur l'autre rive a Brazzaville? Que non, répond le crocodile. Je te connais trop bien: tu seras sur mon dos, et une fois au milieu du fleuve, tu vas me piquer et nous allons couler tous les deux. Mais non, rétorque le scorpion! Comment ferais-je une chose aussi aberrante? Si je te pique et que nous coulons tous les deux, je n'arriverai jamais à Brazzaville où pourtant je veux me rendre. Bien raisonné, dit le crocodile, monte sur mon dos et je t'emmène à Brazzaville. Et voilà notre scorpion sur le dos du crocodile qui se met à nager en direction de l'autre rive. Arrivé au beau milieu du fleuve, le scorpion pique à mort le crocodile et tous les deux se mettent à couler. Alors le crocodile mourant s'écrie dans un dernier souffle: Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Le scorpion à moitié mort de répondre: c'est le Zaïre, ne cherche pas à comprendre.’ Ilunga Kabongo (1984: 13) i Table of Contents Table of Contents ......................................................................................................... -

Inventory of the Henry M. Stanley Archives Revised Edition - 2005
Inventory of the Henry M. Stanley Archives Revised Edition - 2005 Peter Daerden Maurits Wynants Royal Museum for Central Africa Tervuren Contents Foreword 7 List of abbrevations 10 P A R T O N E : H E N R Y M O R T O N S T A N L E Y 11 JOURNALS AND NOTEBOOKS 11 1. Early travels, 1867-70 11 2. The Search for Livingstone, 1871-2 12 3. The Anglo-American Expedition, 1874-7 13 3.1. Journals and Diaries 13 3.2. Surveying Notebooks 14 3.3. Copy-books 15 4. The Congo Free State, 1878-85 16 4.1. Journals 16 4.2. Letter-books 17 5. The Emin Pasha Relief Expedition, 1886-90 19 5.1. Autograph journals 19 5.2. Letter book 20 5.3. Journals of Stanley’s Officers 21 6. Miscellaneous and Later Journals 22 CORRESPONDENCE 26 1. Relatives 26 1.1. Family 26 1.2. Schoolmates 27 1.3. “Claimants” 28 1 1.4. American acquaintances 29 2. Personal letters 30 2.1. Annie Ward 30 2.2. Virginia Ambella 30 2.3. Katie Roberts 30 2.4. Alice Pike 30 2.5. Dorothy Tennant 30 2.6. Relatives of Dorothy Tennant 49 2.6.1. Gertrude Tennant 49 2.6.2. Charles Coombe Tennant 50 2.6.3. Myers family 50 2.6.4. Other 52 3. Lewis Hulse Noe and William Harlow Cook 52 3.1. Lewis Hulse Noe 52 3.2. William Harlow Cook 52 4. David Livingstone and his family 53 4.1. David Livingstone 53 4.2. -

Café, Colons Et Planteurs : Histoire De La Société Plantations Du Congo Oriental
Université Toulouse II – Jean Jaurès UFR Sciences humaines et sociales Département d’histoire « Les caféières les plus belles de l’Ituri » Café, colons et planteurs : histoire de la société Plantations du Congo Oriental (1910 ─ 1943) Dessin 1: Premières floraisons. 1929 Mémoire de M2 Histoire et civilisations moderne et contemporaine Sous la direction de Sophie DULUCQ et Sylvie Vabre Stéphanie DELMOTTE 1 2 Remerciements Ma gratitude à toutes les personnes rencontrées autour de cette histoire. Particulièrement : Jacques Frémeaux, à l’origine de ce travail, pour la dimension humaine que recèlent ces témoignages Sophie Dulucq et sa patience pour la néophyte en histoire que j’étais Sylvie Vabre qui a accepté de suivre cette étude Ma sœur Brigitte, infatigable dans le recueil de la mémoire familiale Ma belle-sœur Béatrice, sans qui je n’aurais pu scanner les archives Les archivistes de l’université catholique de Louvain : Françoise Mirguet, Caroline Derauw, Françoise Hiraux et tous les agents des archives, professionnels, aimables et terriblement efficaces Hommages À mon grand-père, cet aventurier de génie À ma grand-mère et ma mère, laissées en marge de l’histoire À mon père, industrieux et noble Illustration de la page de titre : Premières floraisons, Collignon dans les caféières, 1929 3 TABLE DES ABRÉVIATIONS ARSOM Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer AIMO Affaires Indigènes et Main-d’Oeuvre ARCA Archives Africaines SPF Affaires étrangères, Bruxelles ARCF Archives familiales ARCG Archives Générales du Royaume, Bruxelles ARCJ Archives -

HA.01.0015 Inventaire Des Archives De Frédéric Orban
HA.01.0015 Inventaire des archives de Frédéric Orban 1857 – 1883 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren, 2016 Description des archives Nom: Archives Frédéric Orban Référence: HA.01.0015 Dates extrêmes: 1881-1884, 1932 Importance matérielle: 0,23 m.l. Langues des pièces: Les documents sont rédigés en Français pour la majeure partie. Lieu de conservation: Musée royal de l'Afrique Centrale Historique de la conservation : Don au MRAC de M. Deborsu en 1929 et de M. De Suray en 1932 Context Le Producteur d'archives Frédéric Orban est né le 3 mars 1857 à Emptinne (Belgique). Sorti de l’École militaire en 1877 avec le grade de sous-lieutenant, il demande à être détaché à l’Institut cartographique militaire en 1881. C’est le 17 février de cette année-là que Frédéric Orban part en Afrique pour le compte du Comité d’études du Haut-Congo, en compagnie d’Eugène Janssen. Ils parviennent à Vivi en avril et y retrouvent Valcke. Bientôt ils sont chargés de superviser les travaux du poste d’Isanghila. En décembre 1881, Orban et Callewaert se voient confier la mission de transporter les pièces du nouveau vapeur l’AIA par voie de terre jusqu’à Léopoldville. C’est chose fait en mars 1882. Quand en novembre 1882, Hanssens fonde le poste de Bolobo, Orban est commissionné pour prendre la direction de la station. Mais sa mauvaise santé l’oblige à quitter ses fonctions en mars 1883. Il envisageait d’aller se rétablir au sanatorium de Banana mais en chemin il rencontre Stanley qui le charge de se rendre à Vivi puis au Pool avec un lot important de marchandises d’échange destinées au Haut-Congo. -

Bulletin Mededelingen Des Séances Der Zittingen
ACADÉMIE ROYALE KONINKLIJKE ACADEMIE DES VOOR SCIENCES COLONIALES KOLONIALE WETENSCHAPPEN BULLETIN MEDEDELINGEN DES SÉANCES DER ZITTINGEN XXV - 1954 - 5 Le présent fascicule constitue Ja suite Met deze aflevering wordt de ver de la collection du Bulletin des Séances, zameling van de Mededelingen der Zit publiée par l’institut Royal Colonial tingen voortgezet, die werd uitgegeven door het Koninklijk Belgisch Koloniaal Belge de 1929 à 1954. Instituut van 1929 tot 1954. ★ Avenue M amix, 25 M amixlaan, 25 BRUXELLES BRUSSEL 1954 Prix Abonnement 1954 F 250 600 Prijs (5 num.) ! f TABLE DES MATIÈRES. — INHOUDSTAFEL. Section des Sciences morales et politiques. Sectie voor Morele en Politieke Wetenschappen. Pages. — Bladz. Séance du 22 novembre 1954. — Zitting van 22 november 1954 ..................................................................................... 1336, 1337 Communication administrative. — Administratieve medede ling ..................................................................................... 1336, 1337 J. Stengers. A propos de la révision de l’article Ier de la C onstitution.................................................... 1336-1337,1353-1363 Th. Heyse. — Intervention dans la discussion de la commu nication de M. J. Stengers sur la révision de l’article I er de la Constitution : Le Congo est territoire national........... 1336-1337, 1364-1366 A. Durieux. — Intervention dans la discussion de la commu nication de M. J. Stengers sur la Colonie et la révision, en 1892-1893, de l’article 1er de la Constitution 1336-1337,1367-1370 A. Sohier. — Intervention dans la discussion de la commu nication de M. J. Stengers, intitulée : A propos de la révision de l’article 1er de la Constitution........... 1336-1337, 1371-1372 E.-J. Devroey présente — stelt voor : «La deuxième édition de la Grande Encyclopédie soviétique, ouvrage offert à l’Aca- démie royale des Sciences coloniales par l’Académie des Sciences de Moscou », mémoire — verhandeling A. -

Nouvelle Édition Revue Et Corrigée
Nouvelle édition revue et corrigée 1 Guy De Boeck Les Héritiers de Léopold II, ou l’anticolonialisme impossible 2 « Quand nous parlions, jadis, vous pouviez ne pas nous croire, vous pouviez suspecter nos intentions, vous aviez le droit d’ignorer ce qui n’était pas révélé par des documents officiels. Mais aujourd’hui vous savez, vous devez savoir, vous ne pouvez plus ignorer, vous ne pouvez plus rester sourds aux plaintes et aux protestations qui s’élèvent de toutes parts. » … «Je m’adresse à vous, catholiques. Je vous demande d’oublier vos attaches gouvernementales et de songer avant tout à ce que vous dicte votre conscience. En présence de pareils faits,.., vous n’avez pas le droit de rester impassibles, de vous laver les mains du sang versé; car si vous le faisiez, si vous refusiez la justice aux indigènes, si vous ne leur donniez pas le pain de vie qu’ils réclament, on pourrait vous appliquer le mot d’un des pères de votre Eglise ‘Ton frère te demandait aide et protection, tu es resté sourd à son appel; tu ne l’as pas secouru; donc tu l’as tué’ » Emile VANDERVELDE * « L'Etat du Congo, loin de s'acquitter de ce devoir primordial de colonisateur (d'enseigner a l'indigène a tirer de son sol natal un parti de plus en plus complet, a améliorer ses procédés de culture), interdit aux indigènes, d'après les constatations de la Commission (d'Enquête de 1904-1905), de tirer parti du sol qui lui appartient légitimement, dans une autre mesure que celle ou il l'utilisait avant 1885.. -

Fête De L'indépendance À Madimba
N°53 MÉMOIRES DU MARS 2020 CONGO DU RWANDA ET DU BURUNDI FÊTE DE L’INDÉPENDANCE À MADIMBA ANDRÉ RYCKMANS Congo M o é g m n o o ires du C Mémoires du Congo N°53 - Mars 2020 1 LE MOT DU PRÉSIDENT SOMMAIRE Si le mois de février 2020 a été celui des tempêtes, le vent ayant CARTE BLANCHE soufflé fort et parfois jusque dans certaines réunions de nos 04 Ils faisaient leur boulot, un point c’est tout ! propres instances, le mois de mars nous aura amené le véritable tsunami viral. Certaines de nos activités en sont directement af- HISTOIRE fectées, comme les Mardis et le Forum, la revue. Le rédacteur en 05 Introduction au discours de Madimba chef eut fort à faire pour réunir les articles et rédiger ses propres 07 Discours de Madimba textes, en période de voyage de plusieurs collaborateurs, puis de confinement. 16 Une interview surprenante 17 Pourquoi Léopold II n’alla pas au Congo ? Mémoires du Congo entame sa 19ème année dans des conditions de combat. Pas un combat pour notre survie, elle est déjà assurée ÉCONOMIE par le formidable travail réalisé par ses équipes de bénévoles, dont 18 L’industrialisation du Congo notre past-président Paul Vannès, qui a œuvré 15 années durant à son rayonnement. Mais un combat pour la vérité de l’Histoire qui DÉFENSE lie le Congo, le Rwanda et le Burundi à la Belgique depuis pas loin 24 La grande guerre au Congo Belge d’un siècle et demi. Avec une attention particulière aux périodes sous administration belge, durant laquelle de grandes transforma- 30 Ernesto Guevara tions furent enregistrés en quelques décennies. -

HA.01.0020 Inventaire Des Archives De Louis Valcke
HA.01.0020 Inventaire des archives de Louis Valcke 1857 – 1940 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren, 2018 Description des archives Nom : Archives Louis Valcke Référence : HA.01.0020 Dates extrêmes : 1887, 1927-1938 Importance matérielle : 0,35 m.l. Langues des pièces : Les documents sont rédigés en Français pour la majeure partie Lieu de conservation : Musée royal de l'Afrique Centrale Historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Louis Valcke en 1930 (RG 671) et par E.J. Devroey en 1965 (1965.16). Context Le Producteur d'archives Né à Bruges (Belgique), le 22 décembre 1857, Louis Valcke entre à l’École Militaire en 1874 et est promu lieutenant en 1877. C’est en 1880 qu’il est engagé par le Comité d’études du Haut-Congo. Il rejoint Stanley à Ngoma en novembre 1880 et se voit confier la mission de construire une route entre Ngoma et N’Konzo. Ensuite, Valcke est chargé de fonder le poste d’Isanghila. En juillet 1881, il rejoint Stanley à Manyanga et continue avec lui la reconnaissance jusqu’au Pool. Il rentre en Belgique en décembre 1881. Dès février 1882, il repart pour Zanzibar pour y engager de la main d’œuvre. Chargé du commandement de ce contigent zanzibarite, il s’occupe de transporter les pièces du steamer AIA jusqu’au Pool d’octobre 1882 à mai 1883. Par la suite il est chargé d’organiser le transport des marchandises de Vivi au Pool. Il construit des routes et effectue de nombreux voyages pour le ravitaillement et le transport des bateaux. -

The Visual, the Accidental and the Actual in the Historiography of the Fort of Shinkakasa, Democratic Republic of Congo, 1891- 1909
The visual, the accidental and the actual in the historiography of the fort of Shinkakasa, Democratic Republic of Congo, 1891- 1909 Willem Bekers, Robby Fivez Ghent University, Department of Architecture & Urban Planning, Ghent, Belgium [email protected], [email protected] Piecing together the fort of Shinkakasa Boma, the capital of the Congo Free State (État Indépendant du Congo or, from now on, EIC), was nothing like Georges Moulaert, a 25-year-old lieutenant who had joined the EIC’s Force Publique in 1902, had expected. The town he described in his memoirs, published in 1948 was a mosquito-ridden swamp crossed by earthen embankments which were lined by rickety wooden trading posts of Italian, Portuguese and – to Moulaert’s surprise – even African fortune seekers.1 Despite Moulaert’s intentions “to objectively describe the reality he had witnessed”, his lively cityscape reflected more of his own feelings than he accounted for.2 For example, Moulaert’s emphasis on the ricketiness of the ‘wooden shacks’ was probably directly related to his disdain towards the motley crew of coloured traders that inhabited them, just like the general lack of hygiene and infrastructure was probably inspired by his condescending view of the Bomatraciens with their “small bureaucratic mentality”.3 Personal recollections, such as Moulaert’s, are often key sources in the historiography of early colonial Congo. After all, with the archive of the EIC systematically destroyed by king Leopold II prior to the takeover by Belgium, they are often the only textual sources of the period that remain.4 Despite their high historical value, we have to be extremely critical when using these memoirs as a historical source. -

Download Download
Herausgegeben im Auftrag der Karl-Lamprecht-Gesellschaft e. V. (KLG) / European Network in Universal and Global History (ENIUGH) von Matthias Middell und Hannes Siegrist Redaktion Gerald Diesener (Leipzig), Andreas Eckert (Berlin), Ulf Engel (Leipzig), Harald Fischer-Tiné (Zürich), Marc Frey (München), Eckhardt Fuchs (Braunschweig), Frank Hadler (Leipzig), Silke Hensel (Münster), Madeleine Herren (Basel), Michael Mann (Berlin), Astrid Meier (Halle), Katharina Middell (Leipzig), Matthias Middell (Leipzig), Ursula Rao (Leipzig), Dominic Sachsenmaier (Bremen), Hannes Siegrist (Leipzig), Stefan Troebst (Leipzig), Michael Zeuske (Köln) Anschrift der Redaktion Global and European Studies Institute Universität Leipzig Emil-Fuchs-Str. 1 D – 04105 Leipzig Tel.: +49 / (0)341 / 97 30 230 Fax.: +49 / (0)341 / 960 52 61 E-Mail: [email protected] Internet: www.uni-leipzig.de/comparativ/ Redaktionssekretärin: Katja Naumann ([email protected]) Comparativ erscheint sechsmal jährlich mit einem Umfang von jeweils ca. 140 Seiten. Einzelheft: 12.00 €; Doppelheft 22.00 €; Jahresabonnement 50.00 €; ermäßigtes Abonnement 25.00 €. Für Mitglieder der KLG / ENIUGH ist das Abonne ment im Mitgliedsbeitrag enthalten. Zuschriften und Manuskripte senden Sie bitte an die Redaktion. Bestellungen richten Sie an den Buchhandel oder direkt an den Verlag. Ein Bestellformular fi nden Sie unter: http://www.uni-leipzig.de/comparativ/ Wissenschaftlicher Beirat Gareth Austin (London), Carlo Marco Belfanti (Brescia), Christophe Charle (Paris), Catherine Coquery-Vidrovitch