Ballons Sans Entête
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Traces Volume 35, Number 3 Kentucky Library Research Collections Western Kentucky University, [email protected]
Western Kentucky University TopSCHOLAR® Traces, the Southern Central Kentucky, Barren Kentucky Library - Serials County Genealogical Newsletter Fall 2007 Traces Volume 35, Number 3 Kentucky Library Research Collections Western Kentucky University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.wku.edu/traces_bcgsn Part of the Genealogy Commons, Public History Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Kentucky Library Research Collections, "Traces Volume 35, Number 3" (2007). Traces, the Southern Central Kentucky, Barren County Genealogical Newsletter. Paper 145. https://digitalcommons.wku.edu/traces_bcgsn/145 This Newsletter is brought to you for free and open access by TopSCHOLAR®. It has been accepted for inclusion in Traces, the Southern Central Kentucky, Barren County Genealogical Newsletter by an authorized administrator of TopSCHOLAR®. For more information, please contact [email protected]. ISSN-0882-2158 2007 VOLUME 35 ISSUE NO. 3 FALL TR?iCE§ Clear Point School About 1925 Quarterly Publication of THE SOUTH CENTRAL KENTUCKY HISTORICAL AND GENE^^LOGICAL SOCIETY, INCORPORATED P.O. Box 157 Glasgow, Kentucky 42142-0157 SOUTH CENTRAL KENTUCKY HISTORICAL d GENEALOGICAL SOCIETY OFFICERS AND DIRECTORS 2006-2007 PRESIDENT STEVE BOTTS VICE PRESIDENT (PROGRAMS) SANDI GORIN 2^^*^ VICE PRESIDENT (PUBLICITY) MARGIE KINSLOW 3*^ VICE PRESIDENT (MEMBERSHIP) KEN BEARD RECORDING SECRETARY GAYLE BERRY CORRESPONDING SECRETARY/TREASURER JUANITA BARDCV ASSISTANT TREASURER RUTH WOOD EDITOR "TRACES" SANDI GORIN BOARD OF DIRECTORS HASKEL BERTRAM DON NOVOSEL DOROTHY WADE JAMES PEDEN SELMA MAYFIELD MARY B JONES SANDI GORIN PAST PRESIDENTS PAUL BASTIEN L. C. CALHOON CECIL GOODE KAY HARBISON JERRY HOUCHENS * LEONARD KINGREY BRICE T. LEECH * JOHN MUTTER KATIE M. SMITH * RUBYJOIVES SMITH JOE DONALD TAYLOR W. -

The Walter Scott: a Steamboat Ahead of Its Day
THE STATE HISTORICAL SOCIETY OF MISSOURI COLUMBIA, MISSOURI FALL 1967 THE STATE HISTORICAL SOCIETY OF MISSOURI The State Historical Society of Missouri, heretofore organized under the laws of this State, shall be the trustee of this State—Laws of Missouri, 1899, R.S. of Mo., 1959, Chapter 183. OFFICERS 1985-68 LEO J. ROZIER, Perryville, President L. E. MEADOR, Springfield, First Vice President *WILLIAM C. TUCKER, Warrensburg, Second Vice President LEWIS E. ATHERTON, Columbia, Third Vice President RUSSELL V. DYE, Liberty, Fourth Vice President JACK STAPLETON, SR., Stanberry, Fifth Vice President JOHN A. WINKLER, Hannibal, Sixth Vice President R. B. PRICE, Columbia, Treasurer FLOYD C. SHOEMAKER, Columbia, Secretary Emeritus and Consultant RICHARD S. BROWN LEE, Columbia, Director, Secretary, and Librarian TRUSTEES Permanent Trustees, Former Presidents of the Society E. L. DALE, Carthage E. E. SWAIN, Kirksville RUSH H. LIMBAUGII, Cape Girardeau ROY D. WILLIAMS, Boonville GEORGE A. ROZIER, Jefferson City Term Expires at Annual Meeting, 1987 WILLIAM AULL, III, Lexington GEORGE FULLER GREEN, Kansas City WILLIAM R. DENSLOW, Trenton GEORGE H. SCRUTON, Sedalia ELMER ELLIS, Columbia JAMES TODD, Moberly ALFRED O. FUERBRINGER, St. Louis T. BALLARD WAITERS, Marshfield Term Expires at Annual Meeting, 1988 FRANK P. BRIGGS, Macon *W. C. HEWITT, Shelbvville HENRY A. BUNDSCHU, Independence ROBERT NAGEL JONES, St. Louis R. I. COLBORN, Paris LEWIS E. ATHERTON, Columbia VICTOR A. GIERKE, Louisiana * WILLIAM C. TUCKER, Warrensburg Term Expires at Annual Meeting, 1969 *BARTLETT BODER, St. Joseph W. WALLACE SMITH, Independence GEORGE MCCUE, St. Louis JACK STAPLETON, SR., Stanberry L. E. MEADOR, Springfield HENRY C. THOMPSON, Bonne Terre JOSEPH H. -

Virginia of the Looking Westonmainstreet,Yorktown, 1862 Photo Courtesy of Librarycongress Greetings
York County Virginia th Commemorates the Sesquicentennial Anniversary of the American150 Civil War 1862 - 2012 Big Bethel To Fort Magruder Looking West on Main Street, Yorktown, 1862 Photo courtesy of Library of Congress Greetings The Virginia Sesquicentennial of the American Civil War Commission was created during the 2006 Session of the General Assembly for the purpose of planning for and commemorating the 150th anniversary of Virginia’s participation in the American Civil War, the duration of which will be 2011 through 2015. Each locality was asked to form a local committee to begin planning for the four-year, statewide commemoration period. In early 2009, the York County Sesquicentennial of the American Civil War Committee was formed and, on June 2, 2009, the York County Board of Supervisors adopted a resolution supporting the State Commission and its work to commemorate the 150th Anniversary of the American Civil War in Virginia. The resolution also stipulated that York County would join with the neighboring jurisdictions to support the organizational principles and statement of purpose for the Historic Triangle Civil War Committee as set forth to guide the commemoration in America’s Historic Triangle. The Sesquicentennial Committee is composed of representatives of the following: County of York Division of Historic Services, City of Newport News National Park Service (Colonial National Historical Park) Peninsula Campaign Chapter, United Daughters of the Confederacy Poquoson Historical Society, Poquoson Museum and City of Poquoson United States Naval Weapons Station Yorktown Watermen’s Museum York County Historical Committee York County Historical Museum York County Historical Society Dedication The York County War Memorial lists all York County members of the military who died as a result of wars as far back as Bacon’s Rebellion (1676). -

Fort Monroe Hampton, VA Reconnaissance Study May 2008
National Park Service U.S. Department of the Interior Fort Monroe Hampton, VA Reconnaissance Study May 2008 1 This reconnaissance study has been prepared at the request of members of Congress to explore specific resources and advise on whether these resources merit further consideration, through a congressionally authorized Special Resource Study, for potential designation as a unit of the national park system. Publication and transmittal of this report should not be considered an endorsement or a commitment by the National Park Service to seek or support specific legislative authorization for the project or its implementation. Authorization and funding for any new commitments by the National Park Service will have to be considered in light of competing priorities for existing units of the national park system and other programs. This report was prepared by the United States Department of the Interior, National Park Service, Northeast Region. For further information contact: National Park Service Division of Park Planning and Special Studies 200 Chestnut Street Philadelphia, Pennsylvania 19106 215–597-7260 Front Cover: Old Point Comfort and Hygeia Hotel, Virginia. Drawn from nature, lithograph & print. by E. Sachse & Co., Balto. Pub. & sold by C. Bohn, Washington, D.C. Washington, D.C.: C. Bohn, c. 1861. Image courtesy of Library of Congress, American Memory Collection, Civil War Maps. Accessed 04/23/2008. http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g3884h.cw0547000 2 RECONNAISSANCE STUDY OF FORT MONROE IN HAMPTON, VIRGINIA CONDUCTED BY THE NORTHEAST REGION OF THE NATIONAL PARK SERVICE May 2008 TABLE OF CONTENTS I. EXECUTIVE SUMMARY--------------------------------------------------------------1 II. PURPOSE AND METHODOLOGY -------------------------------------------------4 III. -

1 2. Seating Will Be in Groupings of 4 Chairs; Six Feet Apart. Not Necessary to Fill Chairs As Arranged. You May Move Chairs To
The TVCWRT is open for business Thursday, 10 September and we will configure seating to maximize your safety and health. (Note the Little Round Table has met two months in a row at the Elks with no ill effects reported.) 1. Enter side lobby door (not the bar door) with mask on. Honor system that you do not have temperature or showing symptoms; have not traveled to COVID hotspots or have person now in your residence with symptoms. 2. Mask to remain on, except when sitting to eat or drink in dining room. (No smoking.) 3. 5:30--food and drink available in dining room. Sandwiches and a dinner special only, the server will take your order. ---NO BUFFET. Meeting set up in ballroom guidance: 1. Keep masks on during program, before and after; wear to move around (e.g., bathroom). 2. Seating will be in groupings of 4 chairs; six feet apart. Not necessary to fill chairs as arranged. You may move chairs to sit solo or in other groupings such as with family but practice social distancing. 6 feet apart from others. For those who notice: There has been no smoking in the room we meet in at the Elk’s since March. There will be NO further smoking in that room in the future. You will notice a fresher atmosphere in the ballroom and we expect it to get even better over future months. Smoking is permitted in the bar area, but the doors will be shut during our visits. You must go outside to smoke a cigar. -

The United States Balloon Corps in Action in Northern
THE UNITED STATES BALLOON CORPS IN ACTION IN NORTHERN VIRGINIA DURING THE CIVIL WAR By June Robinson The first use of balloons for military purposes in the United States was made at Falls Church, Virginia, on June 23, 1861, by Thaddeus Sobieski Coulincourt Lowe at the direction of Captain Amie! Weeks Whipple of the Topographical Engineers Corps. 1 Professor Lowe, one of the best-known balloonists in the country, had come to Washington earlier that month to persuade the government of the advantages of the use of aeronautical services in the war that had just begun. With the encouragement of Joseph Henry, Secretary of the Smithsonian Institution, whose scientific interests had been aroused by Lowe's earlier efforts to demonstrate the possibility of transatlantic balloon travel, Lowe came to Washington with the balloon Enterprise in which he had just completed a voyage from Cincinnati, Ohio to South Carolina, a distance of 900 miles, in nine hours. In the capital he inflated the Enterprise with illuminating gas from one of the mains in the Armory and made tethered ascensions from the Armory grounds, from the Smithsonian grounds, and in front of the Executive Mansion. At one point telegraph operator Herbert Robinson went up with him, and using a direct wire to the ground, tapped out a message to President Lincoln: Balloon Enterprise Washington, D.C. June 18, 1861 To the President of the United States: Sir: This point of observation commands an area nearly 50 miles in diameter. The city with its girdle of encampments presents a superb scene. I have pleasure in sending you this first dispatch ever telegraphed from an aerial station and in acknowledging indebtedness for your encouragement for the opportunity of demonstrating the availability of the science of aeronautics in the service of the country. -

THE HUDSON RIVER VALLEY REVIEW a Journal of Regional Studies
THE HUDSON RIVER VALLEY REVIEW A Journal of Regional Studies The Hudson River Valley Institute at Marist College is supported by a major grant from the National Endowment for the Humanities. Publisher Thomas S. Wermuth, Vice President for Academic Affairs, Marist College Editors Christopher Pryslopski, Program Director, Hudson River Valley Institute, Marist College Reed Sparling, Writer, Scenic Hudson Editorial Board The Hudson River Valley Review Myra Young Armstead, Professor of History, (ISSN 1546-3486) is published twice Bard College a year by The Hudson River Valley BG (Ret) Lance Betros, Dean of Academics, Institute at Marist College. U.S. Army War College James M. Johnson, Executive Director Kim Bridgford, Professor of English, West Chester University Poetry Center Research Assistants and Conference Taylor Mullaney Christina Ritter Michael Groth, Professor of History, Wells College Susan Ingalls Lewis, Associate Professor of History, Hudson River Valley Institute State University of New York at New Paltz Advisory Board COL Matthew Moten, Professor and Head, Peter Bienstock, Chair Department of History, U.S. Military Barnabas McHenry, Vice Chair Academy at West Point Margaret R. Brinckerhoff Dr. Frank Bumpus Sarah Olson, Superintendent, Roosevelt- Frank J. Doherty Vanderbilt National Historic Sites BG (Ret) Patrick J. Garvey Roger Panetta, Professor of History, Shirley M. Handel Fordham University Maureen Kangas H. Daniel Peck, Professor of English, Alex Reese Vassar College Robert E. Tompkins Sr. Denise Doring VanBuren Robyn L. -
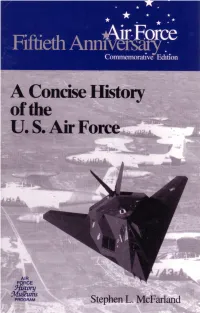
A Concise History of the US Air Force
A Concise History of the U.S. Air Force Stephen L. McFarland Air Force History and Museums Program 1997 Contents The Genesis of American Air Power ..................... 1 Trial and Error in World War I .......................... 4 Interwar Doctrine. Organization. and Technology ........... 11 World War II-Global Conflict ......................... 21 Air Power in the Nuclear Age .......................... 40 Limited War in Korea ................................ 45 The “New Look” Air Force ............................ 51 Flexible Response and Vietnam ......................... 57 The Cold War Concluded ............................. 69 Air Power Triumphant-The Gulf War ...................75 TheFuture ........................................ 81 Suggested Readings ................................. 83 iii They shall mount up with wings as eagles. -Isaiah 40:31 The Genesis of American Air Power Americans took to the skies at an early date. Benjamin Franklin considered the possibility of using balloons in warfare in 1783, only days after the first successful hot-air balloon flights in France. John Sherburne, frustrated by the Army’s ineffectiveness during the Seminole War of 1840, proposed using balloons for observation above the wilderness that hid the adversary. John Wise, dismayed by the prospects of a long and costly siege of Veracruz during the Mexican War, suggested using bal- loons in 1846 for bombing defending forces, three years before Austria actually did so against Venice. John LaMountain and Thaddeus Lowe successfully launched manned reconnaissance balloons in support of Union operations during the American Civil War. In late June 1861 Lowe’s map of Confederate positions in Falls Church, Virginia, was the first significant contribution of manned flight to American warfare, although the Union lost the battle at Bull Run in July. The map allowed Lowe to report after the battle that the Confederates were not advancing on Washington. -

Airpower Through WWI
Airpower through WWI Cognitive Lesson Objective: • Know the evolution of airpower and the significance of key people, events, doctrinal changes, and weapon systems through the end of WWI. Cognitive Samples of Behavior: • Describe the U.S. Army’s initial reaction to the Wright Brothers’ heavier- than-air flying machine. • Recognize the accomplishments of early American aviators Benny Foulois, Billy Mitchell, and Eddie Rickenbacker. • Describe the significant characteristics of airpower doctrine as advocated by Douhet, Trenchard, and Gorrell. • State lessons learned from the success of the St. Mihiel and Meuse- Argonne Offensives and their impact on doctrine. Affective Lesson Objectives: • Value to the importance of airpower and airpower advancements through WWI. Affective Sample of Behavior: • Discuss the importance of airpower and airpower advancements. 5 Airpower through WWI 5 THE GENESIS OF AMERICAN AIR POWER Americans took to the skies at an early date. Benjamin Franklin considered the possibility of using balloons in warfare in 1783, only days after the first successful hot-air balloon flights in France. John Sherburne, frustrated by the Army’s ineffectiveness during the Seminole War of 1840, proposed using balloons for observation above the wilderness that hid the adversary. John Wise, dismayed by the prospects of a long and costly siege of Veracruz during the Mexican War, suggested using balloons in 1846 for bombing defending forces, three years before Austria actually did so against Venice. John LaMountain and Thaddeus Lowe successfully launched manned reconnaissance balloons in support of Union operations during the American Civil War. In late June 1861 Lowe’s map of Confederate positions in Falls Church, Virginia, was the first significant contribution of manned flight to American warfare. -

Index to the Historical Archives of the Town Of
INDEX TO THE HISTORICAL ARCHIVES OF THE TOWN OF SALEM SALEM, NY WASHINGTON COUNTY HISTORIAN'S COLLECTION DR. ASA FITCH HISTORICAL SOCIETY COLLECTION Revised January 2016 William Cormier, Historian The following lists contain the archival records of the village of Salem and represent only a part of all administrative records generated by the village. The archives contain those records, pictures, artifacts, correspondence, etc. which have and will have administrative, legal, research and historical value. Without these records much of our history would be lost forever. In 1992, a grant from the NYS Archives and Records Administration (SARA) enabled the town and village of Salem to begin the process of sorting, inventorying, preserving and cataloging the town and village records. In addition to the actual records, a growing microfilm collection, which consists of local newspapers, vital records, town minutes and the Dr. Asa Fitch Jr. Journals, was created. Microfilming was made possible through a Washington County SARA grant. In the 1994-95 year, a New York State LGRMIF grant made possible an historical archives indexing project. This project was completed through the efforts of William A. Cormier, historian and grant coordinator; Dorothy Shane, archival clerk; and Patricia Baltz, typist and proof reader, with the cooperation from Mary Kilpatrick, town clerk and Peg Culver, librarian. At present, Salem's village archives are housed in the History Room off the Bancroft Library in the Proudfit Building. Other village records, kept by the village clerk, village justice, and fire department, are found in the village office in the Proudfit Building. Inactive records are stored in the Inactive Record Storage Room in the Proudfit Building. -

Oiliessfiill Ilireuions Wstb Each '" Tne COMMISSION ME11CIIANTS "U'aipole, U.-- Siouiacti.As PR0DUCE JACKSON, N
I . 71 (ur TU1 LLATION OF AEW HaMPSIIIP.K. The and IN b,lio"- - A has let'ii the case heretofore, the first Te iutroductiou ot this izreat developiuent .f "VTOTICE Is hereby given that 1 have , MOTT'S MAGIC . pilOF. returns are so far reported that the no'dica was throush a six warstri.ii in - JL cases sold to my son, Curtis Stacy the rcmaindcr ; TROF. MOTT'S MAGIC ,jav of our annual Fair opened rainy Xpw "tluate usually rouml aiiiong the poor, and G l X and llampshire m by "mi-th- E W 0 0 D S nf liic in!?mrit ntifl clinll nllini TinllP ff h? nrt rr papers put the populatlOn of mre their poor ltviiiK. ln all the eommoii p what is Powms for Cough and N cheerless : for more cheerless than a f?fatn I.hiir that of nis nor pay any ueots oi ms comracing aucr iaj. x i V 1 A 1 U 1L ' at JJ2,000,an mcreaseof only 4,000 a" toisood resuits is the iniroduciio.i r three perVct l - i bU It , , FOR late in ? Notwith-jtaiiJini- ..v.-- juw, iR-u- i Ol VIUIIUUIIV PUBJJFYING THE BIOOD. ct!d rain storm the fall ? m uiriii, aiMl a SlltllU- - X ten years. There is a falline-offi- n the ru lant as basU, produelnc on ran.i AVcst Concord, Scpt. 17, 18C0. IS DECIDED SCCCF.SI. Inert. Ti ive to the 1 And for 9-- A DECIUEI) SCCCEJs. the speedy cuxo of tho Hiljoined Torieties of world a preparatiou which you ts RECEIVED the weather, articles for exhibition ral towns arc obhjied to caution JUST Attcst Jcfferson Chase. -

The A.C.W.S. NEWSLETTER
P.O. Box 52, Brighouse, West Yorkshire, HD6 1JQ, England The A.C.W.S. NEWSLETTER Spring Edition Stanford Hall 2009 Issue No 156 Website :- www.acws.co.uk Spring 2010 1 West Point Sutlers incorporating Albion Small Arms RFD 1951 West Midlands Antique guns & curios 17th - 19th Century Antique muzzle loading haversack fillers muskets, pistols and blank firers Leatherwear Gun accessories Brasswear & and cleaning insignia equipment Gun repairs & deactivations Phil & Jayne Olden 21 Edgewood Road Rednal Birmingham B45 8SB Tel: 0121 453 7016 Mob: 07974 956401 Email: [email protected] Website: www.westpointsutlers.org 2 Events 2010 All events are FULL SOCIETY EVENTS unless otherwise stated Camping from Friday until Monday unless otherwise stated. 2-5th April - EASTER TRAINING WEEKEND - CONFIRMED Easter holiday weekend event at West Wales Museum of Childhood Pen- ffynnon, Llangeler, Carmarthenshire, SA44 5EY. Authentic and family camping available (family camp area for tents, but only 3 caravan/ motorhome places available please contact Claire Morris 69th NY to register if you need a place). Camping available from Good Friday through to the following Tuesday. Facilities include:- water; indoor toilets; showers; tea- room; toy museum Please bring some wood with you. 10-11th April - CONFEDERATE TRAINING WEEKEND and 17-18th April - FEDERAL CAMP OF INSTRUCTION - CONFIRMED Society Training Weekends at Tatton Old Hall. Tatton Park, Knutsford, Cheshire, WA16 6QN. Members camping available from Friday until Sunday. No arrivals before 15.00 hours on Friday, gates will close at 21.00 hours Friday and 19.00 hours Saturday. They open again at 07.00 hours each morning, Sunday evening last exit will be 21.00 hours.