RNDH2004 12 05 2006.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Le Monde D'après ?
Juillet-Août 2020 NO 31 AMBASSADEUR ILEKA ATOKI DOSSIER Le monde d’après ? SOMMAIRE CONTENTSBEHIND THE SCENES Kia nguvu sana! Promo SEPELASS, la meilleure offre pour appeler tous les réseaux 6 36 54 WHATSAPP MAKUTANO PARCOURS DIEUDO 8 38 HAMADI CARICATURE REGARD 56 EXPLOITATION 10 40 REDEVANCE DISCOURS DU PUBLI MINIÈRE PRÉSIDENT REPORTAGE 58 12 42 ELECTIONS USA A LA UNE DÉCRYPTAGE FINAL LAP OU AMBASSADEUR PROCÈS GO AROUND? ILEKA ATOKI KAMERHE 60 20 46 BRÈVES UNE NOUVELLE BLOCKCHAIN AUBE APRÈS LE COVID ? 65 48 LES FACT CHECK DRC MINING DE L’AFP 22 WEEK ÉCONOMIE TÉLÉTRAVAIL 67 LA FIN DU 50 CHRONIQUE TAXI - BOULOT - EXPERTS CONVERTISSEZ- 150% de bonus à chaque recharge DODO ? VOUS! 52 175 % de bonus à chaque recharge BILLET 34 68 ENTRETIEN D’HUMEUR LES COURS via PROFESSEUR VENANCE CAMILLE KUYU KONAN | MINING&BUSINESS | JUILLET-AOÛT 2020 MINING&BUSINESS | JUILLET-AOÛT 2020 | 3 2 Infoline : 1777 messages_pwc_RDC.pdf 1 13/04/2020 18:37 EDITO Adding value across Africa Audit. Advisory. Tax & Legal. TRISTE ANNIVERSAIRE Qu’il fut plongé dans la « tristitude », Divorce de la carpe et du lapin ou ce 60e anniversaire ! accident de parcours au sein du Alors, c’est vrai, la COVID est couple FCC/CASH? Trop tôt pour passée par là, mais était-ce le seul l’annoncer. Mais le procès Kamehre, Kinshasa Lubumbashi motif ? Car hormis ceux qui, non loin auquel nous consacrons une partie 13, Av. Mongala, Gombe, 3 ème étage immeuble Infinity des interminables chantiers des de nos colonnes, n’a probablement B.P. 10195, Kinshasa 1034, Av. Kilela Balanda, République Démocratique du Congo B.P. -

AFRICAN ECONOMIC CONFERENCE 2015 Addressing Poverty and Inequality in the Post 2015 Development Agenda
AFRICAN ECONOMIC CONFERENCE 2015 Addressing Poverty and Inequality in the Post 2015 Development Agenda Government Building / African Union Building Kinshasa, Democratic Republic of Congo 2 – 4, November 2015 www.africa.undp.org/aec www.afdb.org/aec www.uneca.org/aec2015 AGENDA 1.11.2015 14:00 Pg. 1 Day One DAY ONE: Monday, 2 November 2015 AFRICAN UNION BUILDING 06h30 Setup of the venue complete 07h30 Arrival of participants 08H00 Arrival of invitees 8H30 – 9H00 Arrival of distinguished personalities 9H15 Arrival of the Presidents of the National Assembly of the Senate 09H25 Arrival of His Excellency, the President of the Democratic Republic of the Congo 09:30-10:30 Official Opening Ceremony Welcome Remarks Abdoulaye Mar Dièye, UN Assistant Secretary General and Director of the Regional Bureau for Africa, United Nations Development Programme (7 mins) Steve Kayizzi-Mugerwa, Chief Economist & Vice-President, African Development Bank (7 mins) Carlos Lopes, UN Under-Secretary General and Executive Secretary, United Nations Economic Commission for Africa (7 mins) Goodwill Messages H.E Lionel Zinsou, Prime Minister and Minister of Economic Development and Evaluation of Public Policies and Promotion of Good Governance, Benin (5 mins) Keynote Address: H.E. Joseph Kabila Kabange, State President, Democratic Republic of Congo Moderator: DRC Presidency Rapporteurs Tony Muhumuza, UNDP, Amata Diabate, UNDP, Matfobhi Riba, ECA Pg. 2 Day One 10.30-11.00 Tea/Coffee Break Pg. 3 Day One 10:30-11:00 Press Conference Augustin Matata Ponyo, Prime Minister, -

Le Nom Du Premier Ministre Déjà Sur La Table Du Chef De L'état
L’ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN RD-CONGO 300 FC/200 CFA www.adiac-congo.com N° 3454 - JEUDI 21 MARS 2019 FORMATION DU GOUVERNEMENT SÉCURITÉ INTÉRIEURE Justin Inzun Kakiak Le nom du Premier aux commandes de l’Agence ministre déjà sur nationale des renseignements la table du chef de l’État Justin Inzun Kakiat Nommé au poste de directeur également été promus à général de l’Agence nationale l’instar de Mbelu Biocha des renseignements (ANR), le et de Jean-Pierre Mbombo L’Hôtel du gouvernement à Kinshasa nouveau promu remplace Kalev nommés respectivement ad- Selon le porte-parole du Front commun pour le Au Cap pour le changement, on refuse tout dik- Mutond (2011-2019) sous sanc- ministrateur général adjoint Congo (FCC), Joseph Kabila aurait déjà transmis tat venant du FCC dont la proposition de nom ne tions euro-américaines. Il n’est et responsable du départe- le nom du Premier ministre que le président de la doit pas forcément passer comme une lettre à la pas un novice dans le monde ment intérieur. Kab Tshijik République est censé nommer par voie d’ordon- poste. D’après des sources au faîte du dossier, le de renseignements car, depuis est le nouveau responsable nance. Il a indiqué que Félix Tshisekedi n’a pas chef de l’État refuserait de nommer un près de huit bonnes années, il du département extérieur et d’autre alternative que de nommer la personne dé- Premier ministre dont le nom pourrait heurter les a occupé le poste d’administra- Numbi Kalala s’occupera du signée par l’autorité morale du FCC qui conserve susceptibilités. -

Nicolas Kazadi Signe Avec ERG Sarl Un Accord De 300 Millions
QUOTIDIEN Edition Nationale d'informations générales Mardi 31 Août 2021 30me année N°8521 Prix : 2500 FC à Kinshasa - 2500 FC en Provinces - Editeur-Directeur Général : Ipakala Abeiye Mobiko - Directeur de la Publication : Félix Kabwizi Baluku "Dès lors qu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le devoir de se révolter et de les combattre". (Mahatma GANDHI) Edito Diversification économique et la transition Savoir mettre énergétique en RDC les gants Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Tous ces adages servent pour quel- que chose à ceux qui se donnent la peine de les mettre en pratique. Ainsi, pour les dirigeants de la RD Congo à Nicolas Kazadi signe tous les niveaux, des témoignages fusent de partout auprès des person- nes qui ont eu la chance d'expérimen- ter les sages conseils tirés de ces ada- ges. Cependant, beaucoup d'autres, qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini avec ERG Sarl un accord par regretter bien après. Aujourd'hui en RDC, la traversée du désert, avec autant des décennies de guerres et violences inouïes, le temps est venu d'agir en mettant en première posi- tion la sagesse. Dieu devrait être in- voqué à tout moment pour nous éclai- rer la voie à suivre. Pour une Nation de 300 millions USD à plus de 450 tribus, la répartition du pouvoir et des revenus devrait obéir à une logique pouvant nous éviter les sombres jours d'après l'indépendance * Ce mémorandum d'entente entre le gouvernement de la RDC et le avec les sécessions et autres maux. -

Democratic Republic of the Congo
IMF Country Report No. 21/168 DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO REQUEST FOR A THREE-YEAR ARRANGEMENT UNDER July 2021 THE EXTENDED CREDIT FACILITY; REVIEW OF PERFORMANCE UNDER THE STAFF MONITORED PROGRAM—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO In the context of the Request for a Three-Year Arrangement Under the Extended Credit Facility; Review of Performance Under the Staff Monitored Program, the following documents have been released and are included in this package: • A Press Release including a statement by the Chair of the Executive Board. • The Staff Report prepared by a staff team of the IMF for the Executive Board’s consideration on July 15, 2021, following discussions that ended on May 27, 2021, with the officials of the Democratic Republic of the Congo on economic developments and policies underpinning the IMF arrangement under the Extended Credit Facility. Based on information available at the time of these discussions, the staff report was completed on June 29, 2021. • An Informational Annex prepared by the IMF staff. • A Debt Sustainability Analysis prepared by the staffs of the IMF and the World Bank. • A Supplementary Information of the Staff Report prepared by the IMF. • A Statement by the Executive Director for the Democratic Republic of the Congo. The IMF’s transparency policy allows for the deletion of market-sensitive information and premature disclosure of the authorities’ policy intentions in published staff reports and other documents. Copies of this report are available to the public from International Monetary Fund • Publication Services PO Box 92780 • Washington, D.C. -

MARCH 27-29, 2006 1. Some 200 Participants Representing 25 North
WORKSHOP ON THE PARIS DECLARATION: IMPLICATIONS AND IMPLEMENTATION BAMAKO, MALI MARCH 27-29, 2006 1. Some 200 participants representing 25 North, Central, and West African countries and their development partners met in Bamako to examine the Paris Declaration and its implications for them in their particular circumstances, and discuss ways to enhance its implementation. The workshop was hosted by the Government of Mali and sponsored by the African Development Bank, the World Bank, the Government of France, and the United Nations Development Programme, in collaboration with the Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD-DAC) and its members. Of the countries represented, some had already begun implementing harmonization, alignment, and managing for results (HAMfR) activities, while others were relatively new to the agenda. 2. The agenda was carefully designed to focus on lessons learned, experiences, and the concrete implications of the Paris Declaration. The objectives were to take a closer look at the Paris commitments, focusing particularly on their application to country and country-level donor institutions, policies, procedures, and systems; to facilitate open discussion and exchange of views among partner countries and donors on aid effectiveness issues; and to lay the groundwork for cross-country sharing and a community of practice to continually exchange experiences. Presentations in the plenary sessions set the stage for this work, but much of the specific discussion was carried out in smaller group sessions. In the final session, in line with the outcome orientation of this workshop, partner country representatives shared with the group their plans for HAMfR activities on their return home from Bamako. -
Afghanistan Albania Mr. Gent Sejko Governor Bank
PUBLIC DISCLOSURE AUTHORIZED MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY GOVERNORS AND ALTERNATES Member Governor Alternate Afghanistan Albania Mr. Gent Sejko Ms. Adela Xhemali Governor Deputy Minister of Finance and Economy Bank of Albania Ministry of Finance and Economy Sheshi "Skenderbej", No. 1 Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Nr 3 Tirana Tirana 1001 Albania Albania Algeria H.E. Aimene Benabderrahmane Mr. Ali Bouharaoua Minister of Finance Director General Ministere des Finances Economic and Financial External Affairs Immeuble Ahmed Francis Ministere des Finances Ben Aknoun Immeuble Ahmed Francis Algiers 16306 Ben Aknoun Algeria Algiers 16306 Algeria Angola H.E. Ms. Vera Daves de Sousa H.E. Sergio de Sousa Mendes dos Santos Minister of Finance Minister of Economy and Planning Ministry of Finance Ministry of Economy and Planning Largo da Mutamba Av. ª 1º Congresso do MPLA C.P. 12 35 Edifício do CIF Luanda Luanda One Angola Angola Antigua and Barbuda Hon. Gaston Browne M.P. Hon. Lennox Weston Prime Minister and Minister of Finance, Minister of State Corporate Governance and Public and Private Ministry of Finance, Corporate Governance Partnerships and Public and Private Partnerships Ministry of Finance, Corporate Governance Parliament Drive and Public and Private Partnerships Government Office Complex Parliament Drive St. John’s Government Office Complex Antigua and Barbuda St. John’s Antigua and Barbuda Argentina H.E. Gustavo Osvaldo Beliz Mr. Leandro Adrian Gorgal Secretary of Strategic Affairs National Director of Financing with Office of the President International Credit Organizations Balarce 50 Office of the President Buenos Aires Balarce 50 Argentina Buenos Aires Argentina Corporate Secretariat September 23, 2021 1 PUBLIC DISCLOSURE AUTHORIZED MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY GOVERNORS AND ALTERNATES Member Governor Alternate Armenia H.E. -
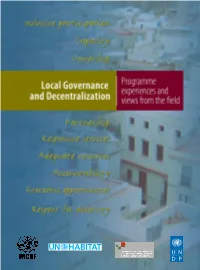
Local Governance and Decentralization: Programme Experiences and Views from the Field
Foreword One of the main roles of the UN Development Programme (UNDP) is to provide knowledge, policy advice, advocacy guidance and technical support in the field of democratic governance. As part of UNDP, the Bureau for Development Policy, through the Democratic Governance Group, is focused on strengthening linkages among international democratic governance principles, related global discussions, and UNDP operational activities at the national and local levels. The current efforts of UNDP are oriented around supporting the most effective public institutions and ownership at all levels, and assisting the design and implementation of policies and programmes that can contribute to sustainable human development, the achievement of the Millennium Devel- opment Goals (MDGs) and the reduction of inequality. The success of these actions depends largely on the quality of national and local governance. Local governance is the first pillar of this publication. It comprises the systems of values, policies and institutions at the local level by which a society organizes collective decision-making and action re- lated to political, economic, socio-cultural and environmental affairs, through the interaction of local public institutions, civil society and the private sector. Good local governance includes respect for human rights, inclusive participation, administrative and bureaucratic capacity and efficiency, and accountable and responsive governing institutions. The second pillar of this publication, decentralization, is a political as well as a technical -

Remaniement Au Comité De Suivi De L'accord FCC – CACH
RD-CONGO L’ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN 1 300 FC/200 F.CFA www.adiac-congo.com N° 3807 - MARDI 18 AOÛT 2020 ENJEUX DE L’HEURE Remaniement au comité de suivi de l’accord FCC – CACH A en croire des indiscré- tions recueillies dans la haute sphère politique, Félix Tshisekedi et Joseph Kabi- la ont préféré se délester de ceux qui représentent, tant au Front commun pour le Congo (FCC) qu’au Cap pour le changement (Cach), l’aile dure et radicale au sein de la coalition. Un noyau de nou- veaux négociateurs plus pon- dérés prend le relai du travail abattu jusque-là. Les négociations entre FCC-Cach interrompues de- puis plusieurs mois à cause des tensions au sein de la coa- lition gouvernementale vont reprendre afi n de parache- ver les nominations dans les entreprises publiques et de préparer un remaniement du gouvernement. Nehemie Mwilanya et Jean Marc Kabund paraphant un protocole d’accord FCC-CACH Page x REPRISE DU TRAFIC AÉRIEN VERS L’UE Une campagne de sensibilisation et de formation Plaidoyer pour la prise en compte des relais communautaires des voyages d’affaires Cette activité organisée dernière- ment par Caritas Congo ASBL, en partenariat avec les Caritas diocé- saines Molegbe et Budjala, dans les zones et les aires de santé situées dans la partie nord et sud de l’Uban- gi, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Un monde sans faim » aux diocèses de Molegbe et de Budjala. Le projet a une durée de cinq ans, al- lant de 2018 à 2022. -
Afghanistan Mr. Khalid Payenda Acting Minister of Finance Ministry
PUBLIC DISCLOSURE AUTHORIZED INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES REPRESENTATIVE AND ALTERNATE REPRESENTATIVE Member Representative Alternate Representative Afghanistan Albania Mrs. Delina Ibrahimaj Ms. Luljeta Minxhozi Minister of Finance and Economy Deputy Governor Ministry of Finance and Economy Bank of Albania Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Nr 3 Sheshi "Skenderbej", No. 1 Tirana 1001 Tirana Albania Albania Algeria H.E. Aimene Benabderrahmane Mr. Ali Bouharaoua Minister of Finance Director General Ministere des Finances Economic and Financial External Affairs Immeuble Ahmed Francis Ministere des Finances Ben Aknoun Immeuble Ahmed Francis Algiers 16306 Ben Aknoun Algeria Algiers 16306 Algeria Argentina H.E. Gustavo Osvaldo Beliz Mr. Leandro Adrian Gorgal Secretary of Strategic Affairs National Director of Financing with Office of the President International Credit Organizations Balarce 50 Office of the President Buenos Aires Balarce 50 Argentina Buenos Aires Argentina Armenia H.E. Tigran Khachatryan Mr. Vahe Houhannisyan Minister of Finance Deputy Minister of Finance Ministry of Finance Ministry of Finance Melik-Adamian St. 1 Melik-Adamian St. 1 Yerevan 0010 Yerevan 0010 Armenia Armenia Australia Hon. Josh Frydenberg MP Hon. Michael Sukkar MP Treasurer of the Commonwealth of Australia Assistant Treasurer Parliament House Parliament House Parliament Dr. Parliament Dr. Canberra ACT 2600 Canberra ACT 2600 Australia Australia Corporate Secretariat September 29, 2021 1 PUBLIC DISCLOSURE AUTHORIZED INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES REPRESENTATIVE AND ALTERNATE REPRESENTATIVE Member Representative Alternate Representative Austria H.E. Gernot Blümel Mr. Harald Waiglein Federal Minister of Finance Director General Federal Ministry of Finance Economic Policy, Financial Markets and Johannesgasse 5 Customs Duties Vienna A-1010 Federal Ministry of Finance Austria Johannesgasse 5 Vienna A-1010 Austria Azerbaijan Mr. -
Sama Lukonde Évalue Le Volet Humanitaire
QUOTIDIEN Edition Nationale d'informations générales Lundi 23 Août 2021 30me année N°8515 Prix : 2500 FC à Kinshasa - 2500 FC en Provinces - Editeur-Directeur Général : Ipakala Abeiye Mobiko - Directeur de la Publication : Félix Kabwizi Baluku "Dès lors qu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le devoir de se révolter et de les combattre". (Mahatma GANDHI) Edito Examinant l'impact d'état de siège avec les Savoir mettre les gants partenaires impliqués en Ituri Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Tous ces adages servent pour quel- que chose à ceux qui se donnent la peine de les mettre en pratique. Ainsi, pour les dirigeants de la RD Congo à tous les niveaux, des témoignages Sama Lukonde fusent de partout auprès des person- nes qui ont eu la chance d'expérimen- ter les sages conseils tirés de ces ada- ges. Cependant, beaucoup d'autres, qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini par regretter bien après. Aujourd'hui évalue le volet en RDC, la traversée du désert, avec autant des décennies de guerres et violences inouïes, le temps est venu d'agir en mettant en première posi- tion la sagesse. Dieu devrait être in- voqué à tout moment pour nous éclai- rer la voie à suivre. Pour une Nation humanitaire à plus de 450 tribus, la répartition du pouvoir et des revenus devrait obéir * Décidé de quitter les sentiers battus, le Premier ministre à une logique pouvant nous éviter les a laissé son bureau climatisé et aseptisé pour Bunia en sombres jours d'après l'indépendance avec les sécessions et autres maux. -
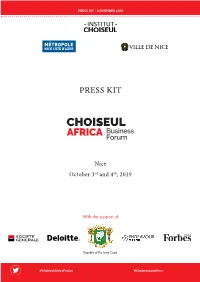
CHOISEUL AFRICA BUSINESS FORUM the Most Important European Event Dedicated to Africa Was Held in Nice on the 3Rd and 4Th of Last October
PRESS KIT - NOVEMBER 2019 PRESS KIT CHOISEUL Business AFRICA Forum Nice October 3rd and 4th, 2019 With the support of Republic of The Ivory Coast #ChoiseulAfricaForum #Choiseul100Africa 1 SOCIETE GENERALE Brand Block 2L R0-G0-B0 HEXA #000000 File: 18J2953E R233-G4-B30 Date : 23/10/2018 HEXA #E9041E AC/DC validation : Client validation : PRESSPRESS KIT KIT - NOVEMBER - NOVEMBER 2019 2019 CHOISEUL AFRICA BUSINESS FORUM The most important European event dedicated to Africa was held in Nice on the 3rd and 4th of last October. The first edition of the Choiseul Africa Business Forum, the annual meeting dedicated to business opportunities in Africa and with Africa, was held in Nice in early October. Organized by the Institut Choiseul in collaboration with the Nice Côte d’Azur Metropolis, the City of Nice and several first-order institutional and economic partners, this platform brought together in an interactive manner some 585 African and European leaders that count among the most influent of both continents. Coming from over 50 countries, they were able to attend some twenty working sessions focusing on key issues that drive African growth. A word from the President: Ambition, audacity, excellence. Now more than ever, these words preside over the actions of the African and European leaders that the Institut Choiseul has gathered together for the first edition of theChoiseul Africa Business Forum. Friendship between Africa and Europe was forged by their past and their brotherhood will be realized by their future, thanks to this cultural proximity from which we are yet to make the most of, and to the synergies that we are yet to jointly develop.