Sur Les Quais
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
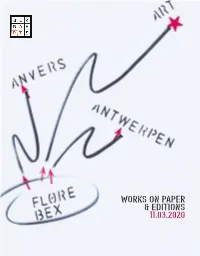
Works on Paper & Editions 11.03.2020
WORKS ON PAPER & EDITIONS 11.03.2020 Loten met '*' zijn afgebeeld. Afmetingen: in mm, excl. kader. Schattingen niet vermeld indien lager dan € 100. 1. Datum van de veiling De openbare verkoping van de hierna geïnventariseerde goederen en kunstvoorwerpen zal plaatshebben op woensdag 11 maart om 10u en 14u in het Veilinghuis Bernaerts, Verlatstraat 18 te 2000 Antwerpen 2. Data van bezichtiging De liefhebbers kunnen de goederen en kunstvoorwerpen bezichtigen Verlatstraat 18 te 2000 Antwerpen op donderdag 5 maart vrijdag 6 maart zaterdag 7 maart en zondag 8 maart van 10 tot 18u Opgelet! Door een concert op zondagochtend 8 maart zal zaal Platform (1e verd.) niet toegankelijk zijn van 10-12u. 3. Data van afhaling Onmiddellijk na de veiling of op donderdag 12 maart van 9 tot 12u en van 13u30 tot 17u op vrijdag 13 maart van 9 tot 12u en van 13u30 tot 17u en ten laatste op zaterdag 14 maart van 10 tot 12u via Verlatstraat 18 4. Kosten 23 % 28 % via WebCast (registratie tot ten laatste dinsdag 10 maart, 18u) 30 % via After Sale €2/ lot administratieve kost 5. Telefonische biedingen Geen telefonische biedingen onder € 500 Veilinghuis Bernaerts/ Bernaerts Auctioneers Verlatstraat 18 2000 Antwerpen/ Antwerp T +32 (0)3 248 19 21 F +32 (0)3 248 15 93 www.bernaerts.be [email protected] Biedingen/ Biddings F +32 (0)3 248 15 93 Geen telefonische biedingen onder € 500 No telephone biddings when estimation is less than € 500 Live Webcast Registratie tot dinsdag 10 maart, 18u Identification till Tuesday 10 March, 6 pm Through Invaluable or Auction Mobility -

Uitgeven in De Zeventiende Eeuw Staat Balthasar I Moretus Aan Het Hoofd Van De Plantijnse Drukkerij
WINTER 2018-2019 ONAANGEKONDIGDE TITELS TITRES INATTENDUS UNANNOUNCED TITLES BAI Balthasar Moretus and the Passion of Publishing In the seventeenth century, Balthasar Moretus I was master of the Plantin Press. The Baroque era was in full sway and proved highly influential on developments in the world of books. Balthasar succeeded in getting leading artists to work on his book designs. This included collaborating with Peter Paul Rubens on more than twenty projects. Even today, publishers still play the role of director in terms of book innovation, and the relationship between publisher and artist remains as important now as it was in the past. Balthasar Moretus and the Passion of Publishing introduces the reader to fascinating publishing projects that make us look at books in a new light. We learn how both publisher and artist are constantly reinventing the book together. Expo: 28/09/2018 - 06/01/2019, Museum Plantin Moretus, Antwerp (Baroque Book Design) E [BE] BAI Hardback,260x210 mm, Eng. ed., 88 p, Dec. 2018, € 22,50 ISBN: 9789085867708 (E) I03 - ART HISTORY Balthasar Moretus en de passie van het uitgeven In de zeventiende eeuw staat Balthasar I Moretus aan het hoofd van de Plantijnse drukkerij. De barok bloeit volop en dat heeft een grote invloed op hoe het boek evolueert. Balthasar betrekt vooraanstaande kunstenaars bij zijn boekontwerpen. Zo werkt hij voor meer dan twintig projecten met Peter Paul Rubens samen. Ook vandaag spelen uitgevers nog steeds de rol van regisseur in de vernieuwing van het boek, en ook nu is de relatie tussen uitgever en kunstenaars daarbij van belang. -

Eugeen Van Mieghem: List of Works – Large Print
Eugeen Van Mieghem: List of Works – Large Print Gallery 17: Antwerp and the River Scheldt Sack Mender Before a Dock, c.1926 Oil on canvas, 69 x 79cm Province of Antwerp The port of Antwerp was exceptional for the large number of women who worked on the docks. From the 1860s women replaced men, who had been demanding higher wages, in areas such as mending sacks, cleaning hides and picking coffee beans. There were an estimated 2000 women working in the port around 1900. Strangers, 1903 Oil on cardboard, 26 x 58cm Private collection Between 1873 and 1935 the Red Star Line transported almost three million emigrants from Antwerp to North America, many of whom were Jewish migrants from Eastern Europe. Van Mieghem lived in close proximity to this vast movement of people as in 1893 the Red Star Line built a warehouse opposite Eugeen’s mother’s café. There every migrant underwent a medical check and their clothes and luggage were disinfected. Van Mieghem’s painting “Vreemden” (“strangers”) records the traffic both ways – the port as a point of contact between cultures. View of the Port, 1912 Pastel and charcoal, 28 x 39cm Private collection Antwerp Roadstead, c.1922 Oil on canvas, 60 x 100cm Eugeen Van Mieghem Museum The phrase “the Roads of Antwerp” or “Antwerp Roadstead” refers specifically to the view of Antwerp from the opposite bank of the Scheldt, with the distinctive spire of the Cathedral of Our Lady towering over the city. The Launch of the Elisabethville II, May 1921, 1921 Oil on cardboard, 40.5 x 61cm Private collection The Elisabethville II was an ocean liner built in 1921 for Compagnie Belge Maritime du Congo. -

Het Leven Van Eugeen Van Mieghem 1875 Op 1 Oktober 1875 Werd Eugeen Van Mieghem Geboren in De Ouderlijke Herberg in Het Hert Op De Van Meterenkaai
Het leven van Eugeen Van Mieghem 1875 Op 1 oktober 1875 werd Eugeen Van Mieghem geboren in de ouderlijke herberg In Het Hert op de Van Meterenkaai. Zijn vader Henri was scheepsbevrachter terwijl zijn moeder Virginie het café openhield. Eugeen groeide op aan de oever van de Schelde en temidden van de toenmalige havenactiviteit. In het café oberserveerde hij de kleurrijke bezoekers: schippers, matrozen, natiebazen, buildragers en zakkenmaaksters. De haven en de gewone mens werden later zijn inspiratiebron. De kunstenaar liet ons een indrukwekkend, uniek en virtuoos beeld na van de mens rond 1900 in een kosmopolitische wereldhaven. Van Mieghem werd terecht de “kunstenaar van het volk” genoemd. In 1873 startte de Red Star Line met het vervoer van emigranten vanuit Antwerpen naar de Nieuwe Wereld (eerst Amerika maar na WO I ook Canada). De schepen meerden aan bij de Rijnkaai. Het eerste kantoor van de Red Star Line bevond zich op de Jordaenskaai. 1883 Door de groeiende activiteit en de grotere schepen moest de Antwerpse haven uitbreiden. De stenen kademuren werden gebouwd en de oude vlieten gedempt. Rond 1883 bereikten de werken de Van Meterenkaai en vader Van Mieghem bouwde een nieuwe herberg in de Montevideostraat. Het café van de familie Van Mieghem (Montevideostraat nr. 6 met telefoonnummer 21) bevond zich op het Eilandje, een havenwijk volledig omgeven door de Schelde en de dokken. De straat was de grens van de haven met de bewoonde wereld. Eugeen liep school in de Keistraat en toonde er al snel zijn tekentalent. Aan het Antwerpse Koninklijk Atheneum kreeg hij les van o.a. -

Turn of the Century'
TURN O F TH E C E N T U R Y Loten met een '*' zijn afgebeeld. 1. Datum van de veiling De openbare verkoping van de hierna geïnventariseerde goederen en kunstvoorwerpen zal plaatshebben op woensdag 12 december om 14u in het Veilinghuis Bernaerts, Verlatstraat 16-22 te 2000 Antwerpen 2. Data van bezichtiging De liefhebbers kunnen de goederen en kunstvoorwerpen bezichtigen Verlatstraat 16-22 te 2000 Antwerpen op donderdag 6 december vrijdag 7 december zaterdag 8 december en zondag 9 december van 10 tot 18u 3. Data van afhaling Onmiddellijk na de veiling of op donderdag 13 december van 9 tot 12u op vrijdag 14 december van 9 tot 12u en van 13u30 tot 17u en ten laatste op zaterdag 15 december van 10 tot 12u 4. Kosten 23 % 28 % via WebCast (registratie tot ten laatste dinsdag 11 december 2018, 18u) 30 % via Silent Sale & After Sale €2/ lot administratieve kost 5. Telefonische biedingen Geen telefonische biedingen onder € 500 Veilinghuis Bernaerts/ Bernaerts Auctioneers Verlatstraat 18 2000 Antwerpen/ Antwerp T +32 (0)3 248 19 21 F +32 (0)3 248 15 93 www.bernaerts.be info bernaerts.be Biedingen/ Biddings F +32 (0)3 248 15 93 Geen telefonische biedingen onder € 500 No telephone biddings when estimation less than € 500 Live Webcast Registratie tot dinsdag 11 december, 18u Identification till Tuesday 11 December, 6 PM Silent Sale Lotnummers vanaf 5001 Enkel online, te bezichtigen tijdens de kantooruren Vrijdag 30 november t.e.m. maandag 17 december 12u www.bernaerts.be > veilingen > enkel online ABK 111-2656241-87 IBAN BE67 1112 6562 4187 BIC ABERBE -

Eng Ground Floor
GALLERY TEXTS ENG GROUND FLOOR FIRST FLOOR CAFÉ THE SHIPPING LINE 9 1 ALWAYS ON THE MOVE 19 2 THE KEY WITNESSES 23 3 THE DEPARTURE 25 4 THE TRAIN JOURNEY 31 5 STAYING IN ANTWERP 35 6 GROUND FLOOR SHOWERS AND DISINFECTION 49 7 THE DOCTOR’S VISIT 55 8 FIRST FLOOR TRAVELLING STEERAGE 59 9 LIFE ON BOARD 65 10 ARRIVING IN AMERICA 73 11 THE AMERICAN DREAM 79 12 AN OPEN ENDING 87 13 ANTWERP TODAY 89 14 DANCE, HANS OP DE BEECK 91 15 AN OPEN HOUSE 93 16 PASSENGER LISTS 97 17 CAFÉ 7 1 2 3 3 4 5 4 6 7 8 9 ELEVATOR 10 11 12 13 1 14 2 15 16 17 THE SHIPPING LINE 1 GROUND 2 3 FLOOR 4 7 1 11 12 13 14 1 1 17 7 THE SHIPPING LINE 1 2 3 4 7 ELEVATOR 1 11 12 13 1 14 1 1 17 THE 1 1 2 3 SHIPPING 4 5 LINE 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 THE SHIPPING LINE 1·1 THE HISTORY OF THE RED STAR LINE Philadelphia In 1871 Peter Wright & Sons, a company of Phil- adelphia-based shipbrokers, founded the Inter- national Navigation Company, with the aim of operating a transatlantic steam line under foreign 1 flag. Ships and crews were quite expensive in the 2 United States. 3 Peter Wright & Sons specialised in oil exports 4 and it was their intention to export oil from the 5 United States to Europe and to ferry migrants 6 from Europe to America on the way back. -

Julia LEVITINA (B
1 Julia LEVITINA (b. 1981, Odessa, Ukraine) 1304 S Fairhill St Philadelphia PA 19147 (00) 1 267 253 2678 [email protected] www.julialevitina.com Curriculum Vitae Education 2005-2007 Schuylkill Academy of the Fine Arts, Philadelphia, PA 2003-2005 Pennsylvania Academy of the Fine Arts (P.A.F.A), Philadelphia, PA 1999-2003 Georgetown University, BA Magna Cum Laude, Washington, DC Honors and Awards 2014 Merit Stipend, Fondation Ténot, Camac Art Centre, Marnay-sur-Seine, France. Visiting Artist, International Artist Residency, Camac Art Centre at Marnay-sur-Seine, Champagne-Ardenne, France. 2013 Visiting Artist and Lecturer, Eugeen van Mieghem Museum, Antwerp, Belgium Merit Stipend, Fondation Ténot, Camac Art Centre, Marnay-sur-Seine, France. Visiting Artist, International Artist Residency, Camac Art Centre at Marnay-sur-Seine, Champagne-Ardenne, France. Visiting Artist, Flanders House, New York, NY. Finalist, 7 th International Figurative Painting and Sculpture Competition. 1st Place, Sculpture, Ex Arte Equinus: International Journal of Horse Art Competition. 2012 Invited Artist Animalier, Association of Artists Animaliers, ArAnima, France Visiting Artist and Lecturer, Eugeen van Mieghem Museum, Antwerp, Belgium Visiting Artist and Lecturer, Georgetown University, Washington, DC Exhibiting Artist and Lecturer, Noyes Museum, Oceanville, NJ Visiting Artist, Jewish Community Center, JCC, Washington, DC 2011 Selected Sculptor Member, Foundation Taylor, Paris, France Visiting Artist and Lecturer, Eugeen van Mieghem Museum, Antwerp, Belgium 2010 Walter and Michael Lantz Prize in Figure Modeling, National Sculpture Society (NSS) Award commission, Eugeen van Mieghem Museum, Antwerp, Belgium, American Friends of the Red Star Line, Philadelphia, PA 2009 Award commission, American Academy of Sacred Arts and Military Branch of the Catholic Church Hilarie Hawley Award, Fellowship of P.A.F.A. -

1 RELIGION for MIGRANTS Joop Vernooij in the Dutch Public Debate
Paper for the IAMS assembly in Malaysia 2004 RELIGION FOR MIGRANTS THE CASE OF THE NETHERLANDS Joop Vernooij In the Dutch public debate on migration the issue of religion has been underrepresented until now. Nevertheless religion is for migrants, not for all of them, very important and essential. In this essay I give first an historical sketch of the religious panorama of the Netherlands and especially of the religions of the migrants. I can distinguish different aspects and models of migrant religion. At the end I can design a new type of theology and pastoral approach for the migrants and the existing institutions of churches in the Netherlands. God at the steerage We want to start with a perhaps strange introduction under the title God at the steerage, as a tween-decks passenger. The Jewish Historical Museum of Amsterdam organized for 2003- 2004 an exposition of works of the Belgian artist Eugeen van Mieghem (1875-1930) living in the harbour of Antwerp, painting people on exodus, predominantly people of Eastern Europe around the turning of the century, to the new world of the United States of America with the Red Star Line. The expo is underlining the quest of migration. It is a phenomenon of life, a clear cut in history of individuals and nations. We have to do with a significant illustration of the migrants by ships, and actually by airplane, but with as basis the ship, the vehicle of a new life under new circumstances, centuries long and without end. Eugeen van Mieghem made migrants to the main subjects of his artistic life. -

Eugeen Van Mieghem (1875-1930) and the Jewish Emigrants of the Red Star Line
Eugeen van Mieghem (1875-1930) and the Jewish Emigrants of the Red Star Line I) Eugeen Van Mieghem The early years Eugeen Van Mieghem was born at his parent’s inn in Antwerp (Belgium) on October 1 st 1875. His father, a former bargee opened a tavern at the bank of the river Scheldt around 1870. It was only in 1863 that a new spring for the Antwerp port started as the Belgian government bought from Holland the free use of the river Scheldt. Around 1880 the Van Mieghem family moved slightly further north to Montevideostraat on The Little Island (‘Het Eilandje’), the port area surrounded by the River Scheldt and the docks. The new inn was situated right opposite the building belonging to the Red Star Line, the shipping company that transported nearly 2.7 million European emigrants (of which Jews from Eastern Europe) to their new lives in America and Canada. In 1892 Van Mieghem enrolled at the Antwerp academy of art but was forced to leave the it after a clash with Professor Siberdt (the very same man who had dismissed Vincent Van Gogh in 1886). His father sent him to the port to look for freight for his shipping agency business. The new social trends of the beginning of the 20 th century struck a chord with Van Mieghem and he began to form ideals he never renounced: he wanted to be the artist of the people in this fast-growing world port. The world passed through his street The Ellis Island Immigration Station was opened in New York on January 1 st 1892 to receive the influx of exiles. -
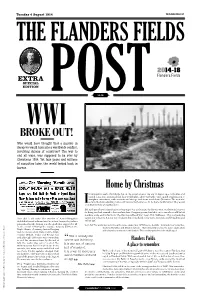
The Flanders Fields Post the Flanders Fields
Tuesday 4 August 1914 THE FLANDERS FIELDS POST THE FLANDERS FIELDS EXTRA SPECIAL EDITION POST14-18 WWI BROKE OUT! Who would have thought that a murder in Sarajevo would turn into a worldwide conflict, involving dozens of countries? The war to end all wars, was supposed to be over by Christmas 1914. Yet four years and millions of casualties later, the world looked back in horror. Home by Christmas n hindsight it seems improbable but, at the actual onset of the war in August 1914, both allies and central states were convinced that they would fight a short war battle - just a quick confrontation to straighten out matters, settle accounts and then go back home to celebrate Christmas. The men who went to the front, whistling, believed it and said to their wives, I’ll be home by Christmas! They would Isoon find out how wrong they were. Did each party have its justifications for going to war at the start? As the war went on, the initial reasons for being involved seemed to become less clear. The great powers battled it out to see who would be left standing at the end. In his book ‘The War that will end War’ (1914), H.G. Wells says, “This is already the How did it all start? The murder of Austro-Hungarian vastest war in history. It is war not of nations but of mankind. It is a war to exorcise a world-madness and Archduke Franz-Ferdinand and his wife in Sarajevo by Serbian end an age.” nationalist Gavrilo Princip was the spark that triggered it all. -

Art & Illustratedbooks
VOORJAAR-ZOMER2019 - PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 - SPRING-SUMMER 2019 BELGI Algemene voorwaarden – Conditions generals – General conditions Prijzen, technische specificities en voorwaarden kunnen wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Exhibitions International is niet verantwoordelijk voor fouten of ontbrekende gegevens. Verzendingskosten zijn voor rekening van de klant. Alle beschadigingen of misdrukken moeten binnen 10 dagen na ontvangst doorgegeven worden. De vermelde prijzen zijn de Belgische prijzen incl. BTW. Prière de noter que les prix peuvent être modifié sans notification préalable (par décision de l’éditeur ou des variations des cours de change). Tous les dommages ou fautes d'impression doivent être signalés dans les 10 jours suivant la réception. Exhibitions International ne peut être tenu responsable pour des indications erronées ou manquants des prix ou autres. Les prix mentionnés sont les prix belge, TVA incl. Prices, specifications, and terms are subject to change without notice. Exhibitions International is not responsible for errors or omissions in prices and other data. Shipping costs are on account of the customer. All defects and printing errors must be notified within 10 days of reception. The prices mentioned are the Belgian prices, VAT included. Retouren boekhandels - Retours libraires – Returns policy booktrade Alle aankopen worden beschouwd als vaste aankoop tenzij anders overeengekomen en als dusdanig vermeld op de factuur. Retouren zijn enkel mogelijk na drie maanden en voor 9 maanden en kunnen enkel gebeuren na voorafgaandelijke, schriftelijke aanvraag. De retourtoelating blijft één maand geldig en dient bij de retour gevoegd te worden. De retour gebeurt op risico van de klant en worden enkel aanvaard als ze ons in perfecte staat bereiken. -

Artist As Witness - Migrations Wednesday 24Th May 14:00 – 16:00
Dublin City Gallery The Hugh Lane Seminar: Artist as Witness - Migrations Wednesday 24th May 14:00 – 16:00 Artist as Witness - Migrations is a seminar in response to the exhibition Port Life - Eugeen Van Mieghem. Invited speakers will take Mieghem's work as a starting point to explore the idea of the 'Artist as Witness' in society and will expand into broader contemporary issues, such as climate change, labour migration and globalisation challenging the world today. For centuries various forms of art practices have responded to real world experiences and artists have consciously taken on the role of witness to events - from the intimate to the historical in scale - across human society. What does being a witness mean for an artist and how has such a role changed over time? Can meaningful work result? What responsibilities do artists and the art process take on and how can these responsibilities be fulfilled? These questions and more will be discussed by Alaina Claire Feldman, Dr Niamh Ann Kelly and Erwin Joos in individual presentations and a chaired discussion with Declan McGonagle. This seminar is initiated by Dublin City Gallery The Hugh Lane in collaboration with the Port Perspectives Programme – a focus on reconnecting Dublin port and Dublin city. Alaina Claire Feldman is Director of Exhibitions at Independent Curators International (ICI), New York. Dr Niamh Ann Kelly is a lecturer in Visual Culture at the Dublin School of Creative Arts, DIT Erwin Joos is the Director of Museum Eugeen Van Mieghem Declan McGonagle is the curator of the engagement programme for Port Perspectives.