République Du Burundi Projet D'appui À L
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Integrated Regional Information Network (IRIN): Burundi
U.N. Department of Humanitarian Affairs Integrated Regional Information Network (IRIN) Burundi Sommaire / Contents BURUNDI HUMANITARIAN SITUATION REPORT No. 4...............................................................5 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 26 July 1996 (96.7.26)..................................................9 Burundi-Canada: Canada Supports Arusha Declaration 96.8.8..............................................................11 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 14 August 1996 96.8.14..............................................13 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 15 August 1996 96.8.15..............................................15 Burundi: Statement by the US Catholic Conference and CRS 96.8.14...................................................17 Burundi: Regional Foreign Ministers Meeting Press Release 96.8.16....................................................19 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 16 August 1996 96.8.16..............................................21 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 20 August 1996 96.8.20..............................................23 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 21 August 1996 96.08.21.............................................25 Burundi: Notes from Burundi Policy Forum meeting 96.8.23..............................................................27 Burundi: IRIN Summary of Main Events for 23 August 1996 96.08.23................................................30 Burundi: Amnesty International News Service 96.8.23.......................................................................32 -
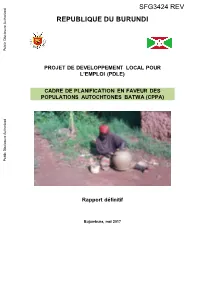
BATWA (CPPA) Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
SFG3424 REV REPUBLIQUE DU BURUNDI Public Disclosure Authorized PROJET DE DEVELOPPEMENT LOCAL POUR L’EMPLOI (PDLE) CADRE DE PLANIFICATION EN FAVEUR DES POPULATIONS AUTOCHTONES BATWA (CPPA) Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Rapport définitif Public Disclosure Authorized Bujumbura, mai 2017 CADRE DE PLANIFICATION EN FAVEUR DES POPULATIONS AUTOCHTONES (CPPA) BATWA Photo 1: Site de construction du Marché de Gifugwe, Mpanda, Bubanza Avril 2017 2 Table des Matières Table des Matières ...................................................................................................................i Liste des abréviations ............................................................................................................ iii Liste des graphiques .............................................................................................................. iii Liste des Photos ..................................................................................................................... iii Liste des tableaux .................................................................................................................. iii Incamake y’ishirwa mu ngiro y’umugambi ............................................ v RESUME EXECUTIF ...................................................................... viii EXECUTIVE SUMMARY .................................................................... xi 1. INTRODUCTION..........................................................................1 1.1. Objectif du CPPA .......................................................................................................... -
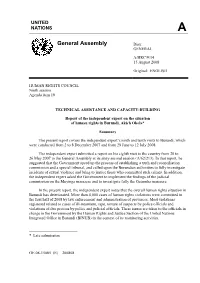
General Assembly Distr
UNITED NATIONS A General Assembly Distr. GENERAL A/HRC/9/14 15 August 2008 Original: ENGLISH HUMAN RIGHTS COUNCIL Ninth session Agenda item 10 TECHNICAL ASSISTANCE AND CAPACITY-BUILDING Report of the independent expert on the situation of human rights in Burundi, Akich Okola* Summary The present report covers the independent expert’s ninth and tenth visits to Burundi, which were conducted from 2 to 8 December 2007 and from 29 June to 12 July 2008. The independent expert submitted a report on his eighth visit to the country from 20 to 26 May 2007 to the General Assembly at its sixty-second session (A/62/213). In that report, he suggested that the Government speed up the process of establishing a truth and reconciliation commission and a special tribunal, and called upon the Burundian authorities to fully investigate incidents of sexual violence and bring to justice those who committed such crimes. In addition, the independent expert asked the Government to implement the findings of the judicial commission on the Muyinga massacre and to investigate fully the Gatumba massacre. In the present report, the independent expert notes that the overall human rights situation in Burundi has deteriorated. More than 4,000 cases of human rights violations were committed in the first half of 2008 by law enforcement and administration of provinces. Most violations registered related to cases of ill-treatment, rape, torture of suspects by police officials and violations of due process by police and judicial officials. These issues are taken to the officials in charge in the Government by the Human Rights and Justice Section of the United Nations Integrated Office in Burundi (BINUB) in the context of its monitoring activities. -

Dep Ar Tement De La Population Republique Du Burundi Ministere De L'interieur Departement De La Population
REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DE L'I1'!TERIEUR DEP AR TEMENT DE LA POPULATION REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DE L'INTERIEUR DEPARTEMENT DE LA POPULATION Centre Français sur 1 et le Dé ppement 15, rue ,'Ecole de Médecine 70 PARIS CEDEX 06 Tél. (1) 46 33 9941 RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1 6 A O'U T 1 979 TOME II Volume VIII RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROVINCE DE NGOZI Bujumbura, Octobre 1983 " -3- RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1 6 A 0 U T 1 979 SOMMAIRE PAGES Ayant-propos 4 1. Introduction 5 2. principaux Résultats 6 2.1- Effectifs et Densités 6 2.2- Lieu de Naissance et Lieu de Résidence 9 2.3- Sexe et Age 11 2.4- Alphabétisation et Scolarisation 15 2.5- population Active et Inactive 17 2.6- Professions et Branches d'Activité 18 2.7- Ménage et Rugo 21 3. Conclusion 23 4. Annexes 24 4.1- Liste des tableaux 24 4.2- Résultats Bruts 28 -4- AVANT·-PROPOS Comme pour toutes les autres publications sur les Résultats définitifs du Recensement général de la Population effectué en 1979, le présent rapport se réfère aux anciennes limites de la Province de NGOZI avant la nouvelle déli mitation du territoire Burundais. Après une brève introduction, le lecteur y trouvera les principaux résultats sur les effectifs et densité, le lieu de naissance et le lieu de ré sidence, le sexe et l'âge, l'alphabétisation et la scolarisation, la population active et inactive, les professions et les branches d'activités, les ménages et rugo et enfin des annexes contenant la liste des tableaux bruts. -

BURUNDI: Carte De Référence
BURUNDI: Carte de référence 29°0'0"E 29°30'0"E 30°0'0"E 30°30'0"E 2°0'0"S 2°0'0"S L a c K i v u RWANDA Lac Rweru Ngomo Kijumbura Lac Cohoha Masaka Cagakori Kiri Kiyonza Ruzo Nzove Murama Gaturanda Gatete Kayove Rubuga Kigina Tura Sigu Vumasi Rusenyi Kinanira Rwibikara Nyabisindu Gatare Gakoni Bugabira Kabira Nyakarama Nyamabuye Bugoma Kivo Kumana Buhangara Nyabikenke Marembo Murambi Ceru Nyagisozi Karambo Giteranyi Rugasa Higiro Rusara Mihigo Gitete Kinyami Munazi Ruheha Muyange Kagugo Bisiga Rumandari Gitwe Kibonde Gisenyi Buhoro Rukungere NByakuizu soni Muvyuko Gasenyi Kididiri Nonwe Giteryani 2°30'0"S 2°30'0"S Kigoma Runyonza Yaranda Burara Nyabugeni Bunywera Rugese Mugendo Karambo Kinyovu Nyabibugu Rugarama Kabanga Cewe Renga Karugunda Rurira Minyago Kabizi Kirundo Rutabo Buringa Ndava Kavomo Shoza Bugera Murore Mika Makombe Kanyagu Rurende Buringanire Murama Kinyangurube Mwenya Bwambarangwe Carubambo Murungurira Kagege Mugobe Shore Ruyenzi Susa Kanyinya Munyinya Ruyaga Budahunga Gasave Kabogo Rubenga Mariza Sasa Buhimba Kirundo Mugongo Centre-Urbain Mutara Mukerwa Gatemere Kimeza Nyemera Gihosha Mukenke Mangoma Bigombo Rambo Kirundo Gakana Rungazi Ntega Gitwenzi Kiravumba Butegana Rugese Monge Rugero Mataka Runyinya Gahosha Santunda Kigaga Gasave Mugano Rwimbogo Mihigo Ntega Gikuyo Buhevyi Buhorana Mukoni Nyempundu Gihome KanabugireGatwe Karamagi Nyakibingo KIRUCNanika DGaOsuga Butahana Bucana Mutarishwa Cumva Rabiro Ngoma Gisitwe Nkorwe Kabirizi Gihinga Miremera Kiziba Muyinza Bugorora Kinyuku Mwendo Rushubije Busenyi Butihinda -

Bdi-1979-Rec-O10 Province Bubanza
RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROVINCE DE BUBANZA i---& _,-___:,-. .. l -REPUBLIQUE DÙ BURuNDI 1 MINISTERE DE cL' INTERIEUR . .DEPARTEMENT· DE LA. POPULATION 1 CEPED Centre Français sur la· Populaf n et le Développe '15, rue de I' - e de Médecine 75 PARIS CEDEX 06 Tél. (1) 46 33 99 41 RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1 6 A 0 U T 1 $ 7 9 TOME I.I Volume 2 RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROVINCE DE BUBANZA Bujumbura, Novembre 1983 RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1 6 A 0 U T 1 9 7 9 SOMMAIRE PAGES Avant-propos 4 1. Introduction 5 2. Principaux Résultats 6 2.1- Effectifs et Densités 6 2.2- Ljeu de Naissance et Lieu de Résidence 9 2.3- Sexe et Age 10 2.4- Alphabétisation et Scolarjsation 14 2.5- Population Active et Inactive 15 2.6- Professions et Branches d'Activité 16 2.7- Ménage et Rugo 19 3. Conclusion 21 4. Annexes 22 4.1- Liste des tableaux 22 4.2- Résultats Bruts 25 -4- AVANT-PROPOS A l'occasion de cette publication nous rappelons au lecteur que ces données ont été collectées et traitées tandis que la province de BUBANZA gardait ses anciennes limites avant la nouvelle loi sur le découpage des circonscrip tions administratives. L'utilisateur pourra certainement trouver des renseigne ments démographiques très utiles dans ces résultats à savoir les effectifs et densités, le lieu de naissance et de résidence, le sexe et l'âge, l'alphabétisa tion et la scolarisation, la population active et inactive, les professions et les branches d'activité, les ménages et rugo et les Résultats Bruts en annexe. -

Current and Future Water Demand in Communes Surrounding Kibira National Park in Burundi
환경영향평가 Vol. 24, No. 1(2015) pp.78~86 J. Environ. Impact Assess. 24(1), 78~86, 2015 ISSN 1225-7184 http://dx.doi.org/10.14249/eia.2015.24.1.78 Research Paper Current and Future Water Demand in Communes Surrounding Kibira National Park in Burundi · · Bankuwiha, Melchiade Daeseok Kang Kijune Sung Department of Ecological Engineering , Pukyong National University 아프리카 부룬디의 Kibira 국립공원 인근 지역의 물수요 예측 Bankuwiha, Melchiade· 강대석 ·성기준 부경대학교 생태공학과 요 약 : 물은 지구상의 생물들이 살아가는데 매우 중요한 역할을 담당한다. 심각한 물 부족 현상이 가난한 지역에 사는 사람들 특히 전세계에서 가장 가난한 아프리카의 시골지역에서 사는 사람들에게 더 큰 문제라 는 것을 주목할 필요가 있다. 브룬디는 바로 그런 위험 군에 속하는 나라이다. 본 연구는 아프리카 브룬디 의 Kibira 국립공원 인근 7개 지역의 현재와 미래의 물 수요를 예측하였다. 잠재적인 물 수요 군을 일반가 정, 가축, 농업부문 및 산업부문으로 나누어 물 수요를 예측하였는데, 이들 지역의 물 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예측되었다. 농업생산에 필요한 물의 양은 2020년에는 연간 288,779,060 m3, 2050년에는 연간 306,018,348 m3로 증가하면서, Kibira 국립공원 인근 지역의 경우 농업부분에서 물 수요가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보인다. 하지만 차 재배가 주 산업인 Muruta 와 Bukeye 의 경우 2050년 차 산업과 관련된 물 수요가 가장 많은 것으로 나타났다. 따라서 이용 가능한 수자원의 양이 Kibira 국립공원 주변 지 역의 발전에 가장 큰 영향을 미치는 변수가 될 것으로 보인다. 현재의 수자원 규모는 이들 7개 지역의 미래 물 수요를 충족할 수 없는 것으로 판단되며, 수자원 확보를 위한 필요한 대책을 강구하여야 한다. 주요어 : 물 수요, 예측, 부룬디, 농업생산, 차 산업 Abstract : Water plays the fundamental role in sustaining the living system. -

World Bank Document
SFG4111 REPUBLIQUE DU BURUNDI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PROJET DE RESTAURATION DES PAYSAGES ET DE RESILIENCE AU BURUNDI (PRPR-BURUNDI) CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) Public Disclosure Authorized RAPPORT DEFINITIF Public Disclosure Authorized Janvier, 2018 TABLE DES MATIERES ACRONYMES ................................................................................................................................................................. iv EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................................. v RESUME EXECUTIF ...................................................................................................................................................... vii LISTE DES FIGURES........................................................................................................................................................ x LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................................... xi 1. INTRODUCTION ........................................................................................................................................................ 1 1.1. Contexte et objectifs du Projet de Restauration des Paysages et de Résilience et de l’étude du cadre de gestion environnementale et sociale ............................................................................................ -

Rapport De Mars 2019
i FORUM POUR LE RENFORCEMENT DE LA SOCIETE CIVILE BURUNDI Une intolérance politique aux conséquences dévastatrices dévastatrices Rapport sur la gouvernance et les droits socio- économiques au Burundi mars 2019 i Table des matières 0. Introduction ................................................................................................................................... 1 I. Contexte socio-politique et économique : la répression politique fait de plus en plus de victimes à la veille des élections de 2020 ............................................................................................................... 1 II. Le droit à l’éducation : la politisation du secteur détruit progressivement l’école ....................... 10 III. Un manque criant d’eau potable et une gestion calamiteuse de l’entreprise REGIDESO ............. 14 V. D’autres faits de mauvaise gouvernance observés pendant la période du rapport......................... 15 VI. Conclusion et recommandations ................................................................................................ 20 1 0. Introduction A la veille des élections de 2020, le phénomène d’intolérance politique continue et s’accentue dans tout le pays. Le parti CNDD-FDD au pouvoir depuis 2005 a érigé la dictature, l’exclusion, la discrimination et la violence politique en un mode de gouvernance à tous les niveaux de la vie du pays. Il veut régner en monopartisme absolu en excluant sans scrupule les autres formations politiques de la course électorale. Les assassinats politiques, les emprisonnements abusifs, les dilapidations des fonds publics, la corruption et d’autres crimes économiques sont le lot quotidien des Burundais. La jeunesse Imbonerakure est utilisée par le régime de Pierre Nkurunziza comme un instrument politique de répression contre les opposants déclarés ou présumés, afin d’arriver à ses objectifs de se maintenir au pouvoir, bon gré mal gré. Les priorités socio-économiques en l’occurrence l’éducation, la santé, le secteur de l’économie constituent une préoccupation mineure. -

Atelier De Dmarrage
Programme pour la Promotion de l’Agro‐Industrie Et des Entreprises Rurales (PAIR) Burundi Agribusiness Program PY 5 Annual Indicator Report Under Contract # EDH‐I‐00‐05‐00004‐00 Task Order # 10 Prepared for: Alice Nibitanga, Cognizant Technical Officer, USAID/Burundi Prepared by: Benjamin E Lentz, Chief of Party DAI/BAP [email protected] October 2012 17 Rue de Coton, Quartier GATOKE, Commune de Rohéro BP 1643 Bujumbura, Burundi Tel +257.22.25.79.52 Fax +257.22.25.79.51 Page 1 of 49 Table of Contents INTRODUCTION .................................................................................................................................... 2 EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................................................................... 2 PRINCIPAL ACCOMPLISHMENTS, BY SECTOR ................................................................................................ 6 CONSTRAINTS & CHALLENGES .................................................................................................................... 16 LESSONS LEARNED BY TECHNICAL COMPONENT……………………………………………………………………………………25 IMPACT OF HOST COUNTRY COMMITMENT………………………………………………………………………………………….34 GENDER AND BAP PROGRAM SUCCESS…………………………………………………………………………………………………38 SUCCESS STORY‐NEW MILK COLLECTION CENTER RAISES RURAL INCOMES………………………………………….42 CONCLUSION………………………………………………………………………………………………………………………………………..46 ANNEXES …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..47 17 Rue de Coton, Quartier GATOKE BP 1643 Bujumbura, Burundi -

Rapport De Monitoring Des Violations Des Droits Humains Pour Septembre
Acat -Burundi Rapport sur le Monitoring des Violations et atteintes aux droits de l’homme commises au Burundi. Période du mois de septembre 2020 Plan du présent rapport INTRODUCTION. ASSASSINATS ET ENLEVEMENTS. ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES. ATTEINTES A L’INTEGRITE PHYSIQUE. AUTRES VIOLATIONS CONCLUSION. RECOMMANDATIONS. INTRODUCTION. La crise politico-sécuritaire que traverse le Burundi depuis avril 2015 continue d’alimenter les violations des droits de l’homme au détriment du peuple burundais qui en paie le lourd tribut alors qu’il aspire comme ailleurs à un Etat de droit. La tendance des violations des droits de l’homme documentées depuis le début de la crise politique en avril 2015 reste inchangée. Il s’agit principalement des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et des détentions arbitraires, des actes de torture et des mauvais traitements qui continuent à être observés. Les victimes de ces violations restent en majorité des opposants au Gouvernement et/ou au parti au pouvoir (le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie – CNDD-FDD) ou des personnes perçues comme tels : membres de partis politiques d’opposition (en particulier du Congrès National pour la Liberté(CNL),le parti fondé par l’ancien leader des FNL, Agathon RWASA et du Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD) , les sympathisants de groupes armés d’opposition , des burundais tentant de fuir le pays et de ce fait suspectés de rejoindre ces groupes , ou journalistes et membres d’organisations de la société civile. Les agents de l’Etat à l’instar des policiers, des agents du Service National de Renseignement (SNR) associés aux miliciens Imbonerakure jeunes affiliés au parti au pouvoir le CNDD-FDD, sont pointés du doigt comme les auteurs présumés de ces violations massives des droits de l’homme. -
Burundi Food Security Monitoring Early Warning System SAP/SSA Bulletin N° 100/February 2011 Publication : March 2011
Burundi Food Security Monitoring Early Warning System SAP/SSA Bulletin n° 100/February 2011 Publication : March 2011 Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire au Burundi ►The UNHCR notes that it has facilitated the repatriation of 771 P ériode de janvier à juin 2011 people, taking the total to 511 244 people repatriated since N UNHCRs repatriation programme began in Burundi (in 2002); Giteranyi ►The La Niña phenomenon, which has seriously affected the Bugabira Busoni North-Eastern and Eastern regions of the country through delays Kirundo Bwambarangwe Ntega and deficits in rainfall throughout season 2011A is set to continue Kirundo until May, but with diminishing effects in Burundi; Rwanda Gitobe Mugina Butihinda Mabayi Vumbi ►The final report published by the Joint Crop and Food Security Marangara Muyinga Cibitoke Nyamurenza Gashoho Rugombo Mwumba Muyinga Assessment Mission (CFSAM) for season 2011A points to a 3% Busiga Kiremba Gasorwe Murwi Kabarore Ngozi Bukinanyana Gashikanwa drop in production compared with season 2010A, mainly due to Kayanza Tangara Muruta Ngozi Gahombo Gitaramuka Buhinyuza the La Niña phenomenon; Buganda Gatara Ruhororo Musigati Kayanza Kigamba Bubanza Muhanga ►The food deficit which emanates from the first semester of the Matongo Buhiga Mwakiro Mishiha Bubanza Mutaho Bugenyuzi Gihogazi year is of 498 884 tons of CE, thus a 10% drop in food availability Mpanda Rango Karuzi Cankuzo Gihanga Bukeye Mutumba Rugazi Cankuzo compared with the same period of the previous year ; Mbuye Gisagara Muramvya Bugendana