Doctorat En Sciences
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Journal Officiel Algérie
N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

Journal Officiel N°2020-59
N° 59 Dimanche 16 Safar 1442 59ème ANNEE Correspondant au 4 octobre 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: 1 An 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A Tél : 021.54.35..06 à 09 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d'expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 16 Safar 1442 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 4 octobre 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 20-274 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux -

Qualité Des Sels De Ta Marché Algérien Et Incid Cas De L'iodation Et Des
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA FACULTE DES SCIENCES DOMAINE : SNV DEPARTEMENT DE MICROBIOLOGIE FILIERE : Sciences Alimentaires ET BIOCHIMIE OPTION : Nutrition et science des N° :………………………… aliments Mémoire présenté pour l’obtention Du diplôme de Master Académique Par : HADERBACHE Mounira Intitulé Qualité des sels de table mis sur le marché algérien et incidence sur la santé: cas de l’iodation et des microplastiques Soutenu devant le jury composé de: YAHIAOUI Merzouk MCA Université de M’sila Président BELBAHI Amine MCB Université de M’sila Rapporteur HAMMOUI Yasmina MCB Université de M’sila Examinateur Année universitaire : 2018/2019 Remerciements En premier, je remercie Dieu le tout puissant De m’avoir donné́santé, courage et patience pour Terminer ce modeste travail. Je tiens à̀exprimer mes vifs remerciements àmon Promoteur Mr BELBAHI A. Pour ses judicieux Conseils sa patience et son soutien Je remercie également Mr DOUMI B. et Mlle ADJISSI Roukia Pour leurs accueils et leur gentillesse au niveau du laboratoire DOUMI Labo de contrôle qualité des produits alimentaires Je remercie les membres du jury d’avoir accepté́de critiquer et d’améliorer ce travail. Je souhaite remercier DR.BARKATI et Dr DIB endocrinologues Pour toute l'aide qu'ils nous ont apporté́. Au Docteur HADJAB Makhloufi A Mr HOUHOU Mohammed sadek Dédicace Je dédie ce modeste travail A mes chers parents, A la prunelle de mes yeux : RACHA et MERIEM A mon cher mari : BAGOU MED REDA A mes sœurs : Salima, Latifa ,Safa, Habiba Au groupe MASTER2 NSA A mes collègues : Riad, Noureddine , Rachid et Zine el Abiddine Et tous ceux qui m’ont honoré de leur présence HADERBACHE Mounira RÉSUMÉ RÉSUMÉ Le sel est un nutriment essentiel pour le fonctionnement de l’organisme humain ;une consommationexcessive pourrait avoir des conséquences néfastes pour l’organisme. -

Distribution: Restricted EB 2003/80/R.36/Rev.1 18 December 2003 Original: English Agenda Item 11(E)(I) English
Distribution: Restricted EB 2003/80/R.36/Rev.1 18 December 2003 Original: English Agenda Item 11(e)(i) English a IFAD INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Executive Board – Eightieth Session Rome, 17-18 December 2003 REPORT AND RECOMMENDATION OF THE PRESIDENT TO THE EXECUTIVE BOARD ON A PROPOSED LOAN TO THE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA FOR THE RURAL DEVELOPMENT PROJECT FOR THE MOUNTAIN ZONES IN THE NORTH OF THE WILAYA OF M’SILA Due to resource constraints and environmental concerns, IFAD documents are produced in limited quantities. Delegates are kindly requested to bring their documents to meetings and to limit requests for additional copies. A INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT TABLE OF CONTENTS CURRENCY EQUIVALENTS iii WEIGHTS AND MEASURES iii ABBREVIATIONS AND ACRONYMS iii GLOSSARY iii MAP OF THE PROJECT AREA iv LOAN SUMMARY v PROJECT BRIEF vi PART I – THE ECONOMY, SECTORAL CONTEXT AND IFAD STRATEGY 1 A. The Economy and Agricultural Sector 1 B. IFAD’s Strategy for Collaboration with Algeria 2 PART II – THE PROJECT 3 A. Project Area and Target Group 3 B. Project Rationale and Strategy 3 C. Objectives and Scope 4 D. Components 4 E. Costs and Financing 7 F. Procurement, Disbursement, Accounts and Audit 8 G. Organization and Management 9 H. Economic Justification 9 I. Risks 10 J. Environmental Impact 10 K. Innovative Features 10 PART III – LEGAL INSTRUMENTS AND AUTHORITY 11 PART IV – RECOMMENDATION 11 ANNEX SUMMARY OF IMPORTANT SUPPLEMENTARY ASSURANCES INCLUDED IN THE NEGOTIATED LOAN AGREEMENT 13 i A INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT APPENDIXES I. COUNTRY DATA 1 II. -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets
No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

Wilaya De M'sila
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA FACULTE DES SCIENCE DOMAINE : SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE FILIERE : SCIENCE AGRONOMIQUE N° :……………………………………….. OPTION : sciences de sole Mémoire présenté pour l’obtention Du diplôme de Master Académique Par: OUALI Nadjat TAIEBI Oum Hani Intitulé Evaluation de la qualité physico-chimique des eaux d’irrigation de la région MAGRA (wilaya de M’sila) Soutenu devant le jury composé de: MADANI .Dj Université M’sila (MAA) Président TIR Ch Université M’sila (MAA) Encadreur Tellache S Université M’sila (MAA) Examinateur Année universitaire : 2018 /2019 Remerciements Avant tout, nous remercions Dieu de nous avoir donné la force et la foi afin de réaliser ce travail. Nous tenons à remercier Mademoiselle TIR CHAFIA, notre promoteur, qui nous a proposé ce travail et accepté de nous encadrer. Son avis et ses remarques, ses critiques et ses qualités humaines apportées tout au long de ce travail nous ont été précieuses. Nous exprimons nos respectueux remerciements à Mademoiselle MADANI .D pour l’honneur qu’elle nous a fait en acceptant de présider le jury. Nous adressons notre profonde reconnaissance à Monsieur TELLACHE.S pour l’honneur qu’il nous a fait en acceptant d’examines notre travail. Profonds remerciements vont également à Monsieur AOUINA .H pour ces aides pratique et scientifique. Nous exprimons nos respectueux remerciements à Madame HAMIDI .N responsable du laboratoire de l’ADE , NAOUI MEHIDI. F et HADJAB .A pour nous avoir accueillis dans son laboratoire, et monsieur DJEGHEDALI. -

Abstract Book
UNDER THE PATRONAJ: MINISTRY OF RESEARCH AND INNOVATION, RO LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU, RO ABSTRACT BOOK Exhibitors Sponsors: HONORARY PRESIDENT Prof. Dr. h.c. Hubertus Lelieveld, EFFoSTT and EHEDG Executive Committee, GHI President, Netherlands CONGRESS PATRONAGE Prof. Ioan Bondrea Ph.D., Rector, Lucian Blaga University of Sibiu, Romania CONGRESS CHAIR Prof. Ovidiu TIŢA Ph.D., University Lucian Blaga, Sibiu, Romania CONGRESS CO-CHAIRS Prof. Mark Shamtsyan Ph. D., St. Petersburg State Institute of Technology, Technical University, St. Petersburg, Russia Prof. Nedovic Viktor, Ph. D., University of Belgrade, Serbia Prof. Liviu Gaceu Ph.D., Transilvania University of Brasov, Romania INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE Prof. Adrian Riviș Ph.D., University of Agronomic Science and Veterinary Medicine – Timișoara, Romania Prof. Adriana-Luminita FÎNARU, Ph.D., ”Vasile Alecsandri” University of Bacău, Bacău, Romania Prof. Brian McKennaPh.D., Scientific Coordinator, ETP Food for Life, Ireland Prof. Dr. Dietrich Knorr, Ph.D., Berlin University of Technology, IUFoST President, Germany Prof. Diana Banati, Ph.D., Executive and Scientific Director. International Life Science Institute, Brussels, Belgium Prof. Dumitru Mnerie Ph. D., University Politehnica Timisoara, Romania Prof. Dumitru Tucu, Ph. D., University Politehnica Timisoara,Romania Prof. Dan Vodnar, Ph. D., University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania Gabriela Mohan, Senior Researcher, Technological Information Centre Manager, National Research Institute for Food Bioresources Bucharest, Romania Prof. Ganesh Bora Ph. D., Mississippi State University , USA Prof. Gaceu Liviu Ph.D., Transilvania University of Brasov, Romania Prof. Gustavo Barbosa Ph. D., Washington State University, USA Prof. Dr. h.c. Hubertus Lelieveld, EFFoSTT and EHEDG Executive Committee, GHI President, The Netherlands Prof. -
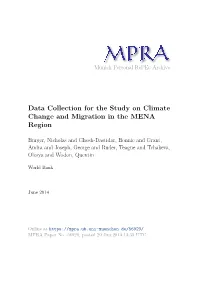
Data Collection for the Study on Climate Change and Migration in the MENA Region
Munich Personal RePEc Archive Data Collection for the Study on Climate Change and Migration in the MENA Region Burger, Nicholas and Ghosh-Dastidar, Bonnie and Grant, Audra and Joseph, George and Ruder, Teague and Tchakeva, Olesya and Wodon, Quentin World Bank June 2014 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56929/ MPRA Paper No. 56929, posted 29 Jun 2014 13:35 UTC Data Collection for the Study on Climate Change and Migration in the MENA Region Nicholas Burger, Bonnie Ghosh-Dastidar, Audra Grant, George Joseph, Teague Ruder, Olesya Tchakeva, and Quentin Wodon June 2014 This paper is forthcoming in: Wodon, Q., A. Liverani, G. Joseph and N. Bougnoux, 2014 editors, Climate Change and Migration: Evidence from the Middle East and North Africa, Washington, DC: The World Bank. Abstract A large part of this study is based on data collected in 2011 in five focus countries of the MENA region. In addition, other existing data sources were used as well, as documented in the various chapters that follow, but this need not be discussed in this chapter. This chapter documents the process followed and some of the choices made for new data collection, both quantitative and qualitative, for the study on climate change and migration in the MENA region. After a brief introduction, we explain the nature of the household survey questionnaire, what it enables us to document, as well as some of its limits. Next, we explain how the household survey sites were selected and how the samples were constructed in each of the five focus countries. We also provide a few comments on the challenges encountered during survey implementation. -

Aba Nombre Circonscriptions Électoralcs Et Composition En Communes De Siéges & Pourvoir
25ame ANNEE. — N° 44 Mercredi 29 octobre 1986 Ay\j SI AS gal ABAN bic SeMo, ObVel , - TUNIGIE ABONNEMENT ANNUEL ‘ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL Abonnements et publicité : Edition originale .. .. .. .. .. 100 D.A. 150 DA. Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE et satraduction........ .. 200 D.A. 300 DA. 7 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER (frais d'expédition | tg}, ; 65-18-15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER en sus) Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années antérleures : suivant baréme. Les tables sont fourntes gratul »ment aux abonnés. Priére dé joindre les derniéres bandes . pour renouveliement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANGAISE) SOMMAIRE DECRETS des ceuvres sociales au ministére de fa protection sociale, p. 1230. Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux siéges & pourvoir pour l’élection a l’Assemblée fonctions du directeur des constructions au populaire nationale, p. 1217. , ministére de la formation professionnelle et du travail, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général da la planification Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux et de. la gestion industrielle au ministére de fonctions du directeur de la sécurité sociale et lindustrie lourde,.p. -

Plan Développement Réseau Transport Gaz Du GR TG 2017 -2027 En Date
Plan de développement du Réseau de Transportdu Gaz 2014-2024 N°901- PDG/2017 N°480- DOSG/2017 CA N°03/2017 - N°021/CA/2017 Mai 2017 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 Sommaire INTRODUCTION I. SYNTHESE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT I.1. Synthèse physique des ouvrages I.2. Synthèse de la valorisation de l’ensemble des ouvrages II. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX GAZ II.1. Ouvrages mis en gaz en 201 6 II.2. Ouvrages alimentant la Wilaya de Tamanrasset et Djanet II.3. Ouvrages Infrastructurels liés à l’approvisionnement en gaz nature l II.4. Ouvrages liés au Gazoduc Rocade Est -Ouest (GREO) II.5. Ouvrages liés à la Production d’Electricité II.6. Ouvrages liés aux Raccordement de la C lientèle Industrielle Nouvelle II.7. Ouvrages liés aux Distributions Publiques du gaz II .8. Ouvrages gaz à réhabiliter II. 9. Ouvrages à inspecter II. 10 . Plan Infrastructure II.1 1. Dotation par équipement du Centre National de surveillance II.12 . Prévisions d’acquisition d'équipements pour les besoins d'exploitation II.13 .Travaux de déviation des gazoducs Haute Pression II.1 4. Ouvrages en idée de projet non décidés III. BILAN 2005 – 201 6 ET PERSPECTIVES 201 7 -202 7 III.1. Evolution du transit sur la période 2005 -2026 III.2. Historique et perspectives de développement du ré seau sur la période 2005 – 202 7 ANNEXES Annexe 1 : Ouvrages mis en gaz en 201 6 Annexe 2 : Distributions Publiques gaz en cours de réalisation Annexe 3 : Distributions Publiques gaz non entamées Annexe 4 : Renforcements de la capacité des postes DP gaz Annexe 5 : Point de situation sur le RAR au 30/04/2017 Annexe 6 : Fibre optique sur gazoducs REFERENCE Page 2 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 INTRODUCTION : Ce document a pour objet de donner le programme de développement du réseau du transport de gaz naturel par canalisations de la Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport du Gaz (GRTG) sur la période 2017-2027. -

Sustainable Tourism, a Priority Challenge
Editorial JEAT nr.1/2018 Sustainable tourism, a priority challenge Sustainable development plays a vital role in on long term economic, ecologic and social-cultural equilibrium of the destinations and allows tourism to contribute to certain global problems. The tourism and recreation sector is submitted to economic, social, environmental and political processes that transform organization and its practices, either in residential, mobility, consumption, technologies, finance field... These evolutions and contradictions belong to a series of profound changes that need to renew the analyses frame. At its turn, knowledge produced in the tourism field opens ways towards other aspects (work, territory, migration, culture, etc.). On the other hand, tourism has a considerable effect upon environment. It is estimated that it will produce a significant proportion of gas with greenhouse effect at worldwide level (approximately 5%). Transportation and accommodation, consumption of „natural” spaces and landscapes are included among the causes of adverse effects. A destination that does not take into consideration the principles of sustainable development will become on short term a place that will not be visited. That is why, taking into account sustainable development approach in the field of tourism industry, it is essential to assure integrated management of territories, in harmony with environment and communities, as well as to assure resource serviceability and a better life quality. We must add that sustainable tourism improves the image of a destination on international level. That is why sustainable tourism is a priority at present. Director of the publication, Full Prof. Romulus GRUIA, PhD, PhD supervisor Journal of EcoAgriTourism Vol. 14, no.1, 2018 SUMMARY Editorial : SUSTAINABLE TOURISM, A PRIORITY CHALLENGE – GRUIA Romulus 5 INVASIVE KNOTWEED SPECIES AS A RICH SOURCE OF ANTIOXIDANTS L. -

Flora and Ethnobotany of Medicinal Plants in the Southeast of the Capital of Hodna (Algeria)
Arabian Journal of Medicinal & Aromatic Plants Flora and ethnobotany of medicinal plants Vol 1, No 1 (2015) Flora and ethnobotany of medicinal plants in the southeast of the capital of Hodna (Algeria) Sarri Madania,b*, Boudjelal Amelc, Hendel Nouic, Sarri Djamela, Benkhaled Abderrahimc aDépartement des Sciences de la Nature et de la Vie, Faculté des Sciences, Université de M’sila, BP. 166 Ichbilia, M'sila 28000, Algérie. bLaboratoire de Phytothérapie Appliquée Aux Maladies Chroniques, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Sétif1, El-Bez, Sétif 19000, Algérie. cDépartement de Microbiologie et Biochimie, Faculté des Sciences, Université de M’sila, BP. 166 Ichbilia, M'sila 28000, Algérie. Received: July 11th, 2015; Accepted: August 10th, 2015 Abstract: Floristic and ethnobotanical studies conducted in the southeast in the capital of Hodna (Bou Saada, El Hamel, Ben Srour, M'Cif, Ain El Melh, Ain Rich, El Houamed, Mohamed Boudiaf, Ain Fares, Ouled Slimane, Zarzour, Oultem and Sidi M’hamed) is to achieve an inventory of medicinal plants and gathering as much information on the therapeutic uses practiced in the study area. Using the 250 question cards, ethnobotanical surveys were conducted in the study area (18 women and 16 men of different ages). The therapeutic uses practiced by local people, have allowed us to identify a number of 41 species of medicinal flora belonging to 24 botanical families and 37 genera, with a relative importance of the family Lamiaceae. The majority of remedies are prepared as a decoction, and all diseases untreated, digestive disorders are the most cited diseases. Keywords: Ethnobotany - Medicinal Plants - M'sila (Algeria) - Questionnaires cards Introduction The province of M’sila called capital of Hodna offers a remarkable floristic and ecological diversity, the value of this heritage flora, especially in terms of floristic research studies, ecology, medicinal and ethnobotanical plants is essential (Kaâbeche 1996, Zedam et al., 2015).