Francia. Band 42
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
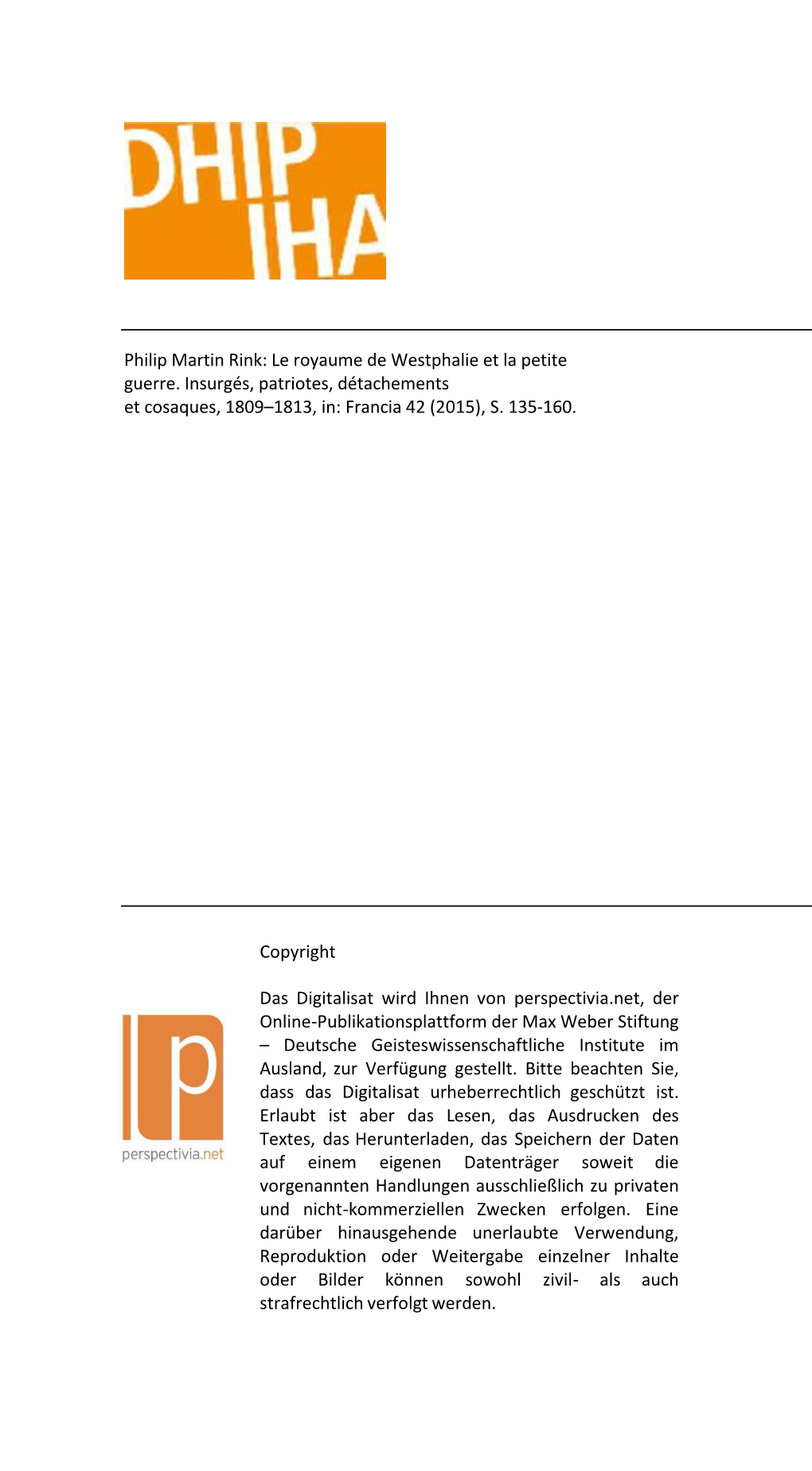
Load more
Recommended publications
-

Denmark and the Duchy of Schleswig 1587-1920
Denmark and the Duchy of Schleswig 1587-1920 The making of modern Denmark The Duchy of Schleswig Hertugdømmet Slesvig Herzogthum Schleswig c. 1821 The President’s Display to The Royal Philatelic Society London 18th June 2015 Chris King RDP FRPSL 8th July 1587, Entire letter sent from Eckernförde to Stralsund. While there was no formal postal service at this time, the German Hanseatic towns had a messenger service from Hamburg via Lübeck, Rostock, Stettin, Danzig and Königsberg to Riga, and this may have been the service used to carry this letter. RPSL Denmark and the Duchy of Schleswig 1587-1920 The Duchy of Schleswig: Background Speed/Kaerius, 1666-68, from “A Prospect of the Most Famous Parts of the World” The Duchies of Slesvig (Schleswig in German) and Holstein were associated with the Danish Crown from the 15th century, until the Second Schleswig War of 1864 and the seizure by Prussia and Austria. From around 1830 sections of the population began to identify with German or Danish nationality and political movements followed. In Denmark, the National Liberal Party used the Schleswig question as part of their programme and demanded that the Duchy be incorporated in the Danish kingdom under the slogan “Denmark to the Eider". This caused a conflict between Denmark and the German states, which led to the Schleswig-Holstein Question of the 19th century. When the National Liberals came to power in Denmark, in 1848, it provoked an uprising of ethnic Germans who supported Schleswig's ties with Holstein. This led to the First Schleswig War. Denmark was victorious, although more through politics than strength of arms. -

Enriching Knowledge Series for Junior Secondary History Revised
Enriching Knowledge Series for Junior Secondary History Revised Curriculum: War and History: New perspectives to Study the Military History (Lecture 4) “War and Society” (New) CDI020191048 27 May 2019 Dr MAK King-sang Ricardo Assistant Professor, Department of History, Hong Kong Baptist University Personal, Social and Humanities Education Section, EDB 1 War and Society: With Reference to 19 th Century Prussia/Germany Ricardo K. S. Mak Hong Kong Baptist University Why War? • The craving for power which characterizes the governing class in every nation is hostile to any limitation of the national sovereignty. This political power-hunger is wont to batten on the activities of another group, whose aspirations are on purely mercenary, economic lines. I have specially in mind that small but determined group, active in every nation, composed of individuals who, indifferent to social considerations and restraints, regard warfare, the manufacture and sale of arms, simply as an occasion to advance their personal interests and enlarge their personal authority. (Einstein to Freud, 30 July, 1932) Some Basic Questions • Who wage war and why? • Who actually fight in war and why? • How to wage war successfully? The Elements of War • Technology, manpower and resources • Tactics: the art of organizing an army, and using weapons or military units in combination against the enemy in military encounters • Operational art: a component of military art concerned with the theory and practice of planning, preparing, conducting, and sustaining campaigns and major operations aimed at accomplishing strategic or operational objectives in each theatre • Strategy: the art of organizing an army, using weapons or military units in combination, employing resources, mobilizing the people, etc. -

Ferdinand Von Schill!:MT-Muster 2005 10.04.09 13:47 Seite 168
Ferdinand von Schill!:MT-Muster 2005 10.04.09 13:47 Seite 168 PETER REISSIG Ich war Ferdinand von Schill Großes gewollt zu haben ist groß Zum 200. Todestag am 31. Mai 2009 as heißt, „Ich war“? Da behauptet der Schreiber eines den Rückseiten den eine Schlange packenden Adler dar. Die historischen Romans, Ferdinand von Schill sei 1806 Schlange symbolisiert die französische Fremdherrschaft. Wbei Jena und Auerstedt gefallen, ein anderer habe sei- Natürlich spielte der Erzfeind Frankreich Anfang des 20. ne Uniform übergezogen, sich als dieser ausgegeben und die Jahrhunderts schon wieder eine Rolle – z.B. in der Kolonial - Heldentaten vollbracht! politik – und der Kaiser glaubte gut daran zu tun, die Erinne- Als Befreiungskriege bezeichnet man geläufig die Erhebun- rung an die Gräueltaten der französischen Okkupanten, aber gen gegen die napoleonische Fremdherrschaft in den Jahren auch deren Niederlage 1813 wach zu halten. 1813 bis 1815. Die vernichtende Niederlage Napoleons nach Das Königreich Sachsen prägte zur Jahrhundertfeier der dem Rußlandfeldzug ermutigte die unter französischem Joch Völkerschlacht bei Leipzig eine 3-Mark-Münze (s. Abb. 3) leidenden Völker Europas, ihre Kräfte zu vereinen, um in den mit dem Bild des nach 15-jähriger Baudauer 1913 eingeweih- Oktobertagen 1813 bei Leipzig den entscheidenden und 1815 ten Denkmals zu Ehren der über 120.000 gefallenen Solda- bei Waterloo endgültigen Sieg zu erringen. ten. Abb. 1: Preußische Medaille 1913, „Frisch auf mein Volk! Die Flammen- Abb. 3: Sachsen, 3 Mark 1913, Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig, Kat. zeichen rauchen“ (Foto: Caspar) Jäger 140 (Foto: Autor) Numismatische Referenzen – die Befreiungskriege betref- Es kam schon einige Jahre vor den eigentlichen Befreiungs- fend – gibt es genügend, während die massiven Volkserhebun- kriegen – nach der Machtübernahme Napoleons – in deutschen gen vor dieser Zeit offensichtlich weniger als Vorlage für Mün- Ländern zu Erhebungen gegen die französische Fremdherrschaft. -

Official Journal C 72
ISSN 1725-2423 Official Journal C72 of the European Union Volume 51 English edition Information and Notices 18 March 2008 Notice No Contents Page IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES Commission 2008/C 72/01 Names and addresses of the Management and Scientific Authorities designated by the Member States in accordance with Article IX(1) of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and referred to in Article 13(1) of Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein . .... 1 2008/C 72/02 Places of introduction and export designated by Member States for Trade with third countries in accordance with Article VIII (3) of the Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora and referred to in Article 12 of Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996, on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein . .... 52 EN Price: EUR 18 18.3.2008 EN Official Journal of the European Union C 72/1 IV (Notices) NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES COMMISSION Names and addresses of the Management and Scientific Authorities designated by the Member States in accordance with Article IX(1) of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and referred to in Article 13(1) of Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating -

THE BATTLE of WATERLOO in GERMAN and BRITISH MEMORY, 1815-1915 Kevin Pryor Southern Illinois University Carbondale, [email protected]
Southern Illinois University Carbondale OpenSIUC Theses Theses and Dissertations 8-1-2010 THE MOBILIZATION OF MEMORY: THE BATTLE OF WATERLOO IN GERMAN AND BRITISH MEMORY, 1815-1915 Kevin Pryor Southern Illinois University Carbondale, [email protected] Follow this and additional works at: http://opensiuc.lib.siu.edu/theses Recommended Citation Pryor, Kevin, "THE MOBILIZATION OF MEMORY: THE BATTLE OF ATERW LOO IN GERMAN AND BRITISH MEMORY, 1815-1915" (2010). Theses. Paper 312. This Open Access Thesis is brought to you for free and open access by the Theses and Dissertations at OpenSIUC. It has been accepted for inclusion in Theses by an authorized administrator of OpenSIUC. For more information, please contact [email protected]. THE MOBILIZATION OF MEMORY: THE BATTLE OF WATERLOO IN GERMAN AND BRITISH MEMORY, 1815-1915 by Kevin Pryor B.A., Millikin University, 1999 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Arts Degree Department of History in the Graduate School Southern Illinois University Carbondale August 2010 Copyright by Kevin Pryor, 2010 All Rights Reserved THESIS APPROVAL THE MOBILIZATION OF MEMORY: THE BATTLE OF WATERLOO IN GERMAN AND BRITISH MEMORY, 1815-1915 By Kevin Pryor A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in the field of History Approved by: S. Jonathan Wiesen, Chair Joseph Sramek Theodore R. Weeks Graduate School Southern Illinois University Carbondale June 28, 2010 AN ABSTRACT OF THE THESIS OF KEVIN PRYOR, for the Master of Arts degree in HISTORY, presented on JUNE 28, 2010, at Southern Illinois University Carbondale. -

Der Aufstands-Dörnberg
Der Aufstands-Dörnberg Zu seiner Rolle im Widerstand gegen Jérôme Bonaparte vor 200 Jahren. von Hans Günther Bickert Im Rahmen der Neubewertung des Königreichs Westphalen (1807-1813), deren neueste Ergebnisse ein opulenter Begleitband zur Hessischen Landesausstellung 2008 in Kassel dokumentiert1, gilt das Interesse hauptsächlich den Reformen des „Modellstaates“. Da es sich um ein deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt handelt, wird das Verbindende besonders betont, ohne daß Kritik vermieden würde. In bisher noch nicht gekannter Aus- führlichkeit werden zumeist längst bekannte „Neuerungen von großer und bleibender Bedeutung“2 vorgestellt, oft in neuer Sicht. Die Modernisierung erfolgte in Westphalen nach französischem Muster und war ein Ergebnis von Fremdherrschaft, diese eine Folge militärischer Gewaltanwendung. Wohl in der Erwartung, daß sich letztere in den bilatera- len Beziehungen auf Dauer erledigt hat, wird dieser sensible Bereich schonend behandelt. Das Thema „Militär und Krieg“ gewinnt durch Präsentation zahlreicher schmucker Uni- formen und Accessoires bei sparsamer Visualisierung der Desastres de la guerra in fer- nen Ländern ästhetischen Reiz: Man erfährt einiges von den Feldzügen in Spanien und Rußland, aber vergleichsweise wenig von den Vorgängen in Westphalen. Nur eine kleine Vitrine war der Insurrektion von 1809 vorbehalten. Ein aus Braunschweig stammendes Ölbild des Anführers in farbenprächtiger Uniform, geschaffen von einem unbekannten zeitgenössischen Maler nach 1815, diente als Blickfang. Die spärlichen Hinweise -
Prelude War, Culture and Memory
Cambridge University Press 978-0-521-19013-8 - Revisiting Prussia’s Wars Against Napoleon: History, Culture and Memory Karen Hagemann Excerpt More information PRELUDE WAR, CULTURE AND MEMORY In November 1816, an article on the latest exhibition at the Berlin Academy of Arts appeared in the Zeitung f ü r die Elegante Welt. Held one year after the end of the 1813–15 wars against Napoleon, this exhibition was entirely devoted to “patriotic art.” 1 One of the works introduced in the report was the diptych On Outpost Duty – The Wreath-Maker (see Figures 1 and 2 ), painted in 1815 by the Saxon artist Georg Friedrich Kersting, who had joined the artistic group of “Dresden Romanticism” some years before. 2 During and after the wars of 1813–15, Kersting expressed his German-national and early-liberal convictions in his paintings more explicitly than most of his artist friends. 3 When he painted the diptych, the wars against Napoleonic France were coming to an end, and hopes for a German-national rebirth and greater political liberty were running high in the circles of “patriots” 4 to which he belonged: reform-oriented, educated middle- and upper-class civil 1 “Analekten: Die Berliner Akademieausstellung,” ZfeW , no. 228, 19 Nov. 1816. 2 On Kersting’s biography and oeuvre, see also Hannelore G ä rtner , Georg Friedrich Kersting ( Leipzig , 1988 ) ; Werner Schnell , Georg Friedrich Kersting (1785–1847): Das zeichnerische und malerische Werk mit Oeuvrekatalog ( Berlin , 1994 ) ; and Helmut B ö rsch-Supan , “ Kersting, Georg ,” NDB 11 ( 1977 ): 539– -

The Austrian Imperial-Royal Army
Enrico Acerbi The Austrian Imperial-Royal Army 1805-1809 Placed on the Napoleon Series: February-September 2010 Oberoesterreicher Regimente: IR 3 - IR 4 - IR 14 - IR 45 - IR 49 - IR 59 - Garnison - Inner Oesterreicher Regiment IR 43 Inner Oersterreicher Regiment IR 13 - IR 16 - IR 26 - IR 27 - IR 43 Mahren un Schlesische Regiment IR 1 - IR 7 - IR 8 - IR 10 Mahren und Schlesischge Regiment IR 12 - IR 15 - IR 20 - IR 22 Mahren und Schlesische Regiment IR 29 - IR 40 - IR 56 - IR 57 Galician Regiments IR 9 - IR 23 - IR 24 - IR 30 Galician Regiments IR 38 - IR 41 - IR 44 - IR 46 Galician Regiments IR 50 - IR 55 - IR 58 - IR 63 Bohmisches IR 11 - IR 54 - IR 21 - IR 28 Bohmisches IR 17 - IR 18 - IR 36 - IR 42 Bohmisches IR 35 - IR 25 - IR 47 Austrian Cavalry - Cuirassiers in 1809 Dragoner - Chevauxlégers 1809 K.K. Stabs-Dragoner abteilungen, 1-5 DR, 1-6 Chevauxlégers Vienna Buergerkorps The Austrian Imperial-Royal Army (Kaiserliche-Königliche Heer) 1805 – 1809: Introduction By Enrico Acerbi The following table explains why the year 1809 (Anno Neun in Austria) was chosen in order to present one of the most powerful armies of the Napoleonic Era. In that disgraceful year (for Austria) the Habsburg Empire launched a campaign with the greatest military contingent, of about 630.000 men. This powerful army, however, was stopped by one of the more brilliant and hazardous campaign of Napoléon, was battered and weakened till the following years. Year Emperor Event Contingent (men) 1650 Thirty Years War 150000 1673 60000 Leopold I 1690 97000 1706 Joseph -

Archiv- Und Literaturverzeichnis
Archiv- und Literaturverzeichnis 1. Archivverzeichnis 1.1. Archives nationales, Paris (= AN Paris) AF IV Secrétairerie d’État: relations extérieures (1802–1813) 29 AP Archives privées. Don de M. le comte Roederer 40 AP Archives privées. Papiers du comte Claude Beugnot, préfet, directeur de la police, ministre de la marine et du comte Arthur Beugnot, membre de l’Institut BB11 Ministère de la Justice. Naturalisation, changements de noms, dispenses de mariage, autorisations de servir à l’étranger, successions aux titres et aux majorats 1.2. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin (= GStA PK) I. HA, Rep. 91 C AktendesZivilgouvernementszwischenElbeund Weser V. HA, Königreich Westphalen Akten des Staatssekretariats und des Ministeriums des Äußern Akten des Justizministeriums Akten des Innenministeriums Akten des Finanzministeriums Akten der Generaldirektion des öffentlichen Unterrichts Akten der Polizeipräfektur zu Kassel Akten der Verwaltung der Hohen Polizei 1.3. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Außenstelle Wernigerode (= Lha S-A, Wernigerode) B18 AktenderPräfekturdesElbdepartements B26 AktenderPräfekturdesSaaledepartements 1.4. Stadtarchiv Magdeburg (= StaM) AI Akten des Magistrats der Altstadt AII AktenderMagistratsderAltstadtII 1.5. Service historique de l’armée de terre, Vincennes (= SHAT Vincennes) 1M Reconnaissances et mémoires 1.6. Hessisches Staatsarchiv Marburg (= StA MR) Best. 75 Akten des Innenministeriums, Akten der Generaldirektion des öffent- lichen Unterrichts Best. 76a Akten der Präfektur des Fuldadepartements Best. 77a Akten der Präfektur des Werradepartements Best. 265 Westphälische Justizbehörden 526 Archiv- und Literaturverzeichnis 1.7. NiedersächsischesHauptstaatsarchivHannover (= HStAH) Hann. 52 AktendesJustizministeriums Akten des Innenministeriums Akten der Generaldirektion des öffentlichen Unterrichts Akten der Staatspolizei Akten der Präfektur des Leinedepartements Akten der Präfektur des Ockerdepartements Akten der Präfektur des Allerdepartements Akten der Zivilgerichte 1. Instanz im Leinedepartement 1.8. -

Download File
#0# DOI: 10.18276/pz.2018.1-04 PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI ROCZNIK XXXIII (LXII) ROK 2018 ZESZYT 1 A W Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczecinski e-mail: [email protected] STRATEGICZNA ROLA TWIERDZY SZCZECIŃSKIEJ PODCZAS WOJNY W LATACH 1806–1807 Słowa kluczowe: dzieje Szczecina, historia wojskowości, wojny napoleońskie Keywords: the history of Szczecin, the history of Military Science, Napoleonic Wars W napoleońskim systemie prowadzenia wojny twierdze odgrywały ważną rolę jako „oparcie dla manewru”, zabezpieczenie linii komunikacyjnych armii, stawały się „ośrodkami operacji”, miejscem gromadzenia rezerw i zaopatrzenia wojsk (magazyny i sprzęt)1. W artykule przedstawiono rolę twierdzy szczeciń- skiej w koncepcjach Napoleona i ich realizacji w okresie od końca października 1806 roku do sierpnia 1807 roku, zamykającego bezpośrednie działania wojenne wokół Szczecina. Fakt, że na interesującym nas obszarze nie doszło do spekta- kularnych walk i oblężeń, jak w przypadku Gdańska, Kołobrzegu, Grudziądza oraz twierdz śląskich, wpłynął na mniejsze zainteresowanie badaczy działaniami wojennymi na Pomorzu Zachodnim2. Tymczasem liczba rozkazów i dyspozycji zawarta w Korespondencji Napoleona3 z tego okresu świadczy o wadze przypisy- wanej twierdzy Szczecin. W literaturze przedmiotu sygnalizowaną problematykę 1 M. Kukiel, Wojny napoleońskie, Warszawa 1927, s. 7, 298. 2 W niniejszym opracowaniu przyjęto współczesne nazewnictwo: Pomorze Zachodnie, mając świadomość braku precyzji posługiwania się tym terminem dla omawianych czasów. 3 Correspondance de Napoleon I-er. Publiee par ordre de l’Empereur Napoleon III, t. XIII, XIV, XV, Paris 1863–1864. 100 Adam Wątor opracowano w syntetycznych publikacjach poświęconych wojnie francusko-pru- sko-rosyjskiej w latach 1806–1807. Na plan pierwszy wysuwają się klasyczne opracowanie niemieckie na czele z E. Höpfnerem4 i O. -
Waar Is Schills Hoofd Gebleven? Nederlands-Duitse Culturele Uitwisseling in De Lange Achttiende Eeuw
GER-MANIE WWW.18E-EEUW.NL 5 GER-MANIE Waar is Schills hoofd gebleven? Nederlands-Duitse culturele uitwisseling in de lange achttiende eeuw Hanco Jürgens en Inger Leemans Het eerste dat de beroemde Duitse reiziger Ludolf Wienbarg vroeg toen hij in Leiden aankwam was ‘wo habt ihr Schill’s Kopf’? Waar is het hoofd van Ferdinand von Schill? De opzichters van het Leidse anatomische kabinet moesten het antwoord schuldig blijven: ‘Er ist seit einigen Jah- ren aus der Anatomie verschwunden, man weiß nicht wie, durch wen und wohin; vermuthlich hat ihn Jemand gestohlen’. ‘Das ist gut’, antwoordde Wienbarg, ‘so brauche ich nicht der Dieb zu sein’.1 Het zal niet vaak gebeurd zijn dat men in anatomische verzamelingen navraag kwam doen naar geprepareerd fysisch materiaal, dat immers doorgaans van criminelen of landlopers was. Maar Schill was een ander verhaal. Ferdinand von Schill was een Duitse militair die in 1809 een opstand tegen Napoleon ontketende in het noorden van Duitsland. Het lukte hem zelfs om met meer dan duizend medestanders Stralsund te bezetten. De opstand was – helaas? – geen lang leven beschoren: al snel werden de opstandelingen uit de stad geveegd door de ‘Franse’ leger- macht van Napoleon, die voor een groot deel uit Nederlanders en Denen bestond.2 Het hoofd van de gesneuvelde Schill werd op bevel van de Franse veldheer door een Nederlandse Officier van Gezondheid van zijn romp gescheiden en op sterk water gezet, waarna het als oorlogstrofee aan Lodewijk Napoleon aangeboden zou worden. Die moest echter niets hebben van dit soort barbarij en zo kwam dit Duitse hoofd als oorlogsresidu in Leiden terecht, onder de hoede van ‘professor in alles’ Sebald Brugmans – de lijfarts van Lodewijk Napoleon.3 Brugmans zou het hoofd in de collectie van het anatomisch museum hebben opgenomen, volgens Wienbarg ‘in eine Spiritusflasche gesetzt, unter Mißgeburten’. -
Prowokacja Partyzanta Schilla W Gdańsku W 1809 R. \
WŁADYSŁAW ZAJEWSKI Prowokacja partyzanta Schilla w Gdańsku w 1809 r. \ 1. Konflikt austriacko-francuski w 1809 r. Austria nigdy nie pogodziła się z klęską 1805 roku i warunkami po koju w Preszburgu. Na przełomie 1808/1809 r. Wiedeń ogarnięty został gorączką nacjonalizmu i odwetu Fryderyk Gentz organizował europej ską elitę kontrrewolucyjną przeciw „korsykańskiemu uzurpatorowi”. Dworska kamaryla wojenna, inspirowana przez kanclerza Filipa Šta dióna i austriacki sztab generalny, zasilane finansowo przez Anglię, pu blicznie nawoływały do rewanżu 2. Napoleon był w trudnej sytuacji. Nie powodzenia wojenne w Hiszpanii mocno nadszarpnęły jego autorytet, szczególnie w Niemczech. Austria się zbroiła 3. Prusy były arcyniepewne i po cichu też pragnęły wojny. Anglicy wylądowali w Portugalii. W sa mej Francji podziemne spiski rojalistyczne, bądź jakobińskie napawały troską cesarza. Austria zamierzała wykorzystać zaangażowanie Francji w Hiszpanii uderzając zbrojnie w południowych Niemczech i północ nych Włoszech, w Chorwacji i w Księstwie Warszawskim. Napoleon żywił złudzenia, że jego sojusznik z Erfurtu, car Aleksan der I, czynnie wystąpi przeciw Austrii, co sparaliżuje zapędy wojenne Wiednia i pozwoli utrzvmac system równowagi osiągnięty w Tylży. Austriacki plan kampanii wojennej zakładał co najmniej życzliwą posta wę Rosji. Lecz główne nadzieje wiązała' Austria z Prusami. To państwo, upokorzone i potężnie okrojone w Tylży, dotknięte kontrybucją i jawną pogardą Napoleona, miało w planach austriackich szczególne miejsce. W Wiedniu liczono, że uda się wciągnąć Prusy do wojny za cenę przeka zania im ziem Księstwa Warszawskiego4. Tuż przed rozpoczęciem dzia łań wojennych wysłannik Štadióna baron Wessenberg w piśmie z 12 mar ca 1809 proponował w imieniu Franciszka I zwrot zabranych Prusom w Tylży ziem polskich, pod warunkiem czynnego wystąpienia przeciw Francji.