Jbaivi. Jobard
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Grosvenor Prints CATALOGUE for the ABA FAIR 2008
Grosvenor Prints 19 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JN Tel: 020 7836 1979 Fax: 020 7379 6695 E-mail: [email protected] www.grosvenorprints.com Dealers in Antique Prints & Books CATALOGUE FOR THE ABA FAIR 2008 Arts 1 – 5 Books & Ephemera 6 – 119 Decorative 120 – 155 Dogs 156 – 161 Historical, Social & Political 162 – 166 London 167 – 209 Modern Etchings 210 – 226 Natural History 227 – 233 Naval & Military 234 – 269 Portraits 270 – 448 Satire 449 – 602 Science, Trades & Industry 603 – 640 Sports & Pastimes 641 – 660 Foreign Topography 661 – 814 UK Topography 805 - 846 Registered in England No. 1305630 Registered Office: 2, Castle Business Village, Station Road, Hampton, Middlesex. TW12 2BX. Rainbrook Ltd. Directors: N.C. Talbot. T.D.M. Rayment. C.E. Ellis. E&OE VAT No. 217 6907 49 GROSVENOR PRINTS Catalogue of new stock released in conjunction with the ABA Fair 2008. In shop from noon 3rd June, 2008 and at Olympia opening 5th June. Established by Nigel Talbot in 1976, we have built up the United Kingdom’s largest stock of prints from the 17th to early 20th centuries. Well known for our topographical views, portraits, sporting and decorative subjects, we pride ourselves on being able to cater for almost every taste, no matter how obscure. We hope you enjoy this catalogue put together for this years’ Antiquarian Book Fair. Our largest ever catalogue contains over 800 items, many rare, interesting and unique images. We have also been lucky to purchase a very large stock of theatrical prints from the Estate of Alec Clunes, a well known actor, dealer and collector from the 1950’s and 60’s. -

James Reed Collection - Ephemera Reed Collection
Fairfield University DigitalCommons@Fairfield The Artist Collects: Highlights from the James The Artist Collects: Highlights from the James Reed Collection - Ephemera Reed Collection Spring 2019 The Artist Collects: Highlights from the James Reed Collection Wall Labels Fairfield University Art Museum Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fairfield.edu/reed-ephemera Recommended Citation Fairfield University Art Museum, "The Artist Collects: Highlights from the James Reed Collection Wall Labels" (2019). The Artist Collects: Highlights from the James Reed Collection - Ephemera. 1. https://digitalcommons.fairfield.edu/reed-ephemera/1 This item has been accepted for inclusion in DigitalCommons@Fairfield by an authorized administrator of DigitalCommons@Fairfield. It is brought to you by DigitalCommons@Fairfield with permission from the rights- holder(s) and is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses, you need to obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/or on the work itself. For more information, please contact [email protected]. William Alfred Delamotte (British, 1775-1863) Landscape with Men and Dogs Resting Under a Tree, from the portfolio Specimens of Polyautography (London, 1803), 1802 Pen and ink lithograph Promised gift from James Reed This landscape was one of the first artists’ lithographs ever published. In a clever bid to market the new process, the director of Senefelder’s London press, Philip André, sent free stones and instructions to a number of prominent English artists. -

Download Report 2010-12
RESEARCH REPORt 2010—2012 MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE Max Planck Institute for the History of Science Cover: Aurora borealis paintings by William Crowder, National Geographic (1947). The International Geophysical Year (1957–8) transformed research on the aurora, one of nature’s most elusive and intensely beautiful phenomena. Aurorae became the center of interest for the big science of powerful rockets, complex satellites and large group efforts to understand the magnetic and charged particle environment of the earth. The auroral visoplot displayed here provided guidance for recording observations in a standardized form, translating the sublime aesthetics of pictorial depictions of aurorae into the mechanical aesthetics of numbers and symbols. Most of the portait photographs were taken by Skúli Sigurdsson RESEARCH REPORT 2010—2012 MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE Max Planck Institute for the History of Science Introduction The Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) is made up of three Departments, each administered by a Director, and several Independent Research Groups, each led for five years by an outstanding junior scholar. Since its foundation in 1994 the MPIWG has investigated fundamental questions of the history of knowl- edge from the Neolithic to the present. The focus has been on the history of the natu- ral sciences, but recent projects have also integrated the history of technology and the history of the human sciences into a more panoramic view of the history of knowl- edge. Of central interest is the emergence of basic categories of scientific thinking and practice as well as their transformation over time: examples include experiment, ob- servation, normalcy, space, evidence, biodiversity or force. -

The Missing Saxophone Recovered(Updated)
THE MISSING SAXOPHONE: Why the Saxophone Is Not a Permanent Member of the Orchestra by Mathew C. Ferraro Submitted to The Dana School of Music in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Music in History and Literature YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY May 2012 The Missing Saxophone Mathew C. Ferraro I hereby release this thesis to the public. I understand that this thesis will be made available from the OhioLINK ETD Center and the Maag Library Circulation Desk for public access. I also authorize the University or other individuals to make copies of this thesis as needed for scholarly research. Signature: ____________________________________________________________ Mathew C. Ferraro, Student Date Approvals: ____________________________________________________________ Ewelina Boczkowska, Thesis Advisor Date ____________________________________________________________ Kent Engelhardt, Committee Member Date ____________________________________________________________ Stephen L. Gage, Committee Member Date ____________________________________________________________ Randall Goldberg, Committee Member Date ____________________________________________________________ James C. Umble, Committee Member Date ____________________________________________________________ Peter J. Kasvinsky, Dean of School of Graduate Studies Date Abstract From the time Adolphe Sax took out his first patent in 1846, the saxophone has found its way into nearly every style of music with one notable exception: the orchestra. Composers of serious orchestral music have not only disregarded the saxophone but have actually developed an aversion to the instrument, despite the fact that it was created at a time when the orchestra was expanding at its most rapid pace. This thesis is intended to identify historical reasons why the saxophone never became a permanent member of the orchestra or acquired a reputation as a serious classical instrument in the twentieth century. iii Dedicated to Isabella, Olivia & Sophia And to my father Michael C. -

Neo-Gothic 2014 30/10/2015 19:07 Page1
Primer N°5 couv Neo-Gothic_2014 30/10/2015 19:07 Page1 Each volume in the series of “primers” introduces primer SERMONS | 1 one genre of medieval manuscripts to a wider Laura Light primer | 5 audience, by providing a brief, general ALCHEMY primer | 2 introduction, followed by descriptions of the Lawrence M. Principe and Laura Light manuscripts and accompanied by other useful information, such as glossaries and suggestions LAW primer | 3 for further reading. Susan L’Engle and Ariane Bergeron-Foote Medieval-like books and manuscripts from the BESTSELLERS primer | 4 late eighteenth to the early twentieth centuries Pascale Bourgain tend to get lost in the shuffle. They are not and Laura Light taken seriously by medievalists, because they NEO-GOTHIC primer | 5 LES ENLUMINURES LTD. postdate the Middle Ages; and they are not Sandra Hindman 23 East 73rd Street assimilated in a history of “modern” book with Laura Light 7th Floor, Penthouse New York, NY 10021 production, because they are anachronistic. MANUSCRIPT primer | 6 PRODUCTION Tel: (212) 717 7273 There are a great many of them. Examining a Fax: (212) 717 7278 group of just such medieval-like books, this Richard H. Rouse [email protected] and Laura Light Primer provides a short introduction to a complex subject: how artists, scribes, and DIPLOMATICS LES ENLUMINURES LTD. NEO-GOTHIC primer | 7 publishers in France, England, Germany, and the Christopher de Hamel 2970 North Lake Shore Drive Book Production and Medievalism and Ariane Bergeron-Foote Chicago, IL 60657 United States used the remote medieval past to _____________________________ Tel: (773) 929 5986 articulate aesthetic principles in the book arts at Fax: (773) 528 3976 the dawn of the modern era. -

Pierre-Joseph Proudhon Et Marcellin Jobard, La Notion De Propriété À L’Ère De La Reproductibilité Technique1
Pierre-Joseph Proudhon et Marcellin Jobard, la notion de propriété à l’ère de la reproductibilité technique1 Nicolas Devigne, Maître de conférences en arts plastiques, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Résumé : En 1840, Proudhon est entré en scène avec une fulgurante formule : « La propriété, c’est le vol ». Traumatisant plusieurs générations de Français et d'Européens, ce « mot-brûlot »2 a collé à la peau du philosophe sans que l’on cherche pour autant à comprendre son raisonnement. Ainsi que l’a démontré Chantal Gaillard, il ne s’agit pas pour Proudhon « d’attaquer la propriété mais [de] la conserver, après l'avoir réformée, en tant que support de la liberté » ; « retenir ses imprécations contre la propriété-vol capitaliste » et ne pas tenir compte de ses éloges de la « propriété-liberté mutualiste » revient à passer à côté de l’essentiel3. Pour éclairer cette distinction, envisageons ici l’idée de « possession » hors de la sphère du foncier, sur le terrain de la propriété intellectuelle. Mots-clés : Propriété intellectuelle, art, industrie, techniques de reproductibilité, photographie. « La propriété, c’est le vol »4 ; l’aphorisme proudhonien, contemporain de la naissance de la photographie, s’inscrit dans un contexte particulier, celui de l’essor des nouvelles techniques de reproductibilité, une voie dans laquelle le progrès technique se conjugue avec la démocratisation de l’art. 1 Cet article évoque dans les grandes lignes les notions développées dans l’ouvrage que nous avons consacré à Proudhon : Devigne, N. (dir.), Proudhon par l’image. dans l’intimité de l’homme public, Estampes, photographies, peintures. Ouvrage collectif; en coll. -

Award Komask Npo Masters Printmaking 2018
Award KoMASK NPO Masters Printmaking 2018 EXPOSITION LANGE ZAAL ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS ANTWERP Venusstraat 36 2000 Antwerp - Belgium 24/04/2018 > 06/05/2018 Private view for the attending Masters of 2017 and delegates of participating academies Demonstration of the Printmaking students KASKA 6 7 Masters Printmaking 2018 This is the second edition of the Masters Printmaking Award, con- taining twelve European Academies and one of the United States. The thirteen participating institutions are: Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles, Académie La Cambre Bruxelles, Kuvataideakatemia Helsinki, Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki Krakowie, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, Central Saint Martin’s College of Art and Design London, Royal College of Art London, Akademie der Bildende n Künste München, Universidad de complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, Pennsylvania Academy of Fine Arts, Accademia di Belle Arti di Roma, Kungliga Kosthögskolan Stockholm. Every academy was asked to select indepen- dently three graduated masters printmaking of the year 2017. The nominees could participate with three works each. We created a catalogue in which every academy has an introduc- tory page, which is followed by the works, submitted by their for- mer students. Not all academies nominated three masters though. Parallel to the Masters Printmaking event, it is our intention to yearly introduce the graphic work of the teaching staff from one of the participating academies. This year we are showing the works of the printmaking staff of the Académie Royale de Bruxelles. A part of the catalogue edition is a bibliophilic edition. -

Antique Polychromy Applied to Modern Art and Hittorff's Saint
Vincentian Heritage Journal Volume 32 Issue 2 Article 5 Summer 10-12-2015 Antique Polychromy Applied to Modern Art and Hittorff’s Saint Vincent de Paul in Paris, the Architectural Showpiece of the Renouveau Catholique Michael Kiene Ph.D. Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/vhj Recommended Citation Kiene, Michael Ph.D. (2015) "Antique Polychromy Applied to Modern Art and Hittorff’s Saint Vincent de Paul in Paris, the Architectural Showpiece of the Renouveau Catholique," Vincentian Heritage Journal: Vol. 32 : Iss. 2 , Article 5. Available at: https://via.library.depaul.edu/vhj/vol32/iss2/5 This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentian Heritage Journal by an authorized editor of Via Sapientiae. For more information, please contact [email protected]. 1 Antique Polychromy Applied to Modern Art and Hittorff’s Saint Vincent de Paul in Paris, the Architectural Showpiece of the Renouveau Catholique MICHAEL KIENE, PH.D. Q Q Q Q QQ Q QQ QQ Q QQ QQ Q QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q previous Q next Q BACK TO CONTENTS Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q article Q article Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q acques-Ignace Hittorff (born Karl Jakob Hittorf, 1792-1867) realized one of the most remarkable artistic careers of the nineteenth century. -

Marcellin Jobard Et Le Musée Royal De L'industrie De Bruxelles
Artefact Techniques, histoire et sciences humaines 5 | 2016 Musées éphémères, musées imaginaires, musées perdus Marcellin Jobard et le Musée royal de l’Industrie de Bruxelles Marcellin Jobard and the Musée royal de l’Industrie in Brussels Marie-Christine Claes Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/artefact/630 DOI : 10.4000/artefact.630 ISSN : 2606-9245 Éditeur : Association Artefact. Techniques histoire et sciences humaines, Presses universitaires du Midi Édition imprimée Date de publication : 15 juin 2017 Pagination : 59-75 ISBN : 978-2-7535-6525-8 ISSN : 2273-0753 Référence électronique Marie-Christine Claes, « Marcellin Jobard et le Musée royal de l’Industrie de Bruxelles », Artefact [En ligne], 5 | 2016, mis en ligne le 15 novembre 2017, consulté le 04 mars 2020. URL : http:// journals.openedition.org/artefact/630 ; DOI : https://doi.org/10.4000/artefact.630 Artefact. Techniques, histoire et sciences humaines Marcellin Jobard et le Musée royal de l’Industrie de Bruxelles Marie-Christine CLAES * Résumé En 1826, est créé à Bruxelles un « Conservatoire des Arts et Métiers ». Le premier directeur, Jacob Canzius-Onderdewijngaart, constructeur d’instruments scientifiques à Delft, y intègre sa propre collection. À partir de 1841, Marcellin Jobard, directeur de journaux, ancien lithographe et premier photographe belge, dirige le désormais « Musée royal de l’industrie » et publie son Bulletin, qui touche un large public belge et étranger. Hélas ! après sa mort en 1861, on vend une partie des collections et le reste est annexé à une école industrielle. La plupart des objets ont aujourd’hui disparu. Heureusement, l’astronome Adolphe Quetelet, membre de la commission administra- 59 tive du musée, avait fait déposer en 1841 à l’Observatoire royal de Belgique à Uccle (Bruxelles) une dizaine des plus beaux instruments, aujourd’hui présentés par les Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles. -
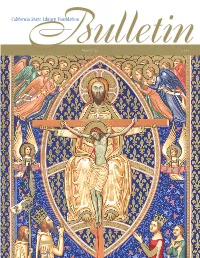
California State Library Foundation Bulletin Is Reproducing an Illuminated Manuscript for His Folio, Status De Published When We Are Able
California State Library Foundation BulletinN u m b e r 8 4 2 0 0 6 California State Library Foundation N u m b e r 8 4 2 0 0 6 EDITOR Bulletin Gary F. Kurutz EDITORIAL ASSISTANT Table of Con T e n T s Kathleen Correia COPY EDITOR 2-10 . The Glories of Chromolithography: M. Patricia Morris Color Plate books during the Victorian era BOARD OF DIRecTORS By John Windle Kenneth B. Noack, Jr. President 11-16 . a “Colored” Mosaic: a Vibrant african american George Basye Community in antebullum san francisco Vice-President By Meredith Eliassen Thomas E. Vinson Treasurer 17-22 . Jerry Kilbride: an appreciation Barbara Campbell By Kevin Starr Secretary 23-26 . California state library Responds to 1906 san Robert Dickover Mead B. Kibbey francisco earthquake and fire Commemoration Allan Forbes Virginia Livingston By Gary F. Kurutz Donald J. Hagerty Thomas Miller J. S. Holliday Sue T. Noack 27-29 . foundation notes Herbert Hunn Marilyn Snider Sandra Swafford Triumph of Helios exhibit Catalog available Joann levy Makes Presentation for Women’s History Month Gary F. Kurutz Julia Schaw A Southern California Album Executive Director Administrative Assistant 30-32 . Recent Contributors Susan Hildreth State Librarian of California Front Cover: Chromolithograph by Godefroy Engelmann The California State Library Foundation Bulletin is reproducing an illuminated manuscript for his folio, Status de published when we are able. © 2004-2006. L’Ordre du Saint-Espirit au Droit Desir (1853). Opinions of the authors are their own and do not necessarily reflect the opinions of their institutions, Back Cover: A plate from Bosqui’s Grapes and Grape Vines of the California State Library or the Foundation. -

J. Paul Getty Trust Report 2018 Art and Science J
J. Paul Getty Trust Report 2018 Art and Science J. Paul Getty Trust Report 2018 On the cover: Macro-XRF scanning of mummy portrait Isidora, AD 100–110. Encaustic on linden wood; gilt; linen. The J. Paul Getty Museum Table of Contents 3 Chair Message Maria Hummer-Tuttle, Chair, Board of Trustees 7 Foreword James Cuno, President and CEO, J. Paul Getty Trust 10 Art and Science 11 Thoughts on Art and Science David Baltimore, President Emeritus and Robert Andrews Millikan Professor of Biology at the California Institute of Technology 15 Getty Conservation Institute Timothy P. Whalen, John E. and Louise Bryson Director 27 Getty Foundation Deborah Marrow, Director 39 J. Paul Getty Museum Timothy Potts, Director 49 Getty Research Institute Andrew Perchuk, Acting Director 59 Trust Report Lists 60 Getty Conservation Institute Projects 72 Getty Foundation Grants 82 Exhibitions and Acquisitions 110 Getty Guest Scholars 114 Getty Publications 122 Getty Councils 131 Honor Roll of Donors 139 Board of Trustees, Officers, and Directors 141 Financial Information Chair Message MARIA HUMMER-TUTTLE, CHAIR, BOARD OF TRUSTEES J. Paul Getty Trust ART AND SCIENCE—the theme of this year’s Trust Time: Art in L.A. 1945–1980, which ran from October Report—merge seamlessly in the Getty’s work of 2011 to April 2012. preserving, protecting, and interpreting the world’s While the majority of PST: LA/LA exhibitions artistic legacy. In the following essays by our four showcased modern and contemporary art, exhibitions program directors, you will learn how these disciplines about the ancient world and the pre-modern era were inform the work of the Getty Conservation Institute, also included. -

Koninklijke Academie Voor Schone Kunsten Antwerpen 1663 — 2013
350 350 1663 — 2013 /Koninklijke Academie Deeltijds voor Schone Kunsten Kunstonderwijs Antwerpen Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen 1663 – 2013 350 jaar deeltijds kunstonderwijs in Antwerpen Inhoudstafel Verwelkoming. 9 Bart’d Eyckermans Onvoltooide beeldenatlas 17 ‘Antwerpen–wereld’. Deel 1: Antwerpen Christian Van Haesendonck Musée imaginaire. 49 Le monde à l’Anvers Frank Verlie Catalogus 69 Index 157 Ateliers 235 Verwelkoming Bart’d Eyckermans Een jubileum vieren is steeds iets vreugdevol maar houdt anderzijds ook iets weemoedigs in. Dit wordt geïllustreerd door de spontaan opborre- lende vraag: ”Is iets ouds beter dan iets jongs?” Zijn de versteende fecaliën van de dinosaurus goede mest? Docent Ludo Lens organiseerde als curator in het begin van het schooljaar 2013-2014 een tentoonstelling, in de reeks vieringen 350 jaar Academie, met als titel “Toekomst is verleden tijd”. Waarschijnlijk duidde de titel niet op een effectieve tijdssingulariteit maar vormde het uiteraard de basis van de filosofische gerichte gedachtegang. Wat wel in de titel, zij het om- floerst, geduid wordt, is de onuitgesproken worsteling van de huidige docenten met de beladenheid waarmee een 350-jarig pedagogisch pro- ject weegt op het functioneren van de huidige equipe. Het verleden wordt, door hen, niet benaderd vanuit een inspiratieloze nostalgie maar als een actieve referentie voor het pedagogisch project van vandaag. De doelstellingen van Teniers waren gericht op kwaliteit die hij wou verhogen door een degelijke tekenopleiding aan te bieden in aanvulling, maar voornamelijk autonoom, aan de ambachtelijke opleiding georgani- seerd door de gilden. Ondertussen zijn alle opleidingen naar de academie verschoven, dit garandeert de best mogelijke degelijkheid, wat ook voor Teniers de doelstelling was.