André Beaumont Et Les Hydravions Schreck-FBA
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

3-VIEWS - TABLE of CONTENTS to Search: Hold "Ctrl" Key Then Press "F" Key
3-VIEWS - TABLE of CONTENTS To search: Hold "Ctrl" key then press "F" key. Enter manufacturer or model number in search box. Click your back key to return to the search page. It is highly recommended to read Order Instructions and Information pages prior to selection. Aircraft MFGs beginning with letter A ................................................................. 3 B ................................................................. 6 C.................................................................10 D.................................................................14 E ................................................................. 17 F ................................................................. 18 G ................................................................21 H................................................................. 23 I .................................................................. 26 J ................................................................. 26 K ................................................................. 27 L ................................................................. 28 M ................................................................30 N................................................................. 35 O ................................................................37 P ................................................................. 38 Q ................................................................40 R................................................................ -

The History of Danish Military Aircraft Volume 1 Danish Military Aircraft Introduction
THE HISTORY OF DANISH MILITARY AIRCRAFT VOLUME 1 DANISH MILITARY AIRCRAFT INTRODUCTION This is a complete overview of all aircraft which has served with the Danish military from the first feeble start in 1912 until 2017 Contents: Volume 1: Introduction and aircraft index page 1-4 Chapter 1 - Marinens Flyvevæsen (Navy) page 5-14 Chapter 2 - Hærens Flyvertropper (Army) page 15-30 Chapter 3 – 1940-45 events page 31-36 Chapter 4 – Military aircraft production page 37-46 Chapter 5 – Flyvevåbnet (RDAF) page 47-96 Volume 2: Photo album page 101-300 In this Volume 1 Each of the five overview chapters shows a chronological list of the aircraft used, then a picture of each type in operational paintscheme as well as some special colourschemes used operationally and finally a list of each aircraft’s operational career. The material has been compiled from a multitude of sources the first of which is my research in the Danish National and Military archives, the second is material from the archives of Flyvevåbnet with which I had a fruitful cooperation in the years 1966 to 1980 and the third are the now (fortunately) many books and magasines as well as the Internet which contains information about Danish military aircraft. The pictures in Volume 1 and Volume 2-the photo album- have mainly been selected from the viewpoint of typicality and rarety and whereever possible pictures of operational aircraft in colour has been chosen. Most of the b/w picures in some way originate from the FLV historical archives, some were originally discovered there by me, whereas others have surfaced later. -

Histoire Tome 1 Chap 2 Les Pr
Les Précurseurs Chapitre 2 Les premiers jours de 1908 allaient être marqués d'un événement important. Le 13 janvier exactement, sur un appareil biplan construit par Gabriel Voisin et muni d'un moteur Antoinette de 40 cv à 1100 tr/mn avec 8 cylindres en V, Henry Farman vient d'accomplir le premier vol officiel de 1 km en circuit fermé de l'histoire , durée du vol 1' 28'', ce qui lui permet de remporter le prix Deutsch-Archdeacon de 50 000 F promis dés 1904. Premier kilomètre en circuit fermé par H. Farman Le 21 mars , Henry Farman, porte le record du monde de distance à 2,004 kilomètres. Le 28 mars 1908, Henry Farman a l'idée de monter comme passager à bord de l'avion piloté par son ami Delagrange. Deux hommes à bord ! On crie à la folie.Le vol se déroule sans aucun problème, Henry Farman enlève ainsi le titre mondial de premier passager à bord d'un avion. Le 8 juillet en Italie, Delagrange emmène à son bord la première femme qui ait volé en avion. Cette femme, qui enlève le titre de "première aviatrice "du monde , est une Française, Mme Thérèse Peltier. Le 6 septembre 1908, Léon Delagrange tient l'air 29 minutes, sur une distance de 24,40 kilomètres à une hauteur de 6 mètres. Le 17 septembre, l'aviation est en deuil. Le premier mort est le lieutenant Thomas Selfridge, décédé de ses blessures. Lorsque Orville Wright vient à Fort Myer pour faire la démonstration du Wright Flyer III pour la division aéronautique du corps des transmissions de l’armée américaine, Selfridge fait en sorte d'être passager pendant le vol .Au milieu du cinquième tour, l'hélice de droite se casse et perd de sa poussée , Orville coupera les moteurs, et réussira à planer jusqu'à 75 pieds (23 m), mais l'avion heurte le sol, le nez en premier. -

Het Grote LUCHTVAARTKENNIS Register
Het grote LUCHTVAARTKENNIS register Het register van het Luchtvaart Historisch Tijdschrift ‘LUCHTVAARTKENNIS’ en de daaraan voorafgaande ‘Mededelingen’ van de Afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL geeft een overzicht van hetgeen in de afgelopen jaren is gepubliceerd, m.u.v. de eerste jaargang, die helaas niet meer te traceren blijkt. Uiteraard is v.w.b. De eerste jaargangen selectief opgetreden, aangezien daarin veel summiere feiten (vliegtuiggegevens etc.) staan, die zo niet achterhaald, dan toch eenvoudiger elders te vinden zijn. Ook de diverse publicaties van het vooroorlogse Nederlandse burgerlucht- vaartregister zijn weggelaten, omdat deze na het verschijnen van het boek ‘75 jaar Nederlandse burgerluchtvaartregisters’ als overbodig kunnen worden beschouwd. Aangezien eerst in 1987 een volledige paginanummering voor het gehele jaar werd ingevoerd, wordt tot dat jaar de vindplaats aangeduid met jaartal en nummer van de betreffende aflevering van de ‘Mededelingen’. Vanaf 1987 geschied zulks per pagina. De in de Luchtvaartencyclopedie verschenen onderwerpen worden aangeduid conform de aflevering waarin deze verschenen. In een enkel geval uit 1985/86 bleek dit niet te achterhalen. Wanneer in een artikel de gehele productie van een bepaalde fabriek wordt weergegeven, wordt volstaan met de vermelding van de fabriek en worden niet de afzonderlijke types vermeld. Bijgewerkt t/m jaargang 66 (2017) Artikel/Onderwerp Jaar/Nummer/Pagina 'Aalsmeer' (PH-TBM) 2014 02 64 Artikel Algemeen 'De Vliegende Hollander' 2014 03 95 Artikel Algemeen 'Eenige -

FRENCH PRE-WAR REGISTER Early Companies: CMA – Compagnie Des Messageries Aeriennes. Commenced 1.5.19 Paris-Lille; Paris-Londo
FRENCH PRE-WAR REGISTER Version 120211 Early Companies: CMA – Compagnie des Messageries Aeriennes. Commenced 1.5.19 Paris-Lille; Paris-London 26.8.19 (JV with Handley Page Transport). CGT – Compagnie Generale Transaerienne. Formed in 1909 to operate airships. Op Paris-London in 1920 in JV with AT&T. CGEA – Compagnie des Grands Express Aeriens. Formed 5.19 by Lt Villier and other air force officers. Paris-London wef 5.3.20. Compagnie Latecoere. Formed 24.12.18 to fly Toulouse-Barcelona; to Alicante 25.2.19; to Rabat 20.3.19; to Casablanca 1.9.19. CAF – Compagnie Aerienne Francaise. Nimes-Nice wef 17.4.19; Suspended 8.20. Aero Transport Compagnie Ernoult. Late 1919 operating Salmsons and Sopwiths Bordeaux-Agen-Toulouse-Narbonne- Bezier-Montpellier. Also op associate as Aero Publicite. TASO – Compagnie des Transports Aeriens du Sud Ouest. Formed 7.19; renamed Societe Franco Bilbaise des Transports Aeriens in 1920 (?). Biarritz-Bordeaux 8.19; to Sans Sebastian 9.19. Bayonne-Bilbao wef 13.6.20 Lignes Farman. Paris-London. To Casablanca & Port Etienne 11.8.19; to Copenhagen 13.8.19. Paris-London 9.19; to Briussels Compagnie Aero Transport. Paris-Geneva 1.7.20 in associateion with L’Ecole Aero Suisse (Sopwiths) CFRNA – Compagnie Franco Roumaine de Navigation Aerienne – formed 23.4.20. Paris-Strasbourg 20.9.20 (Salmson/Potez); to Prague 7.10.20. CGA – Compagnie Generale Aeronautique. Formed 1920 Societe des Transports Aeriens Guyannais. Formed 1919 (Levy seaplanes) St Laurent-Snini-Cayenne F-"ALxx" – Lignes Aeriennes Latecoere Note – Cie Generale d’Entreprises Aeronautiques formed 6/21 by Latecoere) F-ALAA Latecoere Breguet 14 (1) 6.20 [[173] M Latecoere, Toulouse F-ALAE Latecoere Breguet 14 (26) 6.20 [198] M Latecoere, Toulouse F-ALAI Salmson 2.A2 (31) 6.20 (141) M Latecoere, Toulouse. -
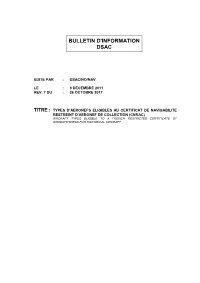
Bi Nav-Cnrac Rev7
BULLETIN D'INFORMATION DSAC EDITE PAR : DSAC/NO/NAV LE : 9 DECEMBRE 2011 REV. 7 DU : 26 OCTOBRE 2017 TITRE : TYPES D’AERONEFS ELIGIBLES AU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE RESTREINT D’AERONEF DE COLLECTION (CNRAC) AIRCRAFT TYPES ELIGIBLE TO A FRENCH RESTRICTED CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS FOR HISTORICAL AIRCRAFT HISTORIQUE DES REVISIONS HISTORY OF REVISIONS Edition originale du 9 décembre 2011 Original issue dated 9th December 2011 Révision 1 du 16 mai 2013 Revision 1 dated 16th May 2013 Ajout des types suivants : Addition of the following types: - Breguet 900 - Fiat Aviazone G46 2B - Sopwith Aviation Company Camel F1 - Albatros Flugzeugwerke D.Va - Breguet BR 1050 - Hawker Aircraft Ltd Hurricane Mk IIA - Cessna UC-78 BOBCAT - SOCATA TB 30 Epsilon Révision 2 du 14 juin 2013 Revision 2 dated 14th June 2013 Ajout du type suivant : Addition of the following type: - PZL TS-8 Bies Révision 3 du 20 décembre 2013 Revision 3 dated 20th December 2013 Ajout des types suivants : Addition of the following types: - Potez 25 - Howard DGA 15 P - Ryan S-CW - Ryan ST-A - North American AT-6C Texan - North American NA 64 Yale - Piper L4-J - Piper J5C-AEM - Piper J3 Clipwing - Yak 12-M - Yak 55 M sn 920403 uniquement (only serial number 920403) - Cessna 140 - Luscombe 8E - ME 108 D Taïfun Révision 4 du 16 février 2015 Revision 4 dated 16th February 2015 Mise à jour de la liste (régularisation) Update list (regularisation) Ajout des types suivants : Addition of the following types: - Avions Fournier RF-2 - Bristol F2B - Cessna 195 A - Consolidated Vultee L-5 - -

Les Avions De Record Français (1928-1932) Les Avions De Record Français (1928-1931) 2
Les avions de record français (1928-1932) Les avions de record français (1928-1931) 2 Nommé président du Conseil - c’est donc lui qui dirige la politique de la France - Raymond La politique de Laurent-Eynac Poincaré appelle Laurent-Eynac le 14 septem- bre 1928 afin de « relever l’aéronautique française Depuis 1924, la France connaît une grave dont la position dans le monde est gravement com- crise économique qui fait trébucher successive- promise en regard de ce qu’elle était en 1918 ». Le ment plusieurs gouvernements. On rappelle gouvernement prend alors plusieurs décisions Raymond Poincaré, qui va devenir le « sauveur importantes : poursuite du relèvement du franc, du franc ». Le franc est si bas en 1926 qu’on ne création d’une Armée de l’Air indépendante, dé- peut plus le changer en devises étrangères. C’est cision du principe d’indépendance énergétique1. paradoxalement une aubaine pour l’industrie française, devenue soudain très compétitive à l’exportation. La France n’a pas encore rem- boursé sa dette de guerre à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis et l’Allemagne n’a pas versé un sou de dédommagement. L’Etat français est surendetté. Dépendant de l’Armée, la construc- tion aéronautique vit au ralenti. Les appareils en service doivent être économisés pour durer longtemps, les marchés sont passés au compte- gouttes. Les budgets vont à la construction de la ligne Maginot, considérée comme prioritaire. Un homme va cependant tout faire changer. Le début de 1927 est marqué par l’expédition aérienne française vers Madagascar. (Collection A. Delmas). Laurent-Eynac félicite les pilotes du raid Paris – Dakar – Tombouc- tou – Alger – Casablanca – Paris (mars 1925). -
Aéronautique Navale De Chez Nous
AERONAUTIQUE Éditions M.D.M. 96, rue de Paris 92100 Boulogne, France Téléphone : (1) 46 99 24 24 Télécopie : (1) 46 05 14 23 © E.T.A.I./M.D.M. 1996 Dépôt légal septembre 1996 Tous droits de reproduction réservés. Couverture : Damien Chavanat Maquette : Isabelle Cransac Imprimé en U.E. ISBN : 2-909333-30-1 ISSN : 1 243-0811 AERONAUTIQUE Pierre Gaillard ÉDITIONS MDM 1 9 20 19 6 0 QUARANTE ANS D'AÉRONAUTIQUE NAVALE RAPPEL HISTORIQUE 'année 1909, qui voit successivement la création, aménagées, des avions et hydravions achetés (une quinzaine sur décision du ministre de la Guerre, d'une d'appareils sont en service à l'été 1913). Le 8 mai 1914, aviation militaire puis, surtout, le 25 juillet, la le constructeur et pilote René Caudron réussit un premier première traversée de la Manche par Louis Blériot, décollage à partir de la plate-forme aménagée sur la va être à l'origine de l'intérêt de l'état-major Foudre. Enfin, le 10 juillet 1914, un nouveau décret précise de la marine envers les aéronefs. En janvier 1910, l'organisation générale de la nouvelle arme. un groupe d'officiers sont désignés pour apprendre l'art du Lorsque éclate la Première Guerre mondiale, le 2 août 1914, pilotage chez les constructeurs du moment (Farman, Levasseur, le matériel volant se limite aux hydravions et amphibies Blériot) et, en avril suivant, le vice-amiral Boué de Lapeyrère, légers, soit basés sur le littoral, soit embarqués sur la Foudre. ministre de la Marine, crée une commission chargée d'étudier Les seules missions prévues sont la reconnaissance et les possibilités de la guerre aérienne au-dessus des mers. -
Photographies D'avions
Jeudi 22 janvier 2009 à 14 h SNCASO Vautour II BR Potez 560 – Aéronautique navale Mirage III C – 10e Escadre de Chasse Paris - Drouot Richelieu - Salle 12 PHOTOGRAPHIES D’AVIONS AVIATION 10 Collection Albert et Jean-Claude SOUMILLE Grumman Avenger – Aéronautique Douglas Dolphin Morane-Saulnier 138 navale Monoplan Nieuport Biplace Nieuport 1916 Patrouille d’Arado 196 Expositions publiques : Mercredi 21 janvier de 11 h à 18 h Jeudi 22 janvier du 11 h à 12 h 1, rue de la Grange-Batelière - 75009 PARIS - Tél. : 33.(0)1.47.70.81.36 - Fax : 33.(0)1.42.47.05.84 Henschell 126 - 1940 Messerschmitt 262 – 1945 Messerschmitt 109 – front de l’Est 1942 Site : www.boisgirard.com - E-mail : [email protected] Commissaires-Priseurs habilités Claude Boisgirard et Isabelle Boisgirard SVV BOISGIRARD & ASSOCIÉS - N° agrément 2001-022-RCSB44177919 aviationok.indd 2-3 22/12/08 11:22:52 Salmson 2A2 – Guerre 1914-18 LeO 451 - 1940 Potez 540 - 1940 Biplan Paul Schmidt – Guerre 14-18 Hanriot 232 - 1940 Messerschmitt 110 Bucker 133 – Luftwaffe 1939 Nieuport 62 – Aéronautique navale Dewoitine 520 - 1944-45 Dewoitine 27 – Armée de l’air espagnole Stinson L-5 – Agadir 1944-45 Hanriot 15 CAP 2 1938 Potez 25 - 1939 Spad VII, Spa 102 – Guerre 14-18 Morane-Saulnier 225 – années 30 Curtiss H-75- 1941 Ballon Dirigeable – Aéronautique navale Junkers 88 Groupe Dor - 1945 Salmson 2A2 –Guerre 14-18 Spad A2 – Guerre 14-18 Potez 25 finlandais Vought V-156 capturé – Aéronautique Dewoitine 520 – Meknes 1944-45 Morane Saulnier 406, 1940 navale 1940 aviationok.indd 4-5 22/12/08 11:23:04 liste aviation ok cedric 16/12/08 9:51 Page 1 DROUOT-RICHELIEU - Salle 12 Tel 01 48 00 20 12 Jeudi 22 janvier 2009 à 14h PHOTOGRAPHIES D’AVIONS COLLECTION Albert et Jean-Claude SOUMILLE Responsable de la vente : M. -

B-0030776 BADOC Eugène Industrie Métallurgique, Sidérurgie 09292 Alfortville 1 À 3 B-0030778 CAZENEUVE Et REMY Industrie
SEINE cote nom du fournisseur activité n° fournisseur commune nbre de marchés B-0030776 BADOC Eugène Industrie métallurgique, sidérurgie 09292 Alfortville 1 à 3 B-0030778 CAZENEUVE et REMY Industrie automobile 09327 Alfortville 1 à 2 B-0029539 FOUREL F. Equipement du soldat et industrie textile 02109 Alfortville 1 à 5 B-0030577 MASSON Jules Industrie de l'armement 07564 Alfortville 1 à 10 B-0029388 Société anonyme Est lumière Industrie de l'énergie 01438 Alfortville 1 B-0030631 Société SORET veuve et Cie Industrie métallurgique, sidérurgie 07970 Alfortville 1 à 2 B-0030367 VIALIS F. Industrie métallurgique, sidérurgie 06085 Alfortville 1 B-0030685 FERNEZ Maurice Matériel médical et industrie pharmaceutique 08215 Alforville 1 à 19 B-0030144 AQUAIRE G.fils Industrie métallurgique, sidérurgie 04903 Antony 1 à 20 B-0030739 BARBOTTE Industrie de l'armement 08812 Arcueil 1 à 2 B-0030739 BARBOTTE et BURGHO Industrie de l'armement 08811 Arcueil 1 à 8 cote nom du fournisseur activité n° fournisseur commune nbre de marchés B-0030261 BONHOMME et VIDAL Industrie de l'armement 05491 Arcueil 1 à 20 B-0029833 DAVID H. et Cie Equipement du soldat et industrie textile 03225 Arcueil 1 à 10 B-0030691 LUDIG frères et Cie Construction publique (bâtiments, travaux publics) 08259 Arcueil 1 à 4 B-0030587 MALAURENT Industrie de l'armement 07611 Arcueil 1 à 14 B-0030628 SAINTE MARIE DUPRE R. et fils Industrie de l'armement 07913 Arcueil 1 à 7 B-0029872 BONTEMPS, WOIRIN et Cie Industrie aéronautique 03435 Asnières 1 à 8 B-0030322 BOURGAIN Albert Industrie de l'armement 05821 Asnières 1 à 56 B-0030188 COTIN A. -

Les Premiers NIEUPORT À Flotteurs
Les premiers NIEUPORT à flotteurs Les premiers NIEUPORT à flotteurs Par Gérard Hartmann Le Nieuport X de la Marine française en poste en décembre 1915 à Port-Saïd en Egypte est le meilleur moyen disponible pour surveiller le canal de Suez. (Musée de l’Air). 1 Les premiers NIEUPORT à flotteurs Citroën est l’un de ses clients. Cette activité va se Edouard Nieuport poursuivre pendant six ans. En 1907, sur ses moteurs d’aviation Né le 24 août 1875 à Blida en Algérie d’un Antoinette, Léon Levavasseur adopte l’allumage père militaire, Edouard de Niéport - qui se fait Nieuport-Duplex. En 1907 précisément ont lieu en appeler plus simplement Nieuport - après de France les premières envolées d’aéroplanes à bonnes études se prépare à entrer en 1896 à moteur à essence : le 15 mars, Charles Voisin l’école Polytechnique. Mais, il préfère s’adonner réussit à Bagatelle (le terrain de sport du bois de à une passion, les courses de vélo et suivre les Boulogne-sur-Seine) sur le biplan Delagrange- cours de l’Ecole d’Electricité. Sur deux roues, Archdeacon (construit chez Voisin) à moteur Edouard Nieuport remporte le prix Zimmermann Antoinette un superbe vol piloté de 80 mètres, en 1897 et se classe plusieurs fois des les sous les yeux de Archdeacon et des commissaires meilleurs dans les grands prix de vélo en 1898, sportifs de l’Aéro-Club de France ; toujours à sur une bicyclette surbaissée à l’avant à cadre Bagatelle, Léon Delagrange sur le même biplan Rudge. Les frères Wright, les frères Farman, Voisin à moteur Antoinette effectue un vol de dix Roger Sommer, Léon Bathiat, le Belge Jan mètres le lendemain, suivi d’un vol de deux Olieslagers, Edmond Audemars, Alexandre cents mètres le 30 mars ; Blériot vole dix mètres Anzani, avant d’être aviateurs, ont commencé le 5 avril à Bagatelle sur son monoplan Blériot, par le sport sur deux roues. -

Industrie Aeronautique
INDUSTRIE AERONAUTIQUE cote nom du fournisseur activité n° fournisseur commune département ou pays nbre de marchés B-0029650 Aéroplanes CAUDRON frères aéroplanes 02591 Rue Somme 1 à 26 B-0029650 Aéroplanes CAUDRON aéroplanes 02591 Issy-les-Moulineaux Seine 27 à 30 B-0029651 Aéroplanes CAUDRON aéroplanes 02591 Issy-les-Moulineaux Seine 31 à 52 B-0029652 Aéroplanes CAUDRON aéroplanes 02591 Issy-les-Moulineaux Seine 53 à 69 B-0029656 Aéroplanes MORANE-SAULNIER constructions aéronautiques 02595 Paris Seine 1 à 23 B-0029657 Aéroplanes MORANE-SAULNIER constructions aéronautiques 02595 Paris Seine 24 à 47 B-0029658 Aéroplanes MORANE-SAULNIER constructions aéronautiques 02595 Paris Seine 48 à 55 B-0029659 Aéroplanes VOISIN aéroplanes 02598 Issy-les-Moulineaux Seine 1 à 29 B-0029660 Aéroplanes VOISIN aéroplanes 02598 Issy-les-Moulineaux Seine 30 à 60 B-0030232 Anjou aéronautique avions S.E.A. 05344 Angers Maine-et-Loire 1 B-0029692 ANZANI Alexandre fabrication de moteurs pour aviation 02697 Courbevoie Seine 1 à 24 cote nom du fournisseur activité n° fournisseur commune département ou pays nbre de marchés Ateliers WILLIAM (KOLPING B-0030362 Marcel) constructeur, fourniture de tuyauteries pour avions 06009 Paris Seine 1 B-0030274 BAILLY – COMTE et BIALOUT manomètres et instruments de précision 05558 Lyon Rhône 1 à 4 B-0029869 BARILLON fourniture d’un moteur GNOME usagé 03428 Paris Seine 1 B-0030233 BASSAN Maurice voilures pour avions 05347 Montreuil-sous-Bois Seine 1 à 3 B-0030240 BATHIAT voilures pour avions 05382 Levallois-Perret Seine 1 à 2 B-0029294 BAYART Achille et Joseph fourniture de tissu schappe de soie pour aéroplanes 01018 Paris Seine 1 à 6 B-0030282 BELY E.