Thèse Waltzing Aline
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Adentifiers *Netherlands ABSTRACT Guidelines for the Development of the Dutch Educational System from 1975 to 1995 Are Presented in This Booklet
DOCUMENT RESUME ED 129 671 SO 009 444 TITLE Reviews of National Policies for Education. Netherlands: Contours of a Future Education System. INSTITUTION Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris (France). PUB DATE 76 NOTE 95p. AVAILABLE FROM OECD Publications Center, Suite 1207, 1750 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, D.C. 20006 ($4.00) EDRS PRICE MF-$0.83 HC-$4.67 Plus Postage. DESCRIPTORS Comparative Analysis; *Comparative Education; Data Analysis; Educational Assessment; Educational Objectives; Educational Philosophy; *Educational Planning; *Educational Policy; Elementary Secondary Education; Foreign Countries; *Futures (of Society) ; Government Role; Higher Education; Program Descriptions; Program Development; Tables (Data); Trend Analysis aDENTIFIERS *Netherlands ABSTRACT Guidelines for the development of the Dutch educational system from 1975 to 1995 are presented in this booklet. Part of a series of reviews of member countries'educaticnal planning and policy, this document is presented in three parts.Part I, Background Report, is the official English summary of the original report titled "Contours of a Future Education System" andknown as the Contours Memorandum. It emphasizes educationalobjectives, the social implications of education, the teacher's role, costs,and efficiency, and describes ideal future schools from the elementary level through higher education. Part II, Examiners' Reportand Questions, presents the report of the Organization forEconomic Cooperation and Development (OECD) examiners who visited the Netherlands in 1976: This section includes criticisms and comments on all phases of the original report and specificquestions on statements made in the report. Part III, TheConfrontation Meeting, gives an account of the discussion which took place at the May1976 meeting of the OECD Education Committee between theexaminers and the Dutch delegation. -
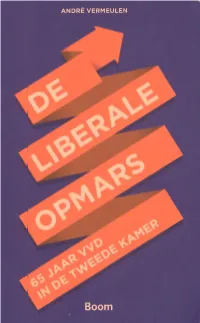
De Liberale Opmars
ANDRÉ VERMEULEN Boom DE LIBERALE OPMARS André Vermeulen DE LIBERALE OPMARS 65 jaar v v d in de Tweede Kamer Boom Amsterdam De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden van de illustraties te ach terhalen. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunt u contact opnemen met Uitgeverij Boom. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonde ringen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part ofthis book may be reproduced in any way whatsoever without the writtetj permission of the publisher. © 2013 André Vermeulen Omslag: Robin Stam Binnenwerk: Zeno isbn 978 90 895 3264 o nur 680 www. uitgeverij boom .nl INHOUD Vooraf 7 Het begin: 1948-1963 9 2 Groei en bloei: 1963-1982 55 3 Trammelant en terugval: 1982-1990 139 4 De gouden jaren: 1990-2002 209 5 Met vallen en opstaan terug naar de top: 2002-2013 De fractievoorzitters 319 Gesproken bronnen 321 Geraadpleegde literatuur 325 Namenregister 327 VOORAF e meeste mensen vinden politiek saai. De geschiedenis van een politieke partij moet dan wel helemaal slaapverwekkend zijn. Wie de politiek een beetje volgt, weet wel beter. Toch zijn veel boeken die politiek als onderwerp hebben inderdaad saai om te lezen. Uitgangspunt bij het boek dat u nu in handen hebt, was om de geschiedenis van de WD-fractie in de Tweede Kamer zodanig op te schrijven, dat het trekjes van een politieke thriller krijgt. -

Speech by Dr. Aalt A. Dijkhuizen, Chairman Executive Board, Wageningen UR 4 September 2007 Your Majesty, Mister Prime Minister
Speech by Dr. Aalt A. Dijkhuizen, Chairman Executive Board, Wageningen UR 4 September 2007 Your Majesty, Mister Prime Minister, Excellencies, Queen’s Commissioner, Mister Mayor, Ladies and Gentlemen , On behalf of the Executive Board of Wageningen UR, I would like to welcome you all here in Wageningen. A special welcome to you, Your Majesty, and to you, Mister Prime Minister. We are extremely pleased and honored to have you both with us. Today we have several things to celebrate: (1) the opening of the academic year of Wageningen University, (2) the opening of the Study Year of Van Hall Larenstein, our University of Professional Education, and (3) the opening of the Wageningen Campus in general and the Forum building, we are currently in, in particular. With the Campus we realize the physical integration of the three pillars of Wageningen UR – university, the more applied research institutes and professional education – exactly 10 years after the start of this unique collaboration. A tremendous project, at least for us, from over 160 million euros of investment, which took many years of preparation and extensive supervision during the building stage. We owe many thanks and a big compliment to the people of our Facilities & Services department, and all others involved, who did, and still do, a great job and who so far also managed to stay within budget, which is certainly not easy with this kind of projects. In this building all our BScĉteaching of Wageningen University and the professional bachelor teaching of Van Hall Larenstein at the former Deventer location will take place and, when completely finished, about twoĉthirds of our staff will be located at the Campus. -

Rechtszekerheid Door Flexibiliteit, Scriptie Duncan Van Den Hoek
Rechtszekerheid door flexibiliteit Een vooruitblik op hoe gemeenten de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet gebruiken om het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid in een omgevingsplan af te wegen. Door: Duncan van den Hoek Illustratie voorblad: ‘de kaders van bestemmingsplannen’ Pagina 2 Colofon Auteur D.N. (Duncan) van den Hoek Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterstudent Spatial Planning Student nr: 5754747 T: 06 531 967 43 M: [email protected] Begeleiders Prof. Dr. T.J.M. (Tejo) Spit Universiteit Utrecht Professor Human Geography and Planning [email protected] Drs. M.M.H.C. (Monique) Arnolds Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmamanager Implementatie Crisis- en herstelwet [email protected] Pagina 3 Voorwoord Voor u ligt mijn afstudeerscriptie voor de master Spatial Planning. Het onderzoek betreft een oud en zwaarbeladen onderwerp binnen de Nederlandse planologie; het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid. Met de resultaten van dit onderzoek hoop ik bij te dragen aan het academisch besef over- en de praktische invulling van dit spanningsveld. Alhoewel ik mij in eerste instantie probeerde te beperken tot het onderzoeken van dit specifieke spanningsveld, strekken de leerpunten van het proces tot het opstellen van deze thesis verder dan dat. Er is inzicht verkregen in veel meer spanningsvelden. Een spanningsveld over de verhouding tussen privé-, studie- en werktijd, de afweging tussen produceren en reflecteren en de scheiding tussen dag- en nacht zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Net als bij het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid blijken dit geen dichotome maatschalen te zijn. Sterker, de veronderstelde tegenstelling tussen uitersten van deze spanningsvelden werd gedurende de looptijd van deze scriptie steeds minder evident. -

'Een Democratische Formatie?'
‘Een democratische formatie?’ Onderzoek naar het debat over de spanning tussen openbaarheid en beslotenheid van kabinetsformaties tussen 1970 en 2012 Masterscriptie Lisa van Bussel Universiteit Leiden S1585355 14 juli 2016 prof. Dr. Henk te Velde en Elisabeth Dieterman aantal woorden: 31013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Arguing and Bargaining 10 Hoofdstuk 2 De besloten formatie 13 Hoofdstuk 3 De schriftelijke formatie 18 Hoofdstuk 4 De tegenstrijdige formatie 26 Hoofdstuk 5 De snelle formatie 35 Hoofdstuk 6 De functionele formatie 42 Hoofdstuk 7 De anti-paarse formatie 50 Hoofdstuk 8 De nieuwe formatie 59 Conclusie Een democratische formatie? 68 Epiloog 78 Literatuurlijst 82 2 Inleiding Openbaarheid zal door elke politicus onderstreept worden als kernbegrip binnen het politieke stelsel van Nederland. Openbaarheid is belangrijk als het gaat om informatievoorziening naar het parlement of de burger, maar heeft nog een andere functionele waarde. Wanneer besluitvorming openbaar plaatsvindt, kunnen buitenstaanders zich identificeren met het proces. In het geval bepaalde afwegingen achteraf toch slechte keuzes geweest blijken te zijn kan er terug gegrepen worden op het transparante proces waaraan iedereen op een bepaalde manier heeft kunnen deelnemen. Maar waarom gebeurt dit dan niet altijd? Als een transparant proces van totstandkoming van besluiten of akkoorden achteraf een hoop ellende wegneemt, waarom worden er dan ook regelmatig radiostiltes afgesproken? Openbaarheid van politieke processen is al lange tijd een thema in Nederland. Johan Rudolf Thorbecke, vormgever van de grondwetswijziging van 1848, had openbaarheid al hoog in het vaandel staan en omschreef het als: ‘Openbaarheid dat is; de groote algemene school van politieke opvoeding.’1 De grondwetswijziging van 1848 stond niet alleen in het teken van de invoering van ministeriële verantwoordelijkheid, maar ook van het creëren van openbaarheid. -

Onder Ministers: De Opkomst Van Ambtelijke En Ministeriële Cultuur in Nederland (1795-1919)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Onder ministers: de opkomst van ambtelijke en ministeriële cultuur in Nederland (1795-1919) Turpijn, J. Publication date 2011 Published in Van Torentje tot Trêveszaal: de geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof Link to publication Citation for published version (APA): Turpijn, J. (2011). Onder ministers: de opkomst van ambtelijke en ministeriële cultuur in Nederland (1795-1919). In H. te Velde, & D. Smit (Eds.), Van Torentje tot Trêveszaal: de geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof (pp. 185-207, 393-395, 434). De Nieuwe Haagsche. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:01 Oct 2021 Noten Voorwoord 13 Riding/Riding, The Houses of Parliament, 19, en [auteur?] verscheidene artikelen in dat boek. -

EEN GROEN LINKSE SAMENWERKING De Redenen Van De PPR Tot Samenwerking Met De Klein-Linkse Partijen Van 1977 Tot En Met 1989
EEN GROEN LINKSE SAMENWERKING De redenen van de PPR tot samenwerking met de klein-linkse partijen van 1977 tot en met 1989 Abstract In de jaren van haar bestaan was de PPR altijd op zoek naar samenwerking met andere partijen, om een progressieve meerderheid in het parlement te bereiken. Eerst was de PvdA de voornaamste partner, maar vanaf 1977 veranderde dat en verschoof de aandacht langzamerhand naar de PSP en CPN, de andere klein-linkse partijen. Welke redenen had het PPR-bestuur om met deze partijen te samenwerken? Op verschillende momenten in de jaren ’80 werkte de PPR met de PSP en CPN samen, vanwege weinig ideologische verschillen en om een machtsfactor te blijven in de Nederlandse politiek. Na een lang traject werd deze samenwerking voltooid met een gezamenlijk akkoord voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1989: Groen Links Tom Plaum (s4341813) Begeleider: dr. K.P.S.S. Vossen Aantal woorden: 16424 Een groen linkse samenwerking Tom Plaum (s4341813) Inhoud Inleiding .................................................................................................................................................. 4 Voorwaarden voor partijfusies ............................................................................................................ 4 Geschiedenis van prominent partijlid .................................................................................................. 6 Overzichtswerken GroenLinks ............................................................................................................ 7 Overzichtswerken -

The Nuclear Option Why Is There a Differentiation Between the Nuclear Energy Policy of the Netherlands and Belgium?
The Nuclear Option Why is there a differentiation between the nuclear energy policy of the Netherlands and Belgium? Name: Bo Snier (6012558) [email protected] th Date: June 20 , 2021. MA-Thesis History oF Politics and Society: Sustainability (GKMV17023) Supervisor: Dr. Hans Schouwenburg Words: 13578 1 Abstract The usage oF nuclear energy has been the subject oF much debate in the past and in the present. Even within the European Union, the use oF nuclear energy is not without complications. For eXample, Belgium is almost dependent on the use oF nuclear energy, while it is hardly used in the Netherlands. This distinction will be analyzed in this thesis, and an attempt will be made to provide an answer to the question: Why is there a diFFerentiation between the nuclear energy policy oF the Netherlands and Belgium? This matter was answered by looking at the trend that has been going on since Second World War and evaluating the actors involved in political and social debates using available source material. These actors are the government, environmental movements, the industrial sector, and scientists, in that order. According to the Findings, there is virtually little variation between Dutch and Belgian policies. The government in the Netherlands, however, made place For environmental groups and incorporated critical voices From scientists in the decision-making process. Although the Dutch government did not Follow the recommendations one-on-one, it did result in a shiFt in policy in Belgium, where these players had little or no impact on political processes; it even appeared that most scientists supported the use oF nuclear energy. -

Binnenwerk Universiteit in Beweging.Indd 1 30-05-17 09:01 Universiteit in Beweging
Mariette Huisjes Mariette Huisjes Universiteit Universiteit in beweging in beweging Bestuurlijke veranderingen aan de TU Delft 1993–2001 Omslagen Uinversiteit in beweging 21x21 HR.indd 1 30-05-17 10:15 Universiteit in beweging Bestuurlijke veranderingen aan de TU Delft 1993–2001 Mariette Huisjes dec ‘93 Binnenwerk Universiteit in beweging.indd 1 30-05-17 09:01 UNIVERSITEIT IN BEWEGING 2 dec ‘93 Binnenwerk Universiteit in beweging.indd 2 30-05-17 09:01 Voorwoord en organisatie zonder kennis van haar verleden is als een boom zonder wortels. De 3 keuzes van generaties voor ons hebben ons gevormd en het 175-jarig bestaan van de ETechnische Universiteit Delft in 2017 is een goede aanleiding om daarbij stil te staan. Dit boekje beschrijft een klein deel van onze geschiedenis: de periode rond 1997, het jaar waarin de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie werd ingevoerd en veel macht overhevelde van de universiteitsraad naar het college van bestuur. Wat mij betreft was deze periode bijzonder en bepalend. In de veertig jaar dat ik meedraai in de academische wereld vind ik de kanteling van het universitaire bestuursmodel in de jaren negentig het belangrijkste scharnierpunt. In Delft werd in die jaren voor het eerst nadrukkelijk de ambitie gearticuleerd om te willen excelleren. De toenmalige bestuurders grepen hun nieuw verworven autonomie aan om de TU letterlijk en figuurlijk op de schop te nemen, wat ze nodig achtten om dit excelle- ren mogelijk te maken. De universiteit herpositioneerde zich ten opzichte van de samenle- ving, het aantal faculteiten werd praktisch gehalveerd, de ondersteunende diensten gereorga- niseerd, het onderwijs gemoderniseerd en ook het onderzoeks- en personeelsbeleid werden aangepast aan de eisen van de tijd. -

0. Om in De Agenda Te Noteren
Stichting Vrienden van de Onderwijsinspectie Postbus 2730 3500 GS Utrecht [email protected] bankrek.nr. NL65RABO0356537129 KvK 851660277 Nieuwsbrief nr. 16 - juni 2017 0. Om in de agenda te noteren Beste mensen, Juni 2017, we staan aan het begin van een nieuwe zomer. Het voorjaar met al het ontluikende leven en de zachte groene kleuren is voorbij. Kleuren worden weer feller en harder en de natuur heeft zich weer gesetteld. Onder het badkamerraam van het huis waarin we enkele weken mochten vertoeven zaten twee nesten, waarin het getsjilp van de jonge vogels niet van de lucht was, met moeder vogel op een boomtak in de buurt. Ze zijn gezond en wel uitgevlogen, het leven tegemoet. Maar niet altijd brengt het voorjaar de vreugde van nieuw leven. Zelfs in de lente is er ook sprake van ziekte en zelfs van naderende eindes. Ook onder ons zijn er oud- collega's die dat zelf of in familiekring momenteel meemaken. Onze gedachten gaan naar hen uit. Wij wensen hen en hun dierbaren erg veel sterkte toe. Het voorjaar was ook de tijd van de examens, waar wij als gepensioneerden van een afstand naar hebben gekeken. We herinneren ons de drukte en de zorg die wij zelf in ons werkzame leven in die examentijden hadden, zowel professioneel als in onze rollen als ouders. En dan sta je toch met een zekere verbazing te kijken naar wat er nu allemaal gebeurt, naar alle klachten die naar voren zijn gebracht: bijna tweehonderdduizend ingediende klachten. En dan weet ik ook wel dat een behoorlijk aantal niet serieus te nemen is, maar toch. -

Worden Zoals Wij: Onderwijs En De Opkomst Van De Geïndividualiseerde Samenleving Sinds 1945
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Worden zoals wij: Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945 Mellink, A.G.M. Publication date 2013 Link to publication Citation for published version (APA): Mellink, A. G. M. (2013). Worden zoals wij: Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:28 Sep 2021 Hoofdstuk 5: Verwezenlijking Opbouw van de geïndividualiseerde samenleving (1973-1981) In de zomer van 1977 uitte kleuterleidster Trudy Uittenbogaard haar bedenkingen bij de relatie tussen school en samenleving. Enkele jaren eerder was de werkgroep Kritiese Kleuterleidsters ontstaan, een verbond van ontevreden kleuterjuffen die hoopten dat het socialisme een betere toekomst brengen zou.1 De werkgroep had zich sindsdien verspreid over Alkmaar, Alphen, Nijmegen, Tilburg en Utrecht. -

Acknowledgements S
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Internationalisation of Higher Education in the United States of America and Europe de Wit, J.W.M. Publication date 2001 Link to publication Citation for published version (APA): de Wit, J. W. M. (2001). Internationalisation of Higher Education in the United States of America and Europe. in eigen beheer. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:29 Sep 2021 VoorVoor mijn ouders ToTo my parents Acknowledgements s Thiss study provides a critical tour d 'horizon of the internationalisation of higher education. It is based on myy twenty years of experience with, and study of, the internationalisation of higher education, as an institutionall director and vice-president for international affairs, a national and international administrator inn a great variety of organisations, and as consultant, researcher and editor.