Morphologie Et Anatomie CARACTÈRES GÉNÉRAUX
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Observations on the Distribution of Freshwater Mollusca and Chemistry of the Natural Waters in Thesouth-Eastern Transvaal and Ad
Bull. Org. mond. Sante' 1964, 30, 389-400 Bull. Wld Hith Org. | Observations on the Distribution of Freshwater Mollusca and Chemistry of the Natural Waters in the South-eastern Transvaal and Adjacent Northern Swaziland* C. H. J. SCHUTTE I & G. H. FRANK' An extensive survey of the molluscan fauna and of the chemistry of the freshwaters of the Eastern Transvaal Lowveld has revealed no simple correlation between the two. The watersfall into fourfairly distinct andgeographically associatedgroups chiefly characterized by their calcium and magnesium content. The frequency of the two intermediate hosts of bilharziasis was found to be roughly proportional to the hardness of the water but as the latter, in this area, is associated with altitude and this again with temperature and stream gradient it is thought highly probable that the distribution of these snails is the result of the interaction of a complex offactors. None of the individual chemical constituents in any of the waters examined is regarded as outside the tolerance range of these snails. It is also concluded that under natural conditions this area would have had few waterbodies suitable for colonization by these snails but that the expansion of irrigation schemes has created ideal conditions for their rapid establishment throughout the area. Primarily, the survey reported here was intended DESCRIPTION OF THE AREA as an attempt, not so much to correlate the presence The area (Fig. 1) is bordered by the Drakensberg of snails and the chemical composition of the waters escarpment in the west, the Lebombo range in the in which they occur, as to compile general ecological east, by the Sabie river in the north and the Komati data essential to further research work on the and Black Umbuluzi rivers in the south. -
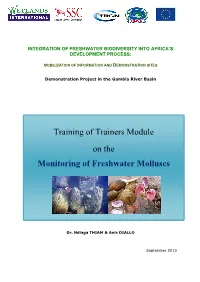
Training of Trainers Module on the Monitoring of Freshwater Molluscs
[Tapez un texte] [Tapez INTEGRATION OF FRESHWATER BIODIVERSITY INTO AFRICA’S DEVELOPMENT PROCESS: MOBILIZATION OF INFORMATION AND DEMONSTRATION SITES Demonstration Project in the Gambia River Basin Training of Trainers Module on the Monitoring of Freshwater Molluscs Dr. Ndiaga THIAM & Anis DIALLO September 2010 INTEGRATION OF FRESHWATER BIODIVERSITY INTO AFRICA’S DEVELOPMENT PROCESS: MOBILIZATION OF INFORMATION AND DEMONSTRATION SITES Demonstration Project in the Gambia River Basin Training of Trainers Module on the Monitoring of Freshwater Molluscs Wetlands International Afrique Rue 111, Zone B, Villa No 39B BP 25581 DAKAR-FANN TEL. : (+221) 33 869 16 81 FAX : (221) 33 825 12 92 EMAIL : [email protected] September 2010 Freshwater Molluscs Page 2 Contents Introduction ................................................................................................................................ 4 Goals and Objectives of the module ....................................................................................... 5 Module Contents ..................................................................................................................... 5 Training needs ........................................................................................................................ 6 Course procedures ................................................................................................................... 6 Expected Results .................................................................................................................... -

College of Natural and Computational Sciences
COLLEGE OF NATURAL AND COMPUTATIONAL SCIENCES DEPARTMENT OF ZOOLOGICAL SCIENCES STUDIES ON ZWAI WETLANDS AS RESERVOIRS OF GASTROINTESTINAL PARASITES OF SHEEP AND HUMANS AND AS HABITATS OF SNAIL VECTORS. A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies of Addis Ababa University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Zoological Sciences (Fisheries and Aquatic Sciences Stream) By Ayalew Sisay Adviser: Professor Brook Lemma October 2019 Addis Ababa, Ethiopia ADDIS ABABA UNIVERSITY SCHOOL OF GRADUATE STUDIES STUDIES ON ZWAI WETLANDS AS RESERVOIR OF GASTROINTESTINAL PARASITES OF SHEEP AND HUMANS AND AS HABITATS OF SNAIL VECTORS. By Ayalew Sisay A thesis presented to the School of Graduate Studies of Addis Ababa University in partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Zoological Science (Fisheries and Aquatic Sciences) Signed by the Examining Committee Advisor Prof. Brook Lemma Signature Date___________ Chairman Prof. Seyoum Mengistou Signature Date ___________ Declaration I, Ayalew Sisay, declared that this dissertation is my original PhD work done by me under the supervision of Professor Brook Lemma from April 2015 to July 2017 at Zoological Sciences of Addis Ababa University. The study and data involved in this PhD thesis have not been submitted for the award of any other degree. All other contributions and sources of information cited herein are duly acknowledged. I Abstract In tropical countries like Ethiopia where the wet seasons are restricted to less than five months of the year, wetlands such as those found around Lake Zwai provide ideal environments for water-related diseases of sheep and humans. -

Vodní Měkkýši ČR 2012
Přehled a determinace vodních měkkýšů ČR Gastropoda: 50 druh ů Bivalvia: 28 druh ů Michal Horsák UBZ PřF MU, Brno Základní fylogeneze m ěkkýšů Poslední analýza – sou časný názor Chybí Monoplacophora – asi sesterská k Polyplacophora (= Serialia) Kocot et al. 2011, Nature Fylogeneze plžů tradi ční klasifikace plžů (Thiele 1929-31, v podstat ě přebral klasifikaci od Mine-Edwards 1848) na Prosobranchia, Opisthobranchia a Pulmonata neodpovídá fylogenezi Prosobranchia – parafyletická skupina Pulmonata a Opisthobranchia = Euthynera (linie 100) jsou potvrzená monofyla Fylogeneze našich plžů Neritaemorphi (Neritidae) Architaenioglossa (Viviparidae, Aciculidae, Ampullariidae) Neotaenioglossa (Bithyniidae, Hydrobiidae, Thiariidae) Ectobranchia (Valvatidae) Pulmonata (Hygrophila: - Caenogastropoda Acroloxidae, Lymnaeidae, - Heterobranchia Physidae, Planorbiidae) plži - diverzita „Prosobranchia - předožábří“ • mo řští jsou druhov ě nejbohatší, také sladkovodní a méně suchozemských (v mediteránu) • žábry jsou v p řední části pláš ťové dutiny (p řed srdcem), p ři stáčení se p řek řížily nervové konektivy - nervové chiasma , u pokro čilejších ztráta pravé ctenidie • charakteristická je p řítomnost víčka z rohoviny - operculum , které je přirostlé k horní stran ě zadní poloviny chodidla a p ři zatažení plže uzavírá ústí ulity (ochrana p řed predátory a vyschnutím) • většinou se jedná o gonochoristy někdy s patrným pohlavním dimorfismem • dýchacím orgánem jsou pravé ctenidie, umíst ěné vp ředu • u nás je 15 vodních a 2 suchozem. druhy operculum Předožábří -

The Newsletter of the Freshwater Mollusk Conservation Society Volume 12 – Number 2 August 2010
! $%" % %#$# %#$# %##& ! 6)&)0&' )0%,% &)+)&# %++% -)* +0 "#&$ &#& #,)-0 '+6&%- )&%62 &#,#)&/6 % -)* +0&"#&$ &/DC@@ >>>*'"+6 # 3?DCFB7DC@@ &)$%3 D@=>F F>F7B>B7B?FC4/D>CF A=B7@?B7A=@A ):&'<%*,6, -,%<&,6, ) $$)$% 6,%% %- )& %3 %6 &#& #' # *+* %6 CDB>7>0#&)& >A>D & %,*+) #)" #"# "3 A@==A ;##&%3 C@@CC C>A7ECC7EBA= C@C7?E>7>FE?4/5=FD@ 1 $$)$%<%- )&* % %6&$ ,%%<&#& #*' # *+*6&$ +-6#*++ &/AC= &)) *3@DE?E 5ECB7BAB7A>A=/?=A ##5ECB7DDC7FB>= &$5ECB7AFA7D@EF #*++<,**6&- ) *+ % 0) ## %& *+,)# *+&)0,)-0 >E>C"+)+3$' %3 C>E?= $0)< %*6, ,6, ,$ ** &%*&)+$)?=>= **,&$0*%++&+ +&)+%0 + $,+))(,*+0 """ ! 6%0&%$0*,$ +%)+ #,+0&, $,*+$$)& +&) -6#*# $ +*,$ ** &%*+&&,+&% '6 +&) * &) &%+) ,+ &%* %#, %.*3 %. ',# + &%*3 $+ % %%&,%$%+*3 ,))%+ **,* + % $&##,*"*3 !& '&*+ %*3&%+) ,+)+ #* 8 %#, % &%& % )*) ')&!+*93 *+)+*3 % *& +0 &$$ ++ )'&)+*6 #+)&% *,$ ** &%*)')))4&%+++ +&). +%0(,*+ &%*6&+++ *,$ ** &%*)%&+'))- .3,+)"&)&%+%+%%)# + %6 NEWSLETTER OF THE FRESHWATER MOLLUSK CONSERVATION SOCIETY Volume 12, No. 2 http://www.molluskconservation.org August 2010 President’s Message Transitions It’s been an exciting past several months as I, your Executive Committee, and your Board have all worked to help transition FMCS into a new era of member services and support and outward visibility. Specifically, through the dedication of Greg Zimmerman, Heidi Dunn, Andy Roberts, and many others in the Society, coupled with the expertise and of hard work of Sophie Binder with Sophie Binder Designs, we have unveiled our new Society web site and presence at http://www.molluskconservation.org. I encourage every member to visit the site and look around at what we have to offer. There is information there for people wishing to learn more about mollusks, as well as a new members-only section that with time will allow you to pay dues, register for meetings, access newsletters, update your contact information and submit a manuscript for publication in the Society Journal, among others. -

Hudson Alves Pinto Biologia E Taxonomia De Trematódeos Transmitidos Por Moluscos Dulciaquícolas Na Represa Da Pampulha, Belo H
HUDSON ALVES PINTO BIOLOGIA E TAXONOMIA DE TREMATÓDEOS TRANSMITIDOS POR MOLUSCOS DULCIAQUÍCOLAS NA REPRESA DA PAMPULHA, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL Universidade Federal de Minas Gerais Instituto de Ciências Biológicas Belo Horizonte 2013 HUDSON ALVES PINTO BIOLOGIA E TAXONOMIA DE TREMATÓDEOS TRANSMITIDOS POR MOLUSCOS DULCIAQUÍCOLAS NA REPRESA DA PAMPULHA, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Parasitologia, Instituto de Ciencias Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Parasitologia Área de Concentração: Helmintologia Orientador: Dr. Alan Lane de Melo Belo Horizonte 2013 1 043 Pinto, Hudson Alves. Biologia e taxonomia de trematódeos transmitidos por moluscos dulciaquícolas na Represa da Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil [manuscrito] / Hudson Alves Pinto. – 2013. 299 f.: il. ; 29,5 cm. Orientador: Alan Lane de Melo. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas. 1. Trematódeo – Pampulha, Lagoa da (MG) - Teses. 2. Molusco – Pampulha, Lagoa da (MG) – Teses. 3. Cercárias – Teses. 4. Infecção laboratorial – Teses. 5. Ciclo biológico. 6. Helmintologia – Teses. 7. Parasitologia – Teses. I. Melo, Alan Lane de. II. Universidade Federal de Minas Gerais. Instituto de Ciências Biológicas. III. Título. CDU: 576.895.122 2 Trabalho desenvolvido no Laboratório de Taxonomia e Biologia de Invertebrados, Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais. 3 À minha esposa Amanda e ao meu filho Miguel 4 AGRADECIMENTOS Ao professor Alan Lane de Melo, amigo e orientador, pelo direcionamento da minha formação científica, além da disponibilidade, paciência, incentivo e orientação segura, sempre presentes durante a realização deste trabalho. -

Human Dispersal of Freshwater Invasive Fauna, Contributing for the Management of These Problematic Species
Human Dispersal of Freshwater Invasive Fauna Filipe Miguel Santos Banha Tese apresentada à Universidade de Évora para obtenção do Grau de Doutor em Ciências do Ambiente ORIENTADOR: Prof. Dr. Pedro Manuel Anastácio ÉVORA, Março 2016 INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO AVANÇADA ii Acknowledgements Quero agradecer ao meu orientador Prof. Dr. Pedro Anastácio, que desde o meu início da minha formação académica me tem acompanhado, por todos os seus conselhos, ensinamentos e companheirismo. Muito Obrigado!!! Ao Prof. António Diniz, à Prof.ª Maria Ilhéu, à Catherine e ao pessoal do Park de Brenne. À Munia, à Concha, ao Vicent e ao Miguel e suas muchachas, ao Javier, não esquecendo as patatas bravas… À Mafalda, à Mónica e à Maria, pelas horas esquecidas em nome da ciência… Ao pessoal da APCF, em especial ao Pedro. Ao pessoal da APPSE, em especial ao João Paulo. Ao Marco pelo companheirismo e diversão junto à água e todos os meus amigos… A toda a minha Família, aos meus pais, à minha irmã, à Alice bebé, aos meus avós, à Angela por tudo e por nada. À minha válvula aórtica… Ao meu 106 que já deu a volta ao mundo em trabalho e lazer… Aos The Verve… ”Cause it’s a bittersweet symphony, this life (…) you’re a slave to the money then you die.” “ There ain't no space and time to keep our love alive. We have existence and it's all we share” “Oh, you're too afraid to touch. Too afraid you'll like it too much.”; “ ’Cause life's an ocean too much commotion, too much emotion. -

Biology of Snail-Killing Sciomyzidae Flies Lloyd Vernon Knutson and Jean-Claude Vala Excerpt More Information
Cambridge University Press 978-0-521-86785-6 - Biology of Snail-Killing Sciomyzidae Flies Lloyd Vernon Knutson and Jean-Claude Vala Excerpt More information 1 • Introduction All finite things reveal infinity. despite the ice which could cover it . And, finally, the Roethke (1964). hatching of the winged insect at springtime . .] But the finite cannot be extended into the infinite. The first report of the larval food of a sciomyzid was presented Leonardo da Vinci. by Perris (1850), who reared Salticella fasciata from larvae found in the terrestrial snail Theba pisana in southwestern Paris, 1846 and southwestern France, 1847. Then, a century France. He stated “Cette larve . devore . Helix pisana, later and continents apart, southwestern Alaska, 1950. In probablement apre`s qu’il est mort.”[“Thislarva...devours... terms of space and time, these critical points are the most Theba pisana, probably after it had died”]. The first conclusive important in the early work on sciomyzid life cycles. The evidence that several sciomyzid larvae kill and consume first description of the larva and puparium of a sciomyzid gastropods was presented one century later by Berg (1953). (that of Tetanocera ferruginea) was presented by Dufour Working in southwestern Alaska in 1950, he reared six species (1847a), in a poetic style, solely on snails (Dictya expansa, Elgiva solicita, Sciomyza dryomyzina, Sepedon fuscipennis, Tetanocera ferruginea,and Vers la fin de l’automne de 1846, je decouvris dans l’eau T. rotundicornis) and “found a third-instar larva of S. fuscipen- d’une mare, pre`s de Saint-Sauveur [near Paris], au milieu nis eating a small Lymnaea emarginata in nature.” The story des lemna et des callitriches, une larve dont . -

Synopsis of the Egyptian Freshwater Snail Fauna
Folia Malacol. 23(1): 19–40 http://dx.doi.org/10.12657/folmal.023.002 SYNOPSIS OF THE EGYPTIAN FRESHWATER SNAIL FAUNA WAEL M. LOTFY1, LAMIAA M. LOTFY2 1Parasitology Department, Medical Research Institute, Alexandria University, Alexandria, Egypt (e-mail: [email protected]) 2Graphics Department, Faculty of Fine Arts, Alexandria University, Alexandria, Egypt ABSTRACT: Egypt harbours many species of freshwater snails that transmit parasites causing serious diseases in humans and animals. Due to their significance, it is important to up-date the faunal list regularly. Our objective was to present such an up-date. The twenty eight species known to exist in the country are reviewed, including their synonymy, type localities, diagnostic features and parasitological importance; the shell morphology is illustrated. Besides, snail species thought to be extinct in the country are noted. This review can be used as a field guide for identification of the various species of snails colonising freshwater habitats in Egypt. KEYWORDS: snail, freshwater, Egypt, field guide INTRODUCTION Freshwater snails play an important role in their in the country are covered, regardless of their medi- ecosystems and many of them have great medical cal and veterinary importance. and veterinary importance. Worldwide, about 350 The taxonomy of class Gastropoda, snails and snail species are estimated to be possible hosts of slugs, is changing rapidly and it will be some time parasites which cause human and animal diseases before a classification system for higher taxa be- (ROZENDAAL 1997). The Egyptian freshwater snail comes generally accepted (HASZPRUNAR 1988, fauna includes many species that transmit serious PONDER & LINDBERG 1997, BOUCHET & ROCROI parasitic diseases such as schistosomiasis and fasci- 2005). -

Vodní Plži ČR
Vodní měkkýši ČR determinace, ekologie, rozší ření v ČR 50 druh ů Příbuzenské vztahy našich vodních plžů Neritaemorphi (zubovci) Architaenioglossa (bahenky, ampulárky a jehlovky) Neotaenioglossa (bahnivky, praménkovití, pisko řky) Ectobranchia (to čenky) Pulmonata (plicnatí: - Caenogastropoda plovatky, okružáci a další) - Heterobranchia „Prosobranchia“ - předožábří • bazální parafyletická skupina (jednotlivé linie se odd ělují postupn ě) • žábry v p řední části pláš ťové dutiny (p řed srdcem), p ři stáčení se přek řížily nervové konektivy - nervové chiasma , u pokro čilejších ztráta pravé ctenidie • všechny naše druhy mají víčko - operculum , z periostraka (vzácn ě kalcifikované – Thedoxus sp.) • víčko je p řirostlé k horní stran ě zadní poloviny chodidla a p ři zatažení plže uzavírá ústí ulity (ochrana p řed predátory a vyschnutím) • většinou se jedná o gonochoristy někdy s patrným pohlavním dimorfismem • dýchacím orgánem jsou pravé ctenidie, umíst ěná v p ředu • u nás je 15 vodních a 2 suchozem. druhy operculum Předožábří - Prosobranchia Čele ď: Neritidae - zubovcovití Theodoxus danubialis - zubovec dunajský, 1 cm, Kyjovka nad zaúst ěním do Dyje Theodoxus fluviatilis - zubovec říční, 1 cm, poslední nález v Labi u Litom ěř ic 1917, ší ří se Dunajem Předožábří - Prosobranchia Čele ď: Viviparidae - bahenkovití Viviparus acerosus - bahenka uherská, 5 cm, pomalu tekoucí vody, povodí Dunaje, závity ploché Viviparus contectus - bahenka živorodá, 4 cm, stojaté vody nížin, nadmuté závity Viviparus viviparus - bahenka pruhovaná, 3 cm, tišiny -

Synthesis and Implications
Synthesis and implications This ecological perspective of the fresh and brackish (inland) waters of the subcontinent has provided an introduction to the limnological literature of southern Africa. It has drawn together some of the research results which, while appearing disparate, form the warp and weft of a limnological pattern for the subcontinent, without which the response of the subcontinent's water resources to the diversity of changes of anthropogenic origin cannot be adequately assessed, and proper management decisions taken. In so doing it has emphasized those studies and investigations which, because of the extent of limnological knowledge and understanding of warm water systems, either rivers or lakes, they have generated, should be incorporated rapidly into management policies. The hydrological effects of the ever increasing demand for water by the growing population and industrialization of southern Africa have to be viewed against the climatic variability of the subcontinent. Preston-Whyte & Tyson (1988) report that between 9000 and 4000 BP wetter conditions prevailed over southern Africa than exist at present. Thereafter wet cool and dry warmer conditions reflected, in general, the major climatological epochs throughout the world, for example the neoglacial advance between 2000 and 3000 BP, and the medieval warm epoch of 1000 AD. Attention has already been drawn to the quasi-periodic rainfall oscillations for the summer rainfall regions from 1910/11 until the present day. Preston Whyte & Tyson (1988) have established that the dry spells are "more persistently dry than the wet spells wet". It is during such dry periods that the land is at its most fragile, and because of our collective ignorance the hazard of desertification in the subcontinent has increased materially. -

Etude De La Protostrongylose Dans La Population De Lièvres Européens (Lepus Europaeus) Dans Le Sud-Est De La France : Approche Épidémiologique Et Écologique
Thèse Pour obtenir le grade de : Docteur de l’Université de Reims Champagne-Ardenne Discipline : Sciences de la vie, Santé Spécialité : Parasitologie par Célia LESAGE Le 4 décembre 2014 Etude de la protostrongylose dans la population de lièvres européens (Lepus europaeus) dans le Sud-est de la France : approche épidémiologique et écologique JURY M. CHARTIER Christophe Professeur, ONIRIS, Nantes Président Mme LINDEN Annick Professeur, Université de Liège Rapporteur M. FELIU Carlos Professeur, Université de Barcelone Rapporteur Mme BASTIAN Suzanne Maître de Conférences, ONIRIS, Nantes Examinateur M. MIGOT Pierre Directeur des Etudes et de la Recherche, Examinateur ONCFS M. FERTÉ Hubert Maître de Conférences, Faculté de Directeur de Pharmacie de Reims thèse Thèse Pour obtenir le grade de : Docteur de l’Université de Reims Champagne-Ardenne Discipline : Sciences de la vie, Santé Spécialité : Parasitologie par Célia LESAGE Le 4 décembre 2014 Etude de la protostrongylose dans la population de lièvres européens (Lepus europaeus) dans le Sud-est de la France : approche épidémiologique et écologique JURY M. CHARTIER Christophe Professeur, ONIRIS, Nantes Président Mme LINDEN Annick Professeur, Université de Liège Rapporteur M. FELIU Carlos Professeur, Université de Barcelone Rapporteur Mme BASTIAN Suzanne Maître de Conférences, ONIRIS, Nantes Examinateur M. MIGOT Pierre Directeur des Etudes et de la Recherche, Examinateur ONCFS M. FERTÉ Hubert Maître de Conférences, Faculté de Directeur de Pharmacie de Reims thèse 3 4 REMERCIEMENTS Je n’aurais pu mener à bien cette thèse sans le soutien financier de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et de la Fédération Nationale des Chasseurs.