Voix Plurielles Volume 1, Numéro 1, Mars 2004 Celui Qui Implose Dans
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

White Paper on Francophone Arts and Culture in Ontario Arts and Culture
FRANCOPHONE ARTS AND CULTURE IN ONTARIO White Paper JUNE 2017 TABLE OF CONTENTS SUMMARY 05 BACKGROUND 06 STATE OF THE FIELD 09 STRATEGIC ISSUES AND PRIORITY 16 RECOMMANDATIONS CONCLUSION 35 ANNEXE 1: RECOMMANDATIONS 36 AND COURSES OF ACTION ARTS AND CULTURE SUMMARY Ontario’s Francophone arts and culture sector includes a significant number of artists and arts and culture organizations, working throughout the province. These stakeholders are active in a wide range of artistic disciplines, directly contribute to the province’s cultural development, allow Ontarians to take part in fulfilling artistic and cultural experiences, and work on the frontlines to ensure the vitality of Ontario’s Francophone communities. This network has considerably diversified and specialized itself over the years, so much so that it now makes up one of the most elaborate cultural ecosystems in all of French Canada. However, public funding supporting this sector has been stagnant for years, and the province’s cultural strategy barely takes Francophones into account. While certain artists and arts organizations have become ambassadors for Ontario throughout the country and the world, many others continue to work in the shadows under appalling conditions. Cultural development, especially, is currently the responsibility of no specific department or agency of the provincial government. This means that organizations and actors that increase the quality of life and contribute directly to the local economy have difficulty securing recognition or significant support from the province. This White Paper, drawn from ten regional consultations held throughout the province in the fall of 2016, examines the current state of Francophone arts and culture in Ontario, and identifies five key issues. -

Groupe Media Tfo Digital Educational Francophone
GROUPE MEDIA TFO DIGITAL EDUCATIONAL FRANCOPHONE TABLE OF CONTENTS SUMMARY P. 6 SECTION 1 The digital race P. 9 SECTION 2 We can run P. 13 SECTION 3 Transforming education through innovation P. 17 SECTION 4 Contributing to the sustainable development of la francophonie P. 29 SECTION 5 Funding innovation P. 35 SECTION 6 Unleashing more digital innovation P. 39 GROUPE MÉDIA TFO STRATEGIC POSITIONING STATEMENT FOREWORD Transformative digital enterprises contribute to momentum, to leverage the innovation strength defining and developing jobs for young talents that we have developed and more fully realize in the creative sectors. This is the story of the potential of our educational enterprise, Groupe Media TFO, a digital educational and Groupe Média TFO requires a new funding model francophone powerhouse. 1 that is more adequately aligned with its new operational activities. Industry and government in Ontario, across Canada, and globally, are becoming increasingly According to World Economic Forum (WEF) data, focused on innovation and determined to lead Canada ranks 14th on the Network Readiness within the global digital economy. Klaus Schwab Index 2016, a key measurement of the capacity of the WEF and others refer to this as the dawn of countries to leverage emerging technologies of the fourth industrial revolution. Enterprises and digital opportunities.2 We are on the outside recognize that vigorous innovation is a defining of the leading cohort consisting of seven countries: condition of success. Finland, Switzerland, Sweden, Israel, Singapore, the Netherland and the United States. For Canada Within this context, it is equally essential for to catch up, we all have our work cut out for us. -

Hospice News Nouvelles De La Maison
Maison Hospice News Vale Hospice Nouvelles de la Maison Spring/Printemps 2015, Volume 9, No 1 Miigwetch for the gift. Walk of Life / Sentier de la vie “I would prefer a Smudging!” Our Mom, Madeleine Genier, made We have added some wonderful pieces to the Enchanted Forest this announcement shortly after she came to live at the spa (her and the front of the house. Thank you to the families who chose term of endearment for the Maison Vale Hospice). Not being of to honour their loved ones in this way! First Nation background, my brother and I were unsure of what to do with this request. Norm, the Coordinator of Supportive Nous avons ajoutés des beaux morceaux dans la Forêt enchantée Care, was quick to introduce us to Perry McLeod-Shabogesic, et à l’entrée principale, grâce aux familles qui ont choisi Director of Traditional Programming of the Shkagamik-Kwe d’honorer leur être cher sur le Sentier de la vie. Health Centre in Sudbury. On a glorious afternoon, my brother and I, my nephew, Shane, Giselle (Moms’ new friend at the spa), and Norm joined Perry on the dock. Perry expressed the honour he felt in being asked to perform a smudging for our Mom. He patiently explained the ceremony, and we watched as a sense of calm and peace enveloped our Mother. Little did we know that we, too, would be forever changed by this smudging experience and by our stay at Maison Vale Hospice. At the end of the ceremony, a dragonfly flew over us and I said, “Look Mom, that means good luck.” Perry added that, in the First Nation culture, the dragonfly is a symbol of transition, change, the ability to adapt, and self-realization. -

Understanding the French Experience in Ontario
A publication of the Ontario Heritage Trust May 2012 HeritageMatters Understanding the French experience in Ontario In this issue: The early French presence in Ontario I Developing communities Prayers, petitions and protests I Portrait of a growing diversity www.heritagetrust.on.ca Feature story An interview with Madeleine Meilleur, Pages 2-3 Heritage A message from the Chairman: Ontario’s Quiet Revolution Heritage Matters is published in English and French The role of French-speaking people in shaping the history and life of this province reaches back to the early 17th and has a combined circulationMatters of 9,200. Digital copies are available on our website at century, when explorers and missionaries embarked on official journeys of reconnaissance and faith. www.heritagetrust.on.ca. Advertising rates: By the time Upper Canada was created in 1791, the relationship of French-speaking people to the province was well Black and white established, and recognized in some of its earliest legislation. In fact, a resolution acknowledging French-language Business card – $125 plus HST ¼ page – $250 plus HST rights in Upper Canada was adopted at Newark as early as June 1793. Inserts – Call to inquire about our exceptional rates. For information, contact: This view of the importance of language to the French-speaking population – and to the identity of the province A publication of the Ontario Heritage Trust May-June 2012 Ontario Heritage Trust as a whole – was shared by those creating a pre-Confederation educational framework for the province. Indeed, HeritageMatters 10 Adelaide Street East, Suite 302 Dr. Egerton Ryerson, the Chief Superintendent of Education in the province for more than 30 years, took the Toronto, Ontario M5C 1J3 view that French was, as well as English, one of the recognized languages of the province, and that children could Telephone: 416-325-5015 Fax: 416-314-0744 therefore be taught in either language in its public schools. -

P221- John Doerr Fonds 1973-2018 (Predominant Dates 1976-1986) 77.2 Cm of Textual Records, Graphic Materials, and Other Document Types
P221- John Doerr Fonds 1973-2018 (predominant dates 1976-1986) 77.2 cm of textual records, graphic materials, and other document types. Biographical sketch: John W. Doerr (1949- ), son of Mervin Doerr and Dorothy Ward, born in Stratford, Ontario, is a musician and a member of CANO musique and one of the founders of Majoma music. While in high school, John was a member of a number of musical groups, performing on bass and trombone. The musical repertoire ranged from the Beatles, Rolling Stones, to Herb Alpert & the Tijuana Brass. After graduating from York University with a degree in Psychology and one in ‘Beaux-Arts’ with a specialisation in Music, John moved to Sudbury to join the the first iteration of Cano Musique. He had met Rachel Paiement & David Burt while playing in Morgan, a popular lounge band in Ontario. They introduced him to André Paiement, whose vision of a musical co-operative was enough for John to make the move to Sudbury. The three, with Marcel Aymar and André Paiement then founded CANO musique, also a cooperative. As a member, Doerr played trombone, the electric bass and synthesizer. He also composed and arranged music for the group. A few of his compositions include “En Mouvement,” part of a collective composition “Au nord de notre vie,” “Partons” (with lyrics by M. Aymar and M. Kendel), and “Mime Artist” (with lyrics by Aymar and Kendel). John took on the accounting duties of the group when André Paiement died in Jan, 1978. Along with Gary McGroarty, Doerr became the contact person for the financial aspects of the different services offered by the group. -
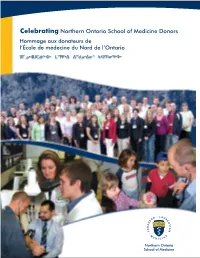
NOSM Donor Report.Pdf
A message from the Minister of Northern Development and Mines A message My message to you today is straightforward and from the heartfelt – thank you. Thank you for your incredible effort and generosity Premier of in making the Northern Ontario School of Medicine Bursary Campaign a truly astonishing achievement in Ontario fundraising. The $6.7 million you raised in a few short months became more than $13 million when the Northern On behalf of the Government of Ontario, I am delighted to Ontario Heritage Fund Corporation (NOHFC) and the extend my sincere thanks to all those who contributed to the Ontario government matched the funding. Northern Ontario School of Medicine (NOSM) Bursary Fund. We believe it ranks among the best investments the The spirit of community involvement and the dedication NOHFC has ever made in Northern Ontario. We’re exemplified by all donors make us proud to be Ontarians and investing in young, motivated doctors – many with Canadians. This goodwill is reflected through the funds raised roots in Aboriginal, Francophone, rural and remote for the NOSM Bursary Fund — an impressive $6.7 million. And communities - who will be graduating from this school. with our government matching the entire amount, the fund They will be working in communities throughout now exceeds $13 million. This will mean more doctors helping Northern Ontario, and improving access to health care people across the province, especially in Northern Ontario. for all northerners. Ensuring that all Ontarians have access to the best health Your fundraising goals from the beginning have been care is a top priority for our government. -

L'autobus De La Pluie (Poemes 1973-1986)
Extrait de la publication Extrait de la publication L'autobus de la pluie (poemes 1973-1986) Extrait de la publication Du merne auteur LeNickelStrange, roman, Montreal, Trait d'union, 2000. Prendre la parole. Lejournal de bord du grand CANO, essai, Hearst (Ontario), Le Nordir, 1996. Souvenir de Daniel, nouvelle, Hearst (Ontario), Le Nordir, 1995. La Veuve rouge, poesie, Sudbury, Prise de parole, 1986. Souuenances, poesie, Sudbury, Prise de parole, 1979. En attendant, poesie, Sudbury, Prise de parole, 1976. Apprentissage dans Lignes-Signes, collectif de poesie, Sudbury, Prise de parole, 1973. AUTRES PUBLICATIONS -Dimanche apres-midi-, Liaison, n° 107 (ete 2000), p. 7. «Rite de passage», Liaison, n° 102 (mai 1999), p. 20-21. -Les partes de l'enfer. L'CEuvre de chair et d'esprit-, memoire de maitrise, universite du Quebec a Montreal, 1999. -Quand les chiffres parlent une langue inconnue des artistes», Liaison, n° 46 (mars 1988), p. 17-19. «Moe je viens de ou-, Liaison, n° 27 (ete 1983), p. 12-17. «Genese: De l'edition francophone en Ontario», Revue du Nouvel-Ontario, n° 2, Litterature sudburoise. Prise de parole 1972-1982, Sudbury, Institut franco-ontarien, (1982), p. 1-20. -Le matin de ton souvenir», poeme dans Au nord du silence, collectif de poesie, Sudbury, Prise de parole, 1975, p. 12. Extrait de la publication Gaston Tremblay L'autobus de la pluie (poemes 1973-1986) Apprentissage suivi de En attendant suivi de Souvenances suivi de La Veuve rouge Poesie Prise de parole Sudbury 2001 ISBN 2-89423-360-3 (PDF) Avant-propos j'ai rencontre Gaston Tremblay pour la premiere fois a Sudbury, a lafin des annees 1970. -

Le Journal De Bord Du Grand CANO De Gaston Tremblay (Ottawa / Hearst, Le Nordir, 1996, 330 P.) François Ouellet
Document generated on 09/30/2021 8:25 p.m. Francophonies d'Amérique Prendre la parole : le journal de bord du grand CANO de Gaston Tremblay (Ottawa / Hearst, Le Nordir, 1996, 330 p.) François Ouellet Le(s) discours féminin(s) de la francophonie nord-américaine Number 7, 1997 URI: https://id.erudit.org/iderudit/1004754ar DOI: https://doi.org/10.7202/1004754ar See table of contents Publisher(s) Les Presses de l'Université d'Ottawa ISSN 1183-2487 (print) 1710-1158 (digital) Explore this journal Cite this review Ouellet, F. (1997). Review of [Prendre la parole : le journal de bord du grand CANO de Gaston Tremblay (Ottawa / Hearst, Le Nordir, 1996, 330 p.)]. Francophonies d'Amérique, (7), 111–114. https://doi.org/10.7202/1004754ar Copyright © Les Presses de l'Université d'Ottawa, 1997 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ PRENDRE LA PAROLE : LE JOURNAL DE BORD DU GRAND CANO de GASTON TREMBLAY (Ottawa/Hearst, Le Nordir, 1996,330 p.) François Ouellet Université Laval (Québec) /\cteur essentiel de la naissance de la Coopérative des artistes du Nouvel- Ontario (CANO) et fondateur de Prise de Parole, la première maison d'édi• tion franco-ontarienne, Gaston Tremblay est sans doute, avec Robert Dickson, la personne la mieux placée pour rappeler l'histoire de l'affirmation identitaire des Franco-Ontariens du Nord à partir de 1970. -

2020 CANO/ACIO Annual Conference Abstracts Index
2020 CANO/ACIO Annual Conference Abstracts Index Abstract Oral Presentation titles Page number number O-01 “You get used to a certain kind of horrible” – An integrative description of moral distress in oncology nursing 115 O-02 An exploration of health provider work-related grief and strategies for moving through it 115 O-03 Experience of oncology nurses and cancer survivors during cancer treatment transitions from oncology teams to primary 115 care providers teams O-04 Improving Pleural Effusion Management – The 11 VIC Experience 115 O-05 Causes, consequences, and management of persistent hiccups in advanced cancer patients 116 O-06 Introducing telepractice oncology nurse for the provision of remote cancer symptom management support 116 O-07 Exploring cancer patients’ perceptions of accessing and experience with using the education material in the Opal Patient 116 Portal O-08 Processes of treatment decision making among older adults with colorectal cancer: implications for oncology nursing 116 practice O-09 Who is your SDM? Empowering nurses to engage in the conversation 117 O-10 Assessing and documenting complementary and integrative medicine in a provincial cancer agency 117 O-11 Strengthening oncology nurses’ collective voice in optimizing care of older adults with cancer and their caregivers: 118 Contributing to an International position statement O-12 How can dynamical neurofeedback help cancer survivors with persistent symptoms: Current evidence and therapy 118 demonstration O-13 Adventures in quality improvement: Lessons and experiences -

This Marks the Connection of Ontario's Section of the Great Trail Of
The Great Trail in Ontario Le Grand Sentier au Ontario This marks the connection of Ontario’s section of The Great Trail of Canada in honour of Canada’s 150th anniversary of Ceci marque le raccordement du Grand Sentier à travers l’Ontario pour le 150e anniversaire de la Confédération Confederation in 2017. canadienne en 2017. À partir d’où vous êtes, vous pouvez entreprendre l’un des voyages les plus beaux et les plus diversifiés du monde. From where you are standing, you can embark upon one of the most magnificent and diverse journeys in the world. Que vous vous dirigiez vers l’est, l’ouest, le nord ou le sud, Le Grand Sentier du Canada—créé par le sentier Whether heading east, west, north or south, The Great Trail—created by Trans Canada Trail (TCT) and its partners— Transcanadien (STC) et ses partenaires—vous offre ses multiples beautés naturelles ainsi que la riche histoire et offers all the natural beauty, rich history and enduring spirit of our land and its peoples. l’esprit qui perdure de notre pays et des gens qui l’habitent. Launched in 1992, just after Canada’s 125th anniversary of Confederation The Great Trail was conceived by a group of Lancé en 1992, juste après le 125e anniversaire de la Confédération du Canada, Le Grand Sentier a été conçu, par un visionary and patriotic individuals as a means to connect Canadians from coast to coast to coast. groupe de visionnaires et de patriotes, comme le moyen de relier les Canadiens d’un océan aux deux autres. -

Raúl J. Cano, Ph.D
Raúl J. Cano, Ph.D. 1854 Castillo Court San Luis Obispo, CA 93405 Phone: 805-748-9717 Fax: 805-783-2351 E-Mail: [email protected] EDUCATION AND TRAINING University Studies Ph.D. 1974 Microbiology and Mycology • University of Montana, Missoula, MT M.S. 1986 Clinical Microbiology • University of Seville School of Medicine, Seville, Spain M.S. 1972 Biology/Fungal Genetics • Eastern Washington University, Cheney, WA B.S. 1970 Biology • Eastern Washington University, Cheney, WA A.A. 1968 Liberal Arts • Spokane Falls Community College, Spokane, WA Certificates and Licenses Public Health Microbiologist 1978 California Department of Public Health Services, Berkeley, CA Certified Milk Tester 1979 California Department of Public Health Services, Berkeley, CA Certified Asbestos Inspector 2012 U.S. Environmental Protection Agency Certified Asbestos Manager 2012 U.S. Environmental Protection Agency Certified Asbestos Project Designer 2012 U.S. Environmental Protection Agency PROFESSIONAL EXPERIENCE Partner, Environmental Diagnostic Consultants, LLC. 1854 Castillo Court, San 2010 - Present Luis Obispo, CA 93405 USA Duties: Provide consulting and analytical services to clients on environmental, public health, source tracking, and/or indoor air quality issues. Manage the affairs of the environmental consulting company, including budget, billing and personnel management. Develop new accounts, evaluate and implement new technologies as well as develop public relation and outreach programs. Professor/Professor Emeritus. California Polytechnic State University, San Luis 1974 - Present Obispo, CA 93407 USA Duties: Design/revise/upgrade courses, teaching of assigned courses, ensuring student awareness of course objectives and monitoring learning outcomes, and providing guidance to instructors relative to the instructor’s teaching assignments; participating in the work of curriculum and other consultative committees as requested. -

Conference Program November 6-8, 2020
CANO/ACIO 2020 Conference Program November 6-8, 2020 Now and Forever Oncology Nursing World Health Organization The Year of the Nurse and the Midwife Les soins infirmiers en oncologie d’aujourd’hui et de demain Organisation mondiale de la Santé Année des infirmières et des sages-femmes ACCESS MANAGEMENT A FULLY INTEGRATED PROGRAM THAT DELIVERS END-TO-END CARE. At BD, we believe that truly effective vascular access therapy starts long before the first IV is ever inserted. That’s why we designed the BD® Vascular Access Management program: an integrated solution that spans the continuum of vascular access care. The program aims to help clinicians reduce complications and improve quality of care by standardizing on industry best practices throughout the entire process. With the combined expertise of BD and BARD—now as one BD—our program offers in-depth assessments, evidence-based recommendations, training and education, and world-class tools and technologies. Discover total vascular access management designed to deliver better clinical and economic outcomes. Discover the new BD. Learn more at bd.com/TotalManagement BD and the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2019 BD. All rights reserved. BD-9535 (0419) The image depicted contains models and is being used for illustrative purposes only. Janssen Global Services, LLC. © JGS 2019 Some treatments manage cancer. We’re out to cure it. Our biggest goal is to stop cancer before it can adapt and evolve. That’s why we’re developing innovative personalized therapies, and other treatments to harness the body’s natural defenses.