Les Transports Au Canada 2001
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Royal Gazette Index 2012
The Royal Gazette Gazette royale Fredericton Fredericton New Brunswick Nouveau-Brunswick ISSN 0703-8623 Index 2012 Volume 170 Table of Contents / Table des matières Page Proclamations . 2 Orders in Council / Décrets en conseil . 2 Legislative Assembly / Assemblée législative. 7 Elections NB / Élections Nouveau-Brunswick . 7 Departmental Notices / Avis ministériels . 7 NB Energy and Utilities Board / Commission de l’énergie et des services publics du N.-B. 11 New Brunswick Securities Commission / Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick . 12 Notices Under Various Acts and General Notices / Avis en vertu de diverses lois et avis divers . 12 Sheriff’s Sales / Ventes par exécution forcée . 13 Notices of Sale / Avis de vente . 13 Regulations / Règlements . 15 Corporate Affairs Notices / Avis relatifs aux entreprises . 17 Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales . 17 Companies Act / Loi sur les compagnies . 55 Partnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales . 58 Limited Partnership Act / Loi sur les sociétés en commandite . 88 2012 Index Proclamations Atlantic Provinces Special Education Authority / Office de l’éducation spéciale pour les provinces de l’Atlantique Acts / Lois McLaughlin, John—OIC/DC 2012-277—p. 1456 (September 26 septembre) Apprenticeship and Occupational Certification Act / Apprentissage et la certification professionnelle, Loi sur l’—OIC/DC 2012-225—p. 1381 Board of Management / Conseil de gestion (September 5 septembre) Fitch, Bruce—OIC/DC 2012-318—p. 1602 (October 31 octobre) Electricity Act, An Act to Amend the / Électricité, Loi modifiant la Loi sur l’— Holder, Trevor—OIC/DC 2012-318—p. -
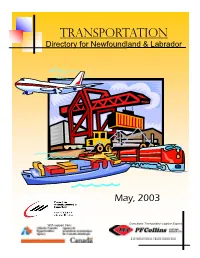
Transportation Directory Newfoundland and Labrador " Was Prepared by PF Collins Under the Direction of CME
Transportation Directory for Newfoundland & Labrador May, 2003 Consultants: Transportation Logistics Experts With support from: TABLE OF CONTENTS SECTION 1 – AIR ............................................................................................................................ 1 AIR FREIGHT LISTING.....................................................................................................3 SECTION 2 – RAIL..........................................................................................................................10 RAIL LISTING...................................................................................................................11 SECTION 3 – OCEAN .....................................................................................................................12 OCEAN LISTING ..............................................................................................................14 NEWFOUNDLAND & LABRADOR PORTS...................................................................23 Compulsory Pilotage Areas ..................................................................................23 General Port Information .....................................................................................23 SECTION 4 – ROAD........................................................................................................................28 ROAD OPTIONS................................................................................................................29 SUFFERANCE AND CUSTOMS BONDED -

(2)\TIU Oct 06.Wpd
Transportation Information Update* Editor: Joseph Monteiro** October 2006, No. 26 Associate Editor: Gerald Robertson** The Asia-Pacific Gateway Corridor Initiative On October 11, 2006, the Government of Canada launched the new Asia-Pacific Gateway and Corridor Initiative announcing concrete measures and long-term direction to strengthen Canada’s competitive position in international commerce. The Initiative is an integrated set of investment and policy measures that will enhance the efficiency and exploitation of the Gateway and Corridor [i.e., infrastructure from Winnipeg to Vancouver (via Regina-Calgary) and Prince Rupert (via Saskatoon-Edmonton) including British Columbia Lower Mainland and Prince Rupert ports, road and rail connections]. The Asia-Pacific Gateway Corridor Initiative, October 12, 2006, www.tc.gc.ca Canada’s New Government Takes Steps Towards New International Air Policy On October 25, 2006, the Honourable Lawrence Cannon, Minister of Transport, Infrastructure and Communities, released a consultation document in support of a new international air transportation policy. Transport Canada is seeking stakeholder views on the document, which calls for a modernized approach to international air transportation, including Canada’s bilateral air transportation negotiations. Transport Canada also seeks the views of stakeholders on longer-term issues such as: a comprehensive Canada-European Union air agreement; a review of ownership and control regimes of foreign air carriers; the movement towards the creation of a North American aviation market; and the adoption of a multi- lateral approach to some negotiations, which means one agreement with a group of countries. Canada’s New Government Takes Steps Towards New International Air Policy, October 25, 2006, www.tc.gc.ca AIR TRANSPORTATION Current Developments in 1. -

Nj\S/\ Hn.:?Ton, Virginia
NASA CONTRACTOR REPORT 166274 NASA-CR-166274 19830001759 Investigation of Advanced Navigation and Guidance System Concepts for All-Weather Rotorcraft Operations H. W. Upton G. E. Boen J. Moore CONTRACT NAS2-1 0743 August 1982 (~ .:.;... ! i-.1 ?-..: ' j 19B? .. ~... \. ~ LANGLEY R;::SEARr:H CENTER L!2RP.RY. NASA NJ\S/\ HN.:?TON, VIRGINIA ~(IIIIIIIIIIII 1111 11111 11111111111111111111111 NF02336 NASA CONTRACTOR REPORT 166274 Investigation of Advanced Navigation and Guidance System Concepts for All-Weather Rotorcraft Operations H. W. Upton G. E. Boen J. Moore Bell Helicopter Textron Fort Worth, Texas Prepared for Ames Research Center under Contract NAS2-l0743 NI\S/\ National Aeronautics and Space Administration Ames Research Center Moffett Field. California 94035 This Page Intentionally Left Blank PREFACE This investigation of Advanced Navigation and Guidance System Concepts for All-Weather Rotorcraft Operations has been con ducted. under National Aeronautics and Space Administration Contract No. NAS2-10743. Gratitude is expressed for the guidance and assistance of Messrs. William Snyder, John Foster, and John Bull, NASA-Ames, and also to the· BHT employees who aided in the investigation and preparation of this report. 1 I J iii This Page Intentionally Left Blank TABLE OF CONTENTS PREFACE. iii LIST OF FIGURES. viii LIST OF TABLES . xi SUMMARY. 1 1. INTRODUCTION. 3· 2. SURVEY ..... 5 2.1 MAJOR FINDINGS . 5 2.2 IFR QUESTIONNAIRE ANALYSIS . 7 2.2.1 Company Related . 7 2.2.2 Aircraft and Equipment Related. 7 2.2.3 Mission Related . 9 2.2.4 Agency .... 11 2.2.5 Facilities .. 11 2.3 INTERVIEW COMMENTS 12 3. MISSION MODEL . -

Chris Brady's Non-British Safety Card Collection Available for Trade For
Chris Brady's Non-British Safety Card Collection List date: 19/05/2021 Available for trade for British Cards Total 2257 cards Aircraft type Code or description Year (un-named operator) 12 cards B 707 Nov 82 S.P.E.product 1982 BAe 111 200 B & W Beech 23, 24, 76 BO 105 11"x7.5" B&W laminated DC 6B N37571 DHC 6 6"x12" DHC 6 300 EC 155 25210 ©2005 Safeair Inc G-73 Mallard P180 Avanti REF.PGO-107-5-2-93 (CSI) 1993 PA 31 350 Navajo Typed on A4 paper S 76 Spirit CSI 1984 bifold 6.5"x11" 1984 (un-named operator) Canadien 1 cards BAe 748 Bifold card Typo-Press Timmins (un-named operator) German 1 cards GA Commander 862025-517F (10x17cm B&W card) Adria 2 cards CRJ DC 9 82 A4 Adria Airways 2 cards BAe 111 500 DC 9 30/50 bifold 1988 AeBal 1 cards DC 9 / B717 Bifold Aegean Airlines 1 cards Page 1 of 108 Aircraft type Code or description Year BAe 146 /RJ100 "Avro RJ 100" Aero Arctic Helicopter 3 cards Bell 204 REF B24-47-2-7-89 (CSI) 1989 Bell 206 JetRanger REF.206-47-11-7-89 (CSI) 1989 Bell 206L LongRanger REF. 26L-47-8-7-89 (CSI) 1989 Aero California 1 cards DC 9 10 Orig. 2/02 2002 Aero Continente s.a. 1 cards B 727 100 trifold 1999 Aero Lyon 1 cards DC 10 30 AEY-DOC-011 2001 Aero Peru 1 cards B 727 100 1.06.29.073.00/UG PL-CL 1999 Aero Virgin Islands 1 cards DC 3 Aeroflot 23 cards A 320 Valid from 17.01.2020 2020 A 330 Valid from 01.07.2016 2016 AN 2 tall vintage paper folder AN 24B tall vintage paper folder IL 62 A4 plastic red borders IL 62 white "3AO NPP" IL 86 6.5"x10" white IL 86 7"x11" white 2003 IL 86 A4 red & white IL 96 300 Skyteam 2003 -

Public Accounts of the Province Of
PUBLIC ACCOUNTS, 1980-81 OFFICE OF THE LIEUTENANT GOVERNOR Hon. John Black Laird, Lieutenant Governor DETAILS OF EXPENDITURE Voted Salaries and Wages ($100,037) Salaries and Wages under $30,000-86,016. Temporary Help Services ($14,021): Accounts under $20,000- 14,021. Employee Benefits ($10,193) Payments to the Treasurer of Ontario re: Canada Pension Plan, 1,093; Group Insurance, 220; Long Term Income Protection, 449; Ontario Health Insurance Plan, 1,760; Public Service Superannuation Fund, 2,837; Payment on Unfunded Liability of the Public Service Superannuation Fund, 1,285; Superannuation Adjustment Fund, 597; Unemployment Insurance, 1,209; Dental Plan, 267; Supplementary Health and Hospital Plan, 401. Other Payments — Credit Union, 75. Other Payments ($58,937) Materials, Supplies, etc. ($8,937): Accounts under $20,000-8,937. Expenses ($50,000): His Honour John Black Aird, allowance for contingencies, 50,000. Total Other Payments 58,937 Summary of Expenditure Voted Salaries and Wages 100,037 Employee Benefits 10,193 Other Payments 58,937 Total Expenditure, Office of the Lieutenant Governor $169,167 ) PUBLIC ACCOUNTS, 1980-81 OFFICE OF THE PREMIER Hon. William G. Davis, Premier and President of the Council DETAILS OF EXPENDITURE Voted Salaries and Wages ($1,280,554* Listed below are the salary rates of those employees on staff at March 31 , where the annual rate is in excess of $30,000. Dr. E. E. Stewart Deputy Minister 64,600 Anderson, H. R., 31,150; S. Y. Barnes, 40,675; R. I. Beatty, 40,675; H. J. Bourke, 31,150; L. M. Campbell, 31,150; R. A. Cook, 37,100; P. -

OFFSHORE HELICOPTER SAFETY INQUIRY February 2, 2010 Tara Place, Suite 213, 31 Peet Street St
OFFSHORE HELICOPTER SAFETY INQUIRY February 2, 2010 Tara Place, Suite 213, 31 Peet Street St. John’s, NL February 2, 2010 PRESENT: John F. Roil, Q.C./ Anne Fagan....................................................................................................Inquiry Counsel John Andrews/Amy Crosbie. ............ Canada-Newfoundland and Labrador Offshore .................................................................................................. Petroleum Board (C-NLOPB) Cecily Strickland/Ian Wallace............................................... Hibernia Management and ............................................................................................ Development Company (HMDC) Denis Mahoney/D. Blair Pritchett............................................... Suncor (Petro-Canada) Alexander C. MacDonald, Q.C./ Stephanie Hickman.. ................................................................ Husky Oil Operations Ltd. Laura Brown Laengle ............................Government of Newfoundland and Labrador Norman J. Whalen, Q.C./ Michael Cohen..................................Cougar Helicopters Inc. Jamie Martin..................................................................Families of Deceased Passengers Kate O’Brien....................................................................................Davis Estate (Pilot) and ............................ agent on behalf of Douglas A. Latto for Lanouette Estate (Co-pilot) V. Randell J. Earle, Q.C. ............Communications, Energy and Paperworkers Union ................................................................................................................................... -

Erospace & Defence Eview
IV/2013 ARerospace &Defence eview Heroism in the Hills Time for the Tejas ? The Rotorcraft Scene Indian Naval Aviation turns 60 Paris Air Show 2013 Eurocopter at Marignane CFM IV/2013 IV/2013 Aerospace &Defence Review Hell & Heroism in Do we want the not much ‘Of Indian Interest’ at 32 52 the Show but HAL’s Chalet was the Hills Tejas – or Not ? rendezvous for many. The last fortnight of June 2013 Air Commodore Parvez Kokhar had scores of helicopters puts its straight when he poses and aircraft engaged in what this question : after 30 years became one of the largest air in the making and cost over Heroism in the Hills Time for the Tejas ? rescue operations in the world. runs, should the IAF now induct The Rotorcraft Scene Indian Naval Aviation turns 60 The IAF deployed 64 aircraft, the Tejas LCA ? The emphatic Paris Air Show 2013 Eurocopter at Marignane mostly helicopters (in Operation answer is both YES and NO ! IAF Mi-17V5 takes off from Dharasu ALG, Rahat) while Army Aviation Read on ! with C-130J at the background (in Operation Surya Hope) (photo courtesy PRO IAF). supported relief operations with another 13 helicopters plus Base Arienne a mountain brigade, in addition 102 EDITORIAL PANEL to which were 12 civil-registered BA 118 at helicopters, evacuating over MANAGING EDITOR Mont-de-Marsan 52,000 people and transporting Continuing Vayu’s tour in Vikramjit Singh Chopra some 400 tonnes of relief stores. France, courtesy the French EDITORIAL ADVISOR Ministry of Defence, was visit to the Armee de l’Air’s largest Admiral Arun Prakash air base for briefings on air EDITORIAL PANEL defence systems, space imagery and defence/intelligence Pushpindar Singh telecommunications as also the Air Marshal Brijesh Jayal The Rotorcraft Scene 61 This Vayu survey on the Global Military Air Experiment Centre Air Cdre. -

Cultural Shift at Chc Helicopter Corporation: Challenges and Opportunities in an Era of Radical Change
CULTURAL SHIFT AT CHC HELICOPTER CORPORATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN AN ERA OF RADICAL CHANGE by Chris Flanagan BJ. University of King's College, 1991 B.A. McGill University, 1989 PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION In the Faculty of Business Administration © Chris Flanagan 2007 2007 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission ofthe author. APPROVAL Name: Christopher J. Flanagan Degree: Master of Business Administration Title ofThesis: Cultural Shift at CHC Helicopter Corporation: Challenges and Opportunities in an Era of Radical Change Examining Committee: Supervisor: Mark Wexler, Professor, Faculty of Business Second Reader: Neil Abramson, Associate Professor, Faculty of Business Date Defended/Approved: _[_l~ >s / aCC.--:t- . II SIMON FRASER UNIVERSITY LIBRARY Declaration of Partial Copyright Licence The author, whose copyright is declared on the title page of this work, has granted to Simon Fraser University the right to lend this thesis, project or extended essay to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. The author has further granted permission to Simon Fraser University to keep or make a digital copy for use in its circulating collection (currently available to the public at the "Institutional Repository" link of the SFU Library website <www.lib.sfu.ca> at: <http://ir.lib.sfu.ca/handle/1892/112>) and, without changing the content, to translate the thesis/project or extended essays, if technically possible, to any medium or format for the purpose of preservation of the digital work. -

Organisation Approvals Foreign Easa Part-145 Invalid/Suspended/Surrendered/Revoked Approvals for Organisations Located in Canada
ORGANISATION APPROVALS FOREIGN EASA PART-145 INVALID/SUSPENDED/SURRENDERED/REVOKED APPROVALS FOR ORGANISATIONS LOCATED IN CANADA EASA CERT NR STATUS DATE OF CHANGE COMPANY NAME ADDRESS TCCA AMO NR EASA.145.7001 Surrendered 18 Jul 2008 MAGELLAN AEROTECH V2T 6H5 Abbotsford, Canada 1- Manitoba R3H 0S9 Winnipeg, EASA.145.7005 Surrendered 20 Aug 2012 AERO RECIP (CANADA), Ltd. 45-89 Canada H4S 2B6 Saint-Laurent, EASA.145.7007 Surrendered 10 Sep 2012 AVEOS FLEET PERFORMANCE, Inc. 6-58 Canada EASA.145.7010 Surrendered 18 Dec 2008 HONEYWELL AEROSPATIALE, INC H4M 2L5 Montreal, Canada 1-72 EASA.145.7016 Surrendered 1 May 2015 Bell Textron Canada Limited J7J 1R4 Mirabel, Canada 31-92 SPAR AEROSPACE, LTD - SPAR AVIATION SERVICES EASA.145.7018 Surrendered 29 May 2008 T5J 2T2 Edmonton, Canada 03-57 DIVISION EASA.145.7020 Revoked 25 Jul 2005 CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL T2E 6Z8 Calgary, Canada 1-88 Manitoba R2J 3T1 Winnipeg, EASA.145.7024 Surrendered 9 Sep 2011 COMPOSITE TECHNOLOGY (CANADA) COMPANY 76-91 Canada EASA.145.7030 Surrendered 26 Nov 2012 First Air Maintenance Services K1V OR1 Glouster, Canada 27-74 EASA.145.7030 Surrendered 26 Nov 2012 First Air Maintenance Services K2M 2V8 Kanata, Canada 27-74 EASA.145.7033 Surrendered 23 Jun 2017 Orenda Aerospace Corporation L4T 1A9 Missisauga, Canada 01-67 H4S 0A1 Ville Saint-Laurent, EASA.145.7039 Surrendered 30 Nov 2012 EXELTECH AEROSPACE, INC 9-86 Canada EASA.145.7041 Surrendered 6 Nov 2017 L-3 COMMUNICATIONS ELECTRONIC SYSTEMS, INC M9W 5A7 Toronto, Canada 03-69 EASA.145.7042 Surrendered 31 Oct 2012 Goodrich Control Systems, Ltd. -
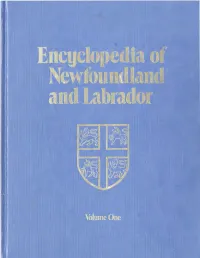
Encyclopedia of Newfoundland and Labrador
AD ...;; "" . .. l · ·~·· / . •, \ : 'I I; .... .;.~ \ 'f' Encyclopedia of Newfoundland and Labrador Editor in Chief Joseph R. S111llllwood P.C. , D.C .L. , LL.D., D . Litt. Managing Editor Robert D. W Pitt H.A.,M.A. Volume One NEWFOUNDLAND BOOK PUBLISHERS (1967) LIMITED @Newfoundland Book Publishers (I 967) Limited First Edition 1981 Canadian Cataloguing in Publication Data Encyclopedia of Newfoundland and Labrador Contents: v.l. A-E. ISBN 0-920508-13-8 (set). -ISBN 0-920508-14-6 (v.1) 1. Newfoundland- Dictionaries and encyclopedias. 2. Labrador- Dictionaries and encyclopedias. I. Smallwood, Joseph R., 1900- II. Pitt, Robert D.W. 1953- FC2154.E52 971.8'003'21 C81-095040-5 F1121.4.E52 Front Endpapers: Giacamo GastaJdi Map, originally engraved from a single wood block that was destroyed by fire in 1557. The map shown was later re-engraved on copper with minor changes from the woodcut. Back Endpapers: J.N. Bellin Map, originally published in 1745, was the official French version of the outline of Newfoundland at that time. Published by Newfoundland Book Publishers (1967) Limited St. John's, Newfoundland, Canada Cover and Text design by Vivant Studio Limited (Sheila Cotton) Rose Bay, Nova Scotia, Canada The Economy design by Wayne C. Stockwood and David Tuck St. John's, Newfoundland, Canada Production co-ordination by B. Dale Russell FitzPatrick St. John's, Newfoundland, Canada Typesetting by General Printers Division of Consolidated Graphics Limited Oshawa, Ontario, Canada Typesetting (The Economy) by Collins Graphics Services Limited St. John's, Newfoundland, Canada Printed and bound by John Deyell Company Lindsay, Ontario, Canada All rights reserved. -

The Globe and Mail Subject Photography
Finding Aid for Series F 4695-1 The Globe and Mail subject photography The following list was generated by the Globe & Mail as an inventory to the subject photography library and may not be an accurate reflection of the holdings transferred to the Archives of Ontario. This finding aid will be replaced by an online listing once processing is complete. How to view these records: Consult the listing and order files by reference code F 4695-1. A&A MUSIC AND ENTERTAINMENT INC. music stores A.C. CROSBIE SHIP AARBURG (Switzerland) AARDVARK animal ABACO ABACUS adding machine ABBA rock group ABBEY TAVERN SINGERS ABC group ABC TELEVISION NETWORK ABEGWAIT ferry ABELL WACO ABERDEEN city (Scotland) ABERFOYLE MARKET ABIDJAN city (Ivory Coast) ABITIBI PAPER COMPANY ABITIBI-PRICE INC. ABKHAZIA republic ABOMINABLE SNOWMAN Himalayan myth ABORIGINAL JUSTICE INQUIRY ABORIGINAL RIGHTS ABORIGINES ABORTION see also: large picture file ABRAHAM & STRAUS department store (Manhattan) ABU DHABI ABU SIMBEL (United Arab Republic) ACADEMIE BASEBALL CANADA ACADEMY AWARDS ACADEMY OF CANADIAN CINEMA & TELEVISION ACADEMY OF COUNTRY MUSIC AWARDS ACADEMY OF MEDICINE (Toronto) see: TORONTO ACADEMY OF MEDICINE 1 ACADIA steamship ACADIA AXEMEN FOOTBALL TEAM ACADIA FISHERIES LTD. (Nova Scotia) ACADIA steamship ACADIA UNIVERSITY (Nova Scotia) ACADIAN LINES LTD. ACADIAN SEAPLANTS LIMITED ACADIAN TRAIL ACAPULCO city (Mexico) ACCESS NETWORK ACCIDENTS - Air (Up to 1963) - Air (1964-1978) - Air (1979-1988) - Air (1988) - Lockerbie Air Disaster - Air (1989-1998) see also: large picture file - Gas fumes - Level crossings - Marine - Mine - Miscellaneous (up to 1959) (1959-1965) (1966-1988) (1989-1998) see also: large picture file - Railway (up to 1962) (1963-1984) (1985-1998) see also: large picture file - Street car - Traffic (1952-1979) (1980-1989) (1990-1998) see also: large picture file ACCORDIAN ACCUTANE drug AC/DC group ACHILLE LAURO ship ACID RAIN ACME LATHING AND DRYWALL LIMITED ACME SCREW AND GEAR LTD.