Reconstitutions
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE TRUTH GAME (Silvan Mühlemann, Geneva 2019)
THE TRUTH GAME (Silvan Mühlemann, Geneva 2019) 1 I. DEFENDING AXIOMATIC-DEDUCTIVE SCIENCE ( ) 1. CHOOSING ONE’S AXIOMS: THE EPISTEMOLOGY OF HAPPINESS. According to Karl Popper2, science begins with falsifiable hypotheses. These hypotheses are, as explained by Ashish Dalela, chosen as a function of happiness they provide us. It is intuitively clear that happiness, not truth, is the highest goal in life. “To know the truth we must know the good, but to pick the good, we must desire that good. Ultimately, our cognition of truth depends on our desire. If that desire is modified, then the truths are modified. Similarly, happiness is produced only when the desires are fulfilled. Therefore, if you find the thing that you desire, then you have the double satisfaction of finding truth and goodness. Your brain tells you that you have found the truth, and your heart tells you that you have fulfilled your desire. If you tell a happy person that his ideas about the world are false, he will most likely ignore you, because he knows that since he is happy he must be doing something correctly, and consequently his beliefs must also be true. On the other hand, if you tell an unhappy person that he is suffering because of his false beliefs, and that he must change his beliefs in order to find happiness, he is more likely to listen to your arguments. In short, new knowledge doesn’t come when you are happy, because there is complacency whereby one’s current beliefs are accepted as true just because one is already happy and contented. -

Mathematical Modeling and Anthropology: Its Rationale, Past Successes and Future Directions
Mathematical Modeling and Anthropology: Its Rationale, Past Successes and Future Directions Dwight Read, Organizer European Meeting on Cybernetics and System Research 2002 (EMCSR 2002) April 2 - 5, 2002, University of Vienna http://www.ai.univie.ac.at/emcsr/ Abstract When anthropologists talk about their discipline as a holistic study of human societies, particularly non-western societies, mathematics and mathematical modeling does not immediately come to mind, either to persons outside of anthropology and even to most anthropologists. What does mathematics have to do with the study of religious beliefs, ideologies, rituals, kinship and the like? Or more generally, What does mathematical modeling have to do with culture? The application of statistical methods usually makes sense to the questioner when it is explained that these methods relate to the study of human societies through examining patterns in empirical data on how people behave. What is less evident, though, is how mathematical thinking can be part of the way anthropologists reason about human societies and attempt to make sense of not just behavioral patterns, but the underlying cultural framework within which these behaviors are embedded. What is not widely recognized is the way theory in cultural anthropology and mathematical theory have been brought together, thereby constructing a dynamic interplay that helps elucidate what is meant by culture, its relationship to behavior and how the notion of culture relates to concepts and theories developed not only in anthropology but in related disciplines. The interplay is complex and its justification stems from the kind of logical inquiry that is the basis of mathematical reasoning. -

Sacredness in an Experimental Chamber
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES (2006) 29, 161–209 Printed in the United States of America Moneyastool,moneyasdrug:The biological psychology of a strong incentive Stephen E. G. Lea University of Exeter, School of Psychology, Washington Singer Laboratories, Exeter EX4 4QG, United Kingdom [email protected] http://www.exeter.ac.uk/SEGLea Paul Webley University of Exeter, School of Psychology, Washington Singer Laboratories, Exeter EX4 4QG, United Kingdom [email protected] http://www.exeter.ac.uk/pwebley Abstract: Why are people interested in money? Specifically, what could be the biological basis for the extraordinary incentive and reinforcing power of money, which seems to be unique to the human species? We identify two ways in which a commodity which is of no biological significance in itself can become a strong motivator. The first is if it is used as a tool, and by a metaphorical extension this is often applied to money: it is used instrumentally, in order to obtain biologically relevant incentives. Second, substances can be strong motivators because they imitate the action of natural incentives but do not produce the fitness gains for which those incentives are instinctively sought. The classic examples of this process are psychoactive drugs, but we argue that the drug concept can also be extended metaphorically to provide an account of money motivation. From a review of theoretical and empirical literature about money, we conclude that (i) there are a number of phenomena that cannot be accounted for by a pure Tool Theory of money motivation; (ii) supplementing Tool Theory with a Drug Theory enables the anomalous phenomena to be explained; and (iii) the human instincts that, according to a Drug Theory, money parasitizes include trading (derived from reciprocal altruism) and object play. -

Miracle Grec»: La « Mentalité Primitive» Et La Chine
Bibliothèque des Sciences humaines PAUL JORION COMMENT LA VÉRITÉ ET LA RÉALITÉ FURENT INVENTÉES GALLIMARD -.-".. AVANT-PROPOS Cet ouvrage se veut une contribution à l'anthropologie des savoirs. J'y analyse la naissance des notions de « vérité» et de « réalité» (objective), notions qui semblent aller de soi, mais qui sont en fait apparues à des moments précis de l'histoire de la culture occidentale et sont totalement absentes du bagage conceptuel de certaines autres, en par ticulier de la culture chinoise traditionnelle. Ces moments de leur émergence sont datés et relativement récents; mieux, leur apparition a donné lieu à des débats houleux et bien documentés entre partisans et adversaires de thèses antagonistes. La « vérité» est née dans la Grèce du :rve siècle avant Jésus-Christ, et la « réalité» (objective), dans l'Europe du XVIe siècle. L'une découle de l'autre: à partir du moment où s'impose l'idée d'une vérité, dire la vérité revient à décrire la réalité telle qu'elle est. Platon et Aristote imposèrent la vérité comme le moyen de dépasser les objections sceptiques de leurs adversaires sophistes. Dans le débat qui les opposa à ceux-ci, ils dépla cèrent le critère de validité d'un discours. Ce dernier passa de l'absence d'autocontradiction dans son développement à la validité de ses propositions individuelles, transformant la notion jusque-là polémique du « vrai » en principe épisté mologique de la « vérité». La distinction établie à cette occasion par Aristote entre l'analytique, qui permet la démonstration scientifique à partir de prémisses vraies, et la dialectique, qui permet l'argumentation juridique ou 8 Comment la vérité et la réalité furent inventées politique à partir de prémisses vraisemblables (les «opi nions généralement admises »), autorisa un cessez-le-feu idéologique dans le débat avec les sophistes et avec les cou rants sceptiques en général (l'analytique et la dialectique seraient ultérieurement regroupées sous l'appellation de logique). -
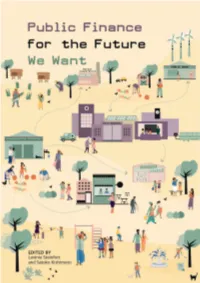
Book Provides Us with the Compelling Evidence That This Is Not Only Necessary but Also Possible.” - Prabir Purkayastha, Founder and Chief Editor At
“An incredibly important and timely collection of essays, offering a detailed diagnosis of the issues afflicting modern financialized economies and a vision of a future beyond neoliberalism. Required reading for all those involved in the project to build a new economy.” - Grace Blakeley, research fellow at the Institute for Public Policy Research and economics commentator at The New Statesman “This thought-provoking series of essays reminds us of a truth often denied: there is no shortage of money for transformation of the economy away from addiction to fossil fuels. The questions tackled by the authors are this: who controls the monetary system and how can the wider public regain control over a) their own savings and b) a great public good - the monetary system.” - Ann Pettifor, director of Policy Research in Macroeconomics (PRIME) and author of The Production of Money “The dominant narrative today is that financial and private capital, will lead – at some distant date – to public good. Increasingly, even public infra- structure is being handed over to big capital. We urgently need a global movement to rein in global finance and safeguard our future. This impor- tant book provides us with the compelling evidence that this is not only necessary but also possible.” - Prabir Purkayastha, founder and chief editor at www.newsclick.in “Here is yet another major contribution from TNI to our understanding of the complex world of high-finance. TNI has gained an international reputation for its extraordinary work on helping us understand the real world machinations of the high-level investment world of financiers.” - Saskia Sassen, Columbia University and author of Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy “The stark reality is that the world stands on the brink of another crash owing to the failure to reform a global financial system dominated by private banking behemoths. -

Libri Nuovi 2017 BIBLIOTECA SANT'alfonso
Libri nuovi 2017 BIBLIOTECA SANT’ALFONSO Via Merulana 31, Roma Catalogo: http://oseegenius2.urbe.it/alf/home Contatti: [email protected] - tel. 0649490214 FRANCESE Hi 62 327 Antoine Wenger, une traversée dans [Roma] : le XXème siècle et dans l'Église : [Assunzionisti], 2015. actes du Colloque d'Histoire, Rome, 5 décembre 2014 / édités par Bernard Le Léannec, A.A. Hi 55 566 Catholicisme en tensions / sous la Paris : Éditions de direction de Céline Béraud, Frédéric l'École des Hautes Gugelot et Isabelle Saint-Martin. Études en Sciences Sociales, 2012. Mo 415 1187 Choc démographique, rebond Paris : Descartes & économique / sous la direction de Cie, 2016. Jean-Hervé Lorenzi. SL 31 IV 34 Dictionnaire de la pensée Paris : Presses écologique / sous la direction de Universitaires de Dominique Bourg et Alain Papaux. France, 2015. SL 31 IV 33 Dictionnaire de la violence / publié Paris : Presses sous la direction de Michela Marzano. Universitaires de France, 2011. SL 41 II 8 Dictionnaire de psychologie / Norbert Paris : Larousse, Sillamy. 2010. SL 34 26 Dictionnaire du Vatican et du Saint- Paris : Robert Laffont, Siège / sous la direction de 2013. Christophe Dickès ; avec la collaboration de Marie Levant et Gilles Ferragu. SL 41 II 40/1- Dictionnaire fondamental de la Paris : Larousse, 2 psychologie / sous la direction de H. 2002. Bloch [ed altri 8] ; conseil éditorial Didier Casalis. Mo 427 225 Discriminations et carrières : Paris : Éditions entretiens sur des parcours de Noir-e- Pepper - s et d'Arabes / Alessio Motta (dir.) L'Harmattan, 2016. Mo 385 233 Le droit, le juste, l'équitable / sous la Paris : Salvator, 2014. direction de Simone Goyard et de Francis Jacques. -

1. Academic Curriculum Vitae...3
Charles RAMOND Professional Page TABLE OF CONTENTS 1. ACADEMIC CURRICULUM VITAE ..................................................... 3 Current Functions .................................................................................................... 3 Synthetic Curriculum Vitae ....................................................................................... 3 Collective Responsibilities ........................................................................................ 3 Component Directorates....................................................................................... 3 Directorates of Research Structures .................................................................... 4 Responsibilities Hold in National Agencies........................................................... 4 Organization of Seminars, Colloquiums, Conferences ......................................... 4 Doctoral and Research Supervision Award / Scientific Excellence Award ........... 4 2. PERSONAL BIBLIOGRAPHY ............................................................. 5 Synthetic Table ........................................................................................................ 5 Books (13) ................................................................................................................ 5 Edited Books (14) .................................................................................................... 6 Articles in Peer Reviewed Journals (31) ................................................................ 10 -
FLI-Nuclear-Open-Letter-Poster.Pdf
Professor of Computer Science Curie Fellow, PostDoc Computing Science, Fellow, Sloan Foundation Nicolas Guiblin CentraleSupélec, Université de Paris-Saclay, lab Clancy William James ECAP, University of Erlangen-Nuremberg, of Electrical Engineering, Fellow, Institution of Engineers (India) and Bjorn Landfeldt Lund University, Professor of Electrical Engineering Immunology, FRS FMedSci Laureate in Physics Fellow, Association for Psychological Science Mingming Wu Cornell University, Professor of Biological and Phoebe C. Ellsworth UNiversity of Michigan, Professor of Psychology Technische Universität Vienna Vincent Craig Research School of Physics, Australian National Daniel Winkler David Duvenaud University of Toronto, Assistant Professor of engineer in X-ray diffraction Astroparticle physicist, 2010 Bragg Gold Medal winner Institution of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE) Oscar Agertz Lund University, Assistant Professor in Astrophysics A David Caplin Imperial College London, Emeritus Professor of H. Robert Horvitz MIT, Professor of Biology, 2002 Nobel Prize in Seth Stein Northwestern University, Deering Professor of Earth & Environmental Engineering Janice R. Naegele Wesleyan University, Professor of Biology, Ryan Kiggins University of Central Oklahoma, Instructor of Political University, Professor of Physical Chemistry Ahmad Salti University of Innsbruck, Researcher in Molecular Computer Science Leonhard Neuhaus Laboratoire Kastler Brossel, PostDoc in physics Dmitry Malyshev Erlangen-Nuremberg University, Postdoc Dr. Kalyan -

111M[M 11 11I Illlli
A Vital Ratio nalist Selected Writings from Georges Canguilhem Edited by Francois Delaporte Translated by Arthur Goldhammer with an introducti.on by Paul Rabinow and a critical bibliography by Camille Limoges ZONE BOOKS • NEW YORK 2000 111m[m�11�11i�illlli�111 � 39001105503513 � © 1994 Urzone, Inc. Q ZONE BOOKS \15 611 Broadway, Suite 608 �c?.> New York, NY 10011 4 2000 All rights reserved. First Paperback Ed�tion No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, including electronic, mechanical, photocopy ing, microfilming, recording or otherwise (except for that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press) without written permission from the Publisher. Sources for the excerpts are listed on pp. 480-81 Printed in the United States of America Distributed by The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England Library of Congre�s Cataloging-in-Publication Data Canguilhem, Georges, 1904-1995 A vital rationalist : selected writings from Georges Canguilhem / edited by Frans:ois Delaporte; translated by Arthur Goldhammer with an introduction by Paul Rabinow and a critical bibliography by Camille Limoges. p. cm. Includes bibliographical references. ISBN 0-942299-73-6 i. Science-History. 2. Science-Philosophy. 1. Delaporte, Frans:ois, 1941- • 11. Title. Ql25 .q4 1993 500-dc20 93-8613 CIP ,••'......... -0. ··<'-le1sltesi� ,.11'll•H., �>· (/J' .....• '•, ./ .� ........ .. .., ...."·.I\,/? '"";., \. .... -
The Chinese Room's Secret Paul Jorion Abstract Starting from A
The Chinese room's secret Paul Jorion Abstract Starting from a reflection by Jean Pouillon, it is shown - both deductively and on the basis of experimental data - that consciousness is deprived of any decisional power. Consciousness© role is reduced to transmitting to the body instructions based on the emotional response to percepts. Language allows human beings to generate a self-justifying narrative of their deeds. Such an account does not reflect, however, the actual psychological mechanism at work. Consciousness© actual effectiveness resides in influencing on the one hand the affect of the speaker (as speech or as ªinner speechº), and on the other hand the affect of any listener. The pair ªbodyº and ªsoulº gets thus validated, but their traditionally assigned responsibilities need reassigning between one body that decides and acts and one soul whose feedback operates at the affective level only. Keywords consciousness, Benjamin Libet, willpower The paper is the English translation of an article initially published in the French anthropological journal L'Homme, 150, 1999: 177-202. At the time of writing the author was Regents' Lecturer at UC Irvine. The 1999 French text can be found online as part of the Persée archive: Le secret de la chambre chinoise : http://www.persee.fr/doc/hom_0439- 4216_1999_num_39_150_453573 The first draft of ªJean Pouillon and the mystery of the Chinese roomº was very different from the article published in L©Homme in July 1997 (Jorion 1997b). In the original text, I carried out much more faithfully the task I had accepted: to account for Pouillon©s contribution to anthropological theory. -

SOCIAL NETWORK ANALYSIS Sociology 920:573:01/02 Paul Mclean Department of Sociology Rutgers University Spring 2021
SOCIAL NETWORK ANALYSIS Sociology 920:573:01/02 Paul McLean Department of Sociology Rutgers University Spring 2021 E-mail: [email protected] Location and time: Tuesdays, 4:10-6:50pm, Davison 128 and/or online Zoom address: https://rutgers.zoom.us/j/91910612309?pwd=UTR2K0xmeERJU1doUStieHM5Nmd0Zz09 Online drop-in hours: M4:00-5:00pm, W7:00-8:00pm, F11:00am-noon, and by appointment Online office hours: M5:00-6:00pm, F12:00-1:00pm Zoom addresses: M: https://rutgers.zoom.us/j/92539621961?pwd=UTVDeHpLeERQakZpSXRoeTl5ajVsZz09 F: https://rutgers.zoom.us/j/92687303157?pwd=ZzloSmV0ZytRMm5zdyt4UWoyQm10QT09 Over the last few decades, and over the last twenty years especially, there has been an enormous increase in the attention paid to social networks as key determinants of many elements of social life, including motivations, identities, tastes, social mobility, group organization and mobilization, resource distributions and power relations, decision-making, patterns of innovation, diffusion of disease and attitudes, and the organization of belief systems. Conversely, sociologists have also been increasingly interested in the factors—structural, cultural, motivational, emotional—that drive the formation and evolution of networks. While social networks was once a highly specialized area of inquiry, nowadays networks are frequently invoked in mainstream sociological research—even though the specific tools of network analysis remain distinctly different from those most commonly used in ‘mainstream’ research, whether it be quantitatively or qualitatively oriented. Certainly there are ways to incorporate network elements (as variables, as metaphor, as narrative design) into many research projects. But in its more radical formulations, the study of networks vies to become a kind of fundamental theory of social organization, not just an add-on. -

NETWORK ANALYSIS Sociology 920:570:01 Paul Mclean
SOCIAL NETWORK ANALYSIS Sociology 920:570:01 Paul McLean Department of Sociology Rutgers University Fall 2017 Location and time: Davison 128, Mondays, 4:10-6:50pm Office hours: M 12:00-1:30; Th 10:00-12:00, Davison 101C, and by appointment E-mail: [email protected] Over the last few decades, and over the last fifteen years especially, there has been an enormous increase in the attention paid to social networks as key determinants of many elements of social life, including motivations, identities, tastes, social mobility, group organization and mobilization, resource distributions and power relations, decision- making, patterns of innovation, diffusion of disease and attitudes, and the organization of belief systems. Conversely, sociologists have also been increasingly interested in the factors—structural, cultural, motivational, emotional—that drive the formation and evolution of networks. While social networks was once a highly specialized area of inquiry, nowadays networks are frequently invoked in mainstream sociological research—even though the specific tools of network analysis remain distinctly different from those most commonly used in such ‘mainstream’ research, whether it be quantitatively or qualitatively oriented. Certainly there are ways to incorporate network elements (as variables, as metaphor, as narrative design) into many research projects. But in its more radical formulations, the study of networks vies to become a kind of fundamental theory of social organization, not just an add-on. In this respect it dovetails with the development over the last decade of a theory of networks as the constitutive material of the physical, biological, technological, and economic worlds. The fundamental idea of social network analysis specifically is that we must study the social order relationally : entities (people, organizations, actions, events, texts) are interdependent and mutually constitutive, and structure emerges as patterns in these interdependencies .