Evolution D'une Unité Agro-Sylvo-Pastorale De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Les Bonnes Adresses Du Pays De L'ours
Les aubergistes du Pays de l’Ours • Auberge de Fougaron Les Bonnes adresses du Pays de l’Ours COURET Jacques - 31 160 FOUGARON f 05 61 97 50 06 .................................................................................. Des professionnels s’engagent... • Auberge du Mount COURET Sylvie - 31 440 EUP - f 05 61 79 42 43 .................................................................................. • La Gentilhommière Village, 31 440 FOS - f 05 61 79 59 41 .................................................................................. • Le Diablotin ALIAS Jean-Philippe Pont de Chaum 31 440 CHAUM f / Fax 05 61 94 35 35 .................................................................................. • L’Escalette Christian et Christiane Labaderque, 31 160 HERRAN f 05 61 90 67 11 / Fax 05 61 87 02 06 mel : [email protected] Bar, restaurant, pizzeria, sandwiches à emporter .................................................................................. • L’Oppidum SALIS Nicole - Rue de la Poste-Ville Haute 31 510 SAINT BERTRAND DE COMMINGES f 05 61 88 33 50 / Fax 05 61 95 94 04 mel : [email protected] www.oppidum.fr .................................................................................. • Lac de Géry BONZOM Jean-Claude - 31 440 SAINT BÉAT f / Fax 05 61 79 48 56 Restaurant, bar, crêperie, base de loisirs .................................................................................. • La Grange LUCETTE Georges Boutx le Mourtis, 31 440 SAINT BÉAT f 05 61 79 41 08 / Fax 05 61 79 80 66 • La Table de l’Ours mel -

Les Bonnes Adresses Du Pays De L'ours
Les Bonnes Adresses du Pays de L’Ours 2010 - 2011 Pour un séjour éthique dans les Pyrénées ! Les Professionnels du Pays de l’Ours vous accueillent Bienvenue au L’ours en questions, questions sur l’ours Pays de l’Ours ! Combien sont-ils dans les L’ours fait-il partie de la Rut et fécondation Pyrénées ? Où sont-ils ? biodiversité pyrénéenne ? À la découverte Sortie de tanière Arrêt du développement de l'embryon Une vingtaine d’ours vivent actuellement dans les L’ours brun est présent dans les Pyrénées depuis d’un territoire engagé, Dormance hivernale Reprise du développement Pyrénées. Comme pour toute popula�on sauvage, 250 000 ans. C’est peu dire qu’il a eu le temps de l'embryon ou avortement dynamique et responsable ! selon les réserves de graisse il est impossible d’en connaître précisément de s’y adapter... L’ours brun est donc un élément Développement de l'embryon l’effec�f et les localisa�ons en permanence. Ils ne incontestable de la biodiversité pyrénéenne. À �tre de Pyrénéens ou touristes de passage, les Dormance hivernale seraient plus que un ou deux aujourd’hui si nous comparaison, l’agropastoralisme s’est développé dans professionnels du Pays de l’ours vous accueillent Naissance n’avions pas lâché en Pyrénées Centrales trois les Pyrénées il y a 3 000 ans environ, le mouton n’ayant et proposent de vous faire découvrir et Sortie ours en 1996-97 et cinq en 2006. En Pyrénées pas d’ancêtre sauvage pyrénéen, ni même européen. comprendre ce territoire, son patrimoine et ses de tanière Occidentales (Béarn, Aragon, Navarre), il ne reste Il descend du mouflon asia�que, domes�qué il y a habitants. -

Ap Peche- 2015 Cle5be716.Pdf
PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES N° d’ordre Direction départementale ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE 2015 RELATIF des territoires À L’EXERCICE DE LA PECHE EN EAU Service Environnement, DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DES Ressource en Eau et Forêt HAUTES-PYRÉNÉES Bureau Ressource en Eau La Préfète des Hautes-Pyrénées, VU le code l’environnement (livre IV – Titre III – Partie Législative et livre II- Titres III et VI – Parie réglementaire) relatif à l’exercice de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ; VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; VU l’arrêté préfectoral n° xxx modifiant le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau des Hautes-Pyrénées ; VU le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 adaptant la délimitation et la réglementation du Parc National des Pyrénées et l’arrêté pris par son Directeur ; VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2012841-0015 du 29 octobre 2012 pris pour la mise en place de mesures de restrictions de pêche en vue de la commercialisation et de la consommation des poissons dans le cadre du plan national d’action sur les PCB ; VU l’avis favorable émis, par le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques ; VU l’avis favorable émis par le Président de la Fédération Départementale pour la Pêche et pour la Protection du Milieu Aquatique ; CONSIDERANT la nécessité de définir les conditions de pêche pour l’année 2015 en application du code de l’environnement et des arrêtés définissant la pratique de la pêche en eau douce dans les Hautes-Pyrénées ; CONSIDERANT l’arrêté de -
Déclaration D'intention De Projet Au Titre De L'article L 121-18 Du Code
Déclaration d’intention de projet au titre de l’article L 121-18 du Code de l’Environnement Reprise des circulations de la ligne 668 000 Montréjeau – Luchon SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, publie la déclaration d’intention relative au projet de modernisation de la ligne Montréjeau – Luchon, en application des articles L.121-18 et R121-25 du Code de l’environnement. Elle est consultable sous le lien : https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/occitanie/modernisation-ligne-entre-montrejeau-et- luchon/presentation 1. Motivations et raisons d’être du projet La ligne ferroviaire entre Montréjeau et Luchon (36 km) qui dessert les Hautes Vallées du Comminges a vu, pour des raisons de sécurité (obsolescence généralisée de l’infrastructure, risque de chutes de rochers sur la voie en plusieurs points de la ligne, ouvrages d’art à consolider), ses circulations suspendues le 18 novembre 2014. Une desserte de substitution par autocar a depuis été mise en place à la fois pour les services TER desservant Luchon. Suite à cette suspension, une étude sur les besoins de transport des Hautes Vallées du Comminges a été menée en 2015 par SNCF Réseau, sous l’égide de l’Etat, afin d’examiner les potentialités et le devenir de la ligne. La Région Occitanie a également participé financièrement à cette étude dans le cadre du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020. Au premier semestre 2016, la Région Occitanie, Autorité Organisatrice des Transports, a organisé les Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM). A l’issue de cette grande concertation, la Région Occitanie a retenu plusieurs projets prioritaires, dont la modernisation de la ligne Montréjeau-Luchon en vue de reprendre les circulations ferroviaires sur l’axe. -

Mise En Évidence De Brèches Marines Paléocènes Discordantes Sur L'axe Orogénique Crétacé Des Pyrénées, Entre Garonne
Bull. Soc. géol. Fr., 2002, t. 173, no 6, pp. 523-532 Mise en évidence de brèches marines paléocènes discordantes sur l’axe orogénique crétacé des Pyrénées, entre Garonne et Gave de Pau BERNARD PEYBERNÈS1,MARIE-JOSÉ FONDECAVE-WALLEZ1 et PIERRE-JEAN COMBES2 Mots clés. – Brèches, Canyon sous-marin, Paléocène, Orogène, Pyrénées. Résumé. – A la suite de la découverte de foraminifères planctoniques paléocènes (intervalle P1c – P3, Danien supé- rieur-Sélandien inférieur) dans la matrice de brèches post-métamorphes et postérieures à la tectonique fini-crétacée à l’est de la Garonne et dans les hémipélagites microrythmées qui leur sont souvent associées, le problème du prolonge- ment occidental du « sillon » marin paléocène sur l’orogène pyrénéen (Zone interne métamorphique, Zone nord-pyré- néenne) se posait. Dans cinq gisements « nord-pyrénéens » du Comminges/Barousse (St-Béat, Bramevaque/ Troubat/Gembrié et Lortet) et de la Bigorre (Médous-Asté et Lourdes-Pibeste), des brèches semblables, remplissant également des morphologies de canyon sous-marin, ont été identifiées et attribuées au Dano-Sélandien (« globigérini- dés »). Elles sont discordantes sur un substratum jurassico-éocrétacé (qu’elles remanient), déjà plissé au Crétacé supé- rieur (phases néo- à fini-crétacées), par l’intermédiaire d’une paléosurface karstique irrégulière ennoyée en domaine marin. Elles ont subi un épimétamorphisme (hydrothermal ?) précédant la compression « pyrénéenne » d’âge éocène su- périeur. Des brèches de cet âge, mais ne remaniant que des éléments de socle hercynien, -
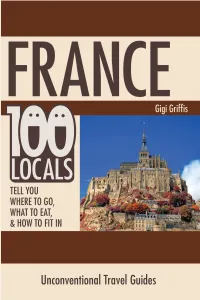
FRANCE 100 Locals Tell You Where to Go, What to Eat, & How to Fit In
FRANCE 100 Locals Tell You Where to Go, What to Eat, & How to Fit In © Gigi Griffis. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher at [email protected] or via gigigriffis.com. ISBN-13: 978-1508869504 2 CONTENTS About this Book 4 On Traveling Like a Local 6 Tips for Fitting In 8 Plan By Interest 12 History & Architecture 13 Food & Wine 25 The Great Outdoors 35 Plan By Place 44 Paris & Northern France 45 Paris, Chartres, Lille, Amiens, Reims, & Epernay Normandy & Brittany 82 Rouen, Evreux, Honfleur, Deauville, Étretat, Caen, Bayeux, Portbail, Mont Saint-Michel, Dinan, Rennes, Josselin, Locronan, & Nantes Loire, Limousin, & Poitou 144 Amboise, Blois, Cheverny, Chenonceaux, Tours, Montresor, Romorantin, Mouchamps, Cognac, La Rochelle, & Royère-de-Vassivière Southwestern France 188 Bordeaux, Saint-Émilion, Sarlat, Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Monguilhem, Condom, Vallée de la Barousse, Toulouse, Albi, Millau, & Carcassonne Southern France & the Riviera 245 Nice, Villefranche-sur-Mer, Monaco, Menton, Èze, Antibes, Saint-Tropez, Marseille, Saint-Cyr-sur-Mer, Cassis, Aix-en-Provence, L’Isle-Sur-La-Sorgue, Vaison- la-Romaine, Avignon, Saint-Rémy-de-Provence, Les Baux-de-Provence, Uzès, Nimes, Aigne, & Narbonne Corsica 321 Barbaggio, Zonza, & Sartène Eastern France 329 Lyon, Grenoble, Annecy, Chamonix, Cluny, Beaune, Dijon, Vézelay, Montbard, Strasbourg, Colmar, & Nancy About the Author 386 Acknowledgements 387 3 ABOUT THIS BOOK This book is for people who want to see another side of France. -

Consulter La Réponse De La CCPHG À L'appel À Projet.Pdf
Candidature de la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises à l’appel à projets « Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne » : S. Duchêne s Crédit photo Crédit Rédaction du rapport : Ségolène Duchêne Lionel Payot Yannick Maurane Rédaction de la Partie 3 (pages 24 à 37) : Carine Massé Relecture : Charles Hormière Candidature CCPHG à l’Appel à Projet STePRiM 2017 Sommaire 1. Introduction ............................................................................................................................................ 2 2. Le territoire de la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises......................................... 4 2.1. Localisation ..................................................................................................................................... 4 2.2. La topographie et le réseau hydrographique ................................................................................. 5 2.3. La géologie du territoire ................................................................................................................. 8 2.4. Le climat .......................................................................................................................................... 9 2.5. La démographie ............................................................................................................................ 11 2.6. L’emploi, les activités économiques et les déplacements ............................................................ 14 2.7. Les infrastructures -

La Barousse. Le Pays, Son Histoire, Se Mœurs
MONOGRAPHIE SUR LA BAROUSSE A la mémoire de ma Mère, pieux et tendre hommage. LA BAROUSSE LE PAYS, SON HISTOIRE, SES MŒURS PAR J.-L. PÊNE PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU COMMINGES Voici ma patrie t ma montagne natale 1 Riant objet de ma tendresse filiale. Anonyme. AVANT-PROPOS Né en Barousse, et à une époque dont mes cheveux blancs n'attestent que trop l'éloignement, les nécessités de l'existence m'en ont arraché de bonne heure. Dès que ces nécessités ne se sont plus fait sentir, j'y suis revenu avec transport, comptant bien y retrouver la forêt profonde et le charmant bocage, le torrent courroucé et le joyeux ruisseau, le chemin abrupt et le sentier fleuri. Tout cela, dont un long exil n'avait pu effacer le souvenir, m'a été rendu en effet, mais dépouillé des illusions et des ravis- sements de mon enfance-: les frimas étaient tombés sur mon âme en même temps que sur met tête. Soit. Mais pourquoi a-t-il fallu que l'âme de la patrie subisse en même temps de bien plus regret- tables vicissitudes 1 Je l'ai retrouvée bien changée Où sont les voix célestes, chants lointains de jeunes filles, si doux et mélan- coliques, qui se mêlaient au roulement des chars par lel crépus- cules d'été ? Où sont les chœurs nocturnes, si puissants que les orgues de nos rochers ne cessaient plus de les répéter ? Où sont les jeux bruyants, les rires éclatants, les contes merveilleux ? Où sont, en un mot, les mœurs traditionnelles ? Mortes 1 Il n'en reste que des regrets dans les cœurs de plus en plus rares qui les ont connues. -

Téléchargez Le Formulaire De La ZNIEFF Au Format
Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011470 Montagnes sèches et rocheuses en rives gauche et droite de l'Ourse et à Saint-Bertrand-de-Comminges (Identifiant national : 730011470) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : Z2PZ2041) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Enjalbal Marc (Nature Comminges), .- 730011470, Montagnes sèches et rocheuses en rives gauche et droite de l'Ourse et à Saint-Bertrand- de-Comminges. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011470.pdf Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées Rédacteur(s) :Enjalbal Marc (Nature Comminges) Centroïde calculé : 456241°-1780158° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 04/09/2009 Date actuelle d'avis CSRPN : 04/09/2009 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 6 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Bilan Des Sites Classés Et Inscrits Des Hautes-Pyrénées Et Classés Bilan Des Sites Juillet 2010 Juillet BILAN DES SITES DES HAUTES-PYRENEES
Juillet 2010 Juillet Bilan des sites classés et inscrits des Hautes-Pyrénées des inscrits et classés sites des Bilan Lieux de beauté, lieux de mémoire de lieux beauté, de Lieux Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer la de et Durable Développement du l’Energie, de l’Ecologie, de Ministère de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées Logement du et l’Aménagement de Direction régionale de l’Environnement, l’Environnement, de régionale Direction t t logemen Ressources, territoires, habitats e l l’avenir p pour P Présent ’ Énergie et climat Déve a loppement d o u r Préventio rable é n des risques v Infrastructures u , tr ansports s e et r mer e n n i r t BILAN DES SITES DES HAUTES-PYRENEES Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer Le mot du Préfet Le patrimoine paysager de notre département est remarquable et très riche. Qu’il s’agisse de paysages de montagne, parfois internationalement reconnus, du piémont ou des villages, les sites des Hautes-Pyrénées participent à la notoriété de notre territoire mais aussi à la renommée de la richesse paysagère de la France. Moteur d’une importante activité touristique, ce patrimoine paysager contribue également à la qualité de vie des habitants. Depuis plus d’un siècle, l’Etat est le garant du maintien de l’intérêt patrimonial de ces espaces remarquables. C’est le sens des lois de protection des sites, aujourd’hui intégrées dans le code de l’environnement. Le classement ou l’inscription d’un site n’est pas seulement une mesure de protection, c’est aussi une reconnaissance qui contribue à la valorisation du territoire concerné. -

Télécharger La Déclaration D'intention Montréjeau-Luchon
Déclaration d’intention de projet au titre de l’article L 121-18 du Code de l’Environnement Reprise des circulations de la ligne 668 000 Montréjeau – Luchon SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, publie la déclaration d’intention relative au projet de modernisation de la ligne Montréjeau – Luchon, en application des articles L.121-18 et R121-25 du Code de l’environnement. Elle est consultable à partir du 2 juin 2020 et jusqu’au 2 octobre 2020 sous le lien : www.sncf-reseau.com/fr/reseau/occitanie/modernisation-ligne-entre-montrejeau-et-luchon/presentation 1. Motivations et raisons d’être du projet La ligne ferroviaire entre Montréjeau et Luchon (36 km) qui dessert les Hautes Vallées du Comminges a vu, pour des raisons de sécurité (obsolescence généralisée de l’infrastructure, risque de chutes de rochers sur la voie en plusieurs points de la ligne, ouvrages d’art à consolider), ses circulations suspendues le 18 novembre 2014. Une desserte de substitution par autocar a depuis été mise en place à la fois pour les services TER desservant Luchon. Suite à cette suspension, une étude sur les besoins de transport des Hautes Vallées du Comminges a été menée en 2015 par SNCF Réseau, sous l’égide de l’Etat, afin d’examiner les potentialités et le devenir de la ligne. La Région Occitanie a également participé financièrement à cette étude dans le cadre du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020. Au premier semestre 2016, la Région Occitanie, Autorité Organisatrice des Transports, a organisé les Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM). -

L´Ourse Et Ses Affluents De Ferrère À Izaourt (Identifiant National : 730030363)
Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030363 L´Ourse et ses affluents de Ferrère à Izaourt (Identifiant national : 730030363) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : Z2PZ0097) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Parde Jean-Michel (Action Recherche Environnement en Midi-Pyrénées), .- 730030363, L´Ourse et ses affluents de Ferrère à Izaourt. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030363.pdf Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées Rédacteur(s) :Parde Jean-Michel (Action Recherche Environnement en Midi-Pyrénées) Centroïde calculé : 459402°-1781449° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 04/09/2009 Date actuelle d'avis CSRPN : 04/09/2009 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS .....................................................................................................................................