1 Sur Une Calèche Longtemps Perdue De Vue
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Remembrance of Things Past: Shakespeare’S Comedies on French Television
Remembrance of Things Past: Shakespeare’s Comedies on French Television Sarah HATCHUEL and Nathalie VIENNE -GUERRIN This essay explores how Shakespeare’s comedies were adapted, appropriated and transformed by French television, with a focus on the early days of television. The first striking fact is that, if one is to except stage productions that were filmed and then broadcast, Shakespeare has not been adapted for French television since 1980. In other words, it has been twenty-eight years since a Shakespeare play was last translated, directed and performed for the exclusive benefit of TV viewers. Shakespeare on French television is not our contempor- ary 1. Through the documentary research for this essay, we went back to a time when the mingling of Shakespeare with television seemed to be less daunting and more economically viable than it is today. From the end of the fifties to the seventies, French television offered a substantial cycle: Twelfth Night was directed by Claude Loursais in 1957, then by Claude Barma in 1962; Othello (dir. Claude Barma) appeared on the TV screens in 1962, soon to be followed by Much Ado About Nothing (dir. Pierre Badel), The Merry Wives of Windsor (dir. Roger Iglesis) and The Taming of the Shrew (dir. Pierre Badel) in 1964, by King Lear (dir. Jean Kerchbron) in 1965, and by Antony and Cleopatra (dir. Jean Prat) in 1967. The seventies saw the broadcast of Measure for Measure (dir. Marcel Bluwal, 1971), As You Like It (dir. Agnès Delarive, 1972) and Romeo and Juliet (dir. Claude Barma, 1973). This cycle of French TV Shakespeare stopped short in 1980 _____ 1. -

Du 14 Mai Au 26 Juin 2010 - LORENZACCIO
Du 14 mai au 26 juin 2010 - LORENZACCIO Lorenzaccio est soutenu par : Nous remercions nos partenaires Hertz, Biblos et Gandousier pour leur soutien : Les Célestins, Théâtre de Lyon sont soutenus par le cercle des entreprises mécènes : Premier membre fondateur Membre associé Membre ami CONTACT PRESSE Magali Folléa Tél. 04 72 77 48 83 [email protected] Vous pouvez télécharger les dossiers de presse et photos des spectacles sur notre site www.celestins-lyon.org La vie est comme une cité : on peut y rester cinquante ou soixante ans sans voir autre chose que des promenades et des palais, mais il ne faut pas entrer dans les tripots, ni s'arrêter, en rentrant chez soi, aux fenêtres des mauvais quartiers. Lorenzo / acte III / sc. 3 Du 14 mai au 26 juin 2010 - LORENZACCIO Création dans le département du Rhône Depuis 6 ans, les Célestins font découvrir leurs spectacles dans plusieurs communes du département du Rhône. L’aventure a commencé en 2004 avec la tournée sous chapiteau de La Cuisine d’Arnold Wesker. L’action s’est étendue avec Jeux Doubles de Cristina Comencini puis la saison dernière avec Les Embiernes commencent par Émilie Valantin. Cette saison, c’est la nouvelle création des Célestins, Lorenzaccio d’Alfred de Musset, mise en scène par Claudia Stavisky qui parcourt le département. Comme en 2004, nous renouons avec l’atmosphère du chapiteau, pour présenter ce spectacle et retrouver l’ambiance conviviale des représentations que génère cette forme éphémère et itinérante. Au cœur de cette démarche réside pour nous la nécessité de garantir une qualité artistique, technique et d’accueil égale à celles proposées au public lyonnais. -

Roger Pierre
2 2 A mes parents et à mon parrain que j’aime. Ils sont près de moi chaque jour de ma vie. 2 3 24 Sommaire Hommage à Haïti ................................................... 9 Renée ..................................................................... 13 Roger Pierre ........................................................... 15 Pierre ..................................................................... 18 Patrick .................................................................... 21 Jean ........................................................................ 24 Ginette ................................................................... 28 Le 70ème anniversaire de la commémoration de l’appel du 18 juin 1940 ..................................... 31 Les couples ............................................................ 33 Cécile ..................................................................... 35 Alfreda ................................................................... 37 Geneviève .............................................................. 39 Le printemps des poètes ........................................ 42 Les voisinages ....................................................... 45 Le chat et l’oiseau (une fable) ............................... 47 2 5 La maladie ............................................................. 48 Les pompiers .......................................................... 50 Bourvil ................................................................... 52 Fernandel .............................................................. -
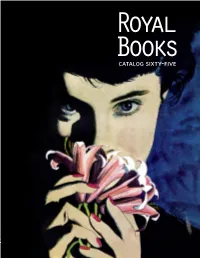
Catalog Sixty-Five Log Sixty-Five
Royal Books Royal Royal Cata Books catalog sixty-five log Sixty-Five log royalbooks.com THE CELLULOID PAPER TRAIL Royal Books is pleased to announce the publication of The Celluloid Paper Trail by Terms and Conditions Oak Knoll Press, the first book All books are first editions unless indicated otherwise. ever published on film script All items in wrappers or without dust jackets advertised have glassine covers, and all dust jackets are protected identification and description, by new archival covers. Single, unframed photographs lavishly illustrated and detailed, housed in new, archival mats. designed for any book scholar, In many cases, more detailed physical descriptions for including collectors, archivists, archives, manuscripts, film scripts, and other ephemeral items can be found on our website. librarians, and dealers. Any item is returnable within 30 days for a full refund. Books may be reserved by telephone, fax, or email, Available now at royalbooks.com. and are subject to prior sale. Payment can be made by credit card or, if preferred, by check or money order with an invoice. Libraries and institutions may be billed Please feel free to let us know if you would like according to preference. Reciprocal courtesies extended your copy signed or inscribed by the author. to dealers. We accept credit card payments by VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, and PAYPAL. Shipments are made via USPS Priority mail or Fedex Ground unless other arrangements are requested. All shipments are fully insured. Shipping is free within the United States. For international destinations, shipping is $60 for the first book and $10 for each thereafter. -

Ab8ea3308c1893d4260136be5b
En tournée dans le département en mai 2010 Du 14 mai au 26 juin 2010 Création Célestins 2010 LORENZACCIO De Alfred de Musset Mise en scène Claudia Stavisky SOUS CHAPITEAU DDDossierDossier pédagogique 1 LORENZACCIO De Alfred de Musset Mise en scène Claudia Stavisky Avec : Thibault Vinçon - Lorenzo Alexandre Zambeaux - Le Duc Denis Ardant - Giomo, l’officier allemand, un des Strozzi Fabien Albanese - Tebaldeo, Maffio, un des 4 Huit, un des Strozzi Christian Taponard - L’orfèvre, Ruccelai, un des bourgeois, un des bannis, un des Strozzi Daniel Pouthier - Le marchand, Sire Maurice, un des bourgeois, un des Strozzi Loïc Risser - Salviati, un des bourgeois, un des banni, un des 4 Huit, un des Strozzi Colin Rey - Léon Strozzi, le provéditeur, un des 4 Huit, un des Strozzi François Herpeux - un masque, un des bourgeois, un des bannis, un des Strozzi Noémie Bianco - Catherine, Louise Strozzi, une Dame de la cour, une des courtisanes Jean-Marc Avocat - Cardinal Cibo, un des Strozzi Magali Bonat - La Marquise Cibo, une femme, une des courtisanes, un des Strozzi Mohamed Brikat - Cardinal Valori, Bindo, Scoronconcolo, un des deux bourgeois, un des Strozzi Laurence Roy - Marie, une Dame de la cour, une femme du peuple, une des courtisanes, un des Strozzi Philippe Vincenot - Philippe Strozzi Clément Carabédian - Pierre Strozzi, un des Strozzi, foule Scénographie – Estelle Gautier Lumière – Franck Thevenon Son - André Serré Costumes – Clara Ognibene Assistante à la mise en scène – Marjorie Evesque Durée : 2h15 Coproduction : Célestins, Théâtre de Lyon Avec le soutien du Département du Rhône et la participation artistique de l’Ensatt Contact : Marie-Françoise Palluy 04 72 77 48 35 [email protected] 2 SOMMAIRE Le texte et l’œuvre Lorenzaccio ………………………………………………………………5 Alfred de Musset ................................................................................................................................................................. -

Hossein Débat Animé Par Yves Alion Après La Projection Du À Lm Le Vampire De Düsseldorf, À L’Ecole Supérieure De Réalisation Audiovisuelle De Paris Le 15 Mars 2007
robert hossein Débat animé par Yves Alion après la projection du À lm Le Vampire de Düsseldorf, à l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de Paris le 15 mars 2007. Robert Hossein est un homme pour le moins éclectique : comédien et metteur en scène, aussi à l’aise au cinéma qu’au théâtre, il est de toute évidence une ¿ gure éminemment populaire du monde artistique de ce demi-siècle. Après une carrière théâtrale plutôt classique (mais précoce et vibrionnante), il s’est depuis quelques temps régalé à mettre en scène de grands spectacles hors normes, à l’occasion interactifs. Ce qui ne l’a pas empêché parallèlement de mener une belle carrière au cinéma, variée autant que durable. Même si les premiers rôles marquent davantage sa jeunesse que l’âge mur. Dans les années 60, il est sans conteste un jeune premier des plus en vue. C’est également à cette époque qu’il passe derrière la caméra pour bâtir une œuvre sans doute inégale mais qui comporte plusieurs réussites, dont laHossein.indd moins 3 contestable est Le Vampire 22/03/12 14:18 de Düsseldorf. Amoureux du cinéma de genre (il ira jusqu’à signer un western), Robert Hossein aime bien le baroque, la démesure, les dé¿ s. Peut-être une façon de se mesurer à l’éternité et d’y frotter sa foi, élément central de sa personnalité et de son rapport au monde. Le Vampire de Düsseldorf Hossein.indd 3 22/03/12 14:18 105 Hossein.indd 1 22/03/12 14:18 Ben-Hur, qui se passait au Stade de France devant 65 000 personnes. -

March 27-29, 2009
Virginia Commonwealth University and the University of Richmond present Richmon d , V irginia March 27-29, 2009 Exclusive Print Media Sponsor All films have English subtitles and are presented by their actors and directors. 17th annual • Byrd Theatre • Richmond, Va. • (804) 827-FILM • www.frenchfilm.vcu.edu Table of contents 3 Schedule and event information 30 Shorts Drift L’Auberge rouge 6 The Sad and Lonely Death of Edgar Allan Poe 8 J’ai vu tuer Ben Barka Music Short Coups de filet 10 Deux jours à tuer Bruit blanc 12 Mia et le Migou Leila L’Homme est le seul oiseau qui porte sa cage 14 15 ans et demi Open the Door Please Subterfuge(s) 16 L’Après-midi de Monsieur Andesmas Anbafèy 18 Cliente La Pomme de Newton Welcome to Whitechapel District 20 Les Murs porteurs Ma sixtine 22 Tabarly La Copie de Coralie Monsieur Cok 24 Magique! Le Tonneau des Danaïdes Arrêt demandé 26 Musée haut, musée bas Wawa 28 Françoise Dolto, le désir de vivre Une leçon particulière Congratulations to Jean Becker for his 2008 film Deux jours à tuer and its three César nominations, including Albert Dupontel for Best Actor, Pierre Vaneck for Best Supporting Actor, and Jean Becker, Eric Assous, Jérôme Beaujour and François d’Epenoux for Best Writing-Adaptation. Congratulations also to Pierre Marcel for his 2008 documentary Tabarly and its Cesar nomination for Best Documentary. In this year’s delegation of more French director Claude Miller, And congratulations to Raphaël than 30 actors and directors Chevènement for his short film honorary president, returns again coming to Richmond, the VCU Une leçon particulière this year to salute founders and and UR French Film Festival nominated for Best Short Film. -

Lorenzaccio’’ (1834)
www.comptoirlitteraire.com André Durand présente ‘’Lorenzaccio’’ (1834) Drame en cinq actes et en prose d’Alfred de MUSSET (340 pages) pour lequel on trouve un résumé des notes (pages 4-22) puis successivement l’examen de : la genèse (page 22) l’intérêt de l’action (page 24) l’intérêt littéraire (page 27) l’intérêt documentaire (page 35) l’intérêt psychologique (page 41) l’intérêt philosophique (page 49) la destinée de l’œuvre (page 53) Bonne lecture ! 1 ACTE I Scène 1 : À Florence, à minuit, à la fin décembre 1536, dans un jardin, le duc Alexandre de Médicis, accompagné de son écuyer, Giomo, et de son favori et entremetteur, Lorenzo, enlève Gabrielle, une jeune fille, dont le frère, Maffio, est brutalement désarmé. Scène 2 : Le lendemain matin, dans une rue, des bourgeois constatent les débordements auxquels se livrent les nobles à la sortie d’un bal, et se plaignent de la déchéance de leur ville, prise entre le pape et l’empereur. Sortent, masqués, le duc, Lorenzo et Julien Salviati qui fait une cour cavalière à Louise Strozzi, qui se montre offusquée. Scène 3 : Plus tard, chez les Cibo, le marquis, avant de partir pour ses terres pendant une semaine, confie sa femme au cardinal, son frère. La marquise déplore l’impiété de la cour et la servitude de Florence. Le cardinal intercepte un billet galant du duc à la marquise. Scène 4 : Le même jour, dans une cour du palais du duc, alors que les messagers du pape reprochent à Alexandre son indulgence envers le jeune débauché qu’est son cousin Lorenzo, surnommé avec mépris Lorenzaccio, celui-ci entre, rabroue les ambassadeurs, mais feint de s'évanouir à la vue d'une épée nue quand sire Maurice, le chancelier, le provoque en duel. -

Bluwal De Réalisation Audiovisuelle De Paris Le 13 Novembre 2008
marcel Débat animé par Yves Alion après la projection du film Dom Juan ou le Festin de pierre, à l’École Supérieure bluwal de Réalisation Audiovisuelle de Paris le 13 novembre 2008 Marcel Bluwal a très jeune le goût du théâtre et du cinéma. Il fréquentera l’un et l’autre une fois parvenu à l’âge adulte. Mais l’essentiel de sa carrière se fera à la télévision, dont il est l’un des pionniers, dès l’immédiat après- guerre. De fait, une fois en place, il se frotte à tous les genres, il est de toutes les expériences, il innove sans cesse dans un média qui n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière et où les propositions parviennent souvent à être entendues. On lui doit les premières émissions pour la jeunesse, il met en scène des pièces de théâtre qui sont diffusées en direct, etc. Mais c’est en réalisant ce que l’on ne nomme pas encore des téléfilms qu’il se fait un nom, unanimement respecté. D’autant que le caractère prolifique de son œuvre n’entame en rien la qualité de son travail. Réalisé au mitan des années 60, son Dom Juan n’a pas pris une ride: il reste encore aujourd’hui considéré comme un modèle d’adaptation. Fin lettré, passionné par la mise en scène, Marcel Bluwal n’est pas pour autant un tenant de l’art pour l’art. Il n’a jamais caché ses préférences politiques, résolument à gauche. Un penchant qui ne doit rien au hasard de la part de ce fils d’immigrés juifs qui a dû rester caché une bonne partie de la guerre pour échapper à la barbarie nazie. -

Filmographie
Filmographie 1947 JOUR DE FETE de Jacques Tati avec Jacques Tati, Paul Frankeur, Guy Decomble, Santa Relli, Maine Vallée, Roger Razal, Beauvais, Delcassan, Valy, Robert Balbo. 1949 PREMIERES ARMES de René Wheeler avec Paul Frankeur, Julien Carette, Guy Decomble, Santa Relli HISTOIRES EXTRAORDINAIRES de Jean Faurez avec Jules Berry, Femand Ledoux 1950 TOPAZE de Marcel Pagnol avec Fernandel, Hélène Perdrières, Jacqueline Pagnol, Jacques Morel, Pierre Larquet, Milly Mathis 1953 LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT de Jacques Tati avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Louis Perrault, Michèle Rolla, André Dubois, Valentine Camax, Lucien Frégis, Marguerite Gérard 1954 PASSION DE FEMMES de Hans Herwigh avec Nadine Alari, Micheline Francey, Catherine Romane, Michèle Sélignac, Jean-Piere Kérien, Alain Quercy, Paul Dupuis, Raymond Loyer, Gérard Sabatier 1956 MISS CATASTROPHE de Dimitri Kirsanov avec Sophie Desmarets, Micheline Dax, Philippe Nicaud, Louis Seigner PLACE DU TERTRE L'AVENTURE EST SUR LA ROUTE 1957 L'ECOLE DES COCOTTES de Jacqueline Audry avec Dany Robin, Femand Gravey, Bernard Blier, Darry Cowl, Odette Laure, Robert Vattier. L'OR DE SAMORY (film non sorti) de Jean Alden-Delos avec Christiane Paray, Danièle Dorlan, René Dary, Adrien Forge, Robert Tenton. 1958 LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Jean Meyer avec Louis Seigner, Jean Meyer, Jacques Charon, Robert Manuel. UNE BALLE DANS LE CANON de Charles Gérard et Michel Deville avec Pierre Vaneck, Mijanou Bardot, Roger Hanin, Paul Frankeur. 1959 PAR DESSUS LE MUR (sorti en 1961) de Jean-Paul Le Chanois -

Art De Yasmina Reza
Fiche de lecture Fiche de lecture Résumé • Étude des personnages • Clés de lecture • Pistes de réflexion Tout ce qu’il faut savoir sur Art de Yasmina Reza ! Retrouvez l’essentiel de l’œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée, avec un résumé, une étude des personnages, des clés de lecture et des pistes de réflexion. Rédigée de manière claire et accessible, la fiche de lecture propose d’abord un résumé chapitre par chapitre du roman, puis s’intéresse aux trois personnages de la pièce : Marc, Serge et Yvan, qui font preuve de trois approches différentes du réel. On étudie ensuite l’usage du monologue chez Reza, la mise en scène de la futilité et le genre de la pièce, entre comédie et drame, avant de commenter le regard caustique porté sur la société. Enfin, les pistes de réflexion, sous forme de questions, vous permettront d’aller plus loin dans votre étude. Art Une analyse littéraire de référence pour mieux lire et comprendre le livre ! Yasmina REZA LePetitLittéraire.fr, une collection en ligne d’analyses litté- raires de référence : • des fiches de lecture, des questionnaires de lecture et des commentaires composés • sur plus de 500 œuvres classiques et contemporaines ISBN 978-2-8062-1254-2 • ... le tout dans un langage clair et accessible! Connectez-vous sur lePetitLittéraire.fr et téléchargez nos documents en quelques clics. 9 782806 212542 lePetitLittéraire.fr lePetitLittéraire.fr simplifiez-vous la lecture Conception graphique: L&A Peiffer simplifiez-vous la lecture Excerpt of the full publication SOMMAIRE 1. RÉSUMÉ 4 2. ÉTUDE DES PERSONNAGES 6 Marc Serge Yvan L’Antrios 3. -
Shakespeare on Film and Television in the Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division of the Library of Congress
SHAKESPEARE ON FILM AND TELEVISION IN THE MOTION PICTURE, BROADCASTING AND RECORDED SOUND DIVISION OF THE LIBRARY OF CONGRESS Compiled by Zoran Sinobad January 2012 Introduction This is an annotated guide to moving image materials related to the life and works of William Shakespeare in the collections of the Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division of the Library of Congress. While the guide encompasses a wide variety of items spanning the history of film, TV and video, it does not attempt to list every reference to Shakespeare or every quote from his plays and sonnets which have over the years appeared in hundreds (if not thousands) of motion pictures and TV shows. For titles with only a marginal connection to the Bard or one of his works, the decision what to include and what to leave out was often difficult, even when based on their inclusion or omission from other reference works on the subject (see below). For example, listing every film about ill-fated lovers separated by feuding families or other outside forces, a narrative which can arguably always be traced back to Romeo and Juliet, would be a massive undertaking on its own and as such is outside of the present guide's scope and purpose. Consequently, if looking for a cinematic spin-off, derivative, plot borrowing or a simple citation, and not finding it in the guide, users are advised to contact the Moving Image Reference staff for additional information. How to Use this Guide Entries are grouped by titles of plays and listed chronologically within the group by release/broadcast date.