Préface (Extrait)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
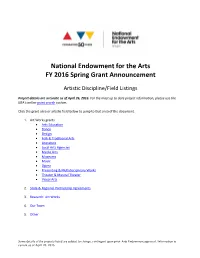
Underserved Communities
National Endowment for the Arts FY 2016 Spring Grant Announcement Artistic Discipline/Field Listings Project details are accurate as of April 26, 2016. For the most up to date project information, please use the NEA's online grant search system. Click the grant area or artistic field below to jump to that area of the document. 1. Art Works grants Arts Education Dance Design Folk & Traditional Arts Literature Local Arts Agencies Media Arts Museums Music Opera Presenting & Multidisciplinary Works Theater & Musical Theater Visual Arts 2. State & Regional Partnership Agreements 3. Research: Art Works 4. Our Town 5. Other Some details of the projects listed are subject to change, contingent upon prior Arts Endowment approval. Information is current as of April 26, 2016. Arts Education Number of Grants: 115 Total Dollar Amount: $3,585,000 826 Boston, Inc. (aka 826 Boston) $10,000 Roxbury, MA To support Young Authors Book Program, an in-school literary arts program. High school students from underserved communities will receive one-on-one instruction from trained writers who will help them write, edit, and polish their work, which will be published in a professionally designed book and provided free to students. Visiting authors, illustrators, and graphic designers will support the student writers and book design and 826 Boston staff will collaborate with teachers to develop a standards-based curriculum that meets students' needs. Abada-Capoeira San Francisco $10,000 San Francisco, CA To support a capoeira residency and performance program for students in San Francisco area schools. Students will learn capoeira, a traditional Afro-Brazilian art form that combines ritual, self-defense, acrobatics, and music in a rhythmic dialogue of the body, mind, and spirit. -

Art Ensemble of Chicago Thelonious Sphere Monk
Art ensemble of chicago thelonious sphere monk Find a Art Ensemble Of Chicago* With Cecil Taylor - Thelonious Sphere Monk: Dreaming Of The Masters Vol.2 first pressing or reissue. Complete your Art. Thelonious Sphere Monk: Dreaming of the Masters Series Vol. 2 is an album by the Art Ensemble of Chicago and Cecil Taylor released on the Japanese DIW. Art Ensemble of Chicago, Cecil Taylor - Thelonious Sphere Monk: Dreaming of the Masters, Vol.2 - Music. This CD promises much more than it delivers, appearing to be a tribute to Thelonious Monk that features the Art Ensemble of Chicago and guest pianist Cecil. Find album release information for Thelonious Sphere Monk: Dreaming of the Masters, Vol. 2 - The Art Ensemble of Chicago on AllMusic. Thelonious Sphere Monk - Dreaming of the Masters Vol. 2 Recorded in , at Systems Two Studios, Brooklyn. Thelonious Sphere Monk: Dreaming of the Masters, Vol. 2, an Album by Art Ensemble of Chicago With Cecil Taylor. Released in on (catalog no. CK Albuminformatie voor Thelonious Sphere Monk: Dreaming of the masters ; vol.2 van Art Ensemble of Chicago. ART ENSEMBLE OF CHICAGO WITH CECIL TAYLOR ~ Thelonious Sphere Monk - Dreaming Of The Masters Vol. 2 []. C'est comme un. Thelonious Sphere Monk: Dreaming of the Masters, Vol. 2 by The Art Ensemble of Chicago release on May 06, Thelonious Sphere Monk: Dreaming of the. "Dreaming of the Masters"、"Intro to Fifteen"、"Excerpt from Fifteen, Pt. 3A" とその他を含む、アルバム「Thelonious Sphere Monk」の曲を聴こう。 . Acquista il CD album Thelonious Sphere Monk di Art Ensemble Of Chicago in offerta; album e dischi in vendita online a prezzi scontati su La Feltrinelli. -

Joseph Jarman's Black Case Volume I & II: Return
Joseph Jarman’s Black Case Volume I & II: Return From Exile February 13, 2020 By Cam Scott When composer, priest, poet, and instrumentalist Joseph Jarman passed away in January 2019, a bell sounded in the hearts of thousands of listeners. As an early member of the Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), as well as its flagship group, the Art Ensemble of Chicago, Jarman was a key figure in the articulation of Great Black Music as a multi- generational ethic rather than a standard repertoire. As an ordained Buddhist priest, Jarman’s solicitude transcended philosophical affinity and deepened throughout his life as his music evolved. His musical, poetic, and religious paths appear to have been mutually informative, in spite of a hiatus from public performance in the nineties—and to encounter Jarman’s own words is to understand as much. The full breadth of this complexity is celebrated in the long-awaited reissue of Black Case Volume I & II: Return from Exile, a blend of smut and sutra, poetry and polemic, that feels like a reaffirmation of Jarman’s ambitious vision in the present day. Black Case wears its context proudly. A near-facsimile of the original 1977 publication by the Art Ensemble of Chicago (which itself was built upon a coil-bound printing from 1974), the volume serves as a time capsule of a key period in the development of an emancipatory musical and cultural program, and an intimate portrait of the artist-as-revolutionary. Black Case, then, feels most contemporary where it is most of its time, as a document of Black militancy and programmatic self-determination in which—to paraphrase Larry Neal’s 1968 summary of the Black Arts Movement—ethics and aesthetics, individual and community, are tightly unified. -

Vindicating Karma: Jazz and the Black Arts Movement
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 1-1-2007 Vindicating karma: jazz and the Black Arts movement/ W. S. Tkweme University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1 Recommended Citation Tkweme, W. S., "Vindicating karma: jazz and the Black Arts movement/" (2007). Doctoral Dissertations 1896 - February 2014. 924. https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1/924 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. University of Massachusetts Amherst Library Digitized by the Internet Archive in 2014 https://archive.org/details/vindicatingkarmaOOtkwe This is an authorized facsimile, made from the microfilm master copy of the original dissertation or master thesis published by UMI. The bibliographic information for this thesis is contained in UMTs Dissertation Abstracts database, the only central source for accessing almost every doctoral dissertation accepted in North America since 1861. Dissertation UMI Services From:Pro£vuest COMPANY 300 North Zeeb Road P.O. Box 1346 Ann Arbor, Michigan 48106-1346 USA 800.521.0600 734.761.4700 web www.il.proquest.com Printed in 2007 by digital xerographic process on acid-free paper V INDICATING KARMA: JAZZ AND THE BLACK ARTS MOVEMENT A Dissertation Presented by W.S. TKWEME Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May 2007 W.E.B. -

Museum Archivist
Newsletter of the Museum Archives Section Museum Archivist Summer 2020 Volume 30, Issue 2 Letter From the Chair Fellow MAS and SAA members, To be blunt, we are currently in the midst of a challenging period of historic proportions. On top of a charged atmosphere filled with vitriol, 2020 has witnessed the unfolding of both a global pandemic and racial tensions exacerbated by systemic racism in law enforcement. The combination of this perfect storm has sowed a climate of chaos and uncertainty. It is easy to feel demoralized and discouraged. For your own mental health, allow yourself to feel. Allow yourself to take a breath and acknowledge that you are bearing witness to a uniquely challenging period like few in global history. Yet, there is reason to hope. The trite phrase, “that which does not kill us only makes us stronger” has significance. We adapt, learn, grow and improve. If this all is to be viewed as an incredible challenge, rest assured, we will overcome it. (To use yet another timeless phrase, “this, too, shall pass.”) I am curious to see what new measures, what new policies, what new courses of action we, as professionals in the field(s) of libraries, archives, and museums (LAMs) will implement to further enhance and reinforce the primary goals of our respective professions. One question that keeps coming to mind is how the archives field—specifically as it relates to museums— will survive and adapt in the post-COVID-19 world. People will continue to turn to publicly available research material to learn and educate others. -

DUNWOODY Houston
\1!W _- CONTENTS Volume 13. Number 12 June 5·11. 1987 Largest Beer Bust In Texas 4pm~2am days a week~ PAGE 44 J 11 TWT NEWS Dallas Baptists Blast Gays. Dara Gray ta Head THRF. $4 24 COMMENT Letters ta the Editor 27 VIEWPOINT Self-Love bV Michoel H. Wilson 29 HEALTH Effects of Stress on Heatlh bV Dr. Terru R. Watson 30 HIGHLIGHT Ten Years After With Anita Bryant (Part 2) bV Phil Johnson 35 CLASSIC TWT Six Years Ago This Week in Texas bV Don Maines 39 BOOKS The Wings of the Phoenix by Florine De Veer Reviewed bV David Fields 43 MOVIES River's edge With Dennis Hopper Reviewed bV O. Flores Alvarez 44 SHOWBIZ Diana Ross & Jackie Ross. The Supremes & The Beatles ... bV .lock Varsi 46 BACKSTAGE Horveo Milk. Delia Stewart. Eartha Kitt ... bv Donolevon Maines 55 HOT TEA Marty Single Wins Mr. Prime Choice. Tierra Michaels Wins Miss Gay South Texas .. 67 SPORTS Marion & Lynn's Rebels Still Ahead in Women's Softball League .. bV BobbV Miller 69 STARSCOPE Your June Lovescope bV Milton voo Stem 74 COVER/PHOTO ESSAY Houston's Marco Roberts Photographs bV G.W. Hing 78 CLASSIFIED Want Ads and Notices 89 CALENDAR Special One-Time Only & Non-Profit Community Events 91 THE GUIDE Texas Business/Club Directory TWT (This Week in Texas) is published by Texas Weekly Publishing Co., at 2205 Montrose, Houston, Texas 77006, phone: (713) 527-9111. Opinions expressed by columnists are not necessarily those of TWT or of its staff. Publication of the name or photograph of any person or organization in articles or advertising in TWT is not to be construed as any indication of the sexual orientation of said person or organization. -

Musica Jazz Autore Titolo Ubicazione
MUSICA JAZZ AUTORE TITOLO UBICAZIONE AA.VV. Blues for Dummies MSJ/CD BLU AA.VV. \The \\metronomes MSJ/CD MET AA.VV. Beat & Be Bop MSJ/CD BEA AA.VV. Casino lights '99 MSJ/CD CAS AA.VV. Casino lights '99 MSJ/CD CAS AA.VV. Victor Jazz History vol. 13 MSJ/CD VIC AA.VV. Blue'60s MSJ/CD BLU AA.VV. 8 Bold Souls MSJ/CD EIG AA.VV. Original Mambo Kings (The) MSJ/CD MAM AA.VV. Woodstock Jazz Festival 1 MSJ/CD WOO AA.VV. New Orleans MSJ/CD NEW AA.VV. Woodstock Jazz Festival 2 MSJ/CD WOO AA.VV. Real birth of Fusion (The) MSJ/CD REA AA.VV. \Le \\grandi trombe del Jazz MSJ/CD GRA AA.VV. Real birth of Fusion two (The) MSJ/CD REA AA.VV. Saint-Germain-des-Pres Cafe III: the finest electro-jazz compilationMSJ/CD SAI AA.VV. Celebrating the music of Weather Report MSJ/CD CEL AA.VV. Night and Day : The Cole Porter Songbook MSJ/CD NIG AA.VV. \L'\\album jazz più bello del mondo MSJ/CD ALB AA.VV. \L'\\album jazz più bello del mondo MSJ/CD ALB AA.VV. Blues jam in Chicago MSJ/CD BLU AA.VV. Blues jam in Chicago MSJ/CD BLU AA.VV. Saint-Germain-des-Pres Cafe II: the finest electro-jazz compilationMSJ/CD SAI Adderley, Cannonball Cannonball Adderley MSJ/CD ADD Aires Tango Origenes [CD] MSJ/CD AIR Al Caiola Serenade In Blue MSJ/CD ALC Allison, Mose Jazz Profile MSJ/CD ALL Allison, Mose Greatest Hits MSJ/CD ALL Allyson, Karrin Footprints MSJ/CD ALL Anikulapo Kuti, Fela Teacher dont't teach me nonsense MSJ/CD ANI Armstrong, Louis Louis In New York MSJ/CD ARM Armstrong, Louis Louis Armstrong live in Europe MSJ/CD ARM Armstrong, Louis Satchmo MSJ/CD ARM Armstrong, Louis -

Dave Burrell, Pianist Composer Arranger Recordings As Leader from 1966 to Present Compiled by Monika Larsson
Dave Burrell, Pianist Composer Arranger Recordings as Leader From 1966 to present Compiled by Monika Larsson. All Rights Reserved (2017) Please Note: Duplication of this document is not permitted without authorization. HIGH Dave Burrell, leader, piano Norris Jones, bass Bobby Kapp, drums, side 1 and 2: b Sunny Murray, drums, side 2: a Pharoah Sanders, tambourine, side . Recording dates: February 6, 1968 and September 6, 1968, New York City, New York. Produced By: Alan Douglas. Douglas, USA #SD798, 1968-LP Side 1:West Side Story (L. Bernstein) 19:35 Side 2: a. East Side Colors (D. Burrell) 15:15 b. Margy Pargy (D. Burrell 2:58 HIGH TWO Dave Burrell, leader, arranger, piano Norris Jones, bass Sunny Murray, drums, side 1 Bobby Kapp, drums side 2. Recording Dates: February 6 and September 9, 1968, New York City, New York. Produced By: Alan Douglas. Additional production: Michael Cuscuna. Trio Freedom, Japan #PA6077 1969-LP. Side: 1: East Side Colors (D. Burrell) 15:15 Side: 2: Theme Stream Medley (D.Burrell) 15:23 a.Dave Blue b.Bittersweet Reminiscence c.Bobby and Si d.Margie Pargie (A.M. Rag) e.Oozi Oozi f.Inside Ouch Re-issues: High Two - Freedom, Japan TKCB-70327 CD Lions Abroad - Black Lion, UK Vol. 2: Piano Trios. # BLCD 7621-2 2-1996CD HIGH WON HIGH TWO Dave Burrell, leader, arranger, piano Sirone (Norris Jones) bass Bobby Kapp, drums, side 1, 2 and 4 Sunny Murray, drums, side 3 Pharoah Sanders, tambourine, side 1, 2, 4. Recording dates: February 6, 1968 and September 6, 1968, New York City, New York. -

The City University of New York Committee on Academic Policy, Programs and Research
THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK COMMITTEE ON ACADEMIC POLICY, PROGRAMS AND RESEARCH AGENDA April 6, 2017 I. Action Items A. Approval of the minutes of the February 6, 2017 meeting B. Policy Calendar 1. Brooklyn College – MM in Global and Contemporary Jazz 2. Medgar Evers College – Establishment of the Department of Social Work 3. Brooklyn College – Resolution to Award an Honorary Degree at the College’s Commencement a) Bernard Sanders – US Senator representing the state of Vermont Degree: Doctor of Humane Letters 4. Hunter College – Resolution to Award an Honorary Degree at the College’s Commencement a) Arthur Elgort ’64 – Influential fashion photographer Degree: Doctor of Fine Arts 5. CUNY School of Law - Resolution to Award an Honorary Degree at the School’s Commencement a) Sherrilyn Ifill – President and Director – NAACP – Legal Defense and Education Fund Degree: Doctor of Law 6. The College of Staten Island - Resolution to Award Honorary Degrees at the College’s Commencement a) Margaret Ricciardi ’86 – Artist and benefactor Degree: Doctor of Arts b) Andy Shih, Senior Vice President, Public Health and Inclusion at Autism Speaks, NY Degree: Doctor of Science c) Deidre DeAngelis, Principal of New Dorp High School Degree: Doctor of Humane Letters d) Peter and Robin Jovanovich, College Benefactors Degree: Doctor of Humane Letters 7. CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy - Resolution to Award an Honorary Degree at the School’s Commencement a) Chirlane McCray, First Lady of New York City and Mental Health Advocate Degree: Doctor of Science 8. Graduate School and University Center - Resolution to Award Honorary Degrees at the School’s Commencement a) Vanita Gupta, former Principal US Deputy Assistant Attorney General Degree: Doctor of Humane Letters b) Wael Shawky, artist Degree: Doctor of Humane Letters c) Lord Nicholas Stern, Chair of the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Degree: Doctor of Humane Letters 9. -

2011 – Cincinnati, OH
Society for American Music Thirty-Seventh Annual Conference International Association for the Study of Popular Music, U.S. Branch Time Keeps On Slipping: Popular Music Histories Hosted by the College-Conservatory of Music University of Cincinnati Hilton Cincinnati Netherland Plaza 9–13 March 2011 Cincinnati, Ohio Mission of the Society for American Music he mission of the Society for American Music Tis to stimulate the appreciation, performance, creation, and study of American musics of all eras and in all their diversity, including the full range of activities and institutions associated with these musics throughout the world. ounded and first named in honor of Oscar Sonneck (1873–1928), early Chief of the Library of Congress Music Division and the F pioneer scholar of American music, the Society for American Music is a constituent member of the American Council of Learned Societies. It is designated as a tax-exempt organization, 501(c)(3), by the Internal Revenue Service. Conferences held each year in the early spring give members the opportunity to share information and ideas, to hear performances, and to enjoy the company of others with similar interests. The Society publishes three periodicals. The Journal of the Society for American Music, a quarterly journal, is published for the Society by Cambridge University Press. Contents are chosen through review by a distinguished editorial advisory board representing the many subjects and professions within the field of American music.The Society for American Music Bulletin is published three times yearly and provides a timely and informal means by which members communicate with each other. The annual Directory provides a list of members, their postal and email addresses, and telephone and fax numbers. -

Träumend Von Den Großen Schwarzen Schwänen“ (*)
KULTUR UND GESELLSCHAFT Organisationseinheit : 46 Reihe : LITERATUR 0.05 Uhr Titel der Sendung: Träumend von den großen Üb schwarzen Schwänen – Die Ästhetik des Widerstands in Alejo Carpentiers Le Sacre du Printemps Autor : : Klaus Emrich Redaktion: : Sigried Wesener Sendetermin : 28.12.2014 Besetzung : Sprecher : Zitatorin : Zitator Regie : Urheberrechtlicher Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf vom Empfänger ausschließlich zu rein privaten Zwecken genutzt werden. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung, die über den in den §§ 45 bis 63 Urheberrechtsgesetz geregelten Umfang hinausgeht, ist unzulässig © Deutschlandradio Deutschlandradio Kultur Funkhaus Berlin Hans-Rosenthal-Platz 10825 Berlin Telefon (030) 8503-0 1 Klaus Emrich „Träumend von den Großen Schwarzen Schwänen“ (*) Die Ästhetik des Widerstands in Alejo Carpentiers „Le Sacre du Printemps“ (*) Alejo Carpentier, Le Sacre du Printemps, Frankfurt/Main 1993, S.11 18. März 2o14 2 MUSIK: Steve Coleman & Dave Holland Phase Space (track 2): Dream of the Elders (nach ca 25’ übersprechen) ZITATOR: Menschen von heute, die schon danach trachteten, Menschen von morgen zu sein. (1:529) SPRECHER: Alejo Carpentier. Le Sacre du Printemps. La Consagración de la Primavera: Alejo Carpentier schrieb sein opus magnum 1978 als „Epos der kubanischen Revolution“. Er verbindet die Geschichte der russischen Tänzerin Vera und des cubanischen Architekten Enrique mit den historischen Ereignissen während des spanischen Krieges 1936 bis 1939 und dem bewaffneten -

1 Miles Davis Quintet, Live in Europe 1967: the Bootleg Series, Vol. 1
77TH ANNUAL READERS POLL HISTORICAL ALBUM OF THE YEAR 1 Miles Davis Quintet, Live In Europe 1967: The Bootleg Series, Vol. 1 (COLUMBIA/LEGACY) 2,619 votes The trumpeter and his second great quintet were in their prime while touring with George Wein’s Newport Jazz Festival in October and November 1967. 2 Wes Montgomery, Echoes 5 Stan Getz, Stan Getz 8 Fela Kuti, Vinyl Box Set I Of Indiana Avenue Quintets: The Clef & (KNITTING FACTORY/ (RESONANCE) 1,270 Norgran Studio Albums LABEL MAISON) 465 (HIP-O SELECT) 642 Newly dis- This package of covered live This three-disc remastered Fela recordings made collection, which Kuti albums—the in Indianapolis concentrates on first in a series sometime in Getz’s earliest sin- of vinyl box sets 1957 or ’58 gles and albums covering the shed light on the early work of (1952–1955) for work of the world-renown Afro- one of jazz’s greatest guitarists Norman Granz, elegantly fills a gap beat vocalist—was curated by during a pivotal point in his career. in the saxophonist’s discography. Ahmir “Questlove” Thompson. 3 The Dave Brubeck Quartet, 6 The Dave Brubeck Quartet, 9 Howlin’ Wolf, Smokestack The Columbia Studio Their Last Time Out Lightning:The Complete Albums Collection: 1955– (COLUMBIA/LEGACY) 596 Chess Masters, 1951–1960 (HIP-O SELECT/GEFFEN) 464 1966 (COLUMBIA/LEGACY) 1,001 Brubeck’s quar- tet of 17 years Perhaps the most Containing about with Paul Des- unique and power- 12 hours of mond, Eugene ful performer in music, this box Wright and Joe the history of the set covers all 19 Morello played blues, How- studio albums their last concert lin’ Wolf cre- that Brubeck together in Pittsburgh on Dec.