Plan Local D'urbanisme Dont Le Territoire Comprend En Tout Ou Partie Un Site Natura 2000
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Le Hohwald – Champ Du Feu LIGNE 510 De SÉLESTAT / VILLÉ Votre Trajet En Navette
2019 www.lechampdufeu.com Plans des pistes - restaurations - hébergements - loisirs - transports - numéros utiles - agenda des manifestations 2 Partagez l’instant Profitez de la nature Faites une pause Goûtez l’air frais en famille, en luge en ski de fond ou ski alpin hors du temps de la forêt ombragée ou raquette... en hiver ! ... en hiver ! ... en été ! ... en été ! LE CHAMP DU FEU PASSION PLEIN AIR & PLEIN LES YEUX Randonneur, cycliste, vttiste, cavalier, Retrouvez-nous Plus d’informations crapahuteur, accro de la glisse ou astronome au chalet du Champ Office de tourisme amateur, c’est là que vous trouverez l’évasion… du feu de décembre du Champ du feu peu importe la saison ! à mars : Chalet du Champ du feu En hiver... ... et en été ! • Office de tourisme — 7j/7 150 route de la Serva Pendant les vacances 67130 Belmont · 9 téléskis · Randonnées pédestres, scolaires de Noël et d’hiver 03 88 97 39 50 · 13 pistes de ski alpin équestres, cyclo ou 03 88 47 18 51 · 41 enneigeurs · Location de vélo • Centre nordique — 5j/7 [email protected] · École de ski français à assistance électrique Réservations · Domaine nordique, · Tubing, accrobranche au 03 88 97 32 63 raquettes, snowscoot, · “Sentier plaisir” : • Salle hors sac — 7j/7 valleedelabruche.fr sentier piéton damé, balades accompagnées · Réservations groupes rando-bruche.fr luge et remonte-luge par les habitants au 03 88 97 30 03 · Tubing · Balades ludiques & famille · Services : casiers, #VisitBruche · Location de matériel · Animations équipements famille, #valleedelabruche · Parcours permanents espace randonnées… @champduFeu d’orientation · WC publics L’office de tourisme, votre interlocuteur privilégié ! Bons plans et conseils sur-mesure.. -
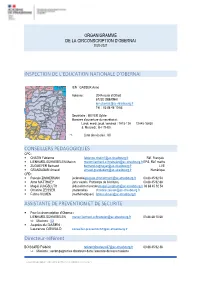
L'organigramme Complet
Les circonscriptions du 1er degré dans le Bas-Rhin WINGEN NIEDERSTEINBACH ROTT WISSEMBOURG SILTZH EIM OBERSTEINBACH CLIMBACH OBERHOFFEN- LEMBACH LES- STEIN SELTZ Wissembourg WISSEMBOURG DAMBACH Haguenau Nord CLEEBOURG RIEDSELTZ SC H LEITH AL DRACHENBRONN- SALMBAC H HERBITZHEIM WINDSTEIN SC H EIBEN H AR D BIRLEN BAC H LAUTERBOURG LAMPERTSLOCH INGOLSHEIM NIEDERLAUTERBACH LANGENSOULTZBACH SEEBAC H KEFFEN AC H SIEGEN NEEWILLER- OERMINGEN LOBSANN HUNSPACH PR ES- NIEDERBRONN-LES-BAINS GOERSDORF MEMMELSHOFFEN LAUTERBOURG SC H OEN EN BOU R G OBERLAUTERBACH MOTHERN DEHLINGEN PR EU SC H D OR F RETSCHWILLER ASC H BAC H TRIMBACH BU TTEN Vosges du Nord WOERTH WINTZENBACH KESKASTEL DIEFFENBACH- KU TZEN H AU SEN CROETTWILLER VOELLER D IN GEN SOU LTZ- EBER BAC H MUNCHHAUSEN FROESCHWILLER LES- HOFFEN OBERROEDERN MERKWILLER- SOU S- -SELTZ SC H AFFH OU SE- LORENTZEN REIPERTSWILLER OBERBRONN REICHSHOFFEN WOERTH STU N D WILLER RATZWILLER PEC H ELBR ON N FORETS PR ES- OBERDORF-SPACHBACH BU H L NIEDERROEDERN SELTZ DIEMERINGEN HINSINGEN SC H OPPER TEN DOMFESSEL VOLKSBER G GUNSTETT ROSTEIG MORSBRONN- SU R BOU R G RITTERSHOFFEN WINGEN-SUR-MODER LICHTENBERG ZINSWILLER BISSER T SAR R E- U N ION LES- BETSC H D OR F OFFWILLER GUNDERSHOFFEN BAIN S SELTZ RIMSDORF WALDHAMBACH WIMMENAU BIBLISH EIM HATTEN KESSELD OR F MACKWILLER WEISLINGEN PU BER G GUMBRECHTSHOFFEN DURRENBACH HARSKIRCHEN FROHMUHL ROTHBACH FORSTHEIM UTTENHOFFEN HEGENEY ALTWILLER THAL-DRULINGEN ZITTERSHEIM WALBOURG AD AMSWILLER TIEFFENBACH HINSBOURG LAUBACH SAR R EWER D EN REXINGEN BISC H H OLTZ EN GWILLER -

Zones PTZ 2017
Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 67 Bas-Rhin Adamswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Albé Alsace C 67 Bas-Rhin Allenwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Alteckendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Altenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Altwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Andlau Alsace C 67 Bas-Rhin Artolsheim Alsace C 67 Bas-Rhin Aschbach Alsace C 67 Bas-Rhin Asswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Auenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Baerendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Balbronn Alsace C 67 Bas-Rhin Barembach Alsace C 67 Bas-Rhin Bassemberg Alsace C 67 Bas-Rhin Batzendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Beinheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bellefosse Alsace C 67 Bas-Rhin Belmont Alsace C 67 Bas-Rhin Berg Alsace C 67 Bas-Rhin Bergbieten Alsace C 67 Bas-Rhin Bernardvillé Alsace C 67 Bas-Rhin Berstett Alsace C 67 Bas-Rhin Berstheim Alsace C 67 Bas-Rhin Betschdorf Alsace C 67 Bas-Rhin Bettwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Biblisheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bietlenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bindernheim Alsace C 67 Bas-Rhin Birkenwald Alsace C 67 Bas-Rhin Bischholtz Alsace C 67 Bas-Rhin Bissert Alsace C 67 Bas-Rhin Bitschhoffen Alsace C 67 Bas-Rhin Blancherupt Alsace C 67 Bas-Rhin Blienschwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Boesenbiesen Alsace C 67 Bas-Rhin Bolsenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Boofzheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bootzheim Alsace C 67 Bas-Rhin -

Antenne Sud : [email protected]
RASED DE LA CIRCONSCRIPTION D’OBERNAI Les numéros de téléphones portables ne sont pas à communiquer aux parents d’élèves Membres du RASED d’Obernai Mme Flora BECKER 06 75 41 03 16 [email protected] Mme Françoise EMERY 06 11 33 66 63 francoise.amstoutz@ac Option E Mme Fabienne WEBER 06 08 46 77 03 [email protected] M. Yves KNOBLOCH 06 09 56 66 58 [email protected] Option G Mme Isabelle ARNAL 06 79 67 51 61 [email protected] Mme Isabelle JANEL 06 47 95 31 24 isabelle.calzolari@ac Psychologues de l’éducation nationale Mme Mireille MENEGHETTI 03 88 08 53 14 mireille.meneghetti@ac Antenne Sud : [email protected] Enseignants spécialisés Adresse administrative WEBER Fabienne BARR Vosges EE Maîtres E KNOBLOCH Yves EPFIG EE Maître G ARNAL Isabelle OBERNAI Picasso EE Psychologue scolaire MENEGHETTI Mireille BARR Vallée EE Secteur d’intervention : secteurs de collèges Dambach la Ville, Heiligenstein, Barr 9 Ecoles maternelle 11 Ecoles primaires 10 Ecoles élémentaires Andlau Barr Tanneurs Andlau Barr Vignes Barr Vosges Barr Vallée Bernardville (RPI 2) Ebersmunster Bourgheim(RPI 3) Blienschwiller (RPI 1) Eichhoffen Dambach la Ville 30 écoles Dambach la Ville Goxwiller RPI3) Ebersheim 2411 élèves Ebersheim Heiligenstein Epfig Epfig Le Hohwald Gertwiller Gertwiller Mittelbergheim Itterswiller (RPI 2) Stotzheim Saint Pierre Nothalten (RPI 1) Valff Stotzheim Zellwiller Circonscription d’Obernai Antenne Nord : [email protected] enseignants spécialisés Adresse administrative -

CC Du Pays De Barr
Communes membres : 0 Export_PDF de toutes les fiches A3 EPCI ortrait P Foncier CC du Pays de Andlau, Barr, Bernardvillé, Blienschwiller, Bourgheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Epfig, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein, Le Hohwald, Itterswiller, Barr Mittelbergheim, Nothalten, Reichsfeld, Saint-Pierre, Stotzheim, Valff, Zellwiller 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC du Pays de Barr Périmètre Communes membres 01/2019 20 ( Bas-Rhin : 20) Surface de l'EPCI (km²) 191,50 Dépt Bas-Rhin Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 126 Poids dans la ZE Molsheim - Obernai*(75,1%) Sélestat(24,9%) ZE 150 Pop EPCI dans la ZE Molsheim - Obernai(13,3%) Sélestat(7%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 23 313 2016 24 063 Évolution 2006 - 2011 173 hab/an Évolution 2011 - 2016 150 hab/an 10 communes les plus peuplées (2016) Barr 7 215 30,0% Epfig 2 274 9,5% 0 Dambach-la-Ville 2 154 9,0% Andlau 1 744 7,2% Valff 1 297 5,4% Gertwiller 1 256 5,2% Stotzheim 1 031 4,3% Heiligenstein 957 4,0% Goxwiller 848 3,5% Zellwiller 772 3,2% Données de cadrage Évolution de la population CC du Pays de Barr Pays CC du Evolution de la population depuis 1968 Composante de l'évolution de la population en base 100 en 1962 de 2011 à 2016 (%) 160 4% 3,2% 140 3% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0%1,9% 2% 120 1,0% 1,1% 1% 0,3% 100 0,0% 0,1% 0% 80 -1% -0,8% -2% 60 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 EPCI ZE Département Grand Est Région -

VTT Le Bas-Rhin Tout Terrain Mountain Biking Im Unterelsass Mountain Biking in Northern Alsace
VTT Le Bas-Rhin tout terrain Mountain biking im Unterelsass Mountain biking in Northern Alsace tourisme-alsace.com Une édition de l’Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin Vue depuis le Grand Wintersberg 1 000 km d’échappées par monts et par vaux 1 000 km Abenteuer über Berg und Tal Obersteinbach 1 000 km break-away up hill and down dale Les plus chevronnés emprunteront la TMV® Die Sportlichsten werden sich für die „Traver- The most seasoned mountain-bikers can – Traversée du Massif Vosgien – qui sillonne sée du Massif Vosgien“, die große Vogesentour take the TMV® across the Vosges Mountains, le département du Bas-Rhin du nord au sud sur TMV®, entscheiden, die das Unterelsass auf 250 km which winds through Northern Alsace from North 250 km. Cet itinéraire convient particulièrement von Nord nach Süd durchquert. Der Weg ist ideal to South over a distance of 250 km. Th is itinerary à des adeptes du vélo passionnés de nature et de für Naturfreunde oder kulturinteressierte, die mit is ideal for mountain bikers fond of nature and culture. dem Fahrrad unterwegs sind. culture. Par ailleurs, une cinquantaine de circuits comptant Außerdem gibt es fünfzig ausgeschilderte Mountain- Moreover, around 50 circuits covering some 900 km quelque 900 km de sentiers spécialement balisés bikestrecken auf einem Radwegenetz von über 900 km, of trails especially signposted for mountain bikes pour la pratique du VTT et répartis sur 13 sites in dreizehn Gebieten im Tal und in den Bergen, für and spread out over 13 sites in the plain and the de plaine et de montagne accueillent vététistes geübte und weniger geübte Mountainbikefahrer. -

Mairies Du Bas-Rhin
DDT 67 Securité L'accessibilité des mairies Transports Ingenierie de dans le Bas-Rhin Crise WISSEMBOURG OBERSTEINBACH WINGEN NIEDERSTEINBACH SILTZHEIM ROTT CLIMBACHOBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG LEMBACH STEINSELTZ DAMBACH CLEEBOURG RIEDSELTZ SCHLEITHAL HERBITZHEIM SALMBACH SCHEIBENHARD WINDSTEIN NIEDERLAUTERBACH DRACHENBRONN-BIRLENBACH LAUTERBOURG LAMPERTSLOCH INGOLSHEIM SEEBACH OERMINGEN KEFFENACH LOBSANN HUNSPACH SIEGEN NEEWILLER-PRES-LAUTERBOURG NIEDERBRONN-LES-BAINS LANGENSOULTZBACH MEMMELSHOFFEN DEHLINGEN GOERSDORF SCHOENENBOURG OBERLAUTERBACH MOTHERN RETSCHWILLER ASCHBACH BUTTEN WOERTH TRIMBACH WINTZENBACH KESKASTEL VOELLERDINGEN PREUSCHDORFKUTZENHAUSEN CROETTWILLER FROESCHWILLER HOFFEN OBERROEDERN EBERBACH-SELTZ DIEFFENBACH-LES-WOERTH SOULTZ-SOUS-FORETS MUNCHHAUSEN LORENTZEN REIPERTSWILLER STUNDWILLER OBERBRONN RATZWILLER REICHSHOFFEN OBERDORF-SPACHBACHMERKWILLER-PECHELBRONN BUHL SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ VOLKSBERG NIEDERROEDERN HINSINGEN SCHOPPERTEN DOMFESSEL DIEMERINGEN ROSTEIG GUNSTETT BISSERT SARRE-UNION SURBOURG BETSCHDORF WIMMENAU LICHTENBERG ZINSWILLER MORSBRONN-LES-BAINS WALDHAMBACH GUNDERSHOFFEN HATTEN OFFWILLER RITTERSHOFFEN SELTZ RIMSDORF BIBLISHEIM PUBERG MACKWILLER WEISLINGEN WINGEN-SUR-MODER GUMBRECHTSHOFFEN FORSTHEIM DURRENBACH KESSELDORF HARSKIRCHEN FROHMUHL ROTHBACH UTTENHOFFEN HEGENEY WALBOURG ALTWILLER THAL-DRULINGEN ADAMSWILLER HINSBOURG SARREWERDEN TIEFFENBACH ZITTERSHEIM BISCHHOLTZ LAUBACH REXINGEN ENGWILLER INGWILLER MULHAUSEN ESCHBACH FORSTFELD STRUTH UHRWILLER MIETESHEIM BURBACH SPARSBACH BEINHEIM BERG DURSTEL -

L'alsace Des Stations Vertes a Velo
Transversale cyclo Nord-Sud Nord-Süd Strecken L’ALSACE DES STATIONS VERTES A VELO North-South cross-country cycle trails Des Vosges du Nord à la Route des Vins Von den Nordvogesen zur Weinstrasse From the Northern Vosges to the Wine Road 5 étapes - 11 stations Landau (D) Wissembourg D77 Parc Rott MOSELLE Lembach Cleebourg Naturel Drachenbronn D152 Birlenbach 1 D27 Lobsan Keffenach Lampertsloch Memmelshoffen Gœrsdorf D77 D51 Retschwiller Niederbronn-les-Bains Frœschwiller D677 Preuschdorf Soultz- Oberbronn D1062 D28 Wœrth Mitschdorf sous-Forêts D28 Reichshoffen Régional Zinswiller Surbourg Betschdorf Wingen-sur-Moder Wimmenau Sauer Rothbach Offwiller des Vosges D919 Mo der du Nord D56 D28 Mertzwiller Weinbourg Ingwiller D1062 Zinsel D1063 Moder Weiterswiller 2 Soufflenheim N61 Pfaffenhoffen D14 Bouxwiller Schweighouse- Neuwiller-lès-Saverne sur-Moder Haguenau er od Cycling through Northern Alsace through Cycling Dossenheim-sur-Zinsel D133 D1340 M Ernolsheim-lès-Saverne A35 Bischwiller A4 D219 A4 Saint-Jean-Saverne Gries Drusenheim Hochfelden Greffern (D) Eckartswiller D1004 Dettwiller Herrlisheim Monswiller in u Rh 4 Brumath n e a or Ottersthal Canal de la Marn Z Saverne Weyersheim Offendorf n or Z 3 Gambsheim Haegen D102 Hœrdt D263 A35 Marmoutier Kilstett La Wantzenau Rheinhardsmunster D117 Dimbsthal Hengwiller Salenthal A4 Le Rhin Allenwiller Mundolsheim Ill Birkenwald D229 D1004 MOSELLE Romanswiller Wasselonne ALLEMAGNE Marlenheim Bischheim / Mit dem Fahrrad durch das Unterelsass / das Unterelsass durch Fahrrad / Mit dem Kirchheim Ittenheim -

Navettes Des Neiges Horaires 2019-2020
258 Strasbourg Obernai Champ du Feu 511 Sélestat Villé Champ du Feu DES NEIGES 252 Schirmeck Saint-Blaise Champ du Feu 542 Barr Le Hohwald Champ du Feu NAVETTES www.fluo.eu/67 Ligne 258 Ligne 252 Ligne 511 Ligne 542 surtaxé non appel Calendrier 2019/2020 67 67 67 0972 Strasbourg Obernai Champ du Feu Schirmeck Saint-Blaise Champ du Feu Sélestat Villé Champ du Feu Barr Le Hohwald Champ du Feu Déc. Jan. Fév. Mars 67 fluo info STRASBOURG Gare routière des Halles 07:45 09:45 12:30 SCHIRMECK Gare 08:05 10:05 12:50 SÉLESTAT Place Vanolles 07:45 09:45 12:30 BARR Gare 08:00 10:00 12:45 D 1 Me 1 S 1 D 1 OBERNAI Collège Europe 08:15 10:15 13:00 LA BROQUE Collège 08:12 10:12 12:57 Gare 07:51 09:51 12:36 MITTELBERGHEIM Route des Vins 08:05 10:05 12:50 L 2 J 2 D 2 L 2 Gare - Paul Emile Victor 08:17 10:17 13:02 ROTHAU Poste 08:15 10:15 13:00 Route de Ste Marie 07:54 09:54 12:39 ANDLAU Commanderie 08:08 10:08 12:53 M 3 V 3 L 3 M 3 CHAMP DU FEU DU CHAMP Parking des Remparts 08:20 10:20 13:04 SAINT-BLAISE-LA-ROCHE Gare 08:21 10:21 13:06 CHÂTENOIS Ancienne Gare 07:57 09:57 12:42 Mairie 08:09 10:09 12:54 Me 4 S 4 M 4 Me 4 J 5 D 5 Me 5 J 5 OTTROTT Ancienne Gare 08:29 10:29 13:14 FOUDAY Route de la Charbonnière 08:27 10:27 13:12 VAL DE VILLÉ Gare 07:59 09:59 12:44 Rue du Maréchal Joffre 08:10 10:10 12:55 Roche la Le Hohwald Le Villé Blaise St Obernai V 6 L 6 J 6 V 6 KLINGENTHAL Armes Blanches 08:33 10:33 13:18 WALDERSBACH Route du Champ du Feu 08:33 10:33 13:18 THANVILLÉ RD 424 08:04 10:04 12:49 Route du Hohwald 08:12 10:12 12:57 Barr Sélestat -

Communiqué De Presse
Communiqué de presse Strasbourg, Le 28 février 2020 Élections municipales 2020 : état des candidatures enregistrées pour le 1er tour Dans le Bas-Rhin, le dépôt des déclarations de candidatures aux élections municipales pour le 1er tour de scrutin a été clôturé le jeudi 27 février 2020 à 18h. Les états des candidatures sont désormais disponibles en ligne à l’adresse : http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Elections-Elus/Elections-municipales- et-communautaires-des-15-et-22-mars-2020 Dans les 194 communes de 1000 habitants et plus ou un scrutin de liste est organisé : • parmi les 142 communes avec liste sans nuances (-3500 habitants) - 78 ont 1 liste - 59 ont 2 listes - 05 ont 3 listes • parmi les 52 communes avec listes avec nuances (+ 3500 habitants) : - 15 ont 1 liste - 01 a 5 listes - 17 ont 2 listes - 01 a 6 listes - 14 ont 3 listes - 01 a 11 listes - 03 ont 4 listes Comparatif 2020/2014 : 2020 2014 Nombre de listes dans les communes de 1000 habitants et plus 336 348 Nombre de candidats dans les communes de 1000 habitants et 8254 8232 plus Nombre de candidats dans les communes de moins de 1000 4968 5407 habitants Nombre total de candidats dans le département du Bas-Rhin 13222 13639 Service de la communication interministérielle Mail : [email protected] Tél. : 03 88 21 68 77 Twitter : @Prefet67 Facebook : @PrefetGrandEstBasRhin Le candidat le plus âgé a 96 ans et les plus jeunes 18 ans. L’âge moyen est de 47 ans (49 ans en 2014). Aucun candidat ne s’est déclaré pour les communes d’Altenheim et d’Ettendorf. -

Plui DU PAYS DE BARR UN TERRITOIRE À LA CROISÉE DE LA PLAINE, 318 DES VIGNES ET DE LA MONTAGNE AVRIL 2021
DE L’ADEUS PLUi DU PAYS DE BARR UN TERRITOIRE À LA CROISÉE DE LA PLAINE, 318 DES VIGNES ET DE LA MONTAGNE AVRIL 2021 PLANIFICATION/ENVIRONNEMENT Prescrit fin 2015, après la création de la Un territoire riche de sa trilogie de patrimoine bâti et naturel, tout en Communauté de Communes du Pays de paysages (plaine rhénane, piémont conciliant développement urbain Barr début 2013, le PLU intercommunal viticole, massif vosgien), traversé par et modération de la consommation constitue une opportunité pour la route des vins avec ses paysages foncière. construire un projet de territoire emblématiques de l’Alsace. Il est global s’articulant autour d’une vision également doté d’un patrimoine urbain commune et stratégique. Il a été remarquable protégé. approuvé le 17 décembre 2019. Cette note a pour objectif de montrer Issue de la fusion de deux anciennes le type d’équilibre recherché pour intercommunalités, la Communauté de la préservation et la valorisation de Communes du Pays de Barr regroupe l’authenticité du territoire dans ce 20 communes et plus de 24 000 type de PLU. Un zoom est approfondi habitants. sur la valorisation du paysage et du TITREPLUi DU DE PAYS L’INDICATEUR DE BARR : UN TERRITOIRE À LA CROISÉE DE LA PLAINE, DES VIGNES ET DE LA MONTAGNE Un triptyque de paysages et un patrimoine authentique : fil rouge du projet de territoire Une identité du territoire organisée Le PLUi a permis d’améliorer la connaissance et autour d’un triptyque de paysages la sensibilité des milieux naturels. Ces avancées faciliteront également la réalisation des projets Sa situation à l’articulation de trois entités de planifiés, grâce à l’évitement des secteurs les plus paysages (plaine, piémont viticole et montagne) sensibles et la préservation de zones humides et contrastées, forme la richesse du territoire et de corridors écologiques. -

Paysager Du Bas-Rhin Référentiel
Albé Allenwiller Andlau Balbronn Barembach Barr Bassemberg Bellefosse Belmont Bernardvillé Birkenwald Blancherupt Boersch Bourg-Bruche Breitenau Breitenbach Bust Butten Châtenois Colroy-la-Roche Cosswiller Crastatt Dambach Dambach-la-Ville Dieffenbach-au-Val Dieffenthal Diemeringen Dimbsthal Dinsheim-sur-Bruche Dossenheim-sur-Zinsel Eckartswiller Erckartswiller Ernolsheim-lès-Saverne Eschbourg Fouchy Fouday Frohmuhl Gottenhouse Grandfontaine Grendelbruch Gresswiller Haegen Heiligenberg Heiligenstein Hengwiller Hinsbourg Hohengoeft Ingwiller Kintzheim La Broque Lalaye Langensoultzbach RÉFÉRENTIEL La Petite Pierre La Vancelle PAYSAGER DU BAS-RHIN Le Hohwald Lembach Lichtenberg Lohr Lutzelhouse Maisonsgoutte Secteur Marlenheim Marmoutier Mollkirch Muhlbach-sur-Bruche Natzwiller Neubois Vosges Neuve-Eglise Neuviller-la-Roche Neuwiller-lès-Saverne Niederbronn-les-Bains Niederhaslach Niedersteinbach Oberbronn Oberhaslach Obernai Synthèse Obersteinbach Offwiller Orschwiller Ottersthal Otterswiller Ottrott Petersbach Pfalzweyer Plaine Puberg Ranrupt Ratzwiller Reinshardsmunster Reichsfeld Reipertswiller, Romanswiller Rosenwiller, Rosheim Rosteig Rothau Rothbach Russ Saales Saint-Blaise-la-Roche Saint-Jean-Saverne Saint-Martin Saint-Maurice Saint-Nabor Saint-Pierre-Bois Salenthal Saulxures Saverne Scherwiller Schirmeck Schoenbourg Singrist Solbach Sparsbach Steige Still Struth Thal-Marmoutier Thanvillé Tieffenbach Triembach-au-Val Urbeis Urmatt Villé Volksberg Wangenbourg-Engenthal Waldersbach Waldhambach Wangen Wasselonne Weinbourg Weislingen