(PPDDSP) 2018-2030 De Wallis Et Futuna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Introduction À La Végétation Et À La Flore Du Territoire De Wallis Et Futuna
CONVENTION ORSTOM/SERVICE DE L'ECONOMIE RURALE DE WALLIS ET FUTUNA INTRODUCTION ALA VEGETATION ET ALA FLORE DU TERRITOIRE DE WALLIS ET FUTUNA • (Rapport des 3 missions botaniques effectuées dans ce territoire en 1981-1982) P. MORAT J.M.· VEILLON M. HOFF OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE_MER OCTOBRE 1983 ______1 CENTRE OoRoSoToOoMo DE NOUMEA NOUVELLE CALEDONIE ·1 OFFICE DE LA REC~ERCHE SCIENTifIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER. CENTRE DE NOUMEA. INTRODUCTION ALA VEGETATION ET ALA FLORE DU TERRITOIRE DE ~1ALLIS ET FUTUNA 1 -O§O- PAR Philippe MORAT Jean-Matie VEILLON Mi che l HOFF Rapp~rt des mi~sions botaniques effectuées dans ce tp.rritoire en 1981-1982. OCTOBRE 1983. TABLE DES MATIERES. Page..6 . INTRODUCTION 1 1 - Le milieu 2 1.1. Situation géographique - Relief - Géologie 2 1. 2. Sols 3 1.3. Réseau hydrographique 3 1. 4 Cl i mat 4 1.5. Peuplement humain 4 -' 2 - La végétation 5 2.1. La végétation autochtone 5 2.1.1. la mangrove 5 2.1.2. la végétation littorale 6 2. 1.2. 1. .ecu gJLoupement.6 p.6ammophUe..6. 2.1.2.2• .ea fioJLêt littoJLale 2.1.3. la forêt sempervirente 8 ·2.1.4. la végétation marécageuse 11 2.2. La végétation modifiée 12 2.2.1. les forêts secondarisées et les fourrés 12 2.2.2. cultures, jachères, végétation des zones fortement anthropisées 13 2.2.3. landes à V-i.CJtMOpteJU.o ou IItoafa li 14 3 - La Flore 16 4 - Conclusions - Recommandations 17 5 - Bibliographie 23 ANNEXES 1 - Carte des itinéraires et lieux prospectés au cours des 3 missions ~I - Liste des espèces et échantillons collectés ainsi que leurs biotopes III - Carte de Végé.tation IV - List~ rles noms sciehtifiques et leur correspondances en noms vernaculaires connys. -
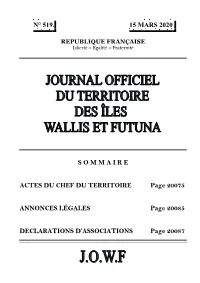
1Ere Page 15 MARS 2020
N° 519 15 MARS 2020 REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté – Egalité – Fraternité S O M M A I R E ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Page 20075 ANNONCES LÉGALES Page 20085 DECLARATIONS D’ASSOCIATIONS Page 20087 SOMMAIRE ANALYTIQUE ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Arrêté n° 2019-1067 du 12 décembre 2019 Décision n° 2020-260 du 03 mars 2020 relative à la approuvant et rendant exécutoire la délibération n° prise en charge des titres de transport et frais de 105/AT/2019 du 04 décembre 2019 portant création séjour des deux représentants de la Chefferie des d’une aide financière en faveur des lycéens du Royaumes de Alo et de Sigave au Comité Consultatif Parcours étudiant. – Page 20075 Territorial de la Formation Professionnelle. – Page 20080 Arrêté n° 2020-163 du 03 mars 2020 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’un Décision n° 2020-261 du 03 mars 2020 relative à la agent permanent, un technicien supérieur génie civil, prise en charge du transport aérien d’un(e) dans les services de l’Administration Supérieure des étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet îles Wallis et Futuna. – Page 20076 étudiant. – Page 20080 Arrêté n° 2020-164 du 03 mars 2020 portant Décision n° 2020-262 du 03 mars 2020 relative à la modification de la désignation des représentants de prise en charge du transport aérien d’un(e) l’Assemblée Territoriale au sein du conseil étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet d’administration de la Caisse des Prestations Sociales étudiant. – Page 20080 de Wallis et Futuna. – Page 20077 Décision n° 2020-263 du 03 mars 2020 relative à la L’arrêté n° 2020-165 du 04 mars 2020 portant ordre prise en charge du transport aérien d’un(e) de réquisition n° 32/2020 a été publié dans le étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet NUMERO SPECIAL n° 517 du 16 mars 2020 Journal étudiant. -

1Ere Page 31 JANVIER 2019
N° 488 31 JANVIER 2019 REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté – Egalité – Fraternité SS OO MM MM AA II RR EE ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Page 18708 ANNONCES LÉGALES Page 18724 DECLARATIONS D’ASSOCIATIONS Page 18726 SOMMAIRE ANALYTIQUE ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Arrêté n° 2019-41 du 16 janvier 2019 portant L’arrêté n° 2019-53 du 29 janvier 2019 autorisant le habilitation d’un agent spécial d’Assurance de la versement de la taxe pour frais de chambre société MUTEX. - Page 18708 interprofessionnelle, de la taxe sur les sociétés sans activité et des droits proportionnels au profit de la Arrêté n° 2019-42 du 17 janvier 2019 modifiant Chambre de commerce, d'industrie, des métiers et l’arrêté 2018-854, portant ouverture d’un concours d'agriculture de Wallis et Futuna - Page 18714 pour le recrutement d’un technicien de maintien en condition opérationnelle des systèmes locaux Arrêté n° 2019-54 du 30 janvier 2019 autorisant le d’information et de communication rattaché au versement d’une subvention destinée à l’Association cabinet du Préfet. - Page 18708 territoriale pour l’emploi sportif et socio-éducatif au titre de la convention pluriannuelle d’objectifs dans le Arrêté n° 2019-43 du 17 janvier 2019 modifiant domaine de la jeunesse et des sports – exercice 2019. - l’arrêté n°2019-35, portant ouverture d’un concours Page 18715 pour le recrutement d’un agent permanent, un sapeur pompier au sein du service de la Circonscription de Wallis. - Page 18709 DÉCISIONS Arrêté n° 2019-44 du 18 janvier 2019 autorisant le versement de la subvention territoriale à la Caisse des er Prestations Sociales au titre du 1 trimestre 2019 Les décisions n° 2019-60 à 2019-68 ne sont pas (Allocation d'aide à l'enfance) - Page 18709 publiables dans le Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna. -

238 the Contemporary Pacific • Spring 2002 K E R Ry Ja M E S Wallis And
238 the contemporary pacific • spring 2002 tions. The government has established Tongan culture, support the rights of the Tonga Communications Corpora- all Tongans, and protect the indepen- tion, in place of the previous compa- dence of the kingdom. These moves, nies (Cable and Wireless and Tonga together with the introduction of a Telecom), to run both international high-speed wireless service and fiber- and domestic telephone services. The optic cable to link the central business new corporation’s immediate plans are area of Nuku‘alofa—which, the to establish a 2.5g gsm cellular tele- Crown Prince avers, will liberate the phone service with email and tele- common man more than the auto- phone capacity, and to increase Inter- mobile—demonstrate again the fre- net accessibility. The government has quently startling juxtaposition of also issued a license to a second tele- complementary ideas that characterize communications carrier, Tonfön, a Tonga. At the very least, they promise fully owned subsidiary of Shoreline interesting future developments on Communications, a company headed several fronts. by the Crown Prince that already pro- duces most of the power for Tonga’s k e r ry ja m e s electricity supply which is then dis- tributed by the Tonga Electricity Power Board. Through Tonfön, the Wallis and Futuna prince aims to introduce wireless technology whereby, “the customer The main subject of political discus- should be able to buy a computer, sion remains the special agreement, plug it in, pull out an aerial and make yet to be signed, between the French a phone call . swipe a card on the Overseas Territory of Wallis and computer, establish an account, and Futuna and the French Overseas switch to his favorite tv channel Country of New Caledonia. -

Inventaire Et Fouille Des Sites Archéologiques Et
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER CENTRE DE NOUMÉA SCIENCES HUMAINES O.FRIMIGACCI -JP.SIORAT -B. VIENNE MISSION ORSTOM-CNRS 1983 INVENTAIRE ET FOUILLE DES SITES ARCHEOLOGIQUES . ET ETHNOHISTORIQUES DE L'ILE D'UVEJ CENTRE ORSTOM - B.P. A 5 - NOUMËA NOUVELLE- CALËOONIE _. INVENTAIRE ET FOUILLE DES SITES ARCHEOLOGIQUES . ET ETHNOHISTORIQUES DE L'ILE D'UVEA \ \ 1 UVEA DANS L'ENSEMBLE PACIFIQUE SUD OUEST N t , TUVALU • TOKELAU. - 1 1 • SANTA CRUZ ~ 10° S 1 SAMOA FUTUNA Ôa "TI ; BANKS ~.. • , ..... ... 1 li --\ - 15°S ~$ .- -...~ FIDJI VANUATU ,. .--.- .. ", 1 • NIUE TONGA .' ~ 20 0 S NOUVELLE CALEDONIE ----~----TROPIQUE DU CAPRICORNE --- --~----- --~--- 1 1-- - -\- -- -- o 100 300 500 Km -1---_ !: •, ! ! \ E 1700 E 180° 1 170°'-N 3 INTRODUCTION Ceci est le deuxième rapport de mission sur l 'ethno-archéologie de l'île d'UVEA - territoire des îles Wallis et Futuna - entrepris en AoOt~ Septem bre et Octobre 1984. Ce travail de recherche sur le Passé d'UVEA a été réalisé à l'instigation de l'Association Socio-culturelle pour l'art Wallisien et Futunien. Sans l'aide des membres de cette association il aurait été impossible d'envisa ger une telle entreprise~ grâce à eux~ nous avons obtenu tous les accords et la confiance des plus hautes autorités coutumières. Tous les membres de la mission étaient hébergés au presbytère de MUA par le père Petelo FALELAVAKI~ nous tenons à le remercier tout particulièrement de son hospi talité bienveillante. Ce travail a été réalisé par B. VIENNE~ anthropologue de l 'ORSTOM~ D. FRIMIGACCI~ Préhistorien du CNRS et J.P. SIORAT, Conservateur adjoint du Musée Néo-Calédonien de Nouméa. -

2006040108 Rapport WALLIS XP OK
EOM __......... INSTITUT D’ÉMISSION D’OUTRE-MER ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL SIÈGE SOCIAL 5, rue Roland Barthes 75598 PARIS CEDEX 12 Les renseignements autres que monétaires publiés dans la présente étude ont été recueillis auprès de diverses sources extérieures à l’Institut d’émission et ne sauraient engager sa responsabilité. L’IEOM tient à remercier les diverses administrations publiques, les collectivités et les entreprises pour les nombreuses informations qu’elles lui ont communiquées. SYNTHESE ........................................................................................................................8 APERCU HISTORIQUE .................................................................................................. 11 PRESENTATION GEOGRAPHIQUE............................................................................. 13 L’EVOLUTION ECONOMIQUE......................................................................................... 15 SECTION 1.............................................................................................................................. 16 LES PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES .................................................... 16 § 1. La population ................................................................................................................. 16 1. Evolution et principales caractéristiques de la population ........................................... 16 2. Caractéristiques de la population.................................................................................. -

1Ere Page 15 Décembre 2020
N° 552 15 DECEMBRE 2020 REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté – Egalité – Fraternité S O M M A I R E ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Page 21212 ANNONCES LÉGALES Page 21323 DECLARATIONS D’ASSOCIATIONS Page 21332 SOMMAIRE ANALYTIQUE ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE L’arrêté n° 2020-1299 du 30 novembre 2020 n’est pas Arrêté n° 2020-1309 du 02 décembre 2020 publiable dans le Journal Officiel du Territoire des approuvant et rendant exécutoire la délibération n° îles Wallis et Futuna. 290/CP/2020 du 18 novembre 2020 accordant une aide à l’habitat à Madame TOLOFUA – Wallis. – Arrêté n° 2020-1300 du 02 décembre 2020 Page 21222 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 270/CP/2020 du 18 novembre 2020 portant création Arrêté n° 2020-1310 du 02 décembre 2020 de l’aide exceptionnelle dénommée « Aide Covid-19 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° pour formation professionnelle Année 2020 » allouée 291/CP/2020 du 18 novembre 2020 accordant une aux stagiaires en formation professionnelle et en école aide à l’habitat à Madame TAGATAMANOGI d’infirmier en Métropole. – Page 21212 Lafaela – Wallis. – Page 21223 Arrêté n° 2020-1301 du 02 décembre 2020 Arrêté n° 2020-1311 du 02 décembre 2020 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° approuvant et rendant exécutoire à la délibération n° 281/CP/2020 du 18 novembre 2020 accordant une 292/CP/2020 du 18 novembre 2020 accordant une subvention à l’association MOLIHINA – aide à l’habitat à FOLITUU Paino. – Page 21224 VILLAGEOIS DE ALELE – Wallis. – Page 21214 Arrêté n° 2020-1312 du 02 décembre 2020 Arrêté n° 2020-1302 du 02 décembre 2020 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 308/CP/2020 du 18 novembre 2020 portant 282/CP/2020 du 18 novembre 2020 accordant une régularisation des prises en charge des subvention à l’Association Handicap Solidarité et accompagnateurs familiaux de personnes évacuées Aide à Domicile (A.H.S.A.D) – Wallis. -

(Wallis), Futuna and Alofi Islands (South-West Pacific): an Update
30 Notornis, 2015, Vol. 62: 30-37 0029-4470 © The Ornithological Society of New Zealand Inc. Birds of Uvea (Wallis), Futuna and Alofi islands (South-West Pacific): an update Jean-Claude ThIbaulT* Muséum National d’histoire Naturelle, département Systématique et evolution, 55 rue buffon, 75005 Paris, France Alice CIbois department of Mammalogy and Ornithology, Natural history Museum of Geneva, CP 6434, 1211 Geneva 6, Switzerland Jean-YveS MeYer délégation à la recherche, Gouvernement de la Polynésie française, b.P. 20981 Tahiti, Polynésie Française Abstract Alofi, Futuna and Uvea (also called Wallis), 3 islands situated north of Fiji and Tonga archipelagos, are rarely visited by ornithologists. We present new data on the avifauna obtained during surveys in 2014 and we compare them with previous surveys made in the 1920s, 1980s and 1990s. We recorded the extirpation of 1 species (friendly ground- dove, Alopecoenas stairi) probably related to predation, and the decline of another (lesser shrikebill, Clytorhynchus vitiensis) linked to deforestation. Although the recent arrival of the black rat (Rattus rattus) in Futuna is a potential threat for the blue-crowned lorikeet (Vini australis), no decline is apparent at the present time. In general, most landbirds seemed common despite loss of native habitats and hunting pressure; similarly, the seabird populations and number of species appeared stable, a situation probably linked with the general decrease of harvesting. Finally, 2 breeding species (spotless crake, Zapornia tabuensis, and tropical shearwater, Puffinus bailloni) and 3 vagrants (white-faced heron, Egretta novaehollandiae, masked lapwing, Vanellus miles, and pectoral sandpiper, Calidris melanotos) are added to the list. Thibault, J.-C.; Cibois, A.; Meyer, J.-Y. -
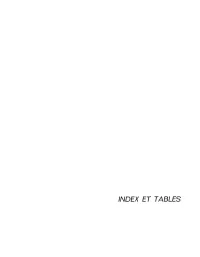
Index Et Tables Index
INDEX ET TABLES INDEX des principaux personnages, toponymes et thématiques narratives Les numéros renvoient à ceux du répertoire 1970-1971 en annexe. Les indications de pages qui font suite à la série des numéros se réfèrent à la pagination de cet ouvrage. Les noms de personnages, suivant la pratique adoptée, sont donnés en capitales, et leur signification entre parenthèses, de façon à les distinguer des toponymes et des noms communs. Les noms communs sont classés suivant l'ordre alphabétique des termes français, traduits en wallisien en caractères maigres. En se servant du lexique botanique et zoologique, il est facile, en partant du vocable wallisien, de retrouver le correspondant français. Les espèces difficilement identifiables sont regroupées sous les entrées : coquillages, crabes, oiseaux, plantes, poissons. Nous remercions M. Richard Rossille pour sa contribution à cet index partiel. Afrique, Afelika : n°s 108, 1.053, 1.185, 1.286 — pp. 19, 98, bananier, fusil : 403, 897, 946, 1.176, 1.207, 1.212, 1.249, 100, 155, 184. 1.271, 1.277 — pp. 66, 69, 72, 74, 75, 77, 177, 182, 183. AGO-MUA (Curcuma-premier) : 144, 177, (396) — p. 96. bêche-de-mer, loli : 580 — p. 141. Ahoa, village du district de Hahake : 826, 935, 987, 1.168, Belle au bois dormant, thématique : 753 — p. 138. 1.235, 1.241, SElvlTSI 1932-2 — pp. 18, 102. bénitier, gaegae : 13, 144, 195, 222, 304, 396, 402, 487, aigle, akuila : 244, 474, 736, 1.053, 1.185 — pp. 34, 115. 741, 895, 1.000, 1.094 — pp. 95 111, 161. ALAALAMAIPE (Réveille-toi) : 325 — p. -

Political Reviews
Political Reviews 0LFURQHVLDLQ5HYLHZ,VVXHVDQG(YHQWV-XO\ WR-XQH david w kupferman, kelly g marsh, donald r shuster, tyrone j taitano 3RO\QHVLDLQ5HYLHZ,VVXHVDQG(YHQWV-XO\ WR-XQH lorenz gonschor, hapakuke pierre leleivai, margaret mutu, forrest wade young 7KH&RQWHPSRUDU\3DFL²F9ROXPH1XPEHU¥ E\8QLYHUVLW\RI+DZDL©L3UHVV 127 political reviews polynesia 183 lt, La Tercera Online. Daily Internet news. 7ëSXUD5H©R Monthly Rapa Nui–language Santiago, Chile. http://latercera.com/ newspaper. Hanga Roa, Rapa Nui. Métis National Council. 2011. Métis UN, United Nations. 2007. United Nations Nation President Visits Easter Island to Declaration of the Rights of Indigenous Support Indigenous Rights Struggle. 8 Peoples. March. http://www.un.org/esa/ August. http://www.metisnation.ca/index socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf .php/news/metis-nation-president-visits [accessed 1 October 2012] -easter-island-to-support-indigenous US Congress. 2011. Calling for a Peaceful -rights-struggle [accessed 1 October 2012] Solution to the Easter Island Crisis. Con- Moore, Sally Faulk. 2000. Law as Process: gressional Record 157 (19). 8 February. An Anthropological Approach. Oxford: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC James Currey Publishers. -2011-02-08/html/CREC-2011-02-08 -pt1-PgH544-2.htm MV, Moe Varua Rapa Nui. Monthly magazine. Municipality of Hanga Roa, Wolfe, Patrick. 2006. Settler Colonialism Rapa Nui. and the Elimination of the Native. Journal of Genocide Research 8 (4): 387–409. Nelson, Aaron. 2012. A Quest For Inde- pendence: Who Will Rule Easter Island’s Young, Forrest Wade. 2012. Polynesia in Stone Heads? Time Magazine, World edi- Review: Issues and Events, 1 July 2010 to tion, March. -

Stratégie Pour La Biodiversité De Wallis Et Futuna
Stratégie pour la Biodiversité de Wallis et Futuna SOMMAIRE SOMMAIRE ............................................................................................................................................... TABLE DES FIGURES .................................................................................................................................. ABREVIATIONS ......................................................................................................................................... 1. INTRODUCTION .............................................................................................................................. 1 1.1 Contexte de la stratégie............................................................................................................ 1 1.2 Cadre de travail du PROE .......................................................................................................... 2 1.3Vision ......................................................................................................................................... 2 2. CONTEXTE....................................................................................................................................... 3 2.1 Géographie et Climat ................................................................................................................ 3 2.2 Contexte social, économique et politique ................................................................................ 4 3. ESPECES PRESENTES, ECOSYSTEMES ET SERVICES ......................................................................... -

Enquête Sur La Filariose À Wallis
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER 20. Rue Monsieur PARIS 7' ENQUÊTE SUR LA FILARIOSE À WALLIS par Jean RAGEAU avec la collaboration du Dr. J. ESTIENNE, • 1NSTITUT FRAN ÇAI S D'OCÉAN 1E NOUMÉA, Nouvelle,Calédonie OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER INSTITUT FRANÇAIS O/OCEANIE Laboratoire d'Entomologie médicale et vétérinaire ENQUÊTE SUR LA FILARIOSE À WALLIS par Jean RAGEAU avec la collaboration du Dr. J. ESTIENNE, Midecin-Chef du Service médical des Iles Wallis et Futuna Avril 1969 r- i ENQUETE SUR LA lILARIOSE A WALLIS • -:-:-:-:-:- • l.N.TI3:0DUC T!ON La. filariose humaine à. Wuc_hAre;r::ia bW.c:.rofti compte parmi les endémies majeures de l'1le Wallis. La lutGe contre cette très grave pa rasitose se limite acblellem~nt à. la di$tribution de Notézine aux malades souffrant de lymphangite filarie!J~e et à. quelques interventions chirurgi cales dans les cas op8rables diéléphantiasis. Ni la proph~rlaxie entomologique, ni la chimioprophylaxie n'ont été tentées, bien q~lun cinqui3me au moins de la pop·~tion ~~lli~ie!Jne renferme des microfilaires dans le sang et qu"un wallisien sur douze sou~ fre de manifestations filarie~~es. Notre enqu~te avait pour objectif principal l'étlme épidémie logique de la filariose àe~e Eancroft dans l'11e VAllie 8t elle nous a per mis de dresser un tableau. de la sitLo.ationsitLo.atio::l actuelle de cette IIl9.ladie. Lf8nqu~te hémuto1og5.que a été réalisée avec la collaboration du Dr. J. Esttep.nc, Médecin de l'île '-{allis, d'octobre 1958 à fé-rrier 1959 ainsi que l'étude sur la morpholoeie des microf..i.laires de W.