Afghanistan-Iran Kaboul
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
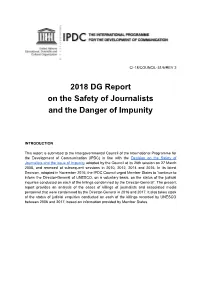
2018 DG Report on the Safety of Journalists and the Danger of Impunity
CI-18/COUNCIL-31/6/REV 2 2018 DG Report on the Safety of Journalists and the Danger of Impunity INTRODUCTION This report is submitted to the Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication (IPDC) in line with the Decision on the Safety of Journalists and the issue of Impunity adopted by the Council at its 26th session on 27 March 2008, and renewed at subsequent sessions in 2010, 2012, 2014 and 2016. In its latest Decision, adopted in November 2016, the IPDC Council urged Member States to “continue to inform the Director-General of UNESCO, on a voluntary basis, on the status of the judicial inquiries conducted on each of the killings condemned by the Director-General”. The present report provides an analysis of the cases of killings of journalists and associated media personnel that were condemned by the Director-General in 2016 and 2017. It also takes stock of the status of judicial enquiries conducted on each of the killings recorded by UNESCO between 2006 and 2017, based on information provided by Member States. TABLE OF CONTENTS 1. Executive Summary 2 2. Background and Context 2 3. Journalists’ killings in 2016 and 2017: key findings 7 3.1 Most dangerous regions 8 3.2 Rise in number of women journalists among fatalities 9 3.3 Highest number of killings among TV journalists 11 3.4 Majority of victims are local journalists 11 3.5 Freelance and staff journalists 12 3.6 More killings occurring in countries with no armed conflict 12 4. Member States’ responses: status of the judicial enquiries on cases of journalists killed from 2006 to end 2017 13 4.1 Decrease in Member State response rate to Director-General’s request 18 4.2 Slight reduction in impunity rate, but 89% of cases remain unresolved 19 4.3 Member States reporting on measures to promote safety of journalists and to combat impunity 22 5. -

H:\Manjeet-M\Journal of Islamic
Journal of Islamic Law Review, Vol. 16, No. 1, January 2020, pp. 59-77p SECURITY CHALLENGES FOR JOURNALISTS AND THE MASS MEDIA IN ADVANCING FREE SPEECH IN WAR TORN COUNTRIES: THE CASE OF AFGHANISTAN The challenges faced by journalists and mass media in war torn countries are serious. The same could be said to be the case in Afghanistan. Though freedom of speech and of the mass media are among the on-going struggles of the Afghan people after the fall of the Taliban regime, it is worrying that the initial success against the Taliban or other new enemies not irreversible. Threats of violence against journalists and the mass media come from militant groups, politicians and government apparatus. The objective of this paper is to examine the security challenges involving the exercise of free of speech by journalists and the mass media in Afghanistan. The situation also requires the analysis provisions of the constitution and relevant legislation to see if they are equal to the threats. On the other side of the question, the paper also examines violations of the rights of journalists by the government machinery. This paper applies the doctrinal method wherein the research examines the laws of Afghanistan relating to the freedom of speech and freedom of the mass media. The quest of the paper among others is about the adequacy of the relevant provisions of the constitution and legislation. Lastly, the paper makes recommendations to improve the safety of journalists and the mass media. Most would consider freedom of expression as the pillar of a democratic State. -

The Safety of Journalists and the Danger of Impunity
CI-16/COUNCIL-30/4 Rev. PARIS, 7 October 2016 Original: English THE SAFETY OF JOURNALISTS AND THE DANGER OF IMPUNITY REPORT BY THE DIRECTOR-GENERAL TO THE INTERGOVERNMENTAL COUNCIL OF THE IPDC (THIRTIETH SESSION) INTRODUCTION This document is submitted to the Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication’s (IPDC) in accordance with its Decision on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity adopted at its 26th session (27 March 2008) and renewed at subsequent sessions in 2010, 2012, and 2014. The latest Decision from 2014 reiterated “the continuing relevance of [previous] IPDC Decisions that request the Director-General of UNESCO to provide to the Intergovernmental Council of the IPDC, on a two-year basis at its biennial session, an analytical report on the Director- General’s condemnations of the killings of journalists, media workers and social media producers who are engaged in journalistic activities and who are killed or targeted in their line of duty”. The present report offers an overview of the killings of journalists condemned by the Director-General in 2014-2015 as well as providing an analysis of the killings condemned over the last 10 years, between 2006 and 2015. It presents an update on the status of investigations into these killings based on the information provided by Member States. Background information is also provided on the latest developments in the implementation of the UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity and on UNESCO’s specific contribution to this process. Communication and Information Sector 2 Communication and Information Sector TABLE OF CONTENTS 1. -

Focus on the Middle East & North Africa
FOCUS ON THE MIDDLE EAST & NORTH AFRICA The IPI World Press Freedom Review is dedicated to the 110 journalists who lost their lives in 2009 Alaa Abdel-Wahab Natalia Estemirova Ernesto “Bart” Maravilla Wasi Ahmad Qureshi Mohamed Amin Adan Abdulle Marco Antonio Estrada Oria Yaasir Mario Fabián Ramírez López Suhaib Adnan Jolito Evardo Juan Daniel Martínez Gil Ando Ratovonirina Benjie Adolfo Basil Ibrahim Faraj Ray Merisco Fernando “Ranny” Razon José Everardo Aguilar Gabriel Fino Noriega Martín Javier Miranda Avilés Alejandro “Bong” Reblando Jawed Ahmad José Emilio Galindo Robles Norberto Miranda Madrid Harold Humberto Rivas Quevedo Said Tahlil Ahmed Santos Gatchalian Omidreza Mirsayafi Bernardo Rivera Malik Akhmedilov José Givonaldo Vieira Reynaldo “Bebot” Momay Diego de Jesús Rojas Velázquez Shafig Amrakhov María Eugenia Guerrero Ernesto Montañez Valdivia Ernie Rollin José Bladimir Antuna García Raja Assad Hameed Marife “Neneng” Montaño Hernando Salas Rojas Henry Araneta Janullah Hashimzada Rosell Morales Napoleon Salaysay Mark Gilbert “Mac-Mac” Arriola Hassan Mayow Hassan Sultan Munadi Orel Sambrano Saleem Tahir Awan Hassan Zubeyr Haji Hassan Rafael Munguía Ortiz Rolando Santiz Anastasja Baburowa Cihan Hayirsevener Dalvison Nogueira de Souza Puniyamoorthy Sathiyamoorthy Eliseo Barrón Hernández Ferney Henao Victor Nuñez Uma Singh Rubello Bataluna Orhan Hijran Francis Nyaruri Francisco “Ian” Subang Arturo Betia Muktar Mohamed Hirabe Martín Ocampo Páez Haidar Hashim Suhail Romeo Jimmy Cabillo Nur Muse Hussein Bayo Ohu Andres “Andy” Teodoro Marites Cablitas Jean Paul Ibarra Ramírez Carlos Ortega Samper Daniel Tiamson Hannibal Cachuela Muhammad Imran Bruno Jacquet Ossébi Jojo Trajano Jepon Cadagdagon Siddique Bacha Khan Joel Parcon Jorge Alberto Velázquez López John Caniban Musa Khankhel Ismael Pasigna Aamir Wakil Antonio Castillo Michelle Lang Gennady Pavlyuk Abdirisak Mohamed Warsame Bruno Koko Chirambiza Bienvenido Legarte Jr. -

Farrell's Reply to CPJ February 5, 2010 on the Last Night of Our Captivity
Farrell’s reply to CPJ February 5, 2010 On the last night of our captivity Sultan Munadi and I heard the sound of NATO helicopters above the house where the Taliban were holding us, followed by gunshots and explosions. The Taliban fled the house. Once they left we escaped through the gate of the courtyard. We ran along a high wall of the courtyard surrounding the house, beside a ditch. When Sultan reached the corner of the wall he continued beyond it into an open clearing. Someone shot him as soon as he emerged from behind the wall. He barely had time to say “journaliste, journaliste” in accented English before shots were fired, and he fell to the ground. I did not see the shooter or shooters. I did not follow him into the clearing, which would have been suicide. Instead I dived into a ditch. Several minutes later I heard British voices above me, right next to where Sultan had just been shot. I shouted that I was a British hostage. I followed the British soldiers’ instructions and emerged from the ditch. I gave the soldiers my name and newspaper, and the very next thing I did was twist around and point to where Sultan was lying and said that I thought he had been shot. He was in plain sight even to me—and unlike the soldiers I had no night vision goggles. The soldiers told me that they had Sultan’s photograph, so they were obviously aware that he was with me, and were able to check if it was him. -

Media-Watch-Report-76-English.Pdf
1 Preamble: Increased insecurity, war and suicide bombings threaten journalists’ lives and make their profession dangerous. Historically, journalists have been the victims of kidnapping and murder by insurgents; however, recently we have seen an increase in suicide bombings and attacks on government and nongovernment buildings, where journalists are among the first to arrive on the scene in order to provide news coverage, putting journalists’ lives in excessive danger. Media and journalists are required to provide immediate news coverage on incidents; therefore, they are obliged to accept the danger and go straight to the scene of the incident. Reporting on such incidents poses great dangers to journalists because they must be positioned in a location from where they can develop a fact based report about the fight. In some cases, police negligence and the lack of security measures, is one of the main challenges for journalists and occasionally prevents journalists from covering the incident altogether. On these occasions, police and other law enforcement personnel do not allow journalists to enter the scene, which is in fact, an attempt to restrict reporting on the incident. In some instances they do not take care of the journalists and allow them to approach to high risk zone, in both cases it becomes difficult for the media to record and report information. In some cases, during such incidents journalists do not care about their life and are deeply focused on obtaining footage and information about the ongoing situation and as a result they become victims of attack for not taking security measures. Moreover, the recent suicide attacks that injured two journalists proved that there is no place in Afghanistan which is immune from terrorists’ reach. -

2010 and 2011
This document is made available through the declassification efforts and research of John Greenewald, Jr., creator of: The Black Vault The Black Vault is the largest online Freedom of Information Act (FOIA) document clearinghouse in the world. The research efforts here are responsible for the declassification of hundreds of thousands of pages released by the U.S. Government & Military. Discover the Truth at: http://www.theblackvault.com UNITED STATES CENTRAL COMMAND OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF 7 11 5 SOUTH BOUNDARY BOULEVARD MACDILL A IR FORCE BASE, FLORIDA 33 62 1-5 101 7 March 2013 Mr. John Greenewald, Jr. Dear Mr. Greenewald: This is in response to your Freedom of Information Act (FOIA) request for a copy of the FOIA case logs for 2010 and 2011. A thorough and good faith search was conducted and four responsive documents (totaling 389 pages) were located. After reviewing the information, I am partially releasing the documents. The withheld information is exempt from release pursuant to 5 U.S.C. § 552 (b)(3), as it relates to 10 U.S.C. § 130b personnel in overseas, sensitive or routinely deployable units; and, (b)(6) personal privacy interest. Accordingly, in my capacity as the Initial Denial Authority, by withholding this information, I am partially denying your request. There are no fees for processing this request since chargeable cost fell below $15. If you are not satisfi ed with this action, you may appeal to the appellate authority, the Director of Administration and Management, Office of the Secretary of Defense. To submit your appeal, please write directly to the Defense Freedom of Information Policy Office, Attn: Mr. -

The Party of Criminal War
Pilger 3/11/05 4:24 AM Page 27 27 The party of On the day Gordon Brown made his ‘major policy speech’ on Afghanistan, repeating his criminal war surreal claim that if the British army did not fight Pashtun tribesmen over there, they would be over here, the stench of burnt flesh hung over the banks of the Kunduz River. Nato fighter planes had blown the poorest of the poor to bits. They were Afghan villagers John Pilger who had rushed to siphon off fuel from two stalled tankers. Many were children with water buckets and cooking pots. ‘At least’ 90 were killed, although Nato prefers not to count its civilian enemy. ‘It was a scene from hell,’ said Mohammed Daud, a witness. ‘Hands, legs and body parts were scattered everywhere.’ No parade for them along a Wiltshire high street. I saw something similar in south-east Asia. An incendiary bomb had razed most of a thatched village, and bits of charred people were hanging on upended fishing nets. Those intact lay splayed and black, like large spiders. John Pilger, renowned I have never believed you need witness investigative journalist such a hell to comprehend the crime. A and documentary film- standard-issue conscience is enough for all maker, is one of only two but the morally corrupt and powerful. Fresh people to have twice won from another dysfunctional photo opportunity British journalism’s top with troops in Afghanistan – a contrivance far award; his television from the impoverished suffering of that documentaries have won country – Brown ‘authorised’ the Rambo- academy awards in both style rescue of Stephen Farrell, a journalist of the United Kingdom and British and Irish nationality, at the site of the the United States. -

Não a Verdade
não a verdade Destaques do Relatório de 2018 da Diretora-Geral da UNESCO sobre a Segurança dos Jornalistas e o Perigo da Impunidade PROGRAMA INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO © UNESCO 2019 Esta publicação está disponível em acesso livre ao abrigo da licença Atribuição-Partilha 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons. org/licenses/by-sa/3.0/igo/). Ao utilizar o conteúdo da presente publicação, os usuários aceitam os termos de uso do Repositório UNESCO de acesso livre (http://unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en). Título original: Punish the crime, not the truth: highlights from the 2018 UNESCO Director-General’s report on the safety of journalists and the danger of impunity, publicado pela UNESCO em 2018. Coordenação técnica da Representação da UNESCO no Brasil: Marlova Jovchelovitch Noleto, Diretora e Representante Adauto Cândido Soares, Coordenador de Comunicação e Informação Revisão técnica: Setor de Comunicação e Informação da Representação da UNESCO no Brasil Tradução: Marina Mendes Revisão editorial e Diagramação: Unidade de Comunicação, Informação Pública e Publicações Esclarecimento: a UNESCO mantém, no cerne de suas prioridades, a promoção da igualdade de gênero, em todas as suas atividades e ações. Devido à especificidade da língua portuguesa, adotam- se, nesta publicação, os termos no gênero masculino, para facilitar a leitura, considerando as inúmeras menções ao longo do texto. Assim, embora alguns termos sejam escritos no masculino, eles referem-se igualmente ao gênero feminino. CI-2018/SANS COTE 1.RESUMO EXECUTIVO Em 2016-2017, um jornalista foi morto a cada quatro dias. Uma testemunha foi silenciada a cada quatro dias. -

09 09 15 Afghanistan
15 September 2009 STATEMENT Afghanistan: ARTICLE 19 Calls for Investigation into Journalist’s Death ARTICLE 19 calls for an immediate investigation into the death of Afghan journalist Sultan Munadi. He was shot dead on 9 September during an armed raid by British-led NATO forces to rescue him and British journalist Steven Farrell. Sultan Munadi and Steven Farrell had been kidnapped and held captive by the Taliban in the northern Afghan province of Kunduz since 5 September. At the time, Sultan Munadi had been working as a fixer and interpreter for Farrell, who was investigating the NATO air attack on two fuel tankers which had been hijacked by Taliban militants. Media reports suggested that the air strike had killed many people, including many civilians. At dawn on 9 September, British-led NATO forces raided the place where Taliban militants were holding Farrell and Munadi. Although Steven Farrell was rescued, Sultan Munadi was killed in the gunfire. One British NATO soldier and two civilians were also killed. ARTICLE 19 welcomes the rescue of Steven Farrell and supports the decision of journalists like him to undertake such investigations, which are clearly in the public interest, provided they are confident about their personal safety and that of their local colleagues. However, ARTICLE 19 is profoundly saddened by Sultan Munadi’s death, which raises serious questions about the safety of Afghan journalists employed by foreign media organisations in Afghanistan and the extent to which international forces are committed to protecting their right to life. ARTICLE 19 emphasises the importance of finding out how Sultan Munadi was killed during the rescue raid not only for his family but also because a lack of credible information and accountability may lead to rumours, misrepresentation and further mistrust of international forces in Afghanistan. -

Attacks on the Press in 2011 a Worldwide Survey by the Committee to Protect Journalists
Attacks on the Press in 2011 A Worldwide Survey by the Committee to Protect Journalists Preface by Sandra Mims Rowe Committee to Protect Journalists Attacks on the Press in 2011 A Worldwide Survey by the Committee to Protect Journalists Committee to Protect Journalists (212) 465-1004 330 Seventh Avenue, 11th Fl. www.cpj.org New York, NY 10001 [email protected] Twitter: @pressfreedom Facebook: @committeetoprotectjournalists Founded in 1981, the Committee to Protect Journalists responds to attacks on the press worldwide. CPJ documents hundreds of cases every year and takes action on behalf of journalists and news organizations without regard to political ideology. To maintain its independence, CPJ accepts no government funding. CPJ is funded entirely by private contributions from individuals, foundations, and corporations. !omson Reuters, Agence France-Presse, and !e Associated Press provided news and photo services for Attacks on the Press in 2011. Editorial Director: Bill Sweeney Senior Editor: Elana Beiser Deputy Editors: Kamal Singh Masuta, Shazdeh Omari Designer: John Emerson Chief Copy Editor: Lew Serviss Copy Editor: Lisa Flam Proofreader: Naomi Serviss : Journalists run for cover during a bombing raid in Ras Lanuf, Libya. (Reuters/Paul Conroy) © 2012 Committee to Protect Journalists, New York All rights reserved Printed by United Book Press in the United States of America Attacks on the Press in 2011: A Worldwide Survey by the Committee to Protect Journalists : 978-0-944823-31-6 Board of Directors Sandra Mims Rowe Terry Anderson Joel Simon Andrew Alexander Rebecca MacKinnon Franz Allina Kati Marton Christiane Amanpour Michael Massing Dean Baquet Geraldine Fabrikant Metz John S. Carroll Victor Navasky Kathleen Carroll Andres Oppenheimer Rajiv Chandrasekaran Burl Osborne Sheila Coronel Clarence Page Josh Friedman Norman Pearlstine Anne Garrels Ahmed Rashid James C. -

Freedom of the Press 2010 Country Header Data and Narrative Reports/Bullets for Selected Countries
Freedom of the Press 2010 Country Header Data and Narrative Reports/Bullets for Selected Countries Afghanistan Status: Not Free Legal Environment: 22 Political Environment: 33 Economic Environment: 21 Total Score: 76 Survey Edition 2005 2006 2007 2008 2009 Total Score, Status 68,NF 69,NF 69,NF 71,NF 74,NF • Article 34 of the constitution allows for freedom of the press and of expression, but Article 130 stipulates that courts and Islamic jurists can rule on a case “in a way that attains justice in the best manner.” Several journalists have been arrested under this arbitrary clause. • A revised 2005 Press Law guarantees the right of citizens to obtain information and prohibits censorship. However, there are broad restrictions on any content that is “contrary to the principles of Islam or offensive to other religions and sects.” • A new media law passed in September 2008 contained a number of registration and content restrictions, but President Hamid Karzai has delayed its implementation, since the law would limit the executive’s control over state-run media. Because of the delay, many journalists do not know which law is in effect, causing them to practice self-censorship. • Media outlets are occasionally fined or warned for broadcasting “un-Islamic material,” resulting in self-censorship. In some cases during the year, journalists were arrested for such violations. • Parvez Kambaksh was sentenced to death for blasphemy in January 2008 after he distributed an article on Islam that he had downloaded from the internet. An appeals court reduced the sentence to a 20-year prison term in October, and the Supreme Court upheld this sentence in February 2009.