Incertitudes Identitaires Uncertain Identities
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ethnicity and Views About the New Zealand Environment
Ethnicity and views about the New Zealand environment Kenneth FD Hughey1, Geoffrey N Kerr2,, Ross Cullen3 1 Faculty of Environment, Society and Design, PO Box 85084, Lincoln University 7647, New Zealand. +64 3 3252811 [email protected] 2 Faculty of Environment, Society and Design, PO Box 85084, Lincoln University 7647, New Zealand. +64 3 3252811 [email protected] 3 Faculty of Commerce, PO Box 85084, Lincoln University 7647, New Zealand. +47 9701 5588 [email protected] Paper prepared for presentation at the EAAE 2014 Congress ‘Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies’ August 26 to 29, 2014 Ljubljana, Slovenia Copyright 2014 by Hughey, Kerr, Cullen. All rights reserved. Readers may make verbatim copies of this document for non-commercial purposes by any means, provided that this copyright notice appears on all such copies. Abstract Limited research has been completed on the relationship between ethnicity and views within a country on the environment, pressures on the environment and its management. Some recent New Zealand research has found no significant difference in environmental world views between different ethnic groupings. We report selected results from a decade of biennial, nationwide surveys of adults in New Zealand. By socio-demographic measures, respondents are broadly representative of New Zealand adults. In each biennial survey we have found significant differences between ethnicities in views on water quality, causes of damage to water, and water management. There are also significant differences between ethnicities in participation in environmental activities. Our survey has an advantage over other work in that it is able to distinguish between indigenous New Zealanders and native-born New Zealanders, a distinction that proved helpful in identifying these significant differences. -

Making a Community: Filipinos in Wellington
Making a Community: Filipinos in Wellington September 2017 ISBN 978-0-9941409-4-4 (PDF) Making a Community: Filipinos in Wellington About the Author As an American living in New Zealand, I’ve been observing the debate here on immigration and multiculturalism. I arrived in Wellington last year with my Kiwi husband and three-year old son – and while settling in we’ve spent a lot of time discovering the delights of the city and its people. The experience also gave me some perspective on being a migrant far from home. I have a professional interest in South East Asian history, languages and culture - I just completed a PhD on the subject. I speak some Filipino, and am fascinated by the Philippines’ complex history. One of the major phenomena in the Philippines since the 1970s has been the growth of the global Filipino diaspora. That story has often been full of sadness. So I was intrigued by anecdotes of positivity and success from Wellington. Writing about how the migrant Filipino community has settled in New Zealand has been more than just a research project. It has highlighted how migration plays a role in community building. It also has meaning for me and my family’s future here. I really wanted to share some of the stories that I think reflect successful outcomes from immigration over the past thirty years. By Dr Rebecca Townsend 1 Key Points 1. 2. 3. Filipinos comprise 1 percent of Filipinos are a vital part of Most Filipinos in New Zealand are New Zealand’s population – the New Zealand’s dairy, healthcare, not Overseas Filipino Workers third largest Asian ethnic group construction, nursing, aged care, (OFW). -

Slave Route Project: Resistance, Freedom and Heritage
26 C&D•№ 1 1 • 2 0 1 4 C&D•№ 11•2014 27 Jesús Guanche Member of the International Scientific RESISTANCE, Committee of the UNESCO Slave Route Project: Resistance, freedom and heritage Background FREEDOM fter UNESCO established the International Slave Route Project in 1994, the Cuban Committee was created in the A same year, and steps were taken to conduct a census of heritage places and sites related to the African heritage in Cuban culture. The results were published, in a timely manner and in a summarized version, in the Catauro review1. There were AND HERITAGE 705 places with very different characteristics, including names, conservation status, integrity, classification, declaration and typology, which provided initial reference for more ambitious purposes. Previously, the Fernando Ortiz Foundation, which headed and IN THE coordinated the Cuban Committee, had started publishing a series of mapping leaflets precisely with The Slave Route,2 which also summarizes key aspects of the legacy of Africans and their descendants in national culture. This leaflet was presented by the then Director-General of UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, to the Executive Board in Paris to promote the CARIBBEAN international implementation of the project. With the support of UNESCO, preparations started at the Castle of San Severino in the city of Matanzas to establish a National Slave Route Museum in Cuba. The third issue of Catauro review was also published. It was entirely dedicated to this topic, with significant contributions by authorities of UNESCO and of the first International Scientific Committee, such as Federico Mayor Zaragoza himself, Doudou Diène, Elikia M'bokolo, Howard Dodson, Luz María Martínez Montiel, Hugo Tolentino Dipp, Claude Meillassoux, Louis Sala-Moulins, and Luis Beltrán Repetto. -

The Formation of Pkeh Identity in Relation to Te Reo Mori and Te Ao
The Formation of Pākehā Identity in Relation to Te Reo Māori and Te Ao Māori QuickTime™ and a TIFF (LZW) decompressor are needed to see this picture. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Māori in the University of Canterbury by Maria Jellie ________________________________ University of Canterbury 2001 I ACKNOWLEDGMENTS My deepest thanks goes to Jeanette King, my supervisor, whose support was invaluable to this thesis. The kaupapa was one very close to both our hearts and thus made working together an enjoyable and enlightening experience. I would also like to thank Te Rita Papesch who conceived of the kaupapa and presented me with the topic. The other people I would like to thank are the people who participated in the interviews. Every interview was an enjoyable experience and a revelation to me on my own identity as a Pākehā who speaks te reo Māori. He mihi nui he mihi aroha hoki ki a koutou katoa. Kia ora rā mø øu koutou tautoko me øu koutou wairua aroha ki a au. Kāore āku kupu ki te whakawhāki ki a koutou te maiohatanga i roto i tøku ngākau ki a koutou katoa. Haeretia tonutia i runga i te ara hirahira, arā, te ara o te reo Māori. QuickTime™ and a TIFF (LZW) decompressor are needed to see this picture. II Abstract This thesis explores the experiences of European New Zealanders who have learnt te reo Māori and how through their learning they have gained a better understanding of what it means to be Pākehā in New Zealand. -

New Zealanders on the Net Discourses of National Identities In
New Zealanders on the Net Discourses of National Identities in Cyberspace Philippa Karen Smith A thesis submitted to Auckland University of Technology in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) 2012 Institute of Culture, Discourse & Communication School of Language and Culture ii Table of Contents List of Figures .............................................................................................................................. v List of Tables ............................................................................................................................... v List of Acronyms ........................................................................................................................ vi Attestation of Authorship ......................................................................................................... vii Acknowledgements .................................................................................................................. viii Abstract ....................................................................................................................................... ix Chapter One : Identifying the problem: a ‘new’ identity for New Zealanders? ................... 1 1.1 Setting the context ............................................................................................................................... 1 1.2 New Zealand in a globalised world .................................................................................................... -

Reserved Seats, Ethnic Constituencies, and Minority
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by ASU Digital Repository “Stand For” and Deliver? Reserved Seats, Ethnic Constituencies, and Minority Representation in Colombia by Jean Paul Crissien A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Approved August 2015 by the Graduate Supervisory Committee: Miki Kittilson, Chair Magda Hinojosa Michael Mitchell ARIZONA STATE UNIVERSITY December 2015 ABSTRACT This project is a comparative exploration of the connection between descriptive representation and the substantive and symbolic representation of ethnic minorities: do Afro and indigenous representatives effectively “stand for” group members by introducing identity and empowering descriptive constituents? Featuring reserved seats for both minority groups, Colombia is an ideal case. In combination, the institutional design of reserved seats and the tradition of mestizaje and racial democracy add complexity to analyzing these populations. Consequently, in order to assess minority representation this work adds to extant representational theory by taking into account the crystallization of minority constituencies across elections. I use quantitative and qualitative data to comparatively assess the use of reserved seats for integrating minority identity to the deliberative process and measuring empowerment impacts for minority-majority municipalities. This data includes an original dataset of electoral outcomes across seven cycles (1990-2010) and transcripts of congressional plenaries spanning three legislative periods (2002-2014). I take into account constituency dynamics identifying the concentration and geographical sources of votes in minority districts. These outcomes translate to expectations of representative behavior, hinging on the theoretical belief that constituency dynamics act as signals of legislator accountability to minority constituents. -

Relating Maori and Pakeha : the Politics of Indigenous and Settler
Copyright is owned by the Author of the thesis. Permission is given for a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and private study only. The thesis may not be reproduced elsewhere without the permission of the Author. Relating Maori and Pakeha: the politics of indigenous and settler identities A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology at Massey University Palmerston North New Zealand Avril Bell 2004 Abstract Settler colonisation produced particular colonial subjects: indigene and settler. The specificity of the relationship between these subjects lies in the act of settlement; an act of colonial violence by which the settler physically and symbolically displaces the indigene, but never totally. While indigenes may be physically displaced from their territories, they continue to occupy a marginal location within the settler nation-state. Symbolically, as settlers set out to distinguish themselves from the metropolitan ‘motherlands’, indigenous cultures become a rich, ‘native’ source of cultural authenticity to ground settler nationalisms. The result is a complex of conflictual and ambivalent relations between settler and indigene. This thesis investigates the ongoing impact of this colonial relation on the contemporary identities and relations of Maori (indigene) and Pakeha (settlers) in Aotearoa New Zealand. It centres on the operation of discursive strategies used by both Maori and Pakeha in constructing their identities and the relationship between them. I analyse ‘found’ texts - non-fiction books, media and academic texts - to identify discourse ‘at work’, as New Zealanders make and reflect on their identity claims. -

Exploring the Cultural Origins of Differences in Time Orientation Between European New Zealanders and Māori Kevin D
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of San Francisco The University of San Francisco USF Scholarship: a digital repository @ Gleeson Library | Geschke Center Organization, Leadership, and Communications School of Management 2012 Exploring the Cultural Origins of Differences in Time Orientation between European New Zealanders and Māori Kevin D. Lo University of San Francisco, [email protected] Carla Houkamau Follow this and additional works at: http://repository.usfca.edu/olc Part of the Anthropology Commons, International Business Commons, and the Sociology Commons Recommended Citation Kevin D. Lo, Carla Houkamau. Exploring the Cultural Origins of Differences in Time Orientation between European New Zealanders and Māori. NZJHRM. 2012 Spring. 12(3),105-123. This Article is brought to you for free and open access by the School of Management at USF Scholarship: a digital repository @ Gleeson Library | Geschke Center. It has been accepted for inclusion in Organization, Leadership, and Communications by an authorized administrator of USF Scholarship: a digital repository @ Gleeson Library | Geschke Center. For more information, please contact [email protected]. NZJHRM 2012 Spring Issue Exploring the Cultural Origins of Differences in Time Orientation Between European New Zealanders and Māori Exploring the Kevin D. Lo, School of Management, University of San Francisco Cultural Origins [email protected] and Carla Houkamau, Department of Management and International Business, University of Auckland1 of Differences [email protected] in Time Abstract: Previous research suggests that time orientation differs as a function of national culture. Orientation National cultures often cluster together by region, thus regional generalizations can provide insights on how cultures in a given cluster perceive time. -

Dynamics of Spatial Differentiation Among Ethnic Groups in New Zealand Douglas Grbic University of Wisconsin-River Falls Email
Dynamics of Spatial Differentiation among Ethnic Groups in New Zealand Douglas Grbic University of Wisconsin-River Falls Email: [email protected] Hiromi Ishizawa University of Minnesota Email: [email protected] Charles Crothers Auckland University of Technology Email: [email protected] Abstract New Zealand has experienced a marked increase in immigration since the early 1990s, which has fostered greater ethnic diversity. However, studies have yet to fully explore the changing patterns of spatial differentiation among ethnic groups. Using the New Zealand Census data from 1991 to 2006, we first examine the patterns of ethnic residential segregation for the Asian, Maori, and Pacific people from the majority European population. We then assess the effects of geographic and group level characteristics on the levels of segregation. The results reveal that Pacific people are the most segregated group from Europeans. The levels of segregation have declined only slightly for Maori and Pacific people, but increased gradually over time for Asians. Regression results for 2006 show two common factors influencing residential segregation for all three groups: the percent of minority group increases segregation while the closer the mean income to that of European decreases segregation. Prepared for presentation at the 2008 Annual Meeting of Population Association of America, New Orleans, LA. Introduction During the later part of the 20th century, New Zealand became an increasingly multiethnic society partly attributable to the growth of immigration from various countries. In 1956, 94 percent of the population was New Zealand European, 6 percent was Maori (the founding people of New Zealand), and less than .1 percent were other ethnicities (McLintock 1966). -
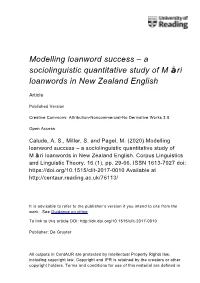
Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 16 (1)
Modelling loanword success – a sociolinguistic quantitative study of Mā ori loanwords in New Zealand English Article Published Version Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Open Access Calude, A. S., Miller, S. and Pagel, M. (2020) Modelling loanword success – a sociolinguistic quantitative study of Mā ori loanwords in New Zealand English. Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 16 (1). pp. 29-66. ISSN 1613-7027 doi: https://doi.org/10.1515/cllt-2017-0010 Available at http://centaur.reading.ac.uk/76113/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . To link to this article DOI: http://dx.doi.org/10.1515/cllt-2017-0010 Publisher: De Gruyter All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online Corpus Linguistics and Ling. Theory 2017; aop Open Access Andreea Simona Calude*, Steven Miller and Mark Pagel Modelling loanword success – a sociolinguistic quantitative study of Māori loanwords in New Zealand English DOI 10.1515/cllt-2017-0010 Abstract: Loanword use has dominated the literature on language contact and its salient nature continues to draw interest from linguists and non-linguists. Traditionally, loanwords were investigated by means of raw frequencies, which are at best uninformative and at worst misleading. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA Los Angeles Dominican Baseball An
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Dominican Baseball An Exploration of the Modern Major League Baseball Academy System A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Art Latin American Studies by Andrew Mitchel 2020 © Copyright by Andrew Mitchel 2020 ABSTRACT OF THE THESIS Dominican Baseball An Exploration of the Modern Major League Baseball Academy System by Andrew Mitchel Master in Latin American Studies University of California, Los Angeles, 2020 Professors Bonnie Taub, Co-Chair Professor Lauren Derby, Co-Chair This project is about Major League Baseball’s (MLB) developmental academies in the Dominican Republic (henceforth D.R.). Athletes from across Latin America, once signed, begin at this first level of Minor League Baseball to prove their sporting abilities, learn English and become consummate professionals. This thesis concerns both the history of the United States (U.S.)-D.R. relationship through the lens of baseball, and ethnographic fieldwork completed at one MLB academy in the D.R. in summer 2019. The research included watching Dominican Summer League games, touring the facility, interviewing staff and sitting in on a high school equivalency course. It analyzes various so-called ‘signs of universality’ as to how baseball is played worldwide: language/ritual, camaraderie, food, education and masculinity. The historical context surrounding the relationship between the nations shows how the baseball academy is one just type of neoliberal and neocolonial enclave in the Dominican Republic. Concluding thoughts cover where this system stands as of 2020 and what can be done to ensure ideal conditions for these teenage players. Keywords: anthropology of sport; U.S.-D.R. -

For Survival in a Hostile New World, Sojourners Are Inclined Toward
Why do Asian immigrants become entrepreneurs? The case of Korean self- employed immigrants in New Zealand Joo-Seok (Joe) Lee A thesis submitted to Auckland University of Technology in partial fulfilment of the degree of Master of Arts (Social Sciences) 2008 Table of Contents ATTESTATION OF AUTHORSHIP ....................................................................................................... 1 ACKNOWLEDGEMENTS ....................................................................................................................... 2 ABSTRACT ................................................................................................................................................ 3 CHAPTER ONE: INTRODUCTION ...................................................................................................... 4 ENTREPRENEURSHIP AND SELF-EMPLOYMENT ......................................................................................... 5 BACKGROUND .......................................................................................................................................... 6 SIGNIFICANCE ........................................................................................................................................ 13 RESEARCH QUESTIONS ........................................................................................................................... 14 THESIS STRUCTURE ...............................................................................................................................