Tome Xiii 1975 N° 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CHRIST CHURCH LIBRARY NEWSLETTER Volume 12, Issue 1 2020 - 2021
CHRIST CHURCH LIBRARY NEWSLETTER Volume 12, Issue 1 2020 - 2021 ISSN 1756-6797 (Print), ISSN 1756-6800 (Online) The Salusbury Manuscripts: Notes on Provenance A Scarlatti Operatic Masterpiece Revisited MS 183 and MS 184 are two manuscripts which Among the many rare and precious holdings of belonged to the Salusbury family. They contain Christ Church Library, Oxford, is a manuscript of heraldry, and poems in Welsh and English, dating unusual importance in the history of music: Mus 989. from the turn of the sixteenth to the seventeenth It preserves a complete musical setting by composer century. Christ Church has no particular Welsh Alessandro Scarlatti of the text of poet Matteo Noris’ associations to explain why it should have been drama Il Flavio Cuniberto. given two manuscripts largely in the Welsh language. By many musicologists’ reckoning, Scarlatti was the The Salusbury family of Denbighshire is celebrated most important Italian opera composer of his time, in both codices. Members of that family were and a complete score of one of his operas is students at Oxford’s Jesus College and one at therefore a document of uncommon significance. Braesnose, in the sixteenth and seventeenth And although perhaps less well-known, Matteo Noris centuries. The two volumes arrived in Christ Church was a librettist of considerable importance. in the mid-eighteenth century but their donor is Historians of opera depend upon various kinds of unrecorded and it may be that the Library did not primary sources to write the performance history of quite know what to make of them. particular works in the repertory. -

University of Florida Thesis Or Dissertation Formatting
SMATHERS LIBRARIES’ LATIN AND GREEK RARE BOOKS COLLECTION UNIVERSITY OF FLORIDA 2016 1 TABLE OF CONTENTS page LECTORI: TO THE READER ........................................................................................ 20 LATIN AUTHORS.......................................................................................................... 24 Ammianus ............................................................................................................... 24 Title: Rerum gestarum quae extant, libri XIV-XXXI. What exists of the Histories, books 14-31. ................................................................................. 24 Apuleius .................................................................................................................. 24 Title: Opera. Works. ......................................................................................... 24 Title: L. Apuleii Madaurensis Opera omnia quae exstant. All works of L. Apuleius of Madaurus which are extant. ....................................................... 25 See also PA6207 .A2 1825a ............................................................................ 26 Augustine ................................................................................................................ 26 Title: De Civitate Dei Libri XXII. 22 Books about the City of God. ..................... 26 Title: Commentarii in Omnes Divi Pauli Epistolas. Commentary on All the Letters of Saint Paul. .................................................................................... -

Contribution a L'histoire Intellectuelle De L'europe : Réseaux Du Livre
CONTRIBUTION A L’HISTOIRE INTELLECTUELLE DE L’EUROPE : RÉSEAUX DU LIVRE, RÉSEAUX DES LECTEURS Edité par Frédéric Barbier, István Monok L’Europe en réseaux Contribution à l’histoire de la culture écrite 1650–1918 Vernetztes Europa Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650–1918 Edité par / Herausgegeben von Frédéric Barbier, Marie-Elisabeth Ducreux, Matthias Middell, István Monok, Éva Ring, Martin Svatoš Volume IV Ecole pratique des hautes études, Paris Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris Centre des hautes études, Leipzig Centre européen d’histoire du livre de la Bibliothèque nationale Széchényi, Budapest CONTRIBUTION A L’HISTOIRE INTELLECTUELLE DE L’EUROPE : RÉSEAUX DU LIVRE, RÉSEAUX DES LECTEURS Edité par Frédéric Barbier, István Monok Országos Széchényi Könyvtár Budapest 2008 Les articles du présent volume correspondent aux Actes du colloque international organisé à Leipzig (Université de Leipzig, Zentrum für höhere Studien) en 2005, sur le thème « Netzwerke des Buchwesens : die Konstruktion Europas vom 15. bis zum 20. Jh. / Réseaux du livre, réseaux des lecteurs : la construction de l’Europe, XVe-XXe siècle ». Secrétariat scientifique Juliette Guilbaud (français) Wolfram Seidler (allemand) Graphiker György Fábián ISBN 978–963–200–550–8 ISBN 978–3–86583–269–6 © Országos Széchényi Könyvtár 1827 Budapest, Budavári palota F. épület Fax.: +36 1 37 56 167 [email protected] Leipziger Universitätsverlag GmbH, Leipzig Oststr. 41, D–04317 Leipzig Fax.: +49 341 99 00 440 [email protected] Table des matières Frédéric Barbier Avant-propos 7 Donatella Nebbiai Les réseaux de Matthias Corvin 17 Pierre Aquilon Précieux exemplaires Les éditions collectives des œuvres de Jean Gerson, 1483-1494 29 Juliette Guilbaud Das jansenistische Europa und das Buch im 17. -

CHRIST CHURCH LIBRARY NEWSLETTER Volume 4, Issue 2 Hilary 2008
CHRIST CHURCH LIBRARY NEWSLETTER Volume 4, Issue 2 Hilary 2008 ISSN 1756-6797 (Print), ISSN 1756-6800 (Online) HEARING MORLEY’S PUZZLES Dating Wolsey’s Lectionaries The beautiful 1608 edition of Thomas Morley’s A Among the most stunningly beautiful volumes Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke housed at Christ Church is the Epistle Lectionary, a was a striking part of the Michaelmas term exhibit at 16th century manuscript richly illuminated in the the Christ Church Library. Indeed, “Sacred Music” Flemish style. This large folio still sparkles brightly in and “Hidden Treasures” made it well worth a hunt all the colours of the rainbow and is - literally - heavy through Morley’s treatise. The cruciform puzzle with gold. The book contains readings from the canon from Part III of the treatise is the sort of visual Epistles for a number of feast days throughout the stimulus to attract both the musician and non- year. Another Lectionary, containing the texts from musician alike; likewise the scholar and the casual the Gospels, illuminated in precisely the same observer. manner and including the same selection of feast days, is now at Magdalen College in Oxford. Morley’s treatise, first published in 1597 and then re- issued in 1608 (of which edition the Christ Church About the provenance of the Epistle Lectionary at copy is one), became a leading theoretical work in Christ Church, there is only a brief entry in the Renaissance England and for many decades Donors’ Book. This simply records that the following. In the treatise, Morley lays out his material manuscript was given by John Lante, in 1614, along as a pleasant dialogue between a Master and two with three printed medical books: “Magister Ioannes eager students. -

Adolf M. Hakkert Editore 27.2009
LEXIS Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica SOMMARIO TRENDS IN COMPUTATIONAL PHILOLOGY. AN ITALIAN OVERVIEW. INTERNATIONAL CONFERENCE, VENICE MAY 22-24 2008 F. Boschetti, Presentation ………………………………………………………………… 1 M. Passarotti, Theory and Practice of Corpus Annotation in the 'Index Thomisticus' 5 Treebank …………………………………………………………………………………... D. Fusi, An Expert System for the Classical Languages: Metrical Analysis Component … 25 M. Maurizio–R. Orsini, Manuzio: an Object Language for Annotated Text Collections … 47 SEMINARIO DI STUDI SU RICHARD PORSON. UNIVERSITÀ DI SALERNO 5-6 DICEMBRE 2008 A.F. Garvie, Porson’s Law Reconsidered …………………………………………………... 65 L. Lomiento, Il metodo ‘scientifico’ di Richard Porson, e i suoi interventi critici ad Eschilo, ‘Supplici’ ed ‘Eumenidi’ ……………………………………………………………………. 77 M. Caputo, Le edizioni di Eschilo di Richard Porson: dati, problemi e storia delle vicende editoriali ..…………………………………………………………………………………... 93 E. Medda, Riflessioni sull’Eschilo di Porson ……………………………………………….. 111 M. Taufer, Congetture porsoniane al ‘Prometheus Vinctus’………………………………... 131 L. Battezzato, Porson e il testo dell’‘Ecuba’ di Euripide …………………………………… 155 G. Pace, Congetture di Richard Porson al ‘Reso’ …………………………………………... 181 O. Imperio, Gli ‘Aristophanica’ di Richard Porson ………………………………………… 197 R. Tosi, Il Fozio di Richard Porson e gli studi lessicografici ………………………………. 221 G. Avezzù, Un bilancio provvisorio ………………………………………………………... 229 CLAUDE CALAME, SENTIERS TRANSVERSAUX. ENTRE POETIQUES GRÉQUES ET POLITIQUES CONTEMPORAINES. ANTICHITÀ E SCIENZE UMANE PER UN APPROCCIO ANTROPOLOGICO DEI TESTI POETICI GRECI, ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA 23 GENNAIO 2009. C. Riedweg, Saluto ………………………………………………………………………. 241 M. Bettini, Il canto delle pernici in Alcmane ……………………………………………… 243 G. Cerri, Inflazione bibliografica e mutamento antropologico degli studiosi di antichistica .. 253 V. Citti, Lo spessore della parola: riflessioni di un critico testuale ……………………..... 263 R. Di Donato, Sentieri trasversali e retta via …………………………………………….. -

Philobiblon Transilvan
JAKÓ ZSIGMOND PHILOBIBLON TRANSILVAN Traducerea: LIVIA BACÂRU Studiile Începuturile tipografiei de la Blaj şi Istoricul bibliotecii lui Timotei Cipariu au fost traduse de Kiss András Indice de nume: Luminiţa Stoichiţescu BIBLIOTECA KRITERION apare sub îngrijirea lui Domokos Géza JAKÓ ZSIGMOND PHILOBIBLON TRANSILVAN Cu o introducere de prof. dr. VIRGIL CÂNDEA EDITURA KRITERION Bucureşti, 1977 Coperta de VASILE SOCOLIUC INTRODUCERE Volumul de faţă cuprinde cele mai însemnate contri- buţii la cunoaşterea istoriei cărţii, tiparului şi biblioteci- lor maghiare din Transilvania publicate vreodată în limba româna. Ele sînt datorate unui cărturar care s-a devotat de mulţi ani, cu aceeaşi pasiune şi competenţă istoriei culturii, bibliologiei, codicologiei. Privilegiu rar în cîmpul ştiinţelor umane, Jakó Zsigmond întruneşte toate calităţile de erudiţie şi metodă capabile să-i în- găduie, cu autoritate, cercetarea domeniului atît de exi- gent al evoluţiei ideilor descifrată în documente, în manuscrise sau tipărituri vechi. Specialiştii şi în general iubitorii de cultură români, cărora li se adresează deopotrivă această carte, vor afla în toate paginile ei, şi mai cu seamă în studiul sintetic din încheiere, o amplă evocare a contribuţiei pe care cărturarii maghiari din Transilvania au adus-o la crea- ţia culturală prin scris şi tipar din ţara noastră, la răs- pândirea învăţăturii şi a ideilor prin cărţi şi biblioteci. Vechi scriptorii din mănăstirile catolice ardelene care au cultivat la noi, odată cu limba şi literele latine, stu- diul patristicei -
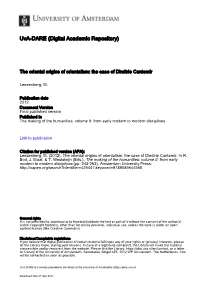
The Case of Dimitrie Cantemir
UvA-DARE (Digital Academic Repository) The oriental origins of orientalism: the case of Dimitrie Cantemir Leezenberg, M. Publication date 2012 Document Version Final published version Published in The making of the humanities: volume II: from early modern to modern disciplines Link to publication Citation for published version (APA): Leezenberg, M. (2012). The oriental origins of orientalism: the case of Dimitrie Cantemir. In R. Bod, J. Maat, & T. Weststeijn (Eds.), The making of the humanities: volume II: from early modern to modern disciplines (pp. 243-263). Amsterdam University Press. http://oapen.org/search?identifier=429447;keyword=9789089644558 General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:25 Sep 2021 Th e Making of the Humanities Volume 11: From Early Modern to Modern Disciplines Edited by Rens Bod, Jaap Maat and Th ijs Weststeijn This book was made possible by the generous support of the J.E. -

The MAKING of the HUMANITIES
RENS BOD, JAAP MAAT & THIJS WESTSTEIJN (eds.) The MAKING of the HUMANITIES volume 11 From Early Modern to Modern Disciplines amsterdam university press the making of the humanities – vol. ii Th e Making of the Humanities Volume 11: From Early Modern to Modern Disciplines Edited by Rens Bod, Jaap Maat and Th ijs Weststeijn This book was made possible by the generous support of the J.E. Jurriaanse Foundation, the Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Foundation, and the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO). This book is published in print and online through the online OAPEN library (www.oapen.org) Front cover: Hendrik Goltzius, Hermes, 1611, oil on canvas, 214 x 120 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, long-term loan of the Royal Gallery of Paintings Mauritshuis, The Hague. Back cover: Hendrik Goltzius, Minerva, 1611, oil on canvas, 214 x 120 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, long-term loan of the Royal Gallery of Paintings Mauritshuis, The Hague. Cover design: Studio Jan de Boer, Amsterdam, the Netherlands Lay-out: V3-Services, Baarn, the Netherlands isbn 978 90 8964 455 8 e-isbn 978 90 4851 733 6 (pdf ) e-isbn 978 90 4851 734 3 (ePub) nur 685 Creative Commons License CC BY NC (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) Rens Bod, Jaap Maat, Th ijs Weststeijn/ Amsterdam University Press, Amsterdam, 2012 Some rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, any part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, record- ing or otherwise). -

The Beginnings of Textual Criticism in Old Romanian Writing
EUGEN PAVEL THE BEGINNINGS OF TEXTUAL CRITICISM IN OLD ROMANIAN WRITING 1.1. Contrary to some opinions advanced on this subject, the first attempts at critical text editing in written Romanian culture date further back than the 19th century. In the mid-17th century, the scholars in Alba Iulia adopted the humanist method of comparing multiple versions in translating and editing biblical writings, by applying textual criticism in establishing both the basic text and the prolegomena and scholia that accompanied it. In two monumental printed texts, the New Testament, published in 1648, and the Psalter, published in 1651, the editors used marginal glosses, in which they rendered parallel translations after secondary sources and signalled out the lexical differences recorded in the control versions. Thus, they managed to compile an incipient critical apparatus. Some of the prefaces or epilogues these texts were equipped with seem to comply with the requirements of notes on an edition, as they stated the sources and the working method used. An example is the “Foreword to the Readers” (Predoslovia cătră cetitori), placed at the end of the Psalter of Bălgrad, where the book’s sources are mentioned. These consisted, according to the authors, primarily in the Masoretic Text (“we fully exerted ourselves to reckon the sources of the Jewish tongue”). In addition, there were the “manuscripts of many great teachers” (izvoadele a mulţi dascali mari). The reference was here to the Vulgate, as well as to other undisclosed Latin editions1, and to the Septuagint, referred to as “the manuscript of the 72 teachers”, the translators being aware of the accuracy of the originary texts, “for water is cleaner and clearer in springs than in rivulets, and the farther away water flows from the spring, the more admixed and the muddier it becomes”. -

Alciphron, Letters of the Courtesans: Edited with Introduction, Translation and Commentary
ALCIPHRON LETTERS OF THE COURTESANS ALCIPHRON LETTERS OF THE COURTESANS EDITED WITH INTRODUCTION, TRANSLATION AND COMMENTARY BY PATRIK GRANHOLM Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Ihresalen, Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3, Uppsala, Saturday, December 15, 2012 at 14:15 for the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in English. Abstract Granholm, P. 2012. Alciphron, Letters of the Courtesans: Edited with Introduction, Translation and Commentary. 265 pp. Uppsala. This dissertation aims at providing a new critical edition of the fictitious Letters of the Cour- tesans attributed to Alciphron (late 2nd or early 3rd century AD). The first part of the introduction begins with a brief survey of the problematic dating and identification of Alciphron, followed by a general overview of the epistolary genre and the letters of Alciphron. The main part of the introduction deals with the manuscript tradition. Eighteen manuscripts, which contain some or all of the Letters of the Courtesans, are described and the relationship between them is analyzed based on complete collations of all the manuscripts. The conclusion, which is illustrated by a stemma codicum, is that there are four primary manuscripts from which the other fourteen manuscripts derive: Vaticanus gr. 1461, Laurentianus gr. 59.5, Parisinus gr. 3021 and Parisinus gr. 3050. The introduction concludes with a brief chapter on the previous editions, a table illustrating the selection and order of the letters in the manuscripts and editions, and an outline of the editorial principles. The guiding principle for the constitution of the text has been to use conjectural emendation sparingly and to try to preserve the text of the primary manuscripts wherever possible. -

Tome Xii-1974 N° 4
ACADÉMIE DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES INSTITUT D'ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES TOME XII-1974N° 4 Démographie et sociologic Problèmes d'histoire politique Contacts culturels Voyageurs et réalités sud-est européennes EDITURA ACADEMIEI REPUBLIC!! SOCIALISTE ROMANIA www.dacoromanica.ro Comité de rédaction M. BERZA membre correspondant de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie rédacteur en chef ; ALEXANDRU DUTU rédacteur en chef adjoint ; EM. CONDURACHI, A. ROSETTI, membres de l'Académie de la République Socialiste de Rou- manie ;H. MIHAESCU, COSTIN MURGESCU, D. M. PIPPIDI, membres correspondants de l'Acadérnie de la République Socialiste de Roumanie ;AL. ELIAN, VALENTIN GEORGESCU, FR. PALL, MIHAI POP, EUGEN STANESCU La REVUE DES ETUDES SUD-EST EUROPEENNES paratt 4 fois par an. Toute commande de l'étranger (fascicules ou abonnement) sera adressée a ROM- PRESFILATELIA", Botte postale 2001, Telex 011631, Bucarest Roumanie, ou a ses représentants a l'étranger. La correspondance, les manuscris et les publications (livres, revues, etc.) envoy& pour comptes rendusserontadressésa L'INSTITUT D'ETUDES SUD-EST EUROPEENNES, Bucarest, sectorul 1str.I.C. Frimu, 9, télephone 50.75.25. pour la REVUE DES ETUDES SUD-EST EUROPEENNES. Les articles seront remis dactylographiés en trois exemplaires. Les collaborateurs sont priés de ne pas dépasser les limites de 25-30 pages dactylo- graphiées pour les articles et de 5-8 pages pour les comptes rendus. EDITURA ACADEMIEI REPUBLIC!! SOCIALISTE ROMANIA str. Gutenberg, 3 bis, télephone 1640 79, Bucure0 Romania www.dacoromanica.ro ETUDES 11110PBE1111E'S TOME XII 1974 N° 4 SOMMAIRE Démographie et sociologie G. CARP CLIMA, Changements démographiques récents dans les pays du Sud- Est européen 453 Problemes d'histoire politigue V.