Rudy RICCIOTTI Mucem, Bâtiment J4 (2002-2013)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Press Kit: VINCI, the Art of Museums
PRESS KIT VINCI, the art of museums Press kit /// VINCI, the art of museums /// June 2013 1 Introduction The Museum concept was first introduced in Europe, primarily in France, at the end of the 18th century for reasons that originally had nothing to do with economics or urban amenity. Until the 1950s, the purpose of the museum was exclusively conservation, in a continuation of the 19th century tradition of private collections. The real museum revolution originated primarily in the United States, where Peggy Guggenheim laid the foundations for the 20th century museum industry, and was also driven by democratisation and the development of cultural industries in Europe. Today, the number, role and visibility of these institutions have undergone radical change. No longer exclusively focused on conservation, the museum has become a flagship institution that lends resonance to the community. Cultural activities create economic value and give cities momentum. Culture also promotes social inclusion when approached as a way to improve "living together". The museum is now seen as an urban landmark and a driver of urban life. With its innovative and bold architecture, the museum is often a work of art in its own right. Building or renovating a museum is therefore a high profile but complex operation. The success of such projects requires broad vision, acknowledged capabilities in advanced technology engineering, sophisticated resources, flawless coordination and total commitment to managing people. On the strength of these qualities, VINCI companies regularly work on exceptional museum projects around the world. Their design, building, network and maintenance expertise makes all the difference in the demanding museum market. -

A+ Architecture in Belgium / BOZAR Program 2006 – 2020 A
A+ Architecture in Belgium / BOZAR Program 2006 – 2020 A. International Lecture Series season 2020 - Tham & Videgard and LAN | 11.02.2020 – Room M - Monadnock | 03.03.2020 – Room M - Carmody Groarke | 14.05.2020 - Room M - Gigon & Guyer | 28.09.2020 – Room Henry Le Boeuf - Thomas Demand | 22.10.2019 – Room M - Lütjens Padnamabhan | 16.11.2019 – Room M season 2019 - Arrhov Frick | 11.02.2019 - Room M - Marte.Marte | 26.02.2019 – Room M - Peter Märkli | 26.03.2019 – Room M - Baukuh | 07.05.2019 – Room M - StudioBASAR | 15.10.2019 – Room M - David Chipperfield | 22.10.2019 – Room Henry Le Boeuf - Go Hasegawa | 19.11.2019 – Room Henry Le Boeuf - Amunt | 05.12.2019 – Room M season 2018 - Gilles Perraudin in conversation with Barrault Pressacco | 06.02.2018 - Room M - Johannes Norlander | 06.03.2018 – Hall Horta - Jan Liesegang, raumlabor | 17.04.2018 – Room M - Paola Viganò | 18.09.2018 – Room M - Caruso St John | 02.10.2018 – Room Henry Le Boeuf - Barozzi Veiga | 25.10.2018 – Room M - Bas Princen | 22.11.2018 – Room M - Grafton Architects | 11.12.2018 – Room Henry Le Boeuf season 2017 - Arno Brandlhuber | 07.03.2017 – Room M - Emanuel Christ, Christ & Gantenbein | 18.04.2017 – Room M - Filipe Magalhães, Fala Atelier | 25.09.2017 - Room M - Christian Kerez | concrete | 24.10.2017 – Room Henry Le Boeuf - Stephen Taylor | 16.11.2017 – Room M - Carme Pigem, RCR Arquitectes | 21.11.2017 – Room Henry Le Boeuf season 2016 - Lucien Kroll | 18.09.2016 - Room M, 358 attendees - Herman Hertzberger | 06.10.2016 – Room Henry Le Boeuf, 1.172 attendees - -

Menton – Musée Jean-Cocteau
Menton Musée Jean-Cocteau 2011 - RUDY RICCIOTTI - 2 700 M2 Les piliers du portique se reflètent dans la surface vitrée. © Agence Rudy Ricciotti. Photo : Réseau Canopé TRANSMETTRE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE Regard de l’expert PROGRAMME ET GENÈSE DU PROJET SITE ET IMPLANTATION Le musée Jean-Cocteau Collection Séverin Wun- « Malgré un immense potentiel, le site est très derman est un établissement public à fonction cultu- contraint : un parking existant en premier sous-sol, relle dont la vocation est de conserver et d’exposer la une station d’épuration en second sous-sol, leurs collection privée de Séverin Wunderman. L’homme rampes d’accès qui traversent le terrain, une nappe d’affaires, né en Belgique en 1938, a fait carrière dans phréatique au niveau de la mer, un sol constitué de l’horlogerie de luxe. Parallèlement, ce collectionneur remblais, une exposition soumise aux embruns mari- passionné a rassemblé tout au long de sa vie 1 800 times, une voie littorale et urbaine bruyante » (Rudy œuvres de Jean Cocteau avant d’en faire don à la ville Ricciotti). Prévu à l’origine sur toute la superficie du de Menton en 2003. Le concours de maîtrise d’œuvre terrain situé face à une halle pittoresque édifiée en est lancé en mai 2007, le projet de Rudy Ricciotti est 1898, le musée a été déplacé par l’architecte à l’extré- retenu en juin 2008 et le chantier est bouclé en 18 mité de la parcelle pour libérer l’espace devant le mois, de janvier 2010 à juin 2011. marché couvert. L’édifice est situé au pied de la vieille ville aux façades ocre, dans un contexte à la fois bal- Le programme imposait à l’architecte un certain néaire, maritime et portuaire. -

Agence Rudy Ricciotti Architecte Dplg
AGENCE RUDY RICCIOTTI ARCHITECTE 17 bd Victor Hugo 83150 Bandol tél : +33 (0)4 94 29 52 61 fax : +33 (0)4 94 32 45 25 www.rudyricciotti.com rudy.ricciott [email protected] RUDY RICCIOTTI Né le 22 Août 1952 à Alger Grand Prix National d’Architecture Médaille d’Or de la Fondation de l’Académie d’Architecture Chevalier de la Légion d’Honneur Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres Officier de l’Ordre National du Mérite Membre de l'Académie des technologies DIPLOMES 1980 Ecole d’architecture de Marseille - 1975 Ecole d'ingénieurs de Genève INSCRIPTION A L’ORDRE DES ARCHITECTES depuis 1980 (date de création) - N° National : 23746 Architecte et ingénieur, Grand Prix National d'Architecture en 2006, Médaille d'or de l'Académie d'Architecture, Membre de l’Académie des technologies, Rudy Ricciotti est représentatif de cette génération d'architectes qui allient puissance de création et véritable culture constructive. Pionnier et ambassadeur du béton, il sublime les bétons innovants dans des réalisations marquantes telles que le Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée à Marseille, le Département des Arts de l’Islam au Musée du Louvre, le Stade Jean-Bouin à Paris, le Musée Jean Cocteau à Menton, le Pont de la République à Montpellier, le Centre International d’Art et de Culture (CIAC) à Liège en Belgique, la Philharmonie Nikolaïsaal à Potsdam en Allemagne, la Philharmonie de Gstaad en Suisse pour le festival créé par Yehudi Menuhin ou encore la Passerelle pour la Paix à Séoul. Monsieur Ricciotti est aussi l’auteur de différents pamphlets, les derniers en date sont : « Mémorial du Camp de Rivesaltes » - Éditions Archibooks – 2016, « Le béton en garde à vue » - Éditions Lemieux Éditeur – 2015, « Rudy Ricciotti En vain » Éditions Jannink – 2014, « Conversations imaginaires « ou pas » avec Rudy Ricciotti » - Éditions un autre Reg’Art – 2014, “L’architecture est un sport de combat” Éditions Textuel – 2013,« La HQE® brille comme ses initiales sur la chevalière au doigt » Editions Le Gac Press, Collection "écrits" – 2013. -

Solutions the Magazine About Uhpcs by Lafarge
OCTOBER 2013 - NO.14 SOLUTIONS THE MAGAZINE ABOUT UHPCs BY LAFARGE STANDARDIZATION: UHPCs ENTER THE INDUSTRIAL AGE AN ARCHITECT’S VISION: BERNARD TschuMI MuCEM DESIGNED BY RuDY RIccIOTTI: DucTAL® FOR PERFORMANCE AND CREATIVITY CONTENTS NEWS - 3 > 6 Standardization > 4 UHPCs enter the industrial age INSIGHTS - 7 > 9 Bernard Tschumi Architecture invents concepts and makes them a reality MARKETS - 10 > 17 Façade > 10 Giving the envelope new functions Wind turbines > 13 Resistance, sealing and flexibility Bridges & footbridges > 14 Pont de la République (France) Blandan footbridge (France) The evolution of Ductal® Joint Fill (North America) PROJECT - 18 > 23 MuCEM > 18 Ductal® combines technical performance with architectural creativity EDITORIAL COMMITTEE: Editor-in Chief: Jean Martin-Saint-Léon - Editors and contacts: Lisa Birnie - [email protected]; Marie Escaich - [email protected] - Photo credits: Lafarge photo library - Charles Plumey-Faye - Philippe Ruault - Max Lerouge - Patrick Kennedy - Luc Boegly - Hervé Abbadie - Ignus Gerber - Brian Moore, Wapello County - Andy Marshall, Ricciotti Architecte - Lisa Ricciotti - Martin Mai - Peter Mauss/Esto - Christian Richters - Iwan Baan - J. M. Monthiers - Base - Explorations architecture - Design/Editorial production: Agence All Write - Translation: TagLine - Printing: TCS/ARCM BUSINESS CONTACTS - E-mail: [email protected] - Mailing addresses: EUROPE, AFRICA, ASIA, MIDDLE EAST: UHPC / Ductal® - Lafarge - 2, avenue du Général de Gaulle - 92148 Clamart Cedex - France NOrth AMERICA: UHPC / Ductal® - Lafarge North America Inc. - 6509 Airport Road, Mississauga, Ontario - Canada L4V 1S7 PAGE 2 I NEWS JEAN-BOUIN STADIUM (FRANCE) Inaugurated on 30 August 2013, the new Jean-Bouin Stadium, designed by the architect, is covered by an asymmetric, curving envelope made from 3,600 light grey, self-supporting triangular panels in Ductal®. -

Marseille-Provence 2013
marseille-provence 2013 visit of the jury september 3rd 2008 marseilles programme 12:00 noon Saint-Charles Station Welcome of jury members Performance by Johan Lorbeer 12:30 pm Les Baumettes Prison Presentation of workshops from the European ‘Frontières’ programme with prisoners and European partners 2:00 pm Vieux Port, esplanade in front of the Hôtel de Ville Boarding the sailing ship Le Don du Vent Lunch Tour of the future ‘Cité culturelle d’Europe et de Méditerranée’ site with international artists who are supporting the application 3:30 pm Fort Saint-Jean – MuCEM Museum of European and Mediterranean Civilisations Presentation of the Marseille-Provence 2013 project > The bid’s sites and locations presented by Bernard Latarjet, the bid’s Managing Director > Governance with members of the Marseille-Provence board > Involvement of the business world with local business leaders 6:15 pm CREAC - European Research Centre into Circus Arts Presentation of a workshop by young European circus artists 7:15 pm Cité des Arts de la Rue Presentation of the ‘Cité des Arts de la Rue’ street arts centre and the upcoming ‘Via Marseille’ festival with regional companies and European Festival Directors 8:15 pm Friche la Belle de Mai Tour and presentation of the ‘Friche 2013’ project 9:00 pm Restaurant ‘Les Grandes Tables de la Friche’ Dinner Presentation of ‘La Brigade d’amateurs’ project Presentation of ‘Les Ateliers de l’Euroméditerranée’ workshops 11:30 pm Palm Beach Pullman Hotel Presentation of a workshop from the ‘Ateliers de l’Euroméditerranée’ Association -

Rudy Ricciotti, Le Béton Dans La Peau
22novembre 2015 | Le Matin Dimanche Architecture 71 Ci-contre et à g.: le MuCEM, le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, à Marseille. Au centre: la sobriété du Mémorial du camp de Rivesaltes dans les Pyrénées- Orientales s’accorde à l’histoire tragique du lieu. Ci-dessous: le projet de centre culturel «Les Arts Gstaad». Lisa Ricciotti - AFP/Camille Moirenc - Olivier Amsellem - Agence Rudy Ricciotti noue avec une monumentalité plus sobre et monolithique. Le musée a pour vocation de rappeler la terrible histoire de ce camp où fu- rent regroupés les républicains espagnols Rudy Ricciotti, fuyant leur pays; où furent ensuite rassem- blés les juifs et les Tziganes avant d’être en- voyés à Drancy puis à Auschwitz; où arrivè- rent enfin les Harkis qui avaient pris le parti de la France lors de la guerre d’Algérie. Pour évoquer tout cela, Rudy Ricciotti a souhaité le béton dans la peau un bâtiment qui donne l’impression à la fois d’être enfoui et de surgir de la terre. Il s’agit FrondeurLe Français vient d’inaugurer le Mémorial du camp de d’un bloc en béton ocre de plus de 200 mè- tres de long et dont la hauteur ne dépasse Rivesaltes (F). Il est aussi l’auteur du très séduisant MuCEM à Marseille. pas celle des baraquements existants. Il n’of- fre aucune vue sur l’extérieur, à part vers le ciel. «Sa violence formelle, écrit l’architecte, témoigne de l’impossibilité de l’oubli!» Mireille Descombes réalisation qui témoigne, une fois encore, de le savoir-faire et la culture du chantier. -

The Next Port of Call
Musée des civilisations de l’Europe & de la Méditerranée THE NEXT PORT OF CALL Musée des civilisations de l’PROGRAMMEEurope & de la Méditerranée Musée des civilisations de l’Europe & de la Méditerranée The Mediterranean finally has its museum: the muCEM In June 2013 the fIrst museum dedIcated to the cIvIlIsatIons of europe and the medIterranean wIll open In marseIlle. For the first time, the State is promoting the creation of a national museum outside the capital. In rehabilitating the historic site of Fort Saint-Jean, entrusting to Rudy Ricciotti the construction of a new building on the J4 pier facing the sea and providing a Centre for Conservation and Resources designed by Corinne Vezzoni in the Belle de Mai district, the Ministry of Culture has given birth to one of the most beautiful museum complexes in France. Marseille is the European Capital of Culture throughout the year 2013. Cultural programming of exceptional depth and appeal is already generating exceptional visitor turnout. The creation of the MuCEM is a defining element of this capital year, and well beyond 2013, the MuCEM will contribute to showcasing Marseille and its region. Marseille welcomes a museum designed in its own image: cleaved to the north shore of the Mediterranean, gazing out over the open sea, open to the winds of ideas. More Partner Institutions: than a museum, a cultural city, drawing on all the disciplines of the humanities and social sciences, mobilizing the artistic expressions of both shores of the Mediterranean. A new way of regarding the Mediterranean as a space for openness and sharing, for envisioning a common history and the dialogue of civilisations, for clarifying the issues, giving depth of field to contemporary phenomena, and shaping a new public space. -

Press File JANUARY 2016
FINE ARTS • EXHIBITION • LIEGE press File JANUARY 2016 With the exceptional collaboration of the Un site exceptionnel dans un parc entre la Meuse et la Dérivation © JP Ers, Ville de Liège Liège, strengthened by an ambitious redeployment, has devoted ten years to providing the most modern infrastructures in terms of mobility and of culture: an HST station, opera, theatre, the River Meuse quays, walkways, museums, cinemas... investments that are redrawing the metropolis for the benefit of its inhabitants and guests. Liège Metropolis has undertaken with its candidacy for the 2017 International Expo a European and global repositioning. This is driven today by the « LIÈGETOGETHER » project, which is the new signature of Liège Metropolis. In 2016, a new space, both museum for Fine Arts and international exhibition centre of international standards, will punctuate this dynamic of urban redeployment : LA BOVERIE. It undoubtedly represents the next asset of a qualitative, accessible and diverse cultural offer. table of contents LA BOVERIE AT THE HEART OF URBAN DEVELOPMENT OF LIÈGE METROPOLIS 4 • A site in the heart of the Guillemins-LA BOVERIE- Mediacité axis, marked by the greatest architects 5 • Orchestra, opera, theatres, cinemas, museums, atypical places and emerging scenes : a bountiful creativity 6 • Culture and international accessibility as motor to development 6 • Liège, an open, creative and connected metropolis 7 LA BOVERIE A MUSEUM FOR FINE ARTS AND EXHIBITION CENTRE OF INTERNATIONAL STANDARD 9 • Permanent collections of the Museum for Fine Arts, a showcase Liège’s treasures 10 • Major temporary exhibitions of multiple dimensions 11 LA BOVERIE AN ARCHITECTURAL PROJECT DESIGNED BY RUDY RICCIOTTI 12 • A project which lies within a strategy of urban development 12 • A project selected according to an international procedure 13 • An ambitious project serving a preserved identity 14 at the heart of urban development of Liège Metropolis Liège was the capital of a sovereign state, the principality of Liège, for eight-hundred years (985- 1789). -

The Architects' Publication
2017 READERSHIP SURVEY L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI “L’Architecture d’Aujourd’hui is an essential landmark of the modern architectural culture of the 20th century. It is the only French review that achieved the respect and adherence of architecture lovers and professionals throughout the world, outside Old Europe, where it had become a bold, provocative and constructive voice.” Jean NOUVEL Architect, Pritzker Prize 2008, member of the editorial board STANDARD REFERENCE MAGAZINE, SINCE 1930 “It’s a mythical magazine.” AA is: Nicolas MICHELIN • Created in 1930 Architect, Nicolas Michelin & Associés office (Paris) • 6 issues per year • Bilingual French / English • 144 pages, flat back, Condat satin 100 gr. • 230 x 298 mm • 25,000 copies distributed per issue • 75,000 readers • 25.00 euros • 80% of subscribers • 20% of sales in selective newsstands and specialized bookstores (France and abroad) • Qualified distribution (partnerships, professional fairs and events) • A renowned editorial board: Jean Nouvel, Frank Gehry, Philippe Starck, Shigeru Ban, Renzo Piano, Patrick Bouchain… “It is the ‘ideal’ French magazine, as it is a worldwide standard setter.” Marc MIMRAM Architect, Marc Mimram office (Paris) 1 FOCUS ON FRENCH READERSHIP Since 1930, AA has been Executive management of building “With AA, you’re in industry companies 2% THE renowned architects’ publication. the architect’s mind. From the 1930s, Art galleries, museums, publishing houses, bookstores, communication agencies 3% this magazine has never lowered AA is also the referene magazine -

Precast Concrete Architecture in Central Europe
PREFABRYKACJA BETONOWA I BETON KOMÓRKOWY W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE Dipl.-Ing. Juergen Glaesle 1) Precast concrete architecture in Central Europe DOI: 10.15199/33.2017.09.15 ardly any other building material is in such demand buildings for diverse uses, which have caused a stir in the at the moment by architects and is more diverse in architectural community. They prove that modern production use than concrete. This is once again reflected in techniques allow the realization of formal and constructive contemporary architecture. The material that was but also structural sophisticated designs. The presentation mostly used previously for construction, has since become takes you on my private and diverse journey through the an architectural statement of the surface, that emphasises current precast concrete architecture to be found in Central Hits message self confidently both visually and haptically. The Europe showing some of the trends and innovations in times of stereotyped concrete blocks are over, in the precast building reflected in objects and products.But keep meantime the “Modern marble“ now appears virtually refined, in mind: it’s just a small selection out of the concrete often with velvet matt surfaces, which are coloured or universe. textured at times. Concrete as a styling medium and design form of modern architecture is experiencing a true Structural precast elements renaissance. Of course not just the aesthetes but also the technologists have taken on the material in the past few Office and production building, Munich (Germany) years. Hardly a material is currently more innovative than Architecture: Kurt Tillich concrete. Research institutions and companies around the In Munich, a building like a dark crystal, a geometrically world are working on developing new, customised types of folded structure that catches the eye immediately among the concrete for general and special applications. -
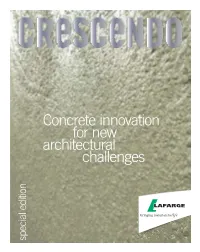
Concrete Innovation for New Architectural Challenges
Concrete innovation for new architectural challenges special edition 04 Journey into the heart of the “gray matter” 06 Concrete, a green material! 08 Concrete, at the heart of sustainable construction 10 A matter of architecture… BRUNO LAFONT Chairman & Chief Executive Officer, Lafarge © Jacques Grison THE MATTER, THE MATERIAL, THE FEAT 14 Zaha Hadid challenges materials 16 Marrec & Combarel : Radical modesty and a passion for concrete 20 The structural revolution of Villa Navarra n emerging markets, the demand for housing, facilities and infrastructure is 22 Le Corbusier’s church is finally “topped out” growing exponentially. To satisfy this huge demand today there is no credible i alternative to concrete. Is this a good enough argument to justify its use? Certainly not. But in view of the challenges of our time, concrete has many other THE EMOTION, THE DREAM, arguments in its favor than the mechanical properties or the competitive pricing THE SENSES that have made it successful. At the time of the battle against climate change 26 Christian de Portzamparc and of the need to design highly energy-efficient buildings, this fantastic material Dreams of musical architecture opens up unsuspected possibilities in answer to the questions asked by society. 28 Rudy Ricciotti’s material dreams It is accessible to the vast majority and can be easily produced everywhere. It is a material of exceptional and unrivalled durability. It is a versatile material that 30 Frédéric Borel: Architecture, a multi-sensory journey has an infinite number of properties and potential uses. Although concrete can be easily produced, the scientific complexity of its content gives an 32 Rémy Marciano builds tomorrow’s memories almost infinite potential for technological innova- TOMORROW’S WORLD, THE THINKING, Concrete, a modern-day material tion.