Apport De L'activite Medico-Legale Pour La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plan De Gestion De La Réserve Naturelle De Réghaia En Algérie
PLAN DE GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE DE RÉGHAIA EN ALGÉRIE Les appellations employées dans ce document et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du CAR/ ASP et du PNUE aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leur autorité, ni quant au tracé de leur frontière ou limites. Les vues exprimées dans ce document d’information technique sont celles de l’auteur et ne représentent pas forcément les vues du PNUE/PAM-CAR/ASP. Publié par: CAR/ASP Droits d’auteur: ©2015 - CAR/ASP Le texte de la présente publication peut être reproduit, à des fins éducatives ou non lucratives, en tout ou en partie, et sous une forme quelconque, sans qu’il ne soit nécessaire de demander une autorisation spéciale au détenteur des droits d’auteur, à condition de faire mention de la source. Pour des fins bibliographiques, citer le présent volume comme suit : CAR/ASP - PNUE/PAM, 2015. Plan de gestion de la future réserve naturelle de Réghaia en Algérie. Par Mouloud BENABDI. Ed. CAR/ASP - Projet MedMPAnet, Tunis: 120 p. Mise en page : Zine El Abidine MAHJOUB et Asma KHERIJI. Crédit photographique de la couverture : Mouloud BENABDI. Crédits photos : Mouloud BENABDI et Kouaci Nadji. Ce document a été édité dans le cadre du ‘Projet Régional pour le Développement d’un Réseau Méditerranéen d’Aires Protégées Marines et Côtières (AMP) à travers le renforcement de la Création et de la Gestion d’AMP’ (Projet MedMPAnet). Le projet MedMPAnet est mis en oeuvre dans le cadre du PNUE/PAM‐GEF MedPartnership avec le soutien financier de: CE, AECID et FFEM. -

Catalogue SITP 2018.Indd
Salon International des e Travaux Publics 1 1 Salon International des e Travaux Publics Adresses Utiles MINISTERE DU COMMERCE COMPAGNIE ALGERIENNE TEL :(+213) 021 89 00 74/85 D’ASSURANCE ET DE GARANTIE E-mail :[email protected] DES EXPORTATIONS -CAGEX- Adresse :Cité Zerhouni Mokhtar El TEL : +213 (0) 23 31 21 00 à 02 Mohammadia (ex.les bannaniers) -Alger FAX : +213 (0) 23 31 20 93 a 94 Adresse : 10, Route Nationale N°36 CNRC Dély Ibrahim ‒Alger Centre National du Registre du Commerce ALGERIENNE DE COMMERCE ET Route nationale n° 24, LIDO Bordj D’INDUSTRIE ‒CACI- El Kiffan , BP n° 18-Alger TEL: +213(0) 21 21 03 53/ 21 21 05 69 Tel : 023 80 43 14/ 023 80 43 42/ 023 FAX: +213(0) 21 21 03 54 80 43 73 Adresse :CCI ,Safex ,Foire Site web : www.cnrc.org.dz D’Alger,Mohammadia ,Alger, Algérie Direction Générale des Douanes Algérennes CACQE 19 rue du Dr Saâdane ‒ Alger Centre Algérien de Contrôle de Tel : 021 21 72 59 Qualité et d’Emballage Fax : 021 54 86 55 Route Nationale, 05, El Alia-Alger Site web : www.douane.gov.dz Tel : 021 24 31 65- 021 24 30 35 Fax : 021 24 30 11 Direction Générale des Impôts Site web : www.cacqe.org Ministère des Finances, Immeuble Ahmed Francis, IANOR Cité Malki, Ben Aknoun ‒Alger Institut Algérien de Normalisation Tel : 021 59 51 51 05, rue Abou ‒Hamou ‒ Moussa, Site web : www.mfdgi.gov.dz BP 104 - Alger. Tel : 021 54 20 75 AGENCE NATIONALE DE Fax : 021 64 21 41 PROMOTION DU COMMERCE Site web : www.ianor.org EXTERIEUR ‒ALGEX- TEL: +213(0) 21 52 12 10 FAX: +213(0) 21 52 11 26 E-mail:[email protected] Adresse : Route -

Algerian Regime to the Test
HUMAN RIGHTS PUT ALGERIAN REGIME TO THE TEST The illusion of change Paris – April 2013 Collective of Families of the Disappeared in Algeria 112, rue de Charenton 75012 Paris – France Telephone: + 33 (0)1 43 44 87 82 – Fax: + 33 (0)1 43 44 87 82 E-mail: [email protected] Website: www.algerie-disparus.org HUMAN RIGHTS PUT ALGERIAN REGIME TO THE TEST The illusion of change Bibliographical information Title: Human Rights Put Algerian Regime to the Test – The illusion of change Author: Collective of Families of the Disappeared in Algeria Publication: Collective of Families of the Disappeared in Algeria Date of the publication: April 2013 Pages: 148 ISBN: 978-2-7466-6386-2 Photos: CFDA, Rachel Corner, El Watan Weekend, Hassen Ferhani, Toufik Hachi, Omar D, Reuters, SOS Disappeared Translation into English and Arabic: Bélaid Hamici / [email protected] Graphic Design: Benjamin Lerasle / [email protected] Reproduction: The Collective of Families of the Disappeared in Algeria authorises the free distribution of extracts of this publication on the condition that it will be properly cited. Collective of Families of the Disappeared in Algeria HUMAN RIGHTS PUT ALGERIAN REGIME TO THE TEST The illusion of change Report 2011-2013 4 Human Rights Put Algerian Regime to the Test - The illusion of change Methodology: Members of the Collective of Families of the Disappeared in Algeria (CFDA) and activists working closely with the CFDA initially came together to form an editorial group. Several meetings were then held in the CFDA office in Paris to select topics to discuss and reflect on the methodology to be followed in preparation for this report. -

Les Membres De La Commission Des Finances Pour
Le Mawlid ennabawi echarif sera célébré le 9 novembre Le Mawlid ennabawi echarif sera célébré samedi 9 novembre 2019, a annoncé, hier, le ministère des Affaires religieuses et des wakfs dans un communiqué. "Le ministère des Affaires religieuses et des wakfs informe tous les citoyens que le mardi 29 octobre 2019 correspond au 1er rabie al awal 1441 de l'hégire. Ainsi, le Mawlid ennabawi echarif sera célébré samedi 12 rabie al awal 1441 correspondant au 9 novembre 2019", a précisé le communiqué. Horaire des prières Fajr : 05h35 Dohr : 12h32 Asr : 15h31 Maghreb : 17h59 Isha : 19h19 DK NEWS MÉTÉO Alger : 23° 13° Oran : 23° 13° Annaba : 23° 15° QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION Béjaïa : 22° 13° Tamanrasset: 27° 12° Mardi 29 octobre 2019 - 1er Rabî`al-awwal 1441 - N° 2352 - 7e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€ www.dknews-dz.com ALGÉRIE-GRÈCE ALGÉRIE-MAURITANIE SAHARA OCCIDENTAL L'Algérie prendra part à Athènes L'Algérie 1er partenaire Des parlementaires algériens aux travaux du Sommet commercial de la réitèrent le soutien au peuple économique UE-monde arabe Mauritanie en Afrique sahraoui et à sa juste cause P. 2 4 P. 2 4 P. 3 IMPORTATION DES VOITURES D'OCCASION : Les membres de la commission des Finances pour une augmentation à 5 ans de l'âge des véhicules concernés Les membres de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé, dimanche, à la nécessité de porter à 5 ans au lieu de 3 ans l'âge des voitures d'occasion importée, et ce dans le cadre de la mesure prévue dans le projet de loi de finances (PLF) 2020. -

La Couverture Sanitaire De La Wilaya D'alger
La couverture sanitaire de la wilaya d’Alger Pr. Larbi ABID Située au bord de la mer méditerranée, la ville donne son nom à la wilaya dont elle est le chef-lieu. La wilaya d'Alger est constituée de 13 daïras et 57 communes. D’une superficie de 820 Km2 (plus petite wilaya du pays) pour une population générale de 3.246.191 habitants (Densité : 3959 habitants/ Km2), Alger est bâtie sur les contreforts des collines du Sahel algérois. La Casbah a été érigée sur le flanc d'une de ces collines qui donne sur la pointe ouest de la baie d’Alger sur un dénivelé de 150 mètres environ. En dehors des fortifications de la ville ottomane, de nouveaux quartiers vont voir le jour le long du bras de colline qui donne sur la baie. La ville va se développer ensuite vers le nord-ouest au pied du mont Bouzareah, qui culmine à 400 m d'altitude, comme le quartier de Bab El Oued, puis tout le long de la corniche qui contourne le massif. Les premières banlieues vont voir le jour au sud-est, le long de la petite bande côtière, jusqu'à l'embouchure du l'Oued El Harrach. L'étalement urbain de la ville se poursuivra au-delà de l'Oued El Harrach à l'est, sur les terres fertiles de la plaine de la Mitidja tout au long de la baie, avant de se poursuivre ces dernières années au Sud et au sud-ouest, sur les collines vallonnées du Sahel, englobant d'anciens villages agricoles. -

The Distressing Image of the Anarchic Constructions That Proliferated from Maghnia to Tebessa ”
“ The distressing image of the anarchic constructions that proliferated from Maghnia to Tebessa ” President Abdelaziz Bouteflika: 19th December, 2006 The Government declares war on precarious housing and slums THE BATTLE OF GREATER ALGIERS “PRESIDENT BOUTEFLIKA FREES ALGERIA OF ITS ACUTE HOUSING CRISIS” Upon taking office in April 1999, President Abdelaziz Bouteflika had grasped the extent of the housing crisis and its devastating impact on millions of Algerians. He had made this issue a priority as well as the restoration of peace, the upgrading of the infrastructural level and the enhancement of Algeria’s position internationally. He promised to resolve this «scourge» and he duly kept all his promises. Since the Algerian people elected Abdellaziz Bouteflika, President of the Republic in 1999, nearly 2.8 million new housing units have been delivered across all provinces of the country. A historical performance, that even his fiercest opponents are forced to recognize today by retreating into a “talking” silence, achieved thanks to the total commitment of the Government led by Abdelmalek Sellal and the remarkable return of a statesman namely Abdelmadjid Tebboune, to the helm of a sector he knows perfectly. But who would have thought that the Algerian capital, completely disfigured in the 1990s, would be fully cleared of misfortune outgrowths in a record time? Who would have sincerely believed that, including the optimists? It took men of the caliber of Tebboune and the tireless Zoukh Abdelkader, Wali or Governor of Algiers, to commit body and soul to a «fight» of the Titans to give back “Algiers the White” its pristine reputation. -
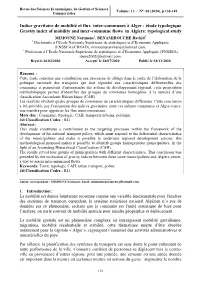
Indice Gravitaire De Mobilité Et Flux Inter-Communes À Alger : Étude Typologique Gravity Index of Mobility and Inter-Commune Flows in Algiers: Typological Study
Revue des Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Volume: 31 / N°: 02 (2020), p 138-149 Commerciales Indice gravitaire de mobilité et flux inter-communes à Alger : étude typologique Gravity index of mobility and inter-commune flows in Algiers: typological study MIMOUNE Narimene1, BENAMIROUCHE Rachid2 1 Doctorante à l’Ecole Nationale Supérieure de statistiques et d’Economie Appliquée (ENSSEA)(CREAD), [email protected], 2 Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure de statistiques et d’Economie Appliquée (ENSSEA) [email protected], Reçu le:26/02/2020 Accepté le:28/07/2020 Publié le:18/11/2020 Résumé : Cette étude constitue une contribution aux processus de ciblage dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale des transports qui doit répondre aux caractéristiques différentielles des communes et permettent d'entreprendre des actions de développement régional, cette proposition méthodologique permet d’identifier des groupes de communes homogènes, à la lumière d’une classification Ascendante Hiérarchique (CAH). Les résultats révèlent quatre groupes de communes de caractéristiques différentes. Cette conclusion a été précédée par l’estimation des indices gravitaires entre ces mêmes communes et Alger-centre, une manière pour apprécier les flux intercommunaux. Mots clés : Commune, typologie, CAH, transports urbains, politique Jel Classification Codes : R41 Abstract: This study constitutes a contribution to the targeting processes within the framework of the development of the national transport policy, which must respond to the differential characteristics of the municipalities and make it possible to undertake regional development actions; this methodological proposal makes it possible to identify groups homogeneous municipalities, in the light of an Ascending Hierarchical Classification (CAH). -

World Bank Document
Document of The World Bank Public Disclosure Authorized Report No. ICR000033 IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT ( IBRD-71390 ) ON A Public Disclosure Authorized LOAN IN THE AMOUNT OF US$5.56 MILLION TO THE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA FOR AN URBAN NATURAL HAZARD VULNERABILITY REDUCTION PROJECT Public Disclosure Authorized June 27, 2007 Public Disclosure Authorized Sustainable Development Department Middle East and North Africa This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its content may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS Currency Unit = Algerian Dinar (DA) Exchange Rate at Appraisal (07/02) DA 1.00 = US$0.0125 US$1.00 = DA 80.00 Exchange Rate as of 04/19/07 DA 1.00 = US$0.1472 US$1.00 = DA 67.92 FISCAL YEAR January 1 – December 31 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ANRH National Agency of Water Resources (Agence Nationale pour les Ressources Hydrauliques) CAS Country Assistance Strategy (Stratégie de Coopération pour le Pays) DGPC National Directorate of Civil Protection (Direction Nationale pour la Protection Civile) GDP Gross Domestic Product (Produit Intérieur Brut, PIB) ONM National Meteorological Office (Office National de la Météorologie) PMU Project Management Unit (Unité de Gestion du Project, UGP) QA6 Quality at Entry Assessment (Evaluation de la Qualité Initiale) QAG Quality Assurance Group (Groupe d’Assurance de la Qualité) SDAU Urban Development Master Plan (Schéma Directeur de l’Aménagement Urbain) Vice President: Daniela Gressani Country Director: Theodore A. Ahlers Sector Manager: Hedi Larbi Project Team Leader: Sateh Chafic El-Arnaout Sateh Chafic El-Arnaout / Abdelghani Inal / ICR Team Leader: Jérôme Chevallier PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA Urban Natural Hazard Vulnerability Reduction Project CONTENTS Page No. -

Region Centre
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES Commission ad-hoc chargée de l'organisation des élections des Conseils nationaux de l'Ordre national des Experts comptables, de la Chambre nationale des Commissaires aux comptes et de l'Organisation nationale des Comptables agréés (Décret n° 11-28 du 27/01/2011) LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILITE EN EXERCICE REGION CENTRE EXPERTS COMPTABLES AGREMENT ORD NOMS ET PRENOMS ADRESSE WILAYA N° DATE 1 ABBED ABDELMAJID 01-11-99 14 AVE DU 1ER NOVEMBRE ALGER 2 ABDELAZIZ SEGHIR 60 143 BD KRIM BELKACEM ALGER 3 ABDOUS HOCINE 025/92 08-08-92 48 DES FRERES MADANI ALGER 4 ABED MOHAMED 713 08 RUE FADHAL AEK BEO ALGER 5 ACG 2516 BT B N° 195 MOHAMADIA ALGER 6 ACHOUCHE KHALED 62 CITE SIGNA COOP GARIDI RABAH REGHAIA ALGER 7 ADANE MED AHMED 2 CITE DNC BT A6 SAID HAMDINE ALGER 8 AHNOU RACHID 614/87 CITE MOHAMED BOUDIAF N,V BT08 TIZIOUZOU 9 AHRIZ OUAHID-EDDINE 1335 40 AV AHMED GHERMOUL ALGER 10 AIT ABDELKADER NOUREDDINE 1073 CITE 1406 LOGT BT A 26 N°8 BOUMERDES 11 AIT KACI ALI LAHCENE 26 LOT G N°36 OUED ROUMANE EL ACHOUR ALGER 12 AIT MESBAH NOUREDDINE 2744 LOT EL BINA VILLA N° 30 DELLY BRAHIM ALGER 13 AIT SALEM HAMID 62 CITE 20 AOUT BT C2 N°04 TIZI OUZOU 14 ALLAL FODIL 2293 CITE DES ANNASSERS BT 805 KOUBA ALGER Page 1 de 71 15 AMER EL KHEDDOUD MOHAMED 2788 CITE 1ER MAI BT N° 10 OULED YAICH BLIDA 16 AMEZIANI LOUNES 28 BT A GROUPE PLACE 1ER MAI ALGER 17 AMMOUR AHMED 104/92 FERME SAINTE ALSA ROUTE DU STADE TIPAZA 18 AMS AUDIT SARL 58 RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER 19 AOUANE HADI 14 8 RUE -

Des Mesures Prises Mais… Le Langage Diplomatique Est Loin Tement Les Dispositions Du Droit Sidaoui
FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT: LE CHIFFRE DU JOUR 125 LE MOTEUR de recherche "Google" a célébré jeudi le 125e anniversaire LE MAGHREB de la naissance de l'artiste plasticien algérien, Mohamed Racim, l'un des Tebboune reçoit le président pionniers de l'art des miniatures en Algérie et l'un des artistes les plus célèbres au monde. Le Quotidien de l’Économie du MSP et le SG du RND (P3) DEPUIS MOSCOU : DEPUIS MOSCOU : L'armée algérienne accuse le Maroc et des puissances L'armée algérienne étrangères de vouloir déstabiliser le Maghreb accuse le Maroc et des LE MAGHREB puissances étrangères de ce partenariat stratégique est jamais été confirmée. Ndlr] pour dans deux territoires ennemis que l'Algérie a accès à des équi- faire face au Maroc ou encore à fictifs, Nehone et Rowand. Mais de vouloir déstabiliser PAR : AMMAR ZITOUNI pements militaires russes de des terroristes maliens. dans une vidéo d'un exercice du haute technologie. Outre la ques- L'objectif est de faire face à une SETAF-AF rendue publique par Le Quotidien de l’Économie le Maghreb (P16) ntervenant dans le cadre de tion historique, cette opportunité menace plus puissante comme un officier américain apparaît la Conférence de Moscou s'explique par plusieurs facteurs: cela a été le cas pour la Libye ou une carte de l'Algérie sur I sur la sécurité, le chef l'Algérie a toujours payé au prix encore pour la Syrie", assure-t-il. laquelle sont identifiés claire- d'état-major de l'armée algé- fort les armes qu'elle achète, c'est Nehone et Rowand :Riadh ment Nehone et Rowand comme rienne, le général Saïd donc un très bon client. -

Pdf Du 26/07/2021
Situation épidémiologique inquiétante Le Pr Rachid Belhadj appelle à l’état d’urgence sanitaire Le CHU a atteint 280 malades pour une capacité de 300 lits/Hausse des contaminations et forte pression sur l'oxygène à Tizi Ouzou Page 3 Journaliste à l'ENTV Décès de Karim LE JOUR Boussalem D’ALGERIE à l’âge Votre quotidien national Dix-neuvième année - N° 5432 - Lundi 26 juillet 2021 – Prix : 10 DA de 49 ans Page 16 Pas d'eau depuis des jours dans des quartiers de la capitale Anarchie de gestion : quand SEAAL ne respecte pas son propre programme… Page 2 Le spectre Sur instruction du président Tebboune lors d'un Conseil des ministres de la brusque détérioration en Tunisie Par Mohamed Habili Retour au confinement vec moins de 6 000 nouveaux cas, il y a A deux jours, la Tunisie a déploré plus de 300 décès, un ordre de grandeur qui en Afrique n'a été jusqu'à présent enregistré, mais également de 20h00 à 6h00 largement dépassé, qu'en De nouvelles mesures anti-Covid à partir d'aujourd'hui Afrique du Sud, depuis le début le pays le plus atteint par la pandémie sur le conti- nent. Pour autant, ce chiffre effarant, de 317 exactement, peut ne pas être le total des seuls décès pour la seule jour- née du 24 juillet, mais englo- ber quelques-uns de ceux sur- venus antérieurement mais non enregistrés alors. Plus d'une centaine de décès toutes les 24 heures constitue probablement la moyenne quotidienne caractéristique de la flambée sévissant pour l'heure en Tunisie. -

Prévalence Du Diabète Sucré, Chez Le Sujet Âgé De Plus De 65 Ans, Dans La Wilaya D’Alger
ACTUALITÉ Prévalence du diabète sucré, chez le sujet âgé de plus de 65 ans, dans la wilaya d’Alger Par M. Chiad 1, I. Ararem 2, A. Aouni 2, D. Iftene 1 * Résumé Introduction: Toutes les études disponibles, actuellement, s’accordent à dire que la prévalence du diabète est supérieure chez les sujets âgés, à celle retrouvé chez les sujets plus jeunes. L’étude de Chami, dans la commune de Sidi Bel-Abbès, l’a estimée à 26,7%. Dans le but de déterminer la prévalence des principaux facteurs de risque cardiovasculaires, chez les sujets âgés de plus de 65 ans, dans la wilaya d’Alger, nous avons réalisé cette étude. Matériel et méthode: Il s’agit d’une étude transversale, descriptive, de type ménage, dans la wilaya d’Alger (25 communes tirées au sort) entre le 22 / 08 / 2015 et le 01 / 01 / 2016. Les sujets, âgés de 65 ans et plus, recrutés, ont bénéficié d’une glycémie veineuse à jeun. Un sujet est déclaré diabétique en présence d’un diabète suivi et ou /traité, ou une glycémie veineuse supérieure, ou égale, à 1,26 g/l. Le résultat final a été réajusté sur la population âgée algéroise, selon le recensement de l’ONS (2008). Résultats: 451 sujets (244 hommes et 207 femmes) ont été inclus dans l’étude. La moyenne d’âge était de 73,06 ans +/- 6,51. 134 sujets (29,7%) étaient suivis pour diabète. Ce dernier était plus fréquent chez les femmes (33,3% vs 26,6% p: ns). Notre étude a permis la découverte de 27 sujets non connus diabétiques, avec une glycémie > 1,26, dont 14 femmes et 13 hommes (4 sujets avec une glycémie > 2g /l) et le diagnostic du diabète a été confirmé par un deuxième prélèvement, chez 17 parmi eux.