A331ebed097c9b9303b78c951a
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bénin, Burkina Faso, Cote D’Ivoir E, Ghana, Mali, Togo Et Le Bassin, De La Volta En Afrique De L’Ouest
Evaluation des besoins de renforcement des capacités - Benin Préparation de projets de gestion intégrée des inondations pour le Bénin, Burkina Faso, Cote d’Ivoir e, Ghana, Mali, Togo et le Bassin, de la Volta en Afrique de l’Ouest Août 2016 Ce rapport provisoire a été produit et validé en 2016 par les acteurs institutionnels et autres parties prenantes en charge de la coordination et impliqué s dans la gestion des inondations au Bénin, dans le cadre de l’initiative « Préparation de Projets de Mise en Œuvre de la Gestion Intégrée des Crues – GIC - » dans le bassin de la Volta et ses six pays riverains (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Ma li et Togo). L ’ initiative, qui s ’ inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d ’ Action Stratégique (PAS) du bassin de la Volta est mise en œuvre en appui à l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) avec le soutien du Programme Associé de Gestion de s Crues (APFM) de l’Organisation Météorologie Mondiale (OMM) et du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) ; et du Programme Eau Climat et Développement (WACDEP) du Conseil des Ministres Africains charges de l’Eau/ Union Africaine (AMCOW/ AU) mis en œuvre par l e GWP. Ce rapport peut être partiellement ou entièrement reproduit à des fins pédagogiques personnelles et non commerciales sans autorisation spéciale de l’ABV, de l’OMM et du GWP. Initiative « Préparation de Projets de Mise en Œuvre de la Gestion Intégr ée des Crues - GIC - » dans le bassin de la Volta et ses six pays riverains (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali et Togo). -

Caractéristiques Générales De La Population
République du Bénin ~~~~~ Ministère Chargé du Plan, de La Prospective et du développement ~~~~~~ Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique Résultats définitifs Caractéristiques Générales de la Population DDC COOPERATION SUISSE AU BENIN Direction des Etudes démographiques Cotonou, Octobre 2003 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1: Population recensée au Bénin selon le sexe, les départements, les communes et les arrondissements............................................................................................................ 3 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de KANDI selon le sexe et par année d’âge ......................................................................... 25 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de NATITINGOU selon le sexe et par année d’âge......................................................................................... 28 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de OUIDAH selon le sexe et par année d’âge............................................................................................................ 31 Tableau G02A&B :Population Résidente recensée dans la commune de PARAKOU selon le sexe et par année d’âge (Commune à statut particulier).................................................... 35 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de DJOUGOU selon le sexe et par année d’âge .................................................................................................... 40 Tableau -
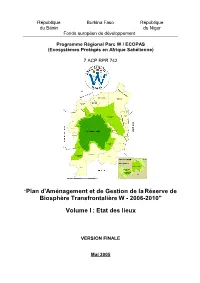
Volume I : Etat Des Lieux
République Burkina Faso République du Bénin du Niger Fonds européen de développement Programme Régional Parc W / ECOPAS (Ecosystèmes Protégés en Afrique Sahélienne) 7 ACP RPR 742 "Plan d'Aménagement et de Gestion de la Réserve de Biosphère Transfrontalière W - 2006-2010" Volume I : Etat des lieux VERSION FINALE Mai 2005 Programme Régional Parc W / ECOPAS 7 ACP RPR 742 "Plan d'Aménagement et de Gestion de la Réserve de Biosphère Transfrontalière W - 2006-2010" janvier - novembre 2004 Réalisé par le Programme Régional Parc W / ECOPAS en collaboration avec les Administrations de tutelles et les Communautés riveraines , avec l’appui technique de : Alain BILLAND, Marie Noël DE VISSCHER, KIDJO Ferdinand Claude, Albert COMPAORE, Amadou BOUREIMA, Alexandra MOREL, Laye CAMARA ; Frank CZESNIK, Nestor René AHOYO ADJOVI Adresse : Consultant Bureau de Coordination du Programme Consortium ECOPAS : Régional Parc W / ECOPAS Agrer S.A., Agriconsulting S.p.A., 01 BP 1607 CIRAD, GFA Terra Systems GmbH, Imm. PPI BF face BIB avenue du Temple Deutsche Gesellschaft für Technische Ouagadougou 01 Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Burkina Faso Tél./Fax: (+226) 335261 s/c GFA Terra Systems GmbH [email protected] Eulenkrugstr. 82 D – 22359 Hamburg Tel.: (+49)40-60306-111 Fax: (+49)40-60306-119 E-Mail: [email protected] Plan d'Aménagement et de Gestion de la RBT W (Bénin, Burkina Faso, Niger) Etat des lieux – Version finale ETAT DES LIEUX DE LA RESERVE DE BIOSPHERE TRANSFRONTALIERE W Sommaire 1 LISTE DES ABREVIATIONS .............................................................................................. 10 2 ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION............................... 14 3 HISTORIQUE........................................................................................................................ 16 3.1 HISTORIQUE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES PARCS NATIONAUX...................... -

Par L'équipe Conjointe BASICS Et DDSPSCFIB 4 Septembre 1997
RAPPORT PRÉLIMINAIRE PRÉSENTÉ À LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA CONDITION FÉMININE (DDSPSCF) DE BORGOU SUR LES INTERVENTIONS DU "PAQUET MINIMUM DES ACTIVITÉS"! NUTRITION (pMAIN) Par l'équipe conjointe BASICS et DDSPSCFIB 4 septembre 1997 Tina Sanghvi Serigne Diène accompagné par Léopold Fakambi BASICS Technical Directive: 000 BN 01 017 USAID Contract Number: HRN-C-00-93-00031-00 TABLE OF CONTENTS ABRÉVIATIONS 1. INTRODUCTION ....................................................... 1 II BUT ET OBJECTIFS .................................................... 1 III ORGANISATION ET MÉTHODOLOGIE DE LA VISITE DE TERRAIN .......... 2 IV RÉSULTATS DE LA VISITE DE TERRAIN ................................. 2 V. PROCHAINES ÉTAPES DE LA MISE EN OEUVRE DU PMAINUTRITION DANS LE DÉPARTEMENT DE BORGOU : PROPOSITIONS POUR LES 12 PROCHAINS MOIS ................................................................. 8 A. ACTIONS COMMUNES À TOUTES LES COMPOSANTES ........ 8 B. PROMOTION DE L'ALLAITEMENT MATERNEL ............... 8 C. L ' ALIMENTATION COMPLÉMENTAIRE (BONNES PRATIQUES DE SEVRAGES) ................................ 8 D. VITAMINE A .............................................. 9 E. LA SUPPLÉMENTATION EN FER DE LA FEMME ENCEINTE .... 9 F. LA PROMOTION DE LA CONSOMMATION DU SEL IODÉ ....... 9 G. PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE DES MALADIES DEL'ENFANT ............................................. 9 LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES Table 1. Overview of PMAIN Protocols in Health Services Table 2. Situation Nutritionnelle et Sanitaire des Enfants dans le Département du Borgou, EDS 1996 Table 3. Health Personnel in Borgou Department Table 4. List of Health Facilities Visited Table 5. Current Situation and Gaps in PMAIN Components in Borgou Table 6. Number Enrolled in the CPS Program in Borgou Figure 1. Contribution of Malnutrition to Child Deaths in Benin Figure 2. Prevalence of Malnutrition by Department Figure 3. Malnutrition by Age in Benin Figure 4. -

Programme D'actions Du Gouvernement 2016-2021
PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT 2016-2021 ÉTAT DE MISE EN œuvre AU 31 MARS 2019 INNOVATION ET SAVOIR : DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE DE L’INNOVATION ET DU SAVOIR, SOURCE D’EMPLOIS ET DE CROISSANCE – © BAI-AVRIL 2019 A PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT 2016-2021 ÉTAT DE MISE EN œuvre AU 31 MARS 2019 2 Sommaire 1. Avant-propos p. 4 2. Le PAG en bref p. 8 3. État d’avancement des réformes p. 14 4. Mise en œuvre des projets p. 26 TOURISME p. 30 AGRICULTURE p. 44 INFRASTRUCTURES p. 58 NUMÉRIQUE p. 74 ÉLECTRICITÉ p. 92 CADRE DE VIE p. 110 EAU POtaBLE p. 134 PROTECTION SOCIALE p. 166 CITÉ INTERNatIONALE DE L’INNOVatION ET DU SaVoir – SÈMÈ CITY p. 170 ÉDUCatION p. 178 SPORT ET CULTURE p. 188 SaNTÉ p. 194 5. Mobilisation des ressources p. 204 6. Annexes p. 206 Annexe 1 : ÉLECTRICITÉ p. 210 Annexe 2 : CADRE DE VIE p. 226 Annexe 3 : EAU POTABLE p. 230 SOMMAIRE – © BAI-AVRIL 2019 3 1 4 RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES MENÉES – © BAI-AVRIL 2019 Avant-propos RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES MENÉES – © BAI-AVRIL 2019 5 Avant-propos Les équipes du Président Patrice TALON poursuivent du PAG. Il convient de souligner que ces fonds ont été résolument la mise en œuvre des projets inscrits dans affectés essentiellement au financement des infrastruc- le Programme d’Actions du Gouvernement PAG 2016– tures nécessaires pour impulser l’investissement privé 2021. Dans le présent document, l’état d’avancement (énergie, routes, internet haut débit, attractions, amé- de chacun des projets phares est fourni dans des fiches nagement des plages,…). -

Presentation Des Regions De Developpement
Ministère de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme Délégation à l’Aménagement du Territoire Mission d’Identification des « régions » comme unités de planification territoriale et de gestion du développement au Bénin. Rapport final LARES- Avril 2005 Table des matières Introduction…………………………………………………………………………..3 1- Objectif du travail…………………………………………………………………4 2- Démarche méthodologie…………………………………………………………...4 3- Les Espaces de développement partagé…………………………………………..5 3-1- Définition…………………………………………………………………5 3-2- Les scénarios alternatifs…………………………………………………6 4- Esquisse d’Espaces de développement Partagé………………………………….9 4-1- la Vallée du Niger……………………………………………………….10 4-2- Pays des trois rivières …………………………………………………..12 4-3- Pays des monts du Borgou……………………………………………...14 4-4- Cœur du Pays Bariba…………………………………………………...16 4-5- Ouémé supérieur……………………………………………………..…18 4-6-Pays de la Pendjari………………………………………………………20 4-7-Pays de la Mékrou……………………………………………………….22 4-8-L’Atacora………………………………………………………………...24 4- 9-La Donga………………………………………………………………...26 4-10-Pays de l’Okpara……………………………………………………….28 4-11-Pays des 41 Collines……………………………………………………30 4-12- Pays du Pacte de Terre………………………………………………..32 4-13-Plateau du Danxomè…………………………………………………...34 4-14-Pays Agonli……………………………………………………………..36 4-15-Le Mono………………………………………………………………...38 4-16-Le Moyen Couffo………………………………………………………40 4-17-Zone Interlacustre……………………………………………………..42 4-18-Pays Nagot……………………………………………………………..44 4-19-Vallée de l’Ouémé……………………………………………………..46 4-20-Pays Gun……………………………………………………………….48 -

Option : Amenagement Et Gestion Des Ressources Naturelles
REPUBLIQUE DU BENIN universite d’abomey-calavi FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES PERCEPTIONS PAYSANNES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, STRATEGIES D’ADAPTATION DANS LA GESTION DES PARCS A KARITE AU BENIN OPTION : AMENAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES Césaire Paul Gnanglè Thèse de Doctorat unique en Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi JURY Président: Professeur Titulaire Dansou Kossou, Université d’Abomey-Calavi, Bénin Rapporteur 1 : Professeur Patrice Toe, Maître de conférences, Université de Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso Rapporteur 2 : Professeur Kossi Badaméli, Maître de conférences, Université de Kara, Togo Rapporteur 3 : Professeur Roch Mongbo, Maître de conférences, Université d’Abomey- Calavi, Bénin Examinateur : Professeur Romain Glèlè Kakaï, Maître de conférences, Université d’Abomey- Calavi, Bénin Directeur de thèse : Professeur Titulaire Nestor Sokpon, Université de Parakou, Bénin Thèse défendue publiquement sous l’autorité du Professeur Titulaire en Sciences Forestières Nestor Sokpon, Directeur du Laboratoire d’Etudes et de Recherches Forestières (LERF), le 26 Juillet 2012 REPUBLIQUE DU BENIN universite d’abomey-calavi FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES PERCEPTIONS PAYSANNES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, STRATEGIES D’ADAPTATION DANS LA GESTION DES PARCS A KARITE AU BENIN OPTION : AMENAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES Césaire Paul Gnanglè Thèse de Doctorat unique en Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi JURY Président: Professeur Titulaire Dansou Kossou, Université d’Abomey-Calavi, -

Annual Report October 1, 2001 - September 30, 2002
BENIN INTEGRATED FAMILY HEALTH PROGRAM (PROSAF) Annual Report October 1, 2001 - September 30, 2002 Contract No. 680-C-00-99-00065-00 Submitted by University Research Co, LLC BENIN INTEGRATED FAMILY HEALTH PROGRAM (PROSAF) Annual Report October 1, 2001 - September 30, 2002 Contract No. 680-C-00-99-00065-00 Submitted by University Research Co, LLC Date of Submission: December 30, 2002 University Research Co., LLC 7200 Wisconsin Ave., Bethesda, MD 20814 Tel: 301-654-8338 ¨ Fax: 301-941-8427 ¨ www.urc-chs.com PROSAF 2002 Annual Report ACRONYMS ABPF Association Béninoise pour la Promotion de la Famille AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome AIMI Africa Integrated Malaria Initiative ATR Administrative and Territorial Reforms BASICS Basic Support for Institutionalizing Child Survival BCC Behavior Change Communication BINGOS Benin Initiative for Non-Governmental Organization Strengthening CA Cooperating Agency CADZS Cellule d'Appui au Dévelopment des Zones Sanitaires CAME Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels CBS Community Based Services CBSA Community Based Services Agents CCS Centre Communal de Santé CDC Center for Disease Control CDEEP Comité Départementale d'Evaluation et Suivi des Projets CLUSA Cooperative League of USA COGEC Comité de Gestion de la Commune COGES Comité de Gestion de la Sous-Préfecture CODIR Comité de Direction CPR Contraceptive Prevalence Rate CVS Comité Villageois de Santé DDSP Direction Départementale de la Santé Publique DHS Demographic and Health Survey FP Family planning FPLM Family Planning Logistic Management -
La Marche Vers Le Développement
1 Urgent: AVIS DE RECRUTEMENT POUR SERVIR UNE ENTREPRISE PARTENAIRE DE LA MVD QUI SE TROUVE DANS UN BESOIN D'URGENCE. -*-*-*-*-*- La Marche Vers le Développement - MVD recrute de toute urgence au profit d'une entreprise, 94 agents commerciaux pour le recensement des écoles, collèges, lycées, complexes scolaires (publics et privés) du Bénin. Les agents commerciaux sont répartis sur toute l'étendue du territoire nationale selon les tableaux ci-après: Veuillez les consulter afin de choisir votre localité. Il s'agit de : 2 Tableau: Liste des commerciaux des communes, des arrondissements et des villages (ou quartiers de villes) du département de l'Alibori Département Communes Arrondissements Villages ou quartiers de ville Commerciaux BANIKOARA ARBONGA, OKIRE, YADIKPAROU, WETEROU, DEMANOU, OROU GNONROU, DEROU GAROU, KOMMON, KORI GINGUIRI, WAGOU, TOKEY BANTA. FOUNOUGO BOFOUNOU- PEULH, FOUNOUGO A, FOUNOUGO B, FOUNOUGO PEULH, GNINGNIMPOGOU, GOUGNIROUBARIBA, GOUGNIROU PEULH, IGGRIGGOU, KANDEROU, KPAKO GBARI, SAMPETO. GOMPAROU BOUHANROU, GOMPAROU A, GOMPAROU B, GOMPAROU PEULH, KPESSANROU, NIEKOUBANTA, PAMPIME, TIGASSOUNON, GOUROUEDE. GOUMORI DOMBOURE BARIBA, DOMBOURE PEULH, GBANGBANGA, GBASSA, GOUMORI A, GOUMORI B, 1 GOUMORI PEULH, MONDOUKOKA. BANIKOARA SOROKO GBENIKI, SOROKO A, SOROKO B, SOROKO PEULH. TOURA ATABENOU, TINTINMOU-BARIBA, TINTINMOU-PEULH, TOURA-A, TOURA-B, T O URA-PEULH. BAGOU BAGOU, BANIGOURE, BAGOU I, BAGOU II, BAGOU PEULH, DIADIA, GANDOBOU, KALI, KEROU, NAFAROU. KOKEY KOKEY A, KOKEY B, NIMBERE PEULH, PIGUIRE PEULH. KOKIBOROU KOKIBOROU A, KOKIBOROU B, KOKIBOROU PEULH, SIKIROU. OUNET OUNET A, OUNET B, OUNET PEULH, SONNOUBARIBA, SENNOU PEULH. 1 SOMPEREKOU POTO, SIMPEROU, SIMPEROU-PEULH, SOMPEREKOU-A, SOMPEREKOU-B, SOMPEREKOU-PEULH, KEGAMONROU. ALIBORI GOGOUNOU GOGOUNOU, KOSSENIN, OUERE, OUERE PEULH. GOUNAROU BORO, BORODAROU, DIGUISSON, GOUNAROU. -
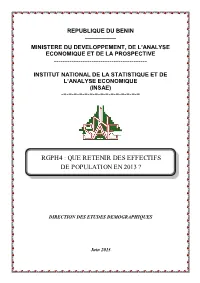
Resultats Definitifs RGPH4.Pdf
REPUBLIQUE DU BENIN _____________ MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L’ANALYSE ECONOMIQUE ET DE LA PROSPECTIVE ------------------------------------------ INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= RGPH4 : QUE RETENIR DES EFFECTIFS DE POPULATION EN 2013 ? DIRECTION DES ETUDES DEMOGRAPHIQUES Juin 2015 La nécessité de disposer de données pertinentes, fiables, diversifiées et désagrégées jusqu’au niveau géographique le plus fin et à jour, est unanimement reconnue par la communauté internationale. Appréciant ce besoin d’information, de nombreuses opérations statistiques se réalisent dans le but de disposer de données fiables facilitant une prise de décision éclairée, tant au niveau des décideurs politiques, qu’au niveau de la communauté scientifique et économique. Au titre de ces opérations, le Recensement Général de la Population et de l’Habitation est la source qui permet de disposer de façon exhaustive des données jusqu’aux plus petites unités administratives. Les travaux de dénombrement du RGPH4 au Bénin se sont déroulés du 11 au 31 Mai 2013 sur toute l’étendue du territoire national. Cette grosse opération a mobilisé près de 17.500 agents de terrain : agents recenseurs, chefs d’équipes, contrôleurs et superviseurs. En dehors des ressources du Budget National, elle a bénéficié de l’appui des partenaires au développement du Bénin, notamment la Coopération Suisse, la Banque Mondiale, l’UNICEF et l’UNFPA. A la suite de la collecte, les travaux de traitement ont démarré avec l’archivage des questionnaires, la vérification, la codification, la saisie et l’apurement des données. Après plusieurs étapes de validation par le Conseil Scientifique de l’INSAE, le Conseil des Ministres en sa séance du jeudi 21 mai 2015 a adopté les résultats définitifs du RGPH4. -

Climate Changes and Progression of Agricultural Practices in North Benin
International Journal of Agricultural Economics, Extension and Rural Development ISSN: 2716-7969 Vol. 2 (1), pp. 017- 026, February, 2014. Available online at www.advancedscholarsjournals.org © Advanced Scholars Journals Full Length Research Paper Climate changes and progression of Agricultural practices in North Benin *Nouatin Guy, Ismail Moumouni, Mohamed N. Baco, Honorat Edja and Jérémie Dedjan Faculty of Agronomy, University of Parakou, B.P. 123 Parakou, Republic of Benin. Accepted 10 December, 2013 Climate changes constitute nowadays potential threat to the environment and to the sustainable development. Their impacts especially affect agriculture which depends on rainfall in poor countries like Benin. In effect, the development of adequate adaptation strategies constitutes a problematic for population. This work aims at studying adaptation strategies developed by population to face climate changes. It analyzes climate changes impacts on seedling periods of cotton, maize and rice. This study was conducted in Alibori department (Banikoara and Malanville). Consequently, this study demonstrates the statement of seedling periods over a year which took into account a diversity of crops varieties (early and late) Eighty households are randomly selected. Data are collected through Unstructured and Semi Structured Interviews, Focus Groups Discussion and Participant Observations. The modifications of seedling periods are determined on the basis of discourse analysis and descriptive statistics. Results reveal that, farmers use many strategies to cope with rainfall interruption. Thus, Crops seedling periods modifications are parts of those strategies where farmers have to modify the seedling periods to these crops as a response to climate changes. Whereas at the extension services level the seedling periods remained unchanged except the case of rice. -

Productivity of Cotton and Sorghum in an Agroforestry System of Shea Trees (Vitellaria Paradoxa Gaertn) in Northern Benin
Vol.5, No.2, 207-213 (2013) Natural Science http://dx.doi.org/10.4236/ns.2013.52031 Productivity of cotton and sorghum in an agroforestry system of shea trees (Vitellaria paradoxa gaertn) in northern Benin Césaire Paul Gnanglè1*, Charlemagne Gbemavo2, Kouèssi Aïhou1, Romain Glèlè Kakaï2, Nestor Sokpon3 1National Institute of Agricultural Research of Benin, Central Agricultural Research Centre, Forest Research Programme, Savè, Benin; *Corresponding Author: [email protected] 2School of Agricultural Sciences, University of Abomey, Cotonou, Benin 3School of Agriculture, University of Parakou, Parakou, Benin Received 26 September 2012; revised 28 October 2012; accepted 10 November 2012 ABSTRACT Agrosystem; Cotton; Sorghum; Shea Tree; Shade-Tree Management; Benin This study evaluates the productivity of cotton and sorghum in a shea-based agroforestry sys- tem in northern Benin. Tomboutou and Goun- 1. INTRODUCTION arou villages were respectively selected in the The presence of trees among crops creates landscapes shea parklands of Bembèrèkè and Kandi. Within known as “agroforestry landscapes” [1]. The benefit of each parkland and village, three classes of tree integrating trees into farming systems has been high- crown diameter for shea trees (4 - 8 m, 8 - 10 m lighted [2,3]. Shea parklands, for instance, help maintain and <10 m), were defined after the inventory soil fertility and the sustainability of cropping systems phase. In each class of crown diameter, three [4]. In fact, the biomass produced by the trees is broken, trees intercropped with cotton and sorghum allowing recycling of nutrients pumped by the shaft dep- were randomly selected among the 18 to 21 th horizons to the surface soil.