Entrb 1860 Et 1895
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2018-2019 Annual Report
2018-2019 annuAl report THE MONTREAL MUSEUM OF FINE ARTS CITED AS MODEL EXAMPLE IN THE OECD AND ICOM’S INTERNATIONAL GUIDE “The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the International Council of Museums (ICOM) recognized the Montreal Museum of Fine Arts’ pioneering role in their guide launched in December 2018, Culture and Local Development: Maximising the Impact. Guide for Local Governments, Communities and Museums. This remarkable validation from two major international economic and cultural institutions will enable us to disseminate our message ever farther, so as to strengthen the role of culture and expand the definition of trailblazing museums, like the MMFA, that are fostering greater inclusion and wellness.” – Nathalie Bondil The Museum is cited in 5 of the 16 international case studies in the guide: a remarkable nod to our institution’s actions that stem from a humanist, innovative and inclusive vision. Below are a few excerpts from the publication that is available online at www.oedc.org: 1. Partnering for urban regeneration 3. Partnership for education: EducArt 5. Promoting inclusiveness, health and Regarding the MMFA’s involvement in creating the digital platform, Quebec, Canada well-being: A Manifesto for a Humanist Zone Éducation-Culture in 2016, in collaboration Launched in 2017 by the MMFA, EducArt gives Fine Arts Museum with Concordia University and the Ville de Montreal: secondary school teachers across the province access “As part of the Manifesto for a Humanist Fine “The project … has its roots in a common vision [of to an interdisciplinary approach to teaching the Arts Museum written by Nathalie Bondil,1 the the three institutions] to improve Montreal’s role as educational curriculum, based on the Museum’s MMFA has put forth a strong vision of the social a city of knowledge and culture. -

View Anne Whitelaw's CV
CURRICULUM VITAE Anne Whitelaw Vice-provost Planning and Positioning Associate Professor, Department of Art History Concordia University 1455 Boul de Maisonneuve Ouest, GM 806.09 Montreal QC H3G 1M8 (514) 848-2424 ext 5674 [email protected] EMPLOYMENT HISTORY Vice-provost Planning and Positioning January 2017 - present Concordia University Office of the Provost and Vice President Academic Affairs Associate Dean – Research Concordia University Faculty of Fine Arts July 2014 – December 2017 Associate Professor (tenured) Concordia University Department of Art History January 2011 - present Associate Professor (tenured) University of Alberta Department of Art and Design July 2005 - December 2010 Assistant Professor (tenure-track) University of Alberta Department of Art and Design July 1999- July 2005 Assistant Professor Concordia University Dept. of Communication Studies August 1998 - May1999 Sessional Lecturer Concordia University Dept. of Communication Studies 1993-1998 Department of Art History 1990-1993 ACADEMIC BACKGROUND 1997 Post-doctoral Fellowship (SSHRC-funded) Visual and Cultural Studies, University of Rochester 1996 Ph.D. Communications, Concordia University 1991 Graduate Diploma, Communication Studies Concordia University 1989 M.A. History and Theory of Art, University of Essex 1987 B.F.A. Honours Art History, Concordia University, with distinction B. RESEARCH PUBLICATIONS Books: Spaces and Places for Art: Making Art Institutions in Western Canada 1912-1990. Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2017. The Visual Arts in Canada: The Twentieth Century. Edited by Anne Whitelaw, Brian Foss and Sandra Paikowsky. Toronto: Oxford University Press, 2010. Book Chapters and Journal Essays (* indicates peer review): * “’If you do not grow you are a dead duck’: Funding Art Publications in Canada from the 1940s to the 1980s,” special issue on Networked Art History in Canada ed. -
![Perspective, 3 | 2008, « Xxe-Xxie Siècles/Le Canada » [En Ligne], Mis En Ligne Le 15 Août 2013, Consulté Le 01 Octobre 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/6274/perspective-3-2008-%C2%AB-xxe-xxie-si%C3%A8cles-le-canada-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-15-ao%C3%BBt-2013-consult%C3%A9-le-01-octobre-2020-1856274.webp)
Perspective, 3 | 2008, « Xxe-Xxie Siècles/Le Canada » [En Ligne], Mis En Ligne Le 15 Août 2013, Consulté Le 01 Octobre 2020
Perspective Actualité en histoire de l’art 3 | 2008 XXe-XXIe siècles/Le Canada Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/perspective/3229 DOI : 10.4000/perspective.3229 ISSN : 2269-7721 Éditeur Institut national d'histoire de l'art Édition imprimée Date de publication : 30 septembre 2008 ISSN : 1777-7852 Référence électronique Perspective, 3 | 2008, « XXe-XXIe siècles/Le Canada » [En ligne], mis en ligne le 15 août 2013, consulté le 01 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/perspective/3229 ; DOI : https://doi.org/ 10.4000/perspective.3229 Ce document a été généré automatiquement le 1 octobre 2020. 1 xxe-xxie siècles Entretien avec Bill Viola sur l’histoire de l’art ; Giacometti ; l’urbanisme des villes d’Europe centrale ; publications récentes sur la couleur au cinéma et dans la photographie, le postmodernisme, les archives d’art contemporain et les revues d’art. Le Canada Développement et pratiques actuelles de la discipline : de l’histoire de l’art aux études d’intermédialité, le rôle des musées et de la muséographie ; Ancien et Nouveau Mondes ; chroniques sur art et cinéma, les revues, le patrimoine… Perspective, 3 | 2008 2 SOMMAIRE De l’utilité des revues en histoire de l’art Didier Schulmann XXe-XXIe siècles Débat Bill Viola, l’histoire de l’art et le présent du passé Bill Viola Alberto Giacometti aujourd’hui Thierry Dufrêne Travaux L’urbanisme et l’architecture des villes d’Europe centrale pendant la première moitié du XXe siècle Eve Blau Actualité Couleur et cinéma : vers la fin des aveux d’impuissance Pierre Berthomieu L’histoire de la photographie prend des couleurs Kim Timby Autour de Fredric Jameson : le postmodernisme est mort ; vive le postmodernisme ! Annie Claustres Les archives d’art contemporain Victoria H. -
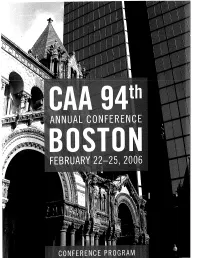
2006 Annual Conference Program Sessions
24 CAA Conference Information 2006 ARTspace is a conference within the Conference, tailored to the interests and needs of practicing artists, but open to all. It includes a large audience session space and a section devoted to the video lounge. UNLESS OTHERWISE NOTED. ALL ARTSPACE EVENTS ARE IN THE HYNES CONVENTION GENTER, THIRD LEVEl, ROOM 312. WEDNESDAY, FEBRUARY 22 ------------------- 7:30 AM-9:00 AM MORNING COFFEE, TEA, AND JUICE 9:30 AM-NOON SlOPART.COM BRIAN REEVES AND ADRIANE HERMAN Slop Art corporate representatives will share popular new product distribution and expression-formatting strategies they've developed to address mounting consumer expectation for increasing affordability, portability, familiar formatting, and validating brand recognition. New franchise opportunities, including the Slop Brand Shippable Showroom™, will be outlined. Certified Masterworks™ and product submission guidelines FREE to all attendees. 12:30 PM-2:00 PM RECENT WORK FROM THE MIT MEDIA LAB Christopher Csikszelltlnihalyi, a visual artist on the faculty at the MIT Media Lab, coordinates a presentation featuring recent faculty work from the MIT Media Lab; see http;llwww.media.mit.edu/about! academics.htm!. 2:30 PM-5:00 PM STUDIO ART OPEN SESSIOII PAINTING Chairs; Alfredo Gisholl, Brandeis University; John G. Walker, Boston University Panelists to be announced. BOSTON 25 THURSDAY, FEBRUARY 23 2:30 PM-5:00 PM STUDIO ART OPEN SESSIOII 7:30 AM-9:00 AM PRINTERLY PAINTERLY: THE INTERRELATIONSHIP OF PAINTING AND PRINTMAKING MORNING COFFEE, TEA, AND JUICE Chair: Nona Hershey, Massachusetts College of Art Clillord Ackley, Museum of Fine Arts, Boston 9:00 AM-5:30 PM Michael Mazur, independent artist James Stroud, independent artist, Center Street Studio, Milton Village, VIDEO lOUNGE: EXPANDED CINEMA FOR THE DIGITAL AGE Massachusetts A video screening curated by leslie Raymond and Antony Flackett Expanded Cinema emerged in the 19605 with aspirations to explore expanded consciousness through the technology of the moving image. -

News Bulletin Is Published Every Thursday Chronicle Gave the University Several Cases of on a Regular Basis, Professor Brigg Says
NEWS E yQ BULLETIN UNIVERSITY OF GUELPH Professor K. F. Gregory and Professor R. E. Smith discuss an unusually large cassava root with Dr. A. E. Reade, a post doctoral fellow who has recently arrived from Aberdeen to work on the University involved in research for Latin America cassava project. Professor Gregory is project co- ordinator of an $82,114 grant to the Microbiology Department. Cassava is flown in from Cali, University of Guelph research on cassava may does not require long absences abroad of Colombia, after harvesting at the age of a year. mean a better diet for humans and animals in faculty and potential interruptions of depart- Normally a cassava root is only two or three other parts of the world. Professor H. R. Binns, mental programs. inches in diameter. Director of the Centre for International The evolution of the program illustrates one Programs at the University, has announced the of the main functions of the Centre for Inter- Science, are all working on this project as multi-discipline involvement of Guelph in a national Programs. This is to seek or create well. long term international program on the relevant and effective opportunities for Professor T. P. Phillips, Agricultural Econ- tropical root crop, cassava, better known as international activities and for cooperation omics and Extension Education, is project tapioca or manioc. This staple food for with institutions overseas, by departments or coordinator of a $39,169 grant for a one year humans in many parts of the world also individual faculty members at Guelph wishing study into the potential utility of cassava provides an important source of swine feed. -

Proquest Dissertations
Atlantic Canadian Representation in the National Gallery of Canada's Biennial Exhibitions of Canadian Art (1953-1968) by Suzanne A. Crowdis, BFA (Concordia University, 2004) School for Studies in Art and Culture, Department of Art History A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Art History Carleton University OTTAWA, Ontario © 2010, Suzanne A. Crowdis Library and Archives Bibliothgque et 1*1 Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'gdition 395 Wellington Street 395, rue Wellington OttawaONK1A0N4 OttawaONK1A0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-71604-5 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-71604-5 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par I'lnternet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Artists in Canada: a National Resource
DOCUMENT RESUME ED 450 732 IR 057 988 AUTHOR Beglo, Jo Nordley; Campbell, Cyndie TITLE Artists in Canada: A National Resource. PUB DATE 2000-08-00 NOTE 9p.; In: IFLA Council and General Conference: Conference Proceedings (66th, Jerusalem, Israel, August 13-18, 2000); see IR 057 981. "Artists in Canada" Web site: http://www.chin.gc.ca. AVAILABLE FROM For full text: http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/067-165e.htm. PUB TYPE Reports Descriptive (141) Speeches/Meeting Papers (150) EDRS PRICE MF01/PC01 Plus Postage. DESCRIPTORS Access to Information; *Artists; Biographies; *Databases; Documentation; Foreign Countries; Information Networks; Museums; Special Libraries; *Union Catalogs; World Wide Web IDENTIFIERS Art Libraries; Art Museums; Canada; *Database Development ABSTRACT "Artists in Canada" is a bilingual union list of documentation files on Canadian artists held by the National Gallery of Canada Library and by 22 libraries and art galleries across the country. More than 42,700 artists are represented in "Artists in Canada," with biographical information, as well as locations for files. Originally compiled manually, "Artists in Canada" has been automated since the late 1970s and has been accessible internationally on the World Wide Web since 1995. "Artists in Canada" is also available in print format. A new edition, published in 1999, is a volume of nearly 750 pages. This paper provides an overview of "Artists in Canada." Topics covered include the Canadian context, documentation files, formats, partnership with CHIN (Canadian Heritage Information Network), entries, bibliographic standards, searching capabilities, and future directions. A chronology from the 1920s to 1999 is included. (Contains 13 references.) (Author/MES) Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. -

History of Art Libraries in Canada (2006, Rev. 2012)
History of Art Libraries in Canada Histoire des bibliothèques d’art au Canada www.arliscanada.ca/hal Sponsored by / Commandité par: ESSAYS IN THE HISTORY OF ART LIBRARIANSHIP IN CANADA National Gallery of Canada Library and Archives Musée des beaux-arts du Canada Bibliothèque et Archives ESSAIS SUR L’HISTOIRE DE LA BIBLIOTHÉCONOMIE D’ART AU CANADA ARLIS/NA ESSAYS IN THE HISTORY OF ART LIBRARIANSHIP IN CANADA ESSAIS SUR L’HISTOIRE DE LA BIBLIOTHÉCONOMIE D’ART AU CANADA Table of Contents Table des matières Introduction Reflections Through the Looking Glass: Murray Waddington The Story of the Fine Arts Library at the Uni- versity of British Columbia Introduction Diana Cooper, Peggy McBride Murray Waddington Traduit par Denise Loiselle A Library for Artists: The Early Years of The Banff Centre Library ARLIS/Canada: James Rout The First Ten Years Jonathan Franklin The Whyte Museum of the Canadian Rockies Bob Foley ARLIS/Canada : les dix premières années The Alberta College of Art + Design: Jonathan Franklin Luke Lindoe Library Traduit par Denise Loiselle Christine Sammon A History of the Canadian Art Libraries Section The Architecture/Fine Arts Library, Fort Garry (CARLIS) Campus, University of Manitoba Melva J. Dwyer Liv Valmestad Hidden Collections: Held in Trust: The Invisible World of English Canadian Book The National Gallery of Canada Library Illustration and Design and Archives Randall Speller Jo Nordley Beglo L’histoire du livre d’artiste au Québec Pour le compte des Canadiens : Sylvie Alix La Bibliothèque et les Archives du Musée des beaux-arts du Canada A History of the Artist's Book in Québec Jo Nordley Beglo Sylvie Alix Traduit par Denise Loiselle Translated by Mark Dobbie “So Hopefully and Imaginatively Founded”: The Vancouver Art Gallery and the Machinery The CCA Library to 1998 of Happiness Rosemary Haddad Cheryl Siegel Le Centre d’information Artexte : Who Was Who: un mandat, et un parcours, atypiques Biographies of Canadian Art Librarians Danielle Léger Steven C. -
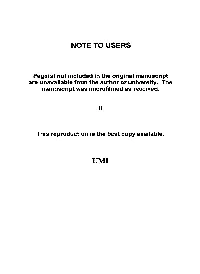
Note to Users
NOTE TO USERS Page(s) not included in the original manuscript are unavailable from the author or university. The manuscript was microfilmed as received. This reproduction is the best copy available. UMI The Shadow of a Nation: Remembering the Black Woman in the Nomadic Picture T. M. T. Provost in The Department of Art History Presented in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Arts at Concordia University Montreal, Quebec, Canada August 1998 @ T. M. T. Provost, 1998 National Library Bibliothèque nationale I*m of Canada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Services senrices bibliographiques 395 Wellington Street 395, me Wellington Ottawa ON K1A ON4 Ottawa ON K1A ON4 Canada Canada Your lire votre re1érence Our file Notre réldrence The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive licence allowing the exclusive permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, distribute or sell reproduire, prêter, distribuer ou copies of this thesis in microfom, vendre des copies de cette thèse sous paper or electronic formats. la forme de microfiche/nlm, de reproduction sur papier ou sur format électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantial extracts fiom it Ni la thèse ni des extraits substantiels may be printed or othenvise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced wiîhout the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. NOTE 10 USERS Page(s) not included in the original manuscript are unavailable from the author or university. -
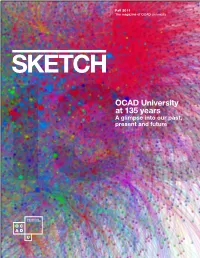
135Th Anniversary Edition (2011)
Fall 2011 The magazine of OCAD University SKETCH OCAD University at 135 years A glimpse into our past, 135present and future Fall 2011 The magazine of OCAD University A MOMENT AT OCAD UNIVERSITY Roly Murphy’s drawing class, circa 1935/36 Contents Past OCAD U’s Physical Evolution 4 Timeline: 1876 to 2011 8 Arthur Lismer on Art Education 10 Student Works: 1920s to 1990s 12 Establishing Design in Canada 14 Environmental Stewardship 16 International Presence 17 Present Our New Visual Identity 18 Teaching Art Today 22 The Idea of an Art & Design University 23 Digital Technology in the Classroom 24 What Students are Making Today 26 Engaging Accessibility Culture 28 96th Annual Graduate Exhibition 30 Future Who We Are: Students at OCAD U 32 A Triple Threat for Ontario 34 The Power of Design 36 Research that Makes a Difference 37 The Evolution of Curating in Canada 38 The Art of the App 40 Four Alumni to Watch Out For 44 OCAD University (ocad.ca) is Canada’s “University of the Imagination,” dedicated to art and design education, practice and research, and to SKETCH knowledge and invention across a wide range of disciplines. President and Vice-Chancellor Dr. Sara Diamond Produced by OCAD U Marketing & Communications Department Return undeliverable copies to: Chancellor Catherine (Kiki) Delaney Editor Cameron Ainsworth-Vincze OCAD University Chair, Board of Governors Robert Montgomery Copy Editor Jen Cutts 100 McCaul Street, Toronto, Ontario Canada M5T 1W1 Vice-President, Academic Dr. Sarah McKinnon Portraits of Deans by Professor Terry Shoffner Telephone 416.977.6000 Associate Vice-President, Research, and Dean, Design Hambly & Woolley Inc. -
Scanned Image
Multiple authorship and polyvalence in the Victorian- Canadian photocollage album: the work of Caroline Walker and Hannah Sarah Howard by Hilary Dow A thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Affairs in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Art History Carleton University Ottawa, Ontario © 2019, Hilary Dow Abstract This thesis examines three photocollage albums made by women in Belleville, Ontario between 1863 and 1875: C.W. Bell Album (1874), Scrap Album (1863) and H Sarah Howard Album (1874) by Caroline Walker and Sarah Howard. Through a close analysis of these albums, I challenge the notion of single authorship in the album and argue for a polyvalent reading, which is constituted by the various subjectivities and identities that contribute to the objects’ production. This analysis presents a new understanding of the Victorian album, not only through examining how women artists from nineteenth-century Ontario created albums as an extension of their artistic practice in the case of Caroline Walker, but also how they were used as a space of learning and artistic collaboration between women. Furthermore, this project illustrates the importance of studying Canadian albums within the larger context of women's art production during the period by emphasizing the collages, paintings and illustrated frames contained in them. i Acknowledgments I have many people and institutions to thank who made this research project possible. To begin, I am thankful for the support given by my co-supervisors, Dr. Carol Payne and Dr. James Opp. Under their supervision, I learned to challenge myself and analyze this material using critical scholarly methods from the fields of art history, history and photographic theory. -

Janet Bellotto CV Nov2018
Janet Bellotto, M.F.A. Professor Academic Background M.F.A. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada, Studio Arts - Sculpture, 2001 AOCA Ontario College of Art and Design, Toronto, Ontario, Canada, Sculpture/Installation, 1997 WORK EXPERIENCE Academic Experience Associate Dean, Professor of Visual Art (2017), Zayed University (September, 2014 - Present), College of Arts and Creative Enterprises, Zayed University, Dubai / Abu Dhabi, United Arab Emirates. Interim Dean / Acting Dean, Zayed University (April, 2014 - August, 2015), College of Arts and Creative Enterprises, Zayed University, Dubai/Abu Dhabi, United Arab Emirates. Assistant Dean, College of Arts and Creative Enterprises, Zayed University (August, 2012 - July, 2014), Dubai, United Arab Emirates. Artistic Director, International Symposium on Electronic Art, ISEA2014, Zayed University (September, 2012 - November, 2014), Dubai, United Arab Emirates. Co-Chair, Associate Professor of Visual Art, Zayed University (September 2010 - July, 2013), Dubai, UAE Assistant Chair, Associate Professor, Zayed University (February, 2010 - August, 2010), Dubai, UAE Assistant Professor, Zayed University (August, 2006 - August, 2010), Dubai, United Arab Emirates. Teaching in the field of Graphic Design and Visual Arts. Courses Taught 2006-2017: Art Education; Basic Graphic Design; Curatorial Practices; Installation; Photography I, II, III; Graphic Design I; Senior Project/Capstone; Senior Research Seminar; Sculpture I; Advanced Visual Art Studio; Video and Installation; Video as performance. Non-Academic Experience Curator / Project Manager, City of Toronto (September, 2005 - August, 2006), Toronto, Canada. Assistant Editor, Tandem News, Corriere Canadese (March, 2003 - December, 2005), Toronto, Canada. Managing Editor, Impulse Society for Creative Development (January, 2003 - July, 2005), Toronto, Canada. Finance Officer Assistant, Finance Office, OCAD University (summer 2007, Spring 2003), Toronto, Canada Website Designer, McGill University (November, 2001 - June, 2002), Montreal, Quebec.