Universite D'antananarivo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
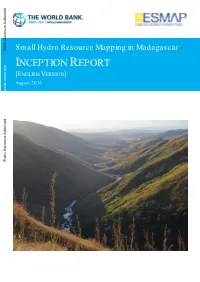
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

RAPPORT D'activité 2015-2016 Projet D'adaptation De La Gestion Des Zones Côtières Au Changement Climatique
17' 0( (/ 1( ¶( 1 & 2 2 5 / , 2 9 * 1 , ( ( ¶ / ( 7 ( ' ' ( ( 6 5 ) ( 2 7 6 5 , ( 1 , 7 6 0 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS SECRETARIAT GENERAL BUREAU NATIONAL DE COORDINATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015-2016 Projet d'Adaptation de la gestion des zones côtières au changement climatique PROJET D’AdaptatioN DE LA GESTION DES ZONES CÔTIÈRES AU CHANGEMENT CLIMatiQUE Etant un pays insulaire, Madagascar est Plusieurs actions ont été entreprises par le considéré comme l’un des pays les plus projet d’Adaptation de la gestion des Zones SOMMAIRE vulnérables à la variabilité et aux changements Côtières au changement climatique en tenant climatiques. Les dits changements se compte de l’Amélioration des écosystèmes CONTEXTE 5 manifestent surtout par le «chamboulement et des moyens de subsistance » au cours du régime des pluviométries, l’augmentation de l’année 2016 comme la réalisation des COMPOSANTE 1 : RENForcement DES capacITÉS de la température, la montée du niveau de études de vulnérabilité dans les quatre zones INSTITUTIONNELLES AUX Impacts DU CHANGEMENT la mer et l’intensification des évènements d’intervention, la création d’un mécanisme de CLImatIQUE DANS LES SITES DU proJET climatiques extrêmes tels que les cyclones, les coordination et la mise en place de la Gestion (MENABE, BOENY, VatovavY FItovINANY ET ATSINANANA) 7 inondations et les sècheresses. Devant cette Intégrée des zones côtières dans les régions situation alarmante, des actions d’adaptation Atsinanana, Boeny, et Vatovavy Fitovinany, ainsi COMPOSANTE 2 : RÉHABILItatION ET GESTION DES ZONES sont déja mises en oeuvre à Madagascar afin de que la mise en œuvre des scénarios climatiques CÔTIÈRES EN VUE d’uNE RÉSILIENCE À LONG TERME 17 renforcer la résilience de la population locale et à l’échelle réduite de ces quatre régions. -

1 COAG No. 72068718CA00001
COAG No. 72068718CA00001 1 TABLE OF CONTENT I- EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................................................. 6 II- INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 10 III- MAIN ACHIEVEMENTS DURING QUARTER 1 ........................................................................................................... 10 III.1. IR 1: Enhanced coordination among the public, nonprofit, and commercial sectors for reliable supply and distribution of quality health products ........................................................................................................................... 10 III.2. IR2: Strengthened capacity of the GOM to sustainably provide quality health products to the Malagasy people 15 III.3. IR 3: Expanded engagement of the commercial health sector to serve new health product markets, according to health needs and consumer demand ........................................................................................................ 36 III.4. IR 4: Improved sustainability of social marketing to deliver affordable, accessible health products to the Malagasy people ............................................................................................................................................................. 48 III.5. IR5: Increased demand for and use of health products among the Malagasy people -

The State of Lemur Conservation in South-Eastern Madagascar
Oryx Vol 39 No 2 April 2005 The state of lemur conservation in south-eastern Madagascar: population and habitat assessments for diurnal and cathemeral lemurs using surveys, satellite imagery and GIS Mitchell T. Irwin, Steig E. Johnson and Patricia C. Wright Abstract The unique primates of south-eastern information system, and censuses are used to establish Madagascar face threats from growing human popula- range boundaries and develop estimates of population tions. The country’s extant primates already represent density and size. These assessments are used to identify only a subset of the taxonomic and ecological diversity regions and taxa at risk, and will be a useful baseline existing a few thousand years ago. To prevent further for future monitoring of habitat and populations. Precise losses remaining taxa must be subjected to effective estimates are impossible for patchily-distributed taxa monitoring programmes that directly inform conserva- (especially Hapalemur aureus, H. simus and Varecia tion efforts. We offer a necessary first step: revision of variegata variegata); these taxa require more sophisticated geographic ranges and quantification of habitat area modelling. and population size for diurnal and cathemeral (active during both day and night) lemurs. Recent satellite Keywords Conservation status, geographic range, GIS, images are used to develop a forest cover geographical lemurs, Madagascar, population densities, primates. Introduction diseases (Burney, 1999). However, once this ecoregion was inhabited, its combination of abundant timber and The island nation of Madagascar has recently been nutrient-poor soil (causing a low agricultural tenure classified as both a megadiversity country and one of time) led to rapid deforestation. 25 biodiversity hotspots, a classification reserved for Green & Sussman (1990) used satellite images from regions combining high biodiversity with high levels 1973 and 1985 and vegetation maps from 1950 to recon- of habitat loss and extinction risk (Myers et al., 2000). -

La Tarification Des Services D'eau Potable
Atelier d’échanges La tarification des services d’eau potable Les 8 et 9 octobre 2015 à l’hôtel La Vanille Manakara A Madagascar, la durée de vie d’une infrastructure d’eau potable reste largement en deçà des prévisions de leurs promoteurs. La raison ? Entres autres, une mauvaise définition du tarif du service de l’eau : trop cher, il conduit à l’incapacité des usagers à payer ; pas assez élevé, il conduit à des recettes insuffisantes pour assurer un entretien correct des infrastructures. Dans le cadre des activités du réseau Ran’Eau, le CITE et le pS-Eau en collaboration avec le Ministère de l’Eau, vous invitent à participer à une réunion d’information et d’échanges des pratiques qui permettent de fixer des tarifs adaptés pour des services d’eau potable durables et accessibles à tous. Ran’Eau – atelier 8-9 octobre 2015 - Manakara I - Objectif pédagogique de l’atelier Les acteurs de développement du secteur EAH à Madagascar sont capables de fixer des tarifs adéquats pour les services d’eau potable à Madagascar. II - Séquences Séquence 1 : Objectif partiel N°1 : être en capacité de proposer un tarif qui soit conforme au cadre juridique et institutionnel malgache. Contenu : exposé des lois et règlements existants et des principales idées sous-jacentes. Messages clefs - un cadre légal existe définissant des points-clefs - il y a actuellement des freins à son application complète mais il y a des points essentiels à respecter. Exposé du représentant du Ministère de l’Eau de l’Assainissement et de l’Hygiène suivi d’échanges/débats Support : note synthétique du cadre juridique (par M. -

Le Developpement Economique De La Region Vatovavy Fitovinany
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Année Universitaire : 2006-2007 Faculté de Droit, d’Economie, de Second Cycle – Promotion Sortante Gestion et de Sociologie Option : DEVELOPPEMENT DEPARTEMENT ECONOMIE « Promotion ANDRAINA » Mémoire de fin de Cycle LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION VATOVAVY FITOVINANY Encadré par : Monsieur Gédéon RAJAONSON Présenté par : MANIRISOA RAZAFIMARINTSARA Firmin Date de soutenance : 14 Décembre 2007 REMERCIEMENTS Pour commencer, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ma formation et à la réalisation de ce Grand Mémoire de fin d’études en Economie. J’adresse donc tout particulièrement mes vifs remerciement à : • DIEU TOUT PUISSANT • Mon encadreur Monsieur Gédéon RAJAONSON ; • Tous les enseignants et les Personnels administratifs du Département Economie de la Faculté DEGS de l’Université d’Antananarivo ; • Monsieur Le Chef de Région de Vatovavy Fitovinany et ses équipes • Monsieur le Directeur Régional des Travaux Publics de Vatovavy Fitovinany • Ma famille pour leurs soutiens permanents. Veuillez accepter le témoignage de ma profonde gratitude. LISTE DES ABREVIATIONS ANGAP : Agence Nationale de la Gestion des Aires Protégés CEG : Collège d’Enseignement Général CHD 1 : Centre Hospitalier de District Niveau 1 CHD 2 : Centre Hospitalier de District Niveau 2 CISCO : Circonscription Scolaire CSB 1 : Centre de Santé de Base Niveau 1 CSB 2 : Centre de Santé de Base Niveau 2 DRDR : Direction Régionale du Développement Rural EPP : Ecole Primaire Public FCE : Fianarantsoa Côte Est FER : Fonds d’Entretien Routier FTM : Foibe Toantsritanin’i Madagasikara GU : Guichet Unique HIMO : Haute Intensité de Main d’œuvre INSTAT : Institut National de la Statistique M.A.E.P. -
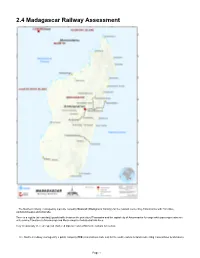
2.4 Madagascar Railway Assessment
2.4 Madagascar Railway Assessment - The Northern railway, managed by a private company Madarail (Madagascar Railway) for the network connecting Antananarivo with Tamatave, Ambatondrazaka and Antsirabe. There is a regular (at least daily) goods traffic between the port city of Toamasina and the capital city of Antananarivo for cargo while passenger trains are only serving Tamatave to Moramanga and Moramanga to Ambatrodrazaka lines. Very occasionally there are special chartered trips on restored Micheline railcars for tourists. - The Southern railway, managed by a public company FCE (Fianarantsoa Cote Est) for the south eastern network connecting Fianarantsoa to Manakara. Page 1 The southern line has regular passenger and cargo trains, which provides a slow but picturesque alternative to the recently rehabilitated road in the region. For more information on railway company contact details, please see the following link: Madagascar Railway Assessment Railway Companies and Consortia 4.2.7 Madagascar Railway Company Contact List Northern railway*: *During our study, Madarail was in the midst of restructuring, therefore, they did not want to share information, statistics or even contacts. All the information gathered and shared in this document comes exclusively from third parties or from data found on the internet. Madarail, was founded on October 10, 2002 following the decision of the Malagasy State to privatize the Malagasy National Railway Network1 (RNCFM). A concession agreement for the management of the North network is then established between the new private operator and the State. Madarail began operating the Northern railway network in Madagascar on 1 July 2003. In 2008, the Belgian operator Vecturis, already active in eight other African countries, became the majority shareholder of the company and the new railway operator. -

Taxonomic Revision of the Genus Manilkara ( Sapotaceae) in Madagascar
E D I N B U R G H J O U R N A L O F B O T A N Y 65 (3): 433–446 (2008) 433 Ó Trustees of the Royal Botanic Garden Edinburgh (2008) doi:10.1017/S096042860800485X TAXONOMIC REVISION OF THE GENUS MANILKARA ( SAPOTACEAE) IN MADAGASCAR V. PLANA1 &L.GAUTIER2 A revision of the five Madagascan species of the genus Manilkara (Sapotaceae)is presented, including a key, descriptions, diagnostic characters, ecological notes and a distribution map. Of the seven species originally described by Aubre´ville, Manilkara tampoloensis is placed in synonymy with M. boivinii, and M. sohihy is removed from the genus and placed within the existing Labramia boivinii (Pierre) Aubre´v. Keywords. Madagascar, Manilkara, Sapotaceae, taxonomic revision. Introduction The genus Manilkara Adans., probably best known for American species such as M. zapota (sapodilla) and M. chicle (chicle), is a pantropical genus comprising c.82 species (Govaerts et al., 2001). Of these, approximately one third are found in Africa (Plana, in prep.) and Madagascar. Although the Madagascan species of Manilkara share some characteristics with mainland African species, none are found in Africa. Afro-Madagascan species can be divided, according to their gross morphology, into three broad biogeographic regions: Madagascar, East and South Africa, and Central and West Africa. Malagasy species share characteristics with species in both regions, where they are commonly constituents of evergreen forest. Manilkara is one of six genera constituting the subtribe Manilkarinae H.J.Lam (tribe Mimusopeae Hartog) (Pennington, 1991) which also includes Labramia A.DC., Faucherea Lecomte, Northia Hook.f., Labourdonnaisia Bojer and Letestua Lecomte. -

MADAGASCAR : PROFIL URBAIN DE MANAKARA Programme Des Nations Unies Pour Les Établissements Humains
MADAGASCAR : PROFIL URBAIN DE MANAKARA PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS DÉNI DE RESPONSABILITÉ : Les termes employés et le matériel utilisé dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les points de vue du Secrétariat des Nations unis ou des diverses organisations qui lui sont liées. Les appellations employées et les informations présentées n’impliquent de la part de l’ONU-Habitat TABLE DES MATIÈRES et de son conseil d’administration, aucune prise de position quant au statut juridique des pays concernés, la délimitation de ses frontières, ou compromettant les autorités en place, le système économique établi ou encore le degré de développement. Les analyses, conclusions et recommandations de ce rapport ne reflètent pas non plus nécessairement le point de vue du Programme des Nations unis pour les établissements humains (ONU-Habitat), son conseil d’administration et de ses États membres. La présente publication peut être reproduite, entièrement ou en partie, sous n’importe quel format ou support, à des fins éducatives mais non lucratives, sans l’autorisation préalable du détenteur des droits d’auteur, à la condition qu’il soit fait mention de la source. ONU-Habitat souhaiterait qu’un exemplaire de l’ouvrage où se trouve reproduit l’extrait lui soit communiqué. La présente publication ne peut être ni revendue ni utilisée à d’autres fins commerciales sans l’autorisation préalable du Programme des Nations unis pour les établissement humains. La réalisation de ce rapport a été supervisée par Kerstin Sommer, Joseph Guiébo, Nicolas Maréchal, Matthieu Sublet et Florence Kuria. Publié par le Programme des Nations unies pour les établissement humains. -

Renforcement Durable Des Capacités Productives Et Organisationnelles
Evaluation finale du projet « Renforcement durable des capacités productives et organisationnelles des familles paysannes du Sud-Est en capitalisant l’expérience Fagnimbogna » Projet UE FSTP 2012 Inter Aide Madagascar Rapport provisoire de mission www.tero.coop Sommaire Sommaire .......................................................................................................................................................... 2 Liste des abréviations ...................................................................................................................................... 4 Lexique des termes malgaches utilisés ......................................................................................................... 5 Résumé exécutif de la mission ....................................................................................................................... 7 Appréciation générale de la pertinence, de l’efficacité, efficience et durabilité des propositions techniques 7 Appréciation du degré de réalisation quantitatif et qualitatif des résultats obtenus en relation avec les objectifs définis : .............................................................................................................................................. 8 Recommandations concrètes et opérationnelles pour la mise en œuvre de la nouvelle phase d’intervention ...................................................................................................................................................................... 11 1. Contexte -

Pentecostã©S En Manampatrana: Despuã©S Del Ciclã³n Gretelle
Vincentiana Volume 43 Number 2 Vol. 43, No. 2 Article 35 3-1999 Pentecostés en Manampatrana: Después del Ciclón Gretelle (Madagascar) Luigi Elli C.M. Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana Part of the Catholic Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, History of Christianity Commons, Liturgy and Worship Commons, and the Religious Thought, Theology and Philosophy of Religion Commons Recommended Citation Elli, Luigi C.M. (1999) "Pentecostés en Manampatrana: Después del Ciclón Gretelle (Madagascar)," Vincentiana: Vol. 43 : No. 2 , Article 35. Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol43/iss2/35 This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana by an authorized editor of Via Sapientiae. For more information, please contact [email protected]. PENTECOSTÉS EN MANAMPATRANA Después del ciclón Gretelle (Madagascar) Se recordará el terrible ciclón que se abatió el 24 de enero de 1997 sobre la región de Farafangana, al sudeste de Madagascar (cf. Nuntia, enero 1997, n° 4), donde nuestros cohermanos tienen una misión importante. El ciclón sembró la destrucción y el hambre. El siguiente artículo, publicado en “Missione Vincenziana” (julio-agosto 1998, p. 5), muestra que algo magnífico e inesperado ha surgido de aquello. De un mal, Dios sabe sacar un bien. Luigi Elli, C.M. Visitador de Madagascar Escribo desde Farafangana, la pequeña ciudad de la costa este que a finales del mes de enero de 1997 fue prácticamente destruida por el ciclón Gretelle. Lentamente, la vida ha recobrado sus derechos. -

Article Lucien
RAMIANDRISOA Lucien – Article 2016 Les chefs coutumiers ont-ils un rôle dans la gestion foncière ? L’exemple des sociétés Antemoro et Antañala, District de Manakara, Région de Vatovavy-Fitovinany, MADAGASCAR Par Lucien RAMIANDRISOA Doctorant en Géographie, Laboratoire Espaces et Sociétés École Doctorale Sciences Humaines et Sociales E-mail : [email protected] Université d’Antananarivo, MADAGASCAR Et En co-diretion de thèse avec le Laboratoire PACTE – Territoires, UMR 5194 CNRS – IEPG – UJF – UPMF Université Grenoble Alpes, FRANCE Résumé Abstract Les deux formalisations de droit de propriété à The two formulations of Malagasy property right Madagascar consistent dans l’immatriculation consist of land registration and land certification foncière et la certification foncière (selon la (according to the land reform of 2005). These two réforme foncière de 2005). Ces deux pratiques official and formal practices were put in place by officielles et formelles ont été instaurées par the Malagasy government since its independence l’État malgache depuis l’indépendance de 1960. 1960. Land management as a basis of “territorial La gestion foncière en tant que base de development” involves different decision makers “développement territorial” implique and will give a major opportunity for all l’intervention de diverses instances de décisions Malagasy farmers in formulation of property et va donner une grande opportunité pour tous les right. In Sub-Saharan African countries and even paysans malgaches dans le cadre de la in Madagascar, traditional leaders involve in the formalisation du droit de propriété. Dans les pays land management in which their decision-making de l’Afrique subsaharienne et même dans tout powers are limited by government.