Livre Protectionnisme Juin 2018 Version Finale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE presentado por Jesús Huerta de Soto Catedrático de Economía Política Madrid, Marzo de 2018 ÍNDICE (Index) Página 1. Datos Personales (Personal Data) ...........................................................................3 2. Títulos Académicos (Academic Degrees) .................................................................5 3. Actividad Docente (Teaching Activities)...................................................................8 4. Actividad Investigadora (Research Activities): Publicaciones (I) (Publications) A. Libros (Books) ................................................................................................11 B. Obras Conjuntas (Coauthored Books) ...............................................................26 C. Capítulos en Obras Colectivas (Chapters of Books) .........................................27 D. Monografías (Monographs) .............................................................................37 E. Lecturas de Economía Política (Readings in Political Economy).........................37 5. Actividad Investigadora (Research Activities): Publicaciones (II) (Other Publications) A. Artículos en Revistas Científicas (Articles in Scientific Journals) .......................40 B. Artículos en otras Revistas de Pensamiento (Articles in other Journals) ...........54 6. Otras Publicaciones A. Prólogos a libros (Prefaces and Introductions)....................................................63 B. Artículos en la prensa (Articles in Newspapers).................................................71 -
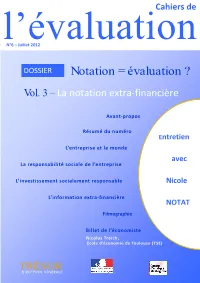
Notation = Évaluation ?
Cahiers de N°6 – Juillet 2012 DOSSIER Notation = évaluation ? Vol. 3 – La notation extra‐financière Avant‐propos Résumé du numéro Entretien L’entreprise et le monde avec La responsabilité sociale de l’entreprise L’investissement socialement responsable Nicole L’information extra‐financière NOTAT Filmographie Billet de l’économiste Nicolas Treich, Ecole d’économie de Toulouse (TSE) Quelques clefs de lecture… Règles du jeu Dossiers Revue électronique annuelle d’une centaine de pages ■ De nombreuses histoires d’évaluation à raconter, des histoires réussies et d’autres publiant des articles et des interviews. moins. Ce sont ces histoires que Les Cahiers se proposent de rapporter dans des dossiers thématiques afin de favoriser une compréhension intuitive des Les articles proposés sont soumis à l’appréciation problématiques d’évaluation. d’un Comité d’orientation dont les avis concourent ■ L’accent est mis sur les aspects concrets de l’évaluation, en privilégiant, dans la au choix des textes et, éventuellement, à leur mesure du possible, des exemples d’évaluation appliquée et en proposant dans amélioration, tant en ce qui concerne leur qualité chaque numéro l’interview d’une personnalité (décideur, expert, acteur de la société scientifique que la clarté de leur exposé. civile) à l’expérience reconnue. ■ Chaque dossier constitue une entité autonome, une « brique » d’information Les opinions et les jugements exprimés pouvant être lue indépendamment. Suivant leur importance, les dossiers seront par les auteurs n’engagent qu’eux‐mêmes traités en un ou plusieurs numéros. et non les institutions auxquelles ces auteurs ■ Chaque dossier s’articule autour d’articles choisis pour leur capacité à éclairer la appartiennent. -

Journal Officiel De La République Française
o Quarante-troisième année. – N 99 B ISSN 0298-2978 Lundi 25 et mardi 26 mai 2009 BODACCBULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Standard......................................... 01-40-58-75-00 DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS Annonces....................................... 01-40-58-77-56 Renseignements documentaires 01-40-58-79-79 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 Abonnements................................. 01-40-58-79-20 www.journal-officiel.gouv.fr (8h30à 12h30) Télécopie........................................ 01-40-58-77-57 BODACC “B” Modifications diverses - Radiations Avis aux lecteurs Les autres catégories d’insertions sont publiées dans deux autres éditions séparées selon la répartition suivante Ventes et cessions .......................................... Créations d’établissements ............................ @ Procédures collectives .................................... ! BODACC “A” Procédures de rétablissement personnel .... Avis relatifs aux successions ......................... * Avis de dépôt des comptes des sociétés .... BODACC “C” Avis aux annonceurs Toute insertion incomplète, non conforme aux textes en vigueur ou bien illisible sera rejetée Banque de données BODACC servie par les sociétés : Altares-D&B, EDD, Experian, Optima on Line, Groupe Sévigné-Payelle, Questel, Tessi Informatique, Jurismedia, Pouey International, Scores et Décisions, Les Echos, Creditsafe, Coface services et Cartegie. Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 17 mai 1984 relatif à la constitution et à la commercialisation d’une banque de données télématique des informations contenues dans le BODACC, le droit d’accès prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la Direction des Journaux officiels. Le numéro : 2,50 € Abonnement. − Un an (arrêté du 21 novembre 2008 publié au Journal officiel du 27 novembre 2008) : France : 367,70 €. -

Le Contrôle Des Investissements Étrangers En France Et Les Offres Publiques D’Acquisitions
Master II de Droit des affaires Dirigé par le Monsieur Professeur Hervé Synvet MEMOIRE DE RECHERCHE Le contrôle des investissements étrangers en France et les offres publiques d’acquisitions Sous la direction de Monsieur le Professeur Hervé Synvet Mlle Saleh Gillan 2014-2015 L’université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires, ces opinions doivent être considérées comme propre à leurs auteurs. Remerciements Je tiens à remercier Monsieur le Professeur Hervé Synvet pour sa confiance dans le cadre de ce Master 2 ainsi que ses précieux conseils dans la rédaction de ce mémoire. Je tiens également à remercier Madame Linda Hesse et Monsieur Alban Caillemer du Ferrage pour leur soutien et leurs encouragements lors de mon stage au sein du cabinet Jones Day. Je remercie plus particulièrement Monsieur Robert Mayo pour son aide dans l’élaboration du sujet et ses conseils. Je remercie plus généralement le corps enseignant de l’Université Panthéon-Assas, dont les exigences durant ces cinq années d’études ont contribué à l’amélioration de ma qualité de réflexion. Sommaire Introduction……………………………………….………………………………………… p. 2 Titre I : Le contrôle direct : la réglementation des relations financières avec l’étranger ………………………………….……………………………………………….. p. 10 Chapitre 1 : Les offres publiques d’acquisitions circonscrites par la réglementation des relations financières avec l’étranger ………………………………………………………………… p. 10 Section 1 : L’impérieuse application d’une réglementation encadrant la prise de contrôle par des investisseurs étrangers ……………………………………………………………..…. p. 11 §1 : L’offre publique : moyen privilégié d’acquisition du contrôle d’une société ……. p. 11 A. L’acquisition du contrôle à travers l’offre publique…………………………………. -

Libertés Conditionnelles
LIBERTÉS CONDITIONNELLES CYCLE DE CONFÉRENCES DÈS JANVIER 2021 LE JEUDI DE 12 H 30 À 14 H 00 LIBERTÉS CONDITIONNELLES Le titre du présent cycle de conférences évoque la libération conditionnelle, une mesure permettant à une personne condamnée de sortir plus tôt que prévu de prison afin de favoriser sa réinsertion sociale. Le parallèle carcéral a souvent été dressé pour caractériser les effets exceptionnels produits par la crise pandémique que nous traversons à l’échelle planétaire, notamment dans la séquence confinement-déconfinement. Après avoir subi, de gré ou de force, une sorte de « grand renfermement », nous émergeons hébétés et dans l’incertitude la plus complète quant aux libertés que nous aurions abandonnées. À tout le moins, l’épreuve révèle que nos libertés individuelles et collectives sont fragiles : même les plus fondamentales ont été suspendues avec l’avènement du virus. Dès lors, comment les repenser à l’aune de cette nouvelle situation ? Comment prendre conscience de leur relativité, de leurs conditionnements et des combats nécessaires à leur ( re ) conquête ? Dans L’homme révolté ( 1951 ), Albert Camus indique : « La liberté absolue raille la justice. La justice absolue nie la liberté. Pour être fécondes, les deux notions doivent trouver, l’une dans l’autre, leur limite. » L’ambition est d’interroger, dans le sillage de l’ébranlement vécu, les libertés humaines telles qu’elles se définissent, s’expriment, se négocient et se recomposent. À défaut de nous illusionner sur un possible retour au monde d’avant, explorons les -

Procesos De Mercado
PROCESOS DE MERCADO REVISTA EUROPEA DE ECONOMÍA POLÍTICA Procesos de Mercado Yeso y pigmentos sobre tela y madera Julio Toquero, 2005 “Subyace en este cuadro una reflexión relativa al cambio, a la energía —acción vigorosa— y a la consciencia: realidades fundamentales en los procesos de mercado y en el arte”. PROCESOS DE MERCADO REVISTA EUROPEA DE ECONOMÍA POLÍTICA VOLUMEN IV, NÚMERO 2, OTOÑO 2007 REVISTA SEMESTRAL PUBLICADA POR UNIÓN EDITORIAL, CON LA COLABORACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS HIMNO Dio, che nell’alma infondere Dios, que has querido poner amor volesti e speme, en nuestra alma el amor y la esperanza, desio nel core accendere debes alumbrar en nuestro corazón tu dei di libertà. el deseo de libertad. Giuramo insiem di vivere Juramos juntos vivir e di morire insieme. y morir juntos. In terra, in ciel En la tierra, en el cielo ... congiungere ci può, ... reunirnos podrá, ci può la tua bontà. podrá tu bondad. Ah! Dio, che nell’alma infondere ¡Ah!, Dios, que has querido poner amor volesti e speme, en nuestra alma el amor y la esperanza, desio nel core accendere debes alumbrar en nuestro corazón tu dei di libertà. el deseo de libertad Don Carlo (1884), GIUSEPPE VERDI (Dúo de Don Carlo y Don Rodrigo, final de la Escena Primera, Acto Segundo) © 2004, Jesús Huerta de Soto Unión Editorial, S.A. © 2004, Unión Editorial, S.A. Martín Machío, 15 ISSN: 1697-6797 28002 Madrid Depósito legal: M-17.229-2004 Tel: 91 350 02 28 • Fax: 91 181 22 12 Correo: [email protected] Administración Procesos de Mercado: www.unioneditorial.es c/o Jesús Huerta de Soto Universidad Rey Juan Carlos Diseño y Maquetación: JPM GRAPHIC, S.L. -

Les Echos – 11 Mai 2020
LUNDI 11 MAI 2020 Enquête Les chiffres fous de deux mois Sciences La course au vaccin contre de vie en apesanteur // PP. 12- 13 le Covid-19, une compétition mondiale // P. 11 Une nouvelle ère k iStoc et ers ut s/Re uente F lo Gonza Le déconfinement, La crainte d’une Entreprises : Comment les Une réouverture Dette européenne : un exercice seconde vague les défis d’un transports publics des établissements bras de fer inédit à haut risque épidémique retour au travail s’adaptent à la scolaires à pas entre l’Allemagne pour l’exécutif n’est pas écartée progressif distanciation sociale comptés et la Commission POLITIQUE Les restrictions impo- SANTÉ La crainte d’une seconde ACTIVITÉ Pour salariés et direc- TRANSPORTS Les opérateurs ÉDUCATION Seul un tiers des pro- DROIT Bruxelles menace l’Allema- sées depuis huit semaines sont par- vague épidémique n’est pas à écar- tions, de nouveaux défis s’annon- déploient un dispositif inédit. Leur fesseurs du premier degré fera sa gne de poursuites en justice, à la tiellement levées. Entre relance de ter. Mais les médecins estiment que cent. A la litanie des problèmes con- message est à la fois de rassurer les rentrée ce lundi et seuls 22 % des suite des attaques de la Cour consti- l’économie et protection, la ligne de son ampleur pourrait être maîtri- crets immédiats, s’ajoute la passagers pour éviter qu’ils ne se élèves retrouveront leur classe le tutionnelle de Karlsruhe contre la crête est périlleuse pour l’exécutif. sée. Le taux d’infection remonte en nécessité de se préparer à l’inconnu ruent sur leur voiture et faire en lendemain. -

SRP GROUPE Public Joint Stock Company
SRP GROUPE Public joint stock company (société anonyme) with capital of 2,026,085.60 euros Registered office: 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex France Trade and Companies Register No. 524 055 613 Bobigny 2018 REGISTRATION DOCUMENT (including the Annual Financial Report) This Registration Document was filed with the French Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) on April 19, 2019, pursuant to Article 212-13 of its General Regulation. This document may not be used in the context of any securities offering unless supplemented by a Prospectus approved by the AMF. The Registration Document has been prepared by the issuer and its signatories are responsible for its contents. Copies of this Registration Document may be obtained free of charge at SRP Groupe’s registered office at 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France, as well as on the websites of SRP Groupe, (www.showroomprivegroup.com) and of the AMF (www.amf-france.org). GENERAL NOTES Unless otherwise specified, in this Registration Document: the terms the “Company” and “SRP Groupe” mean SRP Groupe S.A. ; the term “Group” means SRP Groupe S.A. and its consolidated subsidiaries, collectively; the term “Founders” refers to Ancelle Sàrl (controlled by David Dayan), Victoire Investissement Holding Sàrl (controlled by Eric Dayan), Cambon Financière Sàrl (controlled by Michaël Dayan), and TP Invest Holding Sàrl (controlled by Thierry Petit) and David Dayan, Eric Dayan, Michael Dayan and Thierry Petit; the term “2016 Registration Document” refers to the registration document filed with the AMF on April 27, 2017 under number R.17-028; the term “2017 Registration Document” refers to the registration document filed with the AMF on April 26, 2018 under number R.18-029. -

Financial Markets and Economic Growth Eduard Braun
Financial Markets and Economic Growth Eduard Braun To cite this version: Eduard Braun. Financial Markets and Economic Growth. Economics and Finance. Université d’Angers, 2011. English. tel-00968723 HAL Id: tel-00968723 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00968723 Submitted on 1 Apr 2014 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Université d’Angers Année 2011 N° d’ordre 1182 Financial Markets and Economic Growth Thèse de doctorat en sciences économique Ecole doctorale DEGEST Présentée et soutenue publiquement le 27 Septembre 2011 à Angers par Eduard BRAUN Devant le jury ci-dessous : Renaud Fillieule, Rapporteur Université de Lille 1 Antoine Gentier, Rapporteur Université Paul Cézanne Aix- Marseille 3 Jörg Guido Hülsmann, Directeur de thèse Université d’Angers Thorsten Polleit, Rapporteur Frankfurt School of Finance and Management Bruno Séjourné, Examinateur Université d’Angers Directeur de thèse : Jörg Guido HÜLSMANN Groupe de Recherche Angevine en Economie et Management (GRANEM) N° ED 20077353 ii CONTENTS LIST OF ABREVIATIONS................................................................................................................................. -
Ipsos Flair ANG.Docx
Ipsos Flair Collection France 2011, A society of “extra-lucids” NOBODY’S UNPREDICTABLE* France 2011, A society of “extra-lucids” Ipsos editions December 2010 ©2010 - Ipsos 2| [Lead-in] Ipsos Flair: understanding to anticipate Launched in 2005, Ipsos Flair grew from a desire to combine the six types of expertise Ipsos offers (Marketing, Advertising, Media, Opinion, Customer Relations Management, Data Collection, Data Processing and Distribution), with a view to presenting a vision of society founded on an observation and interpretation of the behaviors, attitudes and opinions of consumer-citizens. The stance Ipsos Flair takes in relation to French society and the changes taking place is one — cherished by psychologists and by Freud in particular — of “benevolent neutrality.” Ipsos sees research findings as symptoms, whose analysis helps define a mapping of structuring and emerging trends. From this point of view, 2010 deserved its title of “no limits year” and its slogan “passion destroyed becomes passion to destroy”… Most of the standards that govern normal relations between individuals, institutions, authorities, etc. were smashed with incredible casualness and ease: the French soccer team refuse to train during the World Cup, looting and setting fire to cars accompany victory, likewise for the defeat of the Algerian team, urban riots break out in Grenoble or Saint-Aignan as reprisals for police actions, the “mass aperitifs” made popular by Facebook reinvent the codes of social drinking, and so on and so forth. After the vocabulary of denial and euphemism, the vocabulary of dysfunction and restructuring are no longer enough. So new words must be invented, words associated with a different perception of law and order. -
Bastiat and the French Connection
The Liberal Roots of American Conservatism: Bastiat and the French Connection A paper given to the Philadelphia Society meeting March 27–29, 2015 on “The Roots of American Conservatism - and its Future”. Place: Sheraton Society Hill, Philadelphia, Pennsylvania; Date: Saturday, March 28; 10:00–11:30 session on “The Liberal Roots of Conservatism”. Participants: Chairman, Phillip W. Magness (IHS); James Otteson (Wake Forest University) Steven D. Ealy (LF), and David M. Hart (LF). An online version of this paper is available: HTML <davidmhart.com/liberty/Papers/Bastiat/DMH_LiberalRoots.html> PDF <davidmhart.com/liberty/Papers/Bastiat/DMH_LiberalRoots.pdf> Draft: Jan. 22, 2015 Revised: March 25, 2015 Word Length: 12,065 w Author: Dr. David M. Hart. Director of the Online Library of Liberty Project at Liberty Fund <oll.libertyfund.org> Academic Editor of the Collected Works of Frédéric Bastiat. Email: Work: [email protected] Private: [email protected] Websites: Liberty Fund: <oll.libertyfund.org> Personal: <davidmhart.com/liberty> 1 Bio David Hart was born and raised in Sydney, Australia. He did his undergraduate work in modern European history and wrote an honours thesis on the radical Belgian/French free market economist Gustave de Molinari, whose book Evenings on Saint Lazarus Street (1849) he is currently editing for Liberty Fund. This was followed by a year studying at the University of Mainz studying German Imperialism, the origins of the First World War, and German classical liberal thought. Postgraduate degrees were completed in Modern European history at Stanford University (M.A.) where he also worked for the Institute for Humane Studies (when it was located at Menlo Park, California) and was founding editor of the Humane Studies Review: A Research and Study Guide; and a Ph.D. -

Les Agences De Notation: L'appréhension Juridique D'un
2 LES AGENCES DE NOTATION: L’APPRÉHENSION JURIDIQUE D’UN POUVOIR PRIVÉ ECONOMIQUE 3 4 REMERCIEMENTS La Thèse est une véritable quête au travers de laquelle les composantes de la trichromie « spiritus, anima, corpus », chère à Saint Augustin, se trouvent intensément sollicitées. Cette quête qui est, en substance, une véritable formation de l’esprit en soi, n’aurait pu aboutir sans le soutien indéfectible d’un certain nombre de personnes auquel ces remerciements sont dédiés. A ce titre, je tiens à témoigner de ma profonde gratitude à mon Directeur de thèse, le Professeur Marina TELLER, qui, depuis ma première année de droit, m’honore par ses enseignements et sa confiance. Cette thèse est le fruit direct de cette attention portée par ce Professeur remarquable qui par son mentorat universitaire a su m’insuffler le désir d’entreprendre ces travaux, et ce, dans la continuité de l’école niçoise du droit économique. Je remercie Monsieur Bertrand BREHIER, Monsieur Thierry GRANIER, Madame Anne- Catherine MULLER, Madame Irina PARACHKEVOVA, pour l’honneur qu’ils me font d’avoir accepté de siéger dans mon jury. Je tiens également à exprimer ma sincère reconnaissance à Eric DUPUY, l’ami et le mentor professionnel, qui m’a toujours encouragé dans cette aventure et dont la relecture de mes travaux a été particulièrement précieuse. Je souhaite adresser, tout particulièrement, mes remerciements à Ines HANSSON, ma fiancée, qui a, notamment, partagé avec moi les différentes phases émotionnelles que peut revêtir une étude doctorale. Elle a été le roc qui par son appui sans pareil m’a permis de me concentrer, en dehors de mon activité professionnelle, sur mes travaux universitaires jusqu'à leur aboutissement.