Projets P1 Et P2 Dossier De Saisine Du Cnpn
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Leaf Anatomical Study of Gypsophila (Caryophyllaceae) and Allied Genera in Iran and Its Taxonomical Implication
IRANIAN JOURNAL OF BOTANY 24 (2), 2018 DOI: 10.22092/ijb.2018.122088.1203 LEAF ANATOMICAL STUDY OF GYPSOPHILA (CARYOPHYLLACEAE) AND ALLIED GENERA IN IRAN AND ITS TAXONOMICAL IMPLICATION E. Amini, Sh. Zarre & M. Assadi Received 2018. 05. 30; accepted for publication 2018. 10. 17 Amini, E., Zarre, Sh. & Assadi, M. 2018. 12. 30: Leaf anatomical study of Gypsophila (Caryophyllaceae) and allied genera in Iran and its taxonomical implication. -Iran. J. Bot. 24 (2): 138-155. Tehran. Aanatomical features as revealed from cross-sections of leaf blades and midribs in 21 taxa of Gypsophila representing its currently recognized seven sections distributed in Iran as well as four species of Saponaria, two species of Allochrusa and one species of Ankyropetalum as its closely related genera are examined. In total nine quantitative and five qualitative characters were selected and measured. The most important characters include general shape of leaves (assessed only for narrow leaves) in transverse section, type of mesophyll (dorsi-ventral vs. isobilateral), thickness of sclerenchyma surrounding the vascular bundles, shape of central vascular bundle, number of parenchyma layers in midrib, thickness (number of layers) and structure of mesophyll, density and distribution of druses. In general, leaf anatomy does not provide any unique feature supporting the separation of genera Ankyropetalum and Allochrusa from Gypsophila. The number of spongy layers provides support at least for separation of Gypsophila (more than two layers) from most species of Saponaria (only one layer). Our results show that leaf anatomical features provide reliable evidence for subgeneric classification of Gypsophila and could be taxonomically valuable. Elham Amini (correspondence< [email protected] >), Shahin Zarre, Centre of Excellence in Phylogeny, and Department of Plant Science, School of Biology, College of Science, University of Tehran, P. -

Untangling Phylogenetic Patterns and Taxonomic Confusion in Tribe Caryophylleae (Caryophyllaceae) with Special Focus on Generic
TAXON 67 (1) • February 2018: 83–112 Madhani & al. • Phylogeny and taxonomy of Caryophylleae (Caryophyllaceae) Untangling phylogenetic patterns and taxonomic confusion in tribe Caryophylleae (Caryophyllaceae) with special focus on generic boundaries Hossein Madhani,1 Richard Rabeler,2 Atefeh Pirani,3 Bengt Oxelman,4 Guenther Heubl5 & Shahin Zarre1 1 Department of Plant Science, Center of Excellence in Phylogeny of Living Organisms, School of Biology, College of Science, University of Tehran, P.O. Box 14155-6455, Tehran, Iran 2 University of Michigan Herbarium-EEB, 3600 Varsity Drive, Ann Arbor, Michigan 48108-2228, U.S.A. 3 Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, P.O. Box 91775-1436, Mashhad, Iran 4 Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, Box 461, 40530 Göteborg, Sweden 5 Biodiversity Research – Systematic Botany, Department of Biology I, Ludwig-Maximilians-Universität München, Menzinger Str. 67, 80638 München, Germany; and GeoBio Center LMU Author for correspondence: Shahin Zarre, [email protected] DOI https://doi.org/10.12705/671.6 Abstract Assigning correct names to taxa is a challenging goal in the taxonomy of many groups within the Caryophyllaceae. This challenge is most serious in tribe Caryophylleae since the supposed genera seem to be highly artificial, and the available morphological evidence cannot effectively be used for delimitation and exact determination of taxa. The main goal of the present study was to re-assess the monophyly of the genera currently recognized in this tribe using molecular phylogenetic data. We used the sequences of nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) and the chloroplast gene rps16 for 135 and 94 accessions, respectively, representing all 16 genera currently recognized in the tribe Caryophylleae, with a rich sampling of Gypsophila as one of the most heterogeneous groups in the tribe. -

Native Or Suitable Plants City of Mccall
Native or Suitable Plants City of McCall The following list of plants is presented to assist the developer, business owner, or homeowner in selecting plants for landscaping. The list is by no means complete, but is a recommended selection of plants which are either native or have been successfully introduced to our area. Successful landscaping, however, requires much more than just the selection of plants. Unless you have some experience, it is suggested than you employ the services of a trained or otherwise experienced landscaper, arborist, or forester. For best results it is recommended that careful consideration be made in purchasing the plants from the local nurseries (i.e. Cascade, McCall, and New Meadows). Plants brought in from the Treasure Valley may not survive our local weather conditions, microsites, and higher elevations. Timing can also be a serious consideration as the plants may have already broken dormancy and can be damaged by our late frosts. Appendix B SELECTED IDAHO NATIVE PLANTS SUITABLE FOR VALLEY COUNTY GROWING CONDITIONS Trees & Shrubs Acer circinatum (Vine Maple). Shrub or small tree 15-20' tall, Pacific Northwest native. Bright scarlet-orange fall foliage. Excellent ornamental. Alnus incana (Mountain Alder). A large shrub, useful for mid to high elevation riparian plantings. Good plant for stream bank shelter and stabilization. Nitrogen fixing root system. Alnus sinuata (Sitka Alder). A shrub, 6-1 5' tall. Grows well on moist slopes or stream banks. Excellent shrub for erosion control and riparian restoration. Nitrogen fixing root system. Amelanchier alnifolia (Serviceberry). One of the earlier shrubs to blossom out in the spring. -

A Guide to Frequent and Typical Plant Communities of the European Alps
- Alpine Ecology and Environments A guide to frequent and typical plant communities of the European Alps Guide to the virtual excursion in lesson B1 (Alpine plant biodiversity) Peter M. Kammer and Adrian Möhl (illustrations) – Alpine Ecology and Environments B1 – Alpine plant biodiversity Preface This guide provides an overview over the most frequent, widely distributed, and characteristic plant communities of the European Alps; each of them occurring under different growth conditions. It serves as the basic document for the virtual excursion offered in lesson B1 (Alpine plant biodiversity) of the ALPECOLe course. Naturally, the guide can also be helpful for a real excursion in the field! By following the road map, that begins on page 3, you can determine the plant community you are looking at. Communities you have to know for the final test are indicated with bold frames in the road maps. On the portrait sheets you will find a short description of each plant community. Here, the names of communities you should know are underlined. The portrait sheets are structured as follows: • After the English name of the community the corresponding phytosociological units are in- dicated, i.e. the association (Ass.) and/or the alliance (All.). The names of the units follow El- lenberg (1996) and Grabherr & Mucina (1993). • The paragraph “site characteristics” provides information on the altitudinal occurrence of the community, its topographical situation, the types of substrata, specific climate conditions, the duration of snow-cover, as well as on the nature of the soil. Where appropriate, specifications on the agricultural management form are given. • In the section “stand characteristics” the horizontal and vertical structure of the community is described. -

Caryophyllaceae) from Turkey
Phytotaxa 394 (1): 071–078 ISSN 1179-3155 (print edition) https://www.mapress.com/j/pt/ PHYTOTAXA Copyright © 2019 Magnolia Press Article ISSN 1179-3163 (online edition) https://doi.org/10.11646/phytotaxa.394.1.4 Morphological, anatomical, palynological and ecological data on the local endemic Dianthus vanensis (Caryophyllaceae) from Turkey MEHMET CENGIZ KARAİSMAİLOĞLU1*, MEHMET EMRE EREZ1, SÜLEYMAN MESUT PINAR2, MEHMET FİDAN1 & HÜSEYIN EROĞLU3 1 Siirt University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, 56100, Kezer-Siirt, Turkey; e-mail: [email protected] 2 Yüzüncü Yıl University, Van School of Health, 65090, Tuþba-Van, Turkey. 3 Yüzüncü Yıl University, Faculty of Sciences, Department of Biology, 65090, Tuşba-Van, Turkey. *author of correspondence Abstract A first detailed taxonomical, palynological, and ecological study of the Turkish endemic Dianthus vanensis is shown based on field data collected at locus classicus. A revised morphological description, including data of seed and pollen by using Scanning Electron Microscope, is provided. Seed surface displays elongated cells, which are lobate with 14−28 teeth, I, S shaped or irregular, and papillate. Pollen grains are radially symmetric, apolar, pantoporate and spheroidal shape (size: 40.38 ± 0.64 × 37.98 ± 0.36 μm), with scabrate ornamentation, and 9–12 pores elliptical (different margin), and operculate (size: 6.17 ± 0.23 × 4.17 ± 0.39 μm). The anatomy of root, stem and leaf are also investigated. On the outer surface of the root is placed a multi-layered periderm. The cortex consists of multi-layered parenchymatic cells under periderm, and its thick- ness is 176.49 ± 7.85 μm. -

Japansese Beetle Potential Host Range
Japanese Beetle Potential Host Range in California D. G. Kelch, Ph.D. Primary Botanist, California Department of Food and Agriculture Japanese Beetle (Popillia japonica Newman) is a species introduced into North America that has spread widely throughout the eastern United States. In this area, infestations have proven extremely damaging to horticultural and agricultural plants. Yearly costs for management and mitigation of damage are estimated at US$500 million (USDA 2007). In addition, areas infested with Japanese beetle can be quarantined by trading partners, resulting in losses to farmers and nursery growers mounting into the millions of dollars per year (National Plant Board 2007; Smith et al. 1996). Japanese Beetle is not yet fully established in California, but recent detections in Sacramento County have raised concerns and triggered control activities by agencies tasked with protecting plants from pests. Japanese beetles have a broad range of host plants. The list of plants used as hosts by Japanese beetle contains more than 300 species (Potter & Held 2002). Because the focus has been on Japanese beetle attacks in gardens and lawns, the host list is dominated by garden plants. Most of the information on host susceptibility to Japanese beetle originated from a landmark survey summariZed by Fleming (1972). This rating system was based on written and oral accounts of Japanese beetle feeding damage noted from 1920 through 1963 primarily in the New England area (Fleming 1972). Although poorly documented, there is little doubt that Japanese beetle can attack many other species of plants not included on the host list (Miller et al., 2001; Potter & Held 2002). -

Approved Plant List
LEGEND Preferred Species Do not over water Abbreviations for Recommended District/Area: UC = Urban Core APPROVED PLANT LIST Allowed Species Protect from sun and wind R = Residential I = Industrial Native* Moisture Rating (Low Moisture – High Moisture) P = Parks The following plant list has been established and approved by the A = All districts/areas (excluding natural areas) North Park Design Review Committee (DRC) for the Baseline Community. Pollinator** Sun Exposure Rating (No Sun – Full Sun) Any substitutions or variances from the following list must be submitted to the DRC for review and approval. * A Native Plant is defined as those native to the Rocky Mountain Inter-Mountain Region. **A Pollinator is defined as those that provide food and/or reproductive resources for pollinating animals, such as honeybees, native bees, butterflies, moths, beetles, flies and hummingbirds. SHRUBS Sun/Shade Moisture Scientific Name Common Name Flower Color Blooming Season Height Spread Notes Tolerance Needs SHRUBS Abronia fragrans Snowball Sand Verbena White 6-7 4-24" 4-24" R, P Greenish UC Agave americana Century Plant Late Spring, Early Summer 6’-12’ 6-10’ Yellow May not be reliably hardy, requires sandy/gritty soil P Alnus incana ssp. tenuifolia Thinleaf Alder Purple Early Spring 15-40’ 15-40’ Host plant, Spreads - more appropriate for parks, More tree-like; catkins through winter Amelanchier alnifolia Saskatoon Serviceberry White Mid Spring 4’-15’ 6’-8’ A Amelanchier canadensis Shadblow Serviceberry White Mid Spring 25’-30’ 15’-20’ A High habitat -

Impact of River Dynamics on the Genetic Variation of Gypsophila
Plant Biology ISSN 1435-8603 RESEARCH PAPER Impact of river dynamics on the genetic variation of Gypsophila repens (Caryophyllaceae): a comparison of heath forest and more dynamic gravel bank populations along an alpine river C. Reisch & J. Sattler Institute of Plant Sciences, University of Regensburg, Regensburg, Germany Keywords ABSTRACT Alpine plant species; alpine river; genetic • differentiation; genetic diversity; River Isar. Alpine rivers are, despite anthropogenic water flow regulation, still often highly dynamic ecosystems. Plant species occurring along these rivers are subject to ecological Correspondence disturbance, mainly caused by seasonal flooding. Gypsophila repens typically grows at C. Reisch, Institute of Plant Sciences, higher altitudes in the Alps, but also occurs at lower altitudes on gravel banks directly University of Regensburg, D-93040 along the river and in heath forests at larger distances from the river. Populations on Regensburg, Germany. gravel banks are considered non-permanent and it is assumed that new individuals E-mail: [email protected] originate from seed periodically washed down from higher altitudes. Populations in heath forests are, in contrast, permanent and not regularly provided with seeds from Editor higher altitudes through flooding. If the genetic structure of this plant species is D. Byers strongly affected by gene flow via seed dispersal, then higher levels of genetic diversity in populations but less differentiation among populations on gravel banks than in Received: 6 April 2020; Accepted: heath forests can be expected. 22 September 2020 • In this study, we analysed genetic diversity within and differentiation among 15 popu- lations of G. repens from gravel banks and heath forests along the alpine River Isar doi:10.1111/plb.13195 using amplified fragment length polymorphisms (AFLP). -

Improved Transcriptome Sampling Pinpoints 26 Ancient and More Recent Polyploidy Events in Caryophyllales, Including Two Allopolyploidy Events
Article type : MS - Regular Manuscript Improved transcriptome sampling pinpoints 26 ancient and more recent polyploidy events in Caryophyllales, including two allopolyploidy events Ya Yang 1,4, Michael J. Moore2, Samuel F. Brockington3, Jessica Mikenas2, Julia Olivieri2, Joseph F. Walker1 and Stephen A. Smith1 1Department of Ecology & Evolutionary Biology, University of Michigan, 830 North University Avenue, Ann Arbor, MI 48109-1048, USA; 2Department of Biology, Oberlin College, 119 Woodland St, Oberlin, OH 44074-1097, USA; 3Department of Plant Sciences, University of Cambridge, Cambridge, CB2 3EA, UK; 4Current address: Department of Plant and Microbial Biology, University of Minnesota, Twin Cities. 1445 Gortner Avenue, St Paul, MN 55108, USA Authors for correspondence: Ya Yang Tel: +1 612 625 6292 Email: [email protected] Stephen A. Smith Tel: +1 734 764 7923 Email: [email protected] Received: 30 May 2017 Accepted: 9 AugustAuthor Manuscript 2017 This is the author manuscript accepted for publication and has undergone full peer review but has not been through the copyediting, typesetting, pagination and proofreading process, which may lead to differences between this version and the Version of Record. Please cite this article as doi: 10.1111/nph.14812 This article is protected by copyright. All rights reserved Summary • Studies of the macroevolutionary legacy of polyploidy are limited by an incomplete sampling of these events across the tree of life. To better locate and understand these events, we need comprehensive taxonomic sampling as well as homology inference methods that accurately reconstruct the frequency and location of gene duplications. • We assembled a dataset of transcriptomes and genomes from 169 species in Caryophyllales, of which 43 were newly generated for this study, representing one of the densest sampled genomic-scale datasets available. -

Sion of Gypsophyla, Bolanthus, (Botanical Herbarium, Utrecht )
Wentia 9 (1962) 1 —203 Sion of Gypsophyla, Bolanthus, Ankyropetalum and Phryna 1 (With Arabic summary) Y.I. Barkoudah (Botanical Museum and Herbarium, Utrecht) 2 (received March 6th, 1962) CONTENTS Introduction 2 GYPSOPHILA 4 A. General Part 4 1. Limits of the and revision of literature 4 genus 2. General morphology 9 the The root; the stem; the leaf; on the phyllotaxy of Gypsophila; found in inflorescence; remarks on the dichasial cymes Gypsophila-, the in the the aestiva- ontogeny of flower genus Gypsophila; calyx; tion of sepals; the corolla; aestivation of the corolla; the androecium; the and seeds. ovary; placentation; capsule 3. Cytology 26 4. Pollen morphology 28 5. Geography 29 6. Ecology 31 7. Uses 32 B. Taxonomic Part 33 1. Material 33 of the Diantheae 34 2. Diagnosis and key to the genera of the 35 3 Diagnosis and subdivisions genus 4. Key to the species 46 5. Species descriptions 55 BOLANTHUS 157 1. Diagnosis and delimitation from other genera 159 2. Geography 160 3. General morphology 160 other 162 4. Relation with genera 162 5. Key to the species 6. Species descriptions 163 ANKYROPETALUM 170 of the and discussion of the literature 171 1. Delimitation genus . 172 2. Key to the species 3. Species descriptions 173 PHRYNA 175 1. Diagnosis 176 x this a scholarship ) The author was enabled to carry out work by received from of the costs. Damascus University and by a special grant covering part publishing 2 ) Future address: Botanical Department, Damascus University, Damascus, Syria. 2 Y. I. BARKOUDAH 2. Taxonomic discussion 177 Species of uncertain status and names of uncertain application . -

Flavonoids of the Caryophyllaceae
Phytochem Rev https://doi.org/10.1007/s11101-021-09755-3 (0123456789().,-volV)( 0123456789().,-volV) Flavonoids of the Caryophyllaceae Katarzyna Jakimiuk . Michael Wink . Michał Tomczyk Received: 1 December 2020 / Accepted: 9 April 2021 Ó The Author(s) 2021 Abstract The plant family Caryophyllaceae, com- flavonols, isoflavones, and their O-orC-glycosides, monly known as the pink family, is divided into 3 exhibit multiple interesting biological and pharmaco- subfamilies and contains over 80 genera with more logical activities, such as antioxidant, anti-inflamma- than 2600 species that are widely distributed in tory, anti-oedemic, antimicrobial, and temperate climate zones. Plants belonging to this immunomodulatory effects. Thus, this review anal- family produce a variety of secondary metabolites ysed the flavonoid composition of 26 different genera important in an ecological context; however, some of and more than 120 species of Caryophyllaceae for the these metabolites also show health-promoting activi- first time. ties. The most important classes of phytochemicals include saponins, phytoecdysteroids, other sterols, Keywords Caryophyllaceae Á Phytochemistry Á flavonoids, lignans, other polyphenols, essential oils, Flavonoids Á Secondary metabolites and N-containing compounds such as vitamins, alka- loids or cyclopeptides. Flavonoids are polyphenolic compounds that remain one of the most extensively studied constituents of the Caryophyllaceae family. Introduction Numerous structurally diverse aglycones, including flavones, flavonols, flavonones (dihydroflavones), The Caryophyllaceae family, commonly known as the pink family, contains over 80 genera with more than 2600 species. The pink family is divided into 3 K. Jakimiuk Á M. Tomczyk (&) subfamilies, Paronychioideae, Alsinoideae, and Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy with Caryophylloideae, according to the presence or the Division of Laboratory Medicine, Medical University absence of stipules as well as the type of calyx and of Białystok, ul. -
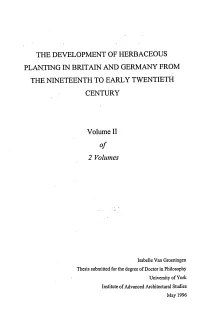
297313 VOL2.Pdf
THE DEVELOPMENT OF HERBACEOUS PLANTING IN BRITAIN AND GERMANY FROM THE NINETEENTH TO EARLY TWENTIETH CENTURY Volume 11 Of 2 Volumes ii IsabelleVan Groeningen Thesissubmitted for the degreeof Doctorin Philosophy Universityof York Instituteof AdvancedArchitectural Studies May 1996 ST COPY AVAILA L Variable print quality Appendix 1: Summer Flowering Plants Listed by Philip Miller in 1731 APPENDIX 1: SUMMER FLOWERING PLANTS LISTED BY PHILIP MILLER IN 1731 Source: Miller, Philip: The Gardener'sDictionary, 1731 Notes: 1. The following list was published by Miller indicating what was flowering in the months of June,July, August and September,which are the four months during which the majority of herbaceousplants flower. The nomenclatureof Miller's nameshas, where possible,been updatedand addedbetween brackets with the help of Tony Lord. 2. The nomenclatureor identity of plants marked with a? is uncertain. acanthus(Acanthus spp.) aloes (Aloe vera) althaeafrutex (Hibiscus syriacus) amaranthus(Amaranthus sp. ) amaranthoides(globe amaranth:Gomphrena globosa) annual stock, July-flowers (Matthiola incana) antirrhinum or calves snouts(Antirrhinum majus), apocynum (Millees Apocynum contains severalspecies from Asclepiadeaeand Apocynaceae:Asclepias, Rhabdadenia,Echites, Forsteronia, Prestonia as well as Apocynum asters(Aster spp.) auricula,(Primula auricula) autumn hyacinth (Polyxena corymbosa) autumn crocus (Crocus speciosus) autumnalis * balsamines(Impatiens balsamina) bean caper (Zygophyllum) bloody cranesbill (Geranium sanguineum) blue featheredhyacinth (Muscari comosummonstrosum) broad-leavedupright lily of the valley (Convallaria lati/blia or Polygonatum spp) bulbous irises (Iris xiphium) bulbous fiery lily (Lilium bulbiferum) buphthalmumsof sorts (probalby Anthemis spp.) campanulas(Campanula spp.) candytuft (Iberis sempervirens) Canterbury bells (Campanula medium) Capsicum indicum (Capsicum annuum) cardinal flower (Lobelia cardinalis) carnations(Dianthus caryophyllus) catchfly (Silene diolca and S.