Corpus Législatif
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Introducció D'espècies De Fauna Invasores Al Medi Natural
Introducció d’espècies de fauna invasores al medi natural Judit Costa Pujol 1176524 Beatriu García Morante 1175438 Marta López Beltrán 1174631 Veterinària i deontologia legal Bellaterra, 21.01.2011 INDEX 1. INTRODUCCIÓ 1 1.1 Fauna salvatge autòctona 1 1.2 Espècie exòtica invasora 1 1.3 Introducció 2 1.4 Per què una espècie exòtica es converteix en espècie invasora? 2 1.5 Conseqüències de la introducció d’espècies exòtiques invasores 3 2. LEGISLACIÓ 5 2.1 El paper de les administracions públiques 5 2.2 Els convenis internacionals 7 2.3 La Unió Europea 8 2.4 Un fons econòmic per conservar la natura 9 2.5 Estat Espanyol 10 2.6 Les administracions autonòmiques 11 2.7 Les administracions locals 13 3. PREVENCIÓ I PLANS D’ACTUACIÓ 14 3.1 Actuacions de prevenció 15 3.2 Actuacions d’eradicació i control 16 3.3 Marc legislatiu 18 3.4 Pla estratègic d’espècies invasores a Catalunya 18 4. ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES A LA PENÍNSULA IBÈRICA 21 4.1 Mamífers 21 4.1.1 Arruí ( Ammotragus lervia ) 21 4.1.2 Mufló ( Ovis ammon musimon ) i Gamo ( Dama dama ) 21 4.1.3 Visó americà ( Neovison vison ) i altres visons comercials 22 4.1.4 Llúdriga o coipú ( Myocastor coipus ) 22 4.2 Aus 22 4.2.1 Malvasia canyella ( Oxyura jamaicensis ) 22 4.2.2 Guatlla japonesa ( Coturnix coturnix japonensis ) i “Colín” de Virgínia ( Colinus virginianus ) 23 4.2.3 Altres espècies d’aus que provoquen problemes ecològics 23 4.3 Peixos 23 4.4 Amfibis 24 4.4.1 Tortugues de Florida ( Trachemys scripta elegans ) 24 4.4.2 Granota toro americana ( Rana catesbeiana ) 24 4.5 Invertebrats 25 5. -

Document D'objectifs Site Natura 2000 I 28
DOCUMENT D’OBJECTIFS SITE NATURA 2000 I 28 PELOUSES, FORETS REMARQUABLES ET HABITATS ROCHEUX DU PLATEAU DE SORNIN FR8201745 SOMMAIRE INTRODUCTION ............................................................................................................... 3 CADRE DE L’ELABORATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS................................ 4 A. LA DIRECTIVE “HABITATS, FAUNE, FLORE” ....................................................... 4 B. LES DOCUMENTS D’OBJECTIFS ............................................................................. 4 C. LE COMITÉ DE PILOTAGE ET LES GROUPES DE TRAVAIL................................ 4 LE SITE I-28........................................................................................................................ 7 ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL ..................................................................................... 7 A. SITUATION GÉOGRAPHIQUE - PROPRIÉTAIRES.................................................. 7 Situation Géographique ................................................................................................. 7 Limites ........................................................................................................................... 7 B. MESURES DE PROTECTION ACTUELLES .............................................................. 7 C. MILIEU NATUREL..................................................................................................... 8 Géomorphologie et Géologie......................................................................................... -

Guidance Document on the Strict Protection of Animal Species of Community Interest Under the Habitats Directive 92/43/EEC
Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC Final version, February 2007 1 TABLE OF CONTENTS FOREWORD 4 I. CONTEXT 6 I.1 Species conservation within a wider legal and political context 6 I.1.1 Political context 6 I.1.2 Legal context 7 I.2 Species conservation within the overall scheme of Directive 92/43/EEC 8 I.2.1 Primary aim of the Directive: the role of Article 2 8 I.2.2 Favourable conservation status 9 I.2.3 Species conservation instruments 11 I.2.3.a) The Annexes 13 I.2.3.b) The protection of animal species listed under both Annexes II and IV in Natura 2000 sites 15 I.2.4 Basic principles of species conservation 17 I.2.4.a) Good knowledge and surveillance of conservation status 17 I.2.4.b) Appropriate and effective character of measures taken 19 II. ARTICLE 12 23 II.1 General legal considerations 23 II.2 Requisite measures for a system of strict protection 26 II.2.1 Measures to establish and effectively implement a system of strict protection 26 II.2.2 Measures to ensure favourable conservation status 27 II.2.3 Measures regarding the situations described in Article 12 28 II.2.4 Provisions of Article 12(1)(a)-(d) in relation to ongoing activities 30 II.3 The specific protection provisions under Article 12 35 II.3.1 Deliberate capture or killing of specimens of Annex IV(a) species 35 II.3.2 Deliberate disturbance of Annex IV(a) species, particularly during periods of breeding, rearing, hibernation and migration 37 II.3.2.a) Disturbance 37 II.3.2.b) Periods -

293 – Les Noms Scientifiques Français Des Mollusques Continentaux De
LES NOMS SCIENTIFIQUES FRANÇAIS DES MOLLUSQUES CONTINENTAUX DE FRANCE : processus d’ÉtABLISSEMENT d’une LISTE DE RÉFÉRENCE Benoît FONTAINE 1, Jean-Michel BICHAIN 2, Xavier CUCHERAT 3, Olivier GAR G OMINY 4 & Vincent PRIÉ 5 SUMMARY. — French scientific names of continental molluscs of France: process for establishing a list of reference. — In the biodiversity crisis context and with the increasing general awareness on this issue, conservation of small and poorly-known species is hampered by the fact they only have latine names. In order to communicate for biodiversity conservation, having French names is an advantage which is lacking in terrestrial and freshwater molluscs from France. To remedy this problem, we propose a list of French scientific names for this group, i.e. all species and subspecies known from France. We have listed existing names in legal documents, in usage and in the 18th and 19th centuries scientific literature. The resulting list being incomplete, we had to create new French names, following a series of recommendations adapted from similar works dealing with other taxonomic groups. We conclude by dealing with the issue of the legitimacy and validity of such names. The list of French scientific names is given as an appendix and is downloadable from internet. RÉSUMÉ. — Dans le contexte de la crise de la biodiversité et de la prise de conscience par le grand public des enjeux environnementaux, la conservation des espèces petites et méconnues est handicapée par le fait que ces espèces ne peuvent être désignées que par leur nom latin. Dans une optique de communication pour la préservation de la biodiversité, disposer de nom français est un atout qui fait défaut pour les mol- lusques terrestres et d’eau douce de France. -

COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora (OJ L 206, 22.7.1992, P
01992L0043 — EN — 01.07.2013 — 006.006 — 1 This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document ►B COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 97/62/EC of 27 October 1997 L 305 42 8.11.1997 ►M2 Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the L 284 1 31.10.2003 Council of 29 September 2003 ►M3 Council Directive 2006/105/EC of 20 November 2006 L 363 368 20.12.2006 ►M4 Council Directive 2013/17/EU of 13 May 2013 L 158 193 10.6.2013 Amended by: ►A1 Act of Accession of Austria, Sweden and Finland C 241 21 29.8.1994 (adapted by Council Decision 95/1/EC, Euratom, ECSC) L 1 1 1.1.1995 ►A2 Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the L 236 33 23.9.2003 Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 176, 20.7.1993, p. -

Organismu Latviskie Nosaukumi (2)
Biosistēmu Terminoloģijas Centra Biļetens 1(1) (2017): 21–51 ISSN 2501-0336 (online) http://www.rpd-science.org/BTCB/V001/BTCB_1_4.pdf © “RPD Science” Citēšanai: BTCB, 2017. Organismu latviskie nosaukumi (2). Biosistēmu Terminoloģijas Centra Biļetens 1(1): 21–51 Organismu latviskie nosaukumi (2) Latvian names of organisms (2) Zinātniskais nosaukums Atbilstība Pēdējā Scientific name Equivalence pārbaude Last verification A Abies gmelinii Rupr. (1845) = Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. var. gmelinii 17.12.2016. Abies ledebourii Rupr. (1845) = Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. var. gmelinii 17.12.2016. Abies menziesii Mirb. (1825) = Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. menziesii 17.12.2016. Acaciaceae = Fabaceae 27.12.2016. Acalitus brevitarsus (Fockeu, 1890) melnalkšņa maurērce 16.12.2016. Acalitus calycophthirus (Nalepa, 1891) bērzu pumpurērce 16.12.2016. Acalitus essigi (Hassan, 1928) aveņu pangērce 16.12.2016. Acalitus longisetosus (Nalepa, 1892) bērzu sārtā maurērce 16.12.2016. Acalitus phloeocoptes (Nalepa, 1890) plūmju stumbra pangērce 16.12.2016. Acalitus phyllereus (Nalepa, 1919) baltalkšņa maurērce 16.12.2016. Acalitus plicans (Nalepa, 1917) dižskābaržu maurērce 16.12.2016. Acalitus rudis (Canestrini, 1890) bērzu baltā maurērce 16.12.2016. Acalitus stenaspis (Nalepa, 1891) dižskābaržu lapmalērce 16.12.2016. Acalitus vaccinii (Keifer, 1939) melleņu pumpurērce 16.12.2016. Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) mazais dzeloņgliemezis 16.12.2016. Acanthinula spinifera Mousson, 1872 Spānijas dzeloņgliemezis 16.12.2016. Acanthocardia echinata (Linnaeus, 1758) dzelkņainā sirsniņgliemene 16.12.2016. Acanthochitona crinita (Pennant, 1777) zaļais bruņgliemis 16.12.2016. Aceria brevipunctatus (Nalepa, 1889) = Aceria campestricola (Frauenfeld, 1865) 16.12.2016. Aceria brevirostris (Nalepa, 1892) ziepenīšu pangērce 16.12.2016. Aceria brevitarsus (Fockeu, 1890) = Acalitus brevitarsus (Fockeu, 1890) 16.12.2016. -
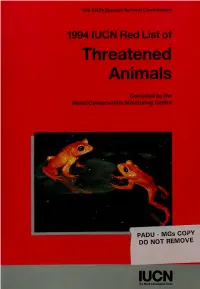
1994 IUCN Red List of Threatened Animals
The lUCN Species Survival Commission 1994 lUCN Red List of Threatened Animals Compiled by the World Conservation Monitoring Centre PADU - MGs COPY DO NOT REMOVE lUCN The World Conservation Union lo-^2^ 1994 lUCN Red List of Threatened Animals lUCN WORLD CONSERVATION Tile World Conservation Union species susvival commission monitoring centre WWF i Suftanate of Oman 1NYZ5 TTieWlLDUFE CONSERVATION SOCIET'' PEOPLE'S TRISr BirdLife 9h: KX ENIUNGMEDSPEaES INTERNATIONAL fdreningen Chicago Zoulog k.J SnuicTy lUCN - The World Conservation Union lUCN - The World Conservation Union brings together States, government agencies and a diverse range of non-governmental organisations in a unique world partnership: some 770 members in all, spread across 123 countries. - As a union, I UCN exists to serve its members to represent their views on the world stage and to provide them with the concepts, strategies and technical support they need to achieve their goals. Through its six Commissions, lUCN draws together over 5000 expert volunteers in project teams and action groups. A central secretariat coordinates the lUCN Programme and leads initiatives on the conservation and sustainable use of the world's biological diversity and the management of habitats and natural resources, as well as providing a range of services. The Union has helped many countries to prepare National Conservation Strategies, and demonstrates the application of its knowledge through the field projects it supervises. Operations are increasingly decentralised and are carried forward by an expanding network of regional and country offices, located principally in developing countries. I UCN - The World Conservation Union seeks above all to work with its members to achieve development that is sustainable and that provides a lasting Improvement in the quality of life for people all over the world. -

European Red List of Non-Marine Molluscs Annabelle Cuttelod, Mary Seddon and Eike Neubert
European Red List of Non-marine Molluscs Annabelle Cuttelod, Mary Seddon and Eike Neubert European Red List of Non-marine Molluscs Annabelle Cuttelod, Mary Seddon and Eike Neubert IUCN Global Species Programme IUCN Regional Office for Europe IUCN Species Survival Commission Published by the European Commission. This publication has been prepared by IUCN (International Union for Conservation of Nature) and the Natural History of Bern, Switzerland. The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN, the Natural History Museum of Bern or the European Union concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of IUCN, the Natural History Museum of Bern or the European Commission. Citation: Cuttelod, A., Seddon, M. and Neubert, E. 2011. European Red List of Non-marine Molluscs. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Design & Layout by: Tasamim Design - www.tasamim.net Printed by: The Colchester Print Group, United Kingdom Picture credits on cover page: The rare “Hélice catalorzu” Tacheocampylaea acropachia acropachia is endemic to the southern half of Corsica and is considered as Endangered. Its populations are very scattered and poor in individuals. This picture was taken in the Forêt de Muracciole in Central Corsica, an occurrence which was known since the end of the 19th century, but was completely destroyed by a heavy man-made forest fire in 2000. -

Official Journal C
Officia^_^ /• /* e e l-f l Journa-wr l"I ISScN 0378 19"69865 Volume 33 of the European Communities 3 A.g.« 1,* Notice No Contents page I Information II Preparatory Acts Commission 90/C 195/01 Supplementary Annexes to the proposal for a Council Directive on the protection of natural and semi-natural habitats and of wild fauna and flora 1 1 3. 8. 90 Official Journal of the European Communities No C 195/1 II (Preparatory Acts) COMMISSION Supplementary Annexes to the proposal for a Council Directive on the protection of natural and semi-natural habitats and of wild fauna and flora COM(90) 59 final (Submitted by the Commission on 14 March 1990 pursuant to the third paragraph of Article 149 of the EEC Treaty) (90/C 195/01) EXPLANATORY NOTE The proposal here presented aims to complete the Annexes of the Council's draft Directive on the protection of natural and semi-natural habitats and of wild fauna and flora, adopted by the Commission on 26 July 1988 (x). (>) OJNoC247, 21. 9. 1988. No C 195/2 Official Journal of the European Communities 3. 8. 90 ANNEX I Animal and plant species whose habitats are threatened in the Community (a) ANIMALS VERTEBRATES MAMMALS Rupicapra rupicapra balcanica Ovis ammon musimon (Natural populations — Corsica and INSECTIVORA Sardinia) Talpidae Capra aegagrus Galemys pyrenaicus CETACEA Soricidae Tursiops truncatus Suncus etruscus Phocoena phocoena CHIROPTERA Rhinolophidae REPTILES Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale TESTUDINES Rhinolophus ferrumequinum Testudinidae Rhinolophus hipposideros Testudo hermanni Rhinolophus -

Liste De Référence Annotée Des Mollusques Continentaux De France Annotated Checklist of the Continental Molluscs from France
MalaCo Le journal de la malacologie continentale française www.journal-malaco.fr MalaCo (ISSN 1778-3941) est un journal électronique gratuit, annuel ou bisannuel pour la promotion et la connaissance des mollusques continentaux de la faune de France. Equipe éditoriale Jean-Michel BICHAIN / Strasbourg / [email protected] Xavier CUCHERAT / Audinghen / [email protected] Benoît FONTAINE / Paris / [email protected] Olivier GARGOMINY / Paris / [email protected] Vincent PRIÉ / Montpellier / [email protected] Pour soumettre un article à MalaCo : 1ère étape – Le premier auteur veillera à ce que le manuscrit soit conforme aux recommandations aux auteurs (consultez le site www.journal-malaco.fr). Dans le cas contraire, la rédaction peut se réserver le droit de refuser l’article. 2ème étape – Joindre une lettre à l’éditeur, en document texte, en suivant le modèle suivant : "Veuillez trouvez en pièce jointe l’article rédigé par << mettre les noms et prénoms de tous les auteurs>> et intitulé : << mettre le titre en français et en anglais >> (avec X pages, X figures et X tableaux). Les auteurs cèdent au journal MalaCo (ISSN1778-3941) le droit de publication de ce manuscrit et ils garantissent que l’article est original, qu’il n’a pas été soumis pour publication à un autre journal, n’a pas été publié auparavant et que tous sont en accord avec le contenu." 3ème étape – Envoyez par voie électronique le manuscrit complet (texte et figures) en format .doc et la lettre à l’éditeur à : [email protected]. Pour les manuscrits volumineux (>5 Mo), envoyez un courriel à la même adresse pour élaborer une procédure FTP pour le dépôt du dossier final. -

Leiostyla Abbreviata, Madeiran Land Snail
The IUCN Red List of Threatened Species™ ISSN 2307-8235 (online) IUCN 2008: T11455A3278905 Leiostyla abbreviata, Madeiran Land Snail Assessment by: Seddon, M.B. View on www.iucnredlist.org Citation: Seddon, M.B. 2013. Leiostyla abbreviata. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T11455A3278905. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T11455A3278905.en Copyright: © 2015 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorized without prior written permission from the copyright holder provided the source is fully acknowledged. Reproduction of this publication for resale, reposting or other commercial purposes is prohibited without prior written permission from the copyright holder. For further details see Terms of Use. The IUCN Red List of Threatened Species™ is produced and managed by the IUCN Global Species Programme, the IUCN Species Survival Commission (SSC) and The IUCN Red List Partnership. The IUCN Red List Partners are: BirdLife International; Botanic Gardens Conservation International; Conservation International; Microsoft; NatureServe; Royal Botanic Gardens, Kew; Sapienza University of Rome; Texas A&M University; Wildscreen; and Zoological Society of London. If you see any errors or have any questions or suggestions on what is shown in this document, please provide us with feedback so that we can correct or extend the information provided. THE IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES™ Taxonomy Kingdom Phylum Class Order Family Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Lauriidae Taxon Name: Leiostyla abbreviata Lowe, 1852 Common Name(s): • English: Madeiran Land Snail Assessment Information Red List Category & Criteria: Critically Endangered (Possibly Extinct) B2ab(iii) ver 3.1 Year Published: 2013 Date Assessed: August 31, 2010 Justification: This species is endemic to Madeira, where all records in the last 50 years are from the fossil deposits at Canical on the Pta de Sao Lourenco. -

1St Meeting of the Group of Experts
*** * 11 * * ~ * COUNCIL CONSEIL OFEUROPE * **** DE L'EUROPE Strasbourg, 18 May 1990 T-PVS (90) 13 [ TPVS90 _ 13E. ] Eng. or. CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN VILDLIFE AND NATURAL HABITATS Group of Experts on Conservation of Invertebrates 1st meeting Strasbourg, 23-25 April 1990 Secretariat Memorandum prepared by the Directorate of Environment and Local Authorities This document will not be distributed at the meeting. Please bring this cop~· Ce document ne sera plus distribue en reunion. Priere de mus munir de cet exemplaire T-PVS (90) 13 - 2 - 1. Opening of the meeting by a representative of the Secretary General of the Council of Europe Mr Fernandez-Galiano, from the Secretariat, welcomed participants (see Appendix 1) and recalled that the Group was to develop its work within the programme of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention). This implied that decisions on future activities had to be reported to the Standing Committee of the Convention for final adoption. He thanked the European Invertebrate Survey (EIS) for its suggestion for launching a group on invertebrate conservation within the Bern Convention (see document T-PVS (89) 34 revised). At the request of some delegates, the Secretariat explained the differences between the work to be developed by the Group and other activities in the field of invertebrate conservation, such as those of the European Communities. The Bern Convention counts at present 22 Contracting Parties, including the EEC. Ten of these Contracting Parties are states which do not belong to the European Community. Other states, such as Burkina Faso, Morocco, Poland, the Soviet Union and Tunisia have been invited to adhere to the Convention and they are likely to do so in the near future.