Rapport Présentation St Python Appro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Ce Document Complète Le Cahier Des Clauses Administratives Générales « Prestations Intellectuelles »
1 ETUDE INTERCOMMUNALE POUR LA VALORISATION DU CADRE DE VIE EN PAYS SOLESMOIS CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Ce document complète le Cahier des Clauses Administratives Générales « Prestations intellectuelles » Novembre 2011 Cahier des Clauses Particulières / étude intercommunale pour la valorisation du cadre de vie en Pays Solesmois –CCPS – Novembre 2011 2 CONTEXTE DE L’ETUDE PRESENTATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES Situation géographique et composition La Communauté de Communes du Pays Solesmois (CCPS) est située dans la partie sud du département du Nord, à l’est de l’arrondissement de Cambrai. Elle a vu le jour dans sa configuration actuelle le 1 er janvier 2003 et regroupe 15 communes qui sont partie intégrante du canton de Solesmes : Beaurain, Bermerain, Capelle, Escarmain, Haussy, Montrécourt, Romeries, Saint Martin sur Ecaillon, Saint Python, Saulzoir, Solesmes, Sommaing, Vendegies sur Ecaillon, Vertain, Viesly. La population totale est de plus de 14 700 habitants. Le territoire a intégré le Pays du Cambrésis à l’échelle duquel un schéma de cohérence territoriale, un schéma « Trame verte et bleue » et un Plan climat territorial sont mis en œuvre. Le SCOT du Cambrésis, en phase d’arrêt de projet, impose depuis plusieurs années une réflexion sur la consommation d’espaces qui se traduit par l’attribution d’un « compte foncier » aux communes. Ce dernier pourrait âtre mutualisé à l’échelle communautaire dans le cadre de l’élaboration d’un PLU intercommunal (voir plus loin). La compétence « Gestion des PLU » et les actions menées La Communauté de communes du Pays Solesmois assure la compétence « Elaboration, révision et modification des Plan Locaux d’Urbanisme et des cartes communales » depuis sa création. -

A History of the Gre
ARTHUR CONAN DOYLE THE BRITISH CAMPAIGN IN FRANCE AND FLANDERS VOLUME VI—JULY TO NOVEMBER 1918 This volume first published by Hodder & Stoughton, London, 1920 TABLE OF CONTENTS CHAPTER I. THE OPENING OPERATIONS From July 1 to August 8, 1918 The general position—German attack of July 16—French counter-attack of July 18—Turn of the tide—Fifty- first and Sixty-second Divisions on the Ardres—Desperate fighting—The Fifteenth Scots Division at Buzancy—Le Glorieux Chardon d'Ecosse—Nicholson's Thirty-fourth Division at Oulchy-le-Château—The campaigns on the periphery CHAPTER II. ATTACK OF RAWLINSON'S FOURTH ARMY The Battle of Amiens, August 8-22 Great British victory—Advance of the Canadians—Of the Australians—Of the Third Corps—Hard struggle at Chipilly—American assistance— Continuance of the operations—Great importance of the battle CHAPTER III. CONTINUATION OF THE OPERATIONS OF RAWLINSON'S FOURTH ARMY From August 22 to the Battle of the Hindenburg Line, September 29 Further advance of the Australians—Of the Third Corps—Capture of Albert —Advance across the old Somme battlefield—Capture of Mont St. Quentin —Splendid Australian exploit—Fall of Peronne—Début of the Yeomanry (Seventy-fourth) Division—Attack on the outliers of the Hindenburg Line —Appearance of the Ninth Corps—Eve of the Judgment CHAPTER IV. THE ATTACK OF BYNG'S THIRD ARMY August 21, 1918, to September 29, 1918 Advance of Shute's Fifth Corps—Great feat in crossing the Ancre—Across the old battlefield—Final position of Fifth Corps opposite Hindenburg's Main Line—Advance of Haldane's Sixth Corps—Severe fighting— Arrival of the Fifty-second Division—Formation of Fergusson's Seventeenth Corps—Recapture of Havrincourt—Advance of Harper's Fourth Corps—Great tenacity of the troops—The New Zealanders and the Jaeger—Final position before the decisive battle CHAPTER V. -

Paix-De-Arras Manus
Armorial de la Paix d'Arras A roll of arms of the participants of the Peace Conference at Arras 1435 Introduction and edition by Steen Clemmensen from (a) London, British Library Add. 11542 fo.94r-106r (b) Paris, Bibliothèque nationale de France Ms.fr. 8199 fo.12r-46v Heraldiske Studier 4 Societas Heraldica Scandinavica Copenhagen 2006 Armorial de la Paix d'Arras Edited by Steen Clemmensen Introduction 3 The conference of 1435 3 The two manuscripts 5 Construction of a combined manuscript 7 The participants and the armorial 8 The extraneous material 12 Postscript 13 The APA proper - combined manuscripts and partly read by 'long lines' 1. Mediators 14 2. French embassy 16 3. English embassy 19 4. Burgundians 22 Figure 60 Appendix A: Schematic representation of the 3 bifolios in the Burgundian segment 61 Appendix B: Concordance of APA/a:b, overlap, Burgundians, as per page 62 Appendix C: Concordance of APA/b:a, overlap, Burgundians, as per page 64 Appendix D: London, BL, Add.11452, APA/a, Burgundians, as in the manuscript 67 Appendix E: Paris, BnF, fr.8199, APA/b, Burgundians, as in the manuscript 73 Appendix F: Concordance of the English of ETO in BL Add.11452 and BA ms.4790 83 Notes 84 References 85 Index of names 92 Ordinary of arms 96 - 2 - Introduction The Armorial de la Paix d'Arras of the participants at the peace conference at Arras in 1435, alternatively named the Arras Roll of Arms or Armorial du héraut Saint-Remy and by various siglas, APA, AR or SR, is known in 2 versions. -
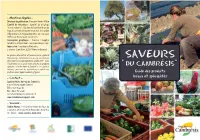
Mise En Page 1
- Mentions légales - Directeur de publication : François-Xavier Villain Comité de rédaction : Comité de pilotage “circuits courts”, l’équipe du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Région Nord Pas-de-Calais et l’Office de Tourisme du Cambrésis. Conception graphique : Yannick Prangère Gra phiste indépendant • www.mesimages.org Impression : Imprimerie Monsoise 5 avenue Léon Blum, 59370 Mons en Baroeul Ce guide a été réalisé et financé par le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis avec le concours financier SAVEURS de l’Europe au titre du programme Leader 2007 – 2013. Il référence les lieux de vente directe de produits agricoles sur le territoire du Cambrésis. Les contacts DU CAMBRÉSIS indiqués sont ceux des agriculteurs et apiculteurs professionnels ayant souhaité y figurer. Guide des produits - Contact - locaux et spécialités Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 3 rue d’Alger, 59400 Cambrai Tél : 03 27 72 92 60 Fax : 03 27 82 57 49 [email protected] www.lecambresisenprojet.com - Sources - Crédits Photos : Le Syndicat Mixte du Pays du Cam brésis et le Comité de Promotion Nord-Pas de-Calais - www.saveurs-npdc.com Guide des produits locaux et spécialités Au carrefour des départements du 1. LA FERME DES 3 TILLEULS Nord, du Pas de Calais, de l'Aisne 2. LES CHAPONS DE SAULZOIR et de la Somme, le Cambrésis O 3. FERME DES 4 SAISONS SAVEURS DU CAMBRÉSIS pré sente la particularité d’offrir 4. EARL DES PRÈS une qualité de vie qui repose sur une 5. LA PETITE FERME DU CAMBRÉSIS harmonie entre le rural et l’urbain. -

Histoire De Saint Python
HISTORIQUE Armoiries de St-Python : D’hermines à trois losanges de gueules. Croix de guerre 1914/1918 aint-Python provient de St-Piat patron de l’église. En 1074 le village s’appelait Sanctus SPiato. Les habitants sont appelés des “Piatonnais” Ce village est abrité dans la vallée de la Selle et coupé en deux parties par cette dernière reliées par un pont, la passerelle dite du moulin et celle de la rue Garlot (Plan du territoire du village) Géographiquement il est à la croisée des nationales 342 et 345 et limitrophe au Sud-Est à Solesmes et au Nord à Haussy. Il fait partie du canton de Solesmes et de l’arrondissement de Cambrai (Localisation générale) D’une superficie de 745 hectares, son sol est argileux. On y trouve néanmoins de la marne et un peu de sable. La culture consiste en des céréales, des graines oléagineuses et des plantes à fourrage. Sa population tend à décroître lentement et n’atteint plus actuellement que 1.117 habitants après avoir connu jusqu’à 1.941 habitants en 1880. Saint-Python garde encore comme vestiges de son passé son église édifiée en 1757, son château reconstruit après son incendie de 1914, les ruines de 2 moulins et quelques belles fermes telles la ferme Cardon. Les deux fêtes de Saint-Python sont les ducasses du dernier dimanche d’Avril et du premier dimanche de Septembre. Ci-dessous la place du village avec l’église, la salle des fêtes, la mairie et un des derniers cafés : 1 HISTORIQUE BAPTÊME DE LA CLOCHE EN 1783 L’an 1783, j’ai été bénite et nommée Adelaïde Victoire par haut et puissant seigneur Gaspard Jacques De Pollinchove, chevalier et seigneur de St-Python, Haussy, Beuvrière etc, conseiller du Roy dans tous ses conseils d’Etat et privés et premier président de sa cour de Parlement de Flandre et par mademoiselle Adélaïde Victoire Joseph De Franqueville d’Abancourt. -

Fiche De Synthèse Scot
FICHE DE SYNTHÈSE SCOT Cambrésis Janvier 2017 Sommaire I Généralités..............................................................................................................................3 I.A Structure porteuse............................................................................................................................. 3 I.B Maîtrise d’œuvre............................................................................................................................... 3 I.C État d'avancement.............................................................................................................................3 I.D Personnes publiques Associées........................................................................................................4 II Périmètre du SCoT................................................................................................................5 II.A Cartographie..................................................................................................................................... 5 II.B Collectivités représentées................................................................................................................6 DDTM 59 – Fiche de synthèse SCoT Cambrésis 2 I GÉNÉRALITÉS I.A Structure Porteuse Syndicat mixte Pays du Cambrésis Président : Sylvain TRANOY Voir la composition complète : http://www.lecambresisenprojet.com/netkali/GabNetKali1.aspx?idItem=11&idDoc=308 3 rue d'Alger - 59 400 Cambrai 03 27 72 92 60 03 27 82 57 49 [email protected] -

The Sparnacian Deposits of the Paris Basin: a Lithostratigraphic Classification
The Sparnacian deposits of the Paris Basin: A lithostratigraphic classification Marie-Pierre Aubry1, 4, Médard Thiry2, Christian Dupuis3, William A. Berggren 1, 4 1Department of Geological Sciences, Wright Labs, Rutgers University, 610 Taylor Road, Piscataway, New Jersey 08854-8066, USA 2Ecole des Mines de Paris, Informatique Géologique, 35 rue St Honoré, 77305 Fontainebleau, France 3Faculté Polytechnique, Géologie fondamentale et appliquée, 9 rue de Houdain, 7000 Mons, Belgium 4Department of Geology and Geophysics, Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA 02543, USA ABSTRACT: As the result of a study integrating lithostratigraphy and biostratigraphy of the Upper Paleocene (Thanetian) and Lower Eocene (Sparnacian-Ypresian) of the Paris Basin, a new lithostratigraphic unit, the Mont Bernon Group, can be formally recognized. The group includes four formational units: the Mortemer (Mortemer Limestone), the Vaugirard (Plastic Clay), the Soissonnais (Lignitic Clay of Soissons) and Epernay (Lignitic Clay of Epernay) formations and associated members. An integration of charophyte, dinoflagellate cyst and, to a lesser extent, calcareous nannoplankton biostratigraphy allows us to place the succession in an approximate, integrated biostratigraphic framework. Our introduction of a formal lithostratigraphic framework for the Upper Paleocene-Lower Eocene succession in the Paris Basin contributes to emphasize the distinctiveness of the Sparnacian deposits as an independent stratigraphic unit. INTRODUCTION that has arisen regarding the correlation -

Cambrésis-Sambre Avesnois
Organisation de la Caf du Nord - 2018 - Cambrésis - Sambre Avesnois Le territoire Cambrésis - Sambre Avesnois est constitué de 7 EPCI : les communautés d'agglomération de Cambrai et Maubeuge - Val de Sambre et les communautés de communes du Pays Solesmois, du Pays de Mormal, du Caudrésis et du Catésis, du CC du Pays de Mormal Coeur de l'Avesnois et du Sud Avesnois. CA Maubeuge Val de Sambre Ces 7 EPCI regroupent 267 communes. GUSSIGNIES VILLERS-SIRE-NICOLE HON-HERGIES BETTIGNIES VIEUX-RENG ETH BELLIGNIES BERSILLIES TAISNIERES-SUR-HON CC du Pays Solesmois BRY MAIRIEUX LA FLAMENGRIE JENLAIN ELESMES SAINT-WAAST MARESCHES WARGNIES-LE-PETIT BOUSSOIS BAVAY LA LONGUEVILLE JEUMONT PREUX-AU-SART ASSEVENT VILLERS-POL BERMERIES MAUBEUGE AUDIGNIES SEPMERIES FRASNOY AMFROIPRET RECQUIGNIES ROUSIES ORSINVAL MECQUIGNIES NEUF-MESNIL BOUSIGNIES-SUR-ROC SOMMAING RUESNES GOMMEGNIES OBIES VIEUX-MESNIL LOUVROIL CERFONTAINE COLLERET HARGNIES AUBENCHEUL-AU-BAC HEM-LENGLET BERMERAIN HAUTMONT ESTRUN LE QUESNOY VILLEREAU FRESSIES PAILLENCOURT CAPELLE BOUSSIERES-SUR-SAMBRE FERRIERE-LA-GRANDE SAULZOIR SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON COUSOLRE ABANCOURT IWUY BEAUDIGNIES PONT-SUR-SAMBRE AIBES JOLIMETZ SAINT-REMY-DU-NORD OBRECHIES VILLERS-EN-CAUCHIES GHISSIGNIES BEAUFORT HAUSSY ESCARMAIN SANCOURT THUN-L'EVEQUE DAMOUSIES BERELLES BLECOURT ESWARS LOUVIGNIES-QUESNOY LIMONT-FONTAINE CHOISIES VERTAIN RAUCOURT-AU-BOIS WATTIGNIES-LA-VICTOIRE SOLRINNES HESTRUD HAYNECOURT RAMILLIES SAINT-AUBERT SALESCHES AULNOYE-AYMERIES NAVES ECCLES DIMECHAUX SAILLY-LEZ-CAMBRAI ECLAIBES NEUVILLE-EN-AVESNOIS -

422 Le Quesnoy Solesmes Q
422 LE QUESNOYQ SOLESMES Course n° 31 41 51 61 71 81 91 101 111 411 Jours de circulation L.M.Me L.M.Me Me L.M.Me L.M.Me L.M L.M L.M.Me DF J.V J.V.S S J.V S J.V.S J.V J.V J.V.S Période scolaire Validité du x x x x x x Vacances scolaires 01/09/2014 au 31/08/15 x NOM DE LA COMMUNE NOM DE L' ARRET LE QUESQUESNOYNOY Les PrPrésés du RRoyoy | 11:11:0808 | 17:17:070717:07 17:0717:07 17:07 | | 119:109:10 119:129:12 LE QUESNOY Les chenes (abribus) 7:25 11:11 12:50 17:10 17:10 17:10 16:10 18:10 19:13 19:15 LE QUESNOY Place Marechal Leclerc 7:27 11:13 12:52 17:12 17:12 17:12 16:12 18:12 19:15 19:17 LE QUESNOY Lycee Eugene Thomas | | 12:55 17:13 | | 16:15 18:15 | | LE QUESNOY Gare (abribus) 7:30 11:15 12:57 17:15 17:15 17:15 16:18 18:18 19:18 19:21 ROMERIES Eglise | | 12:59 | | | 16:20 18:20 | | VERTAIN Paul Pavot | | 13:02 | | | 16:23 18:23 | | VERTAINER A N CiCroise | | 13:0530 | | | 16:266 26 18:268 26 | | VERTAIN Place | | 13:10 | | | 16:31 18:31 | | ESCARMAIN Eglise | | 13:13 | | | 16:34 18:34 | | ESCARMAIN Mairie | | 13:14 | | | 16:35 18:35 | | CAPELLE La Place | | 13:16 | | | 16:37 18:37 | | BERMERAIN Mortier Fondu | | 13:20 | | | 16:41 18:41 | | ST MARTIN Place de la Victoire | | 13:22 | | | 16:43 18:43 | | BERMERAIN Mairie | | 13:25 | | | 16:46 18:46 | | VENDEGIES SUR ECAILLON Calvaire | | 13:28 | | | 16:49 18:49 | | SOMMAING La Fabrique | | 13:29 | | | 16:50 18:50 SOMMAING Mairie | | 13:30 | | | 16:51 18:51 | | VENDEGIES SUR ECAILLON Les Campiaux (Cafe) | | 13:34 | | | 16:55 18:55 | | VENDEGIES SUR ECAILLON Le Roniau | | | | | | | LOUVIGNIES -
2020-4703-Cerfa.Pdf
Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale Article R. 122-3 du code de l’environnement ‘ N° 14734*03 Ministère chargé de l'environnement Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité envi ronnementale Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative Cadre réservé à l’autorité environnementale Date de réception : Dossier complet le : N° d’enregistrement : 12/06/2020 12/06/2020 20 204 703 1. Intitulé du projet Unité de Méthanisation Agricole sur la commune de SOLESMES pour produire du Biométhane et du Digestat. La capacité de traitement des déchets non dangereux sera de 77 t/ jour. Le biométhane sera injecté dans le réseau GRDF. Le digestat sera épandu comme engrais organique sur un plan d'épandage de 1407 ha sur 28 communes du Nord. 2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s) 2.1 Personne physique Nom Prénom 2.2 Personne morale METHA SOLESMOIS Dénomination ou raison sociale Nom, prénom et qua lité de la personne Adrien BLANCHARD Président habilitée à représenter la personne morale SAS RCS / SIRET |__|__|__|84480387400016 |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| Forme juridique Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1 3. Catégorie (s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122 -2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant du projet Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie N° de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.) Catégorie 1b : ICPE Enregistrement ICPE : Unité méthanisation rubrique 2781- 2b moins 100 t/jour : Enregistrement Catégorie 26 b : Stockage et épandages IOTA : TITRE II : REJETS 2.1.4.0 Épandage d'effluents ou de boues de boues et d'effluents, azote total 1° Azote total supérieur à 10 t/an supérieur à 10 t/ an Projet d’Épandage : 23133 m3 de Digestat / an ; une teneur moyenne de 4,8 kg Azote / m3 : Azote à gérer = 111 t/an 4. -

Son Excellence Monsieur Laurent FABIUS Ministre Des Affaires Étrangères Et Du Développement International 37, Quai D'orsay F - 75351 – PARIS
EUROPEAN COMMISSION Brussels, 07.05.2014 C(2014) 2609 final PUBLIC VERSION This document is made available for information purposes only. SUBJECT: STATE AID SA.38182 (2014/N) – FRANCE REGIONAL AID MAP 2014-2020 Sir, 1. PROCEDURE (1) On 28 June 2013 the Commission adopted the Guidelines on Regional State Aid for 2014-20201 (hereinafter "RAG"). Pursuant to paragraph 178 of the RAG, each Member State should notify to the Commission, following the procedure of Article 108(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, a single regional aid map applicable from 1 July 2014 to 31 December 2020. In accordance with paragraph 179 of the RAG, the approved regional aid map is to be published in the Official Journal of the European Union, and will constitute an integral part of the RAG. (2) By letter dated 16 January 2014, registered at the Commission on 16 January 2014 (2014/004765), the French authorities duly notified a proposal for the regional aid map of France for the period from 1 July 2014 to 31 December 2020. (3) On 14 February 2014 the Commission requested additional information (2014/016613), which was provided by the French authorities on 11 March 2014 (2014/027539), on 25 March 2014 (2014/033926) and on 2 April 2014 (2014/037495). 1 OJ C 209, 23.07.2013, p.1 Son Excellence Monsieur Laurent FABIUS Ministre des Affaires étrangères et du Développement international 37, Quai d'Orsay F - 75351 – PARIS Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium Telephone: 00- 32 (0) 2 299.11.11. -

En — 01.10.2003 — 002.001 — 1
2000D0339 — EN — 01.10.2003 — 002.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COMMISSION DECISION of 7 March 2000 listing the areas of France eligible under Objective 2 of the Structural Funds in the period 2000 to 2006 [notified under document number C(2000) 553] (Only the French text is authentic) (2000/339/EC) (OJ L 123, 24.5.2000, p. 1) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Commission Decision 2001/202/EC of 21 February 2001 L 78 42 16.3.2001 ►M2 Commission Decision 2003/679/EC of 26 September 2003 L 249 59 1.10.2003 2000D0339 — EN — 01.10.2003 — 002.001 — 2 ▼B COMMISSION DECISION of 7 March 2000 listing the areas of France eligible under Objective 2 of the Struc- tural Funds in the period 2000 to 2006 [notified under document number C(2000) 553] (Only the French text is authentic) (2000/339/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Community, Having regard to Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds (1), and in particular the first subparagraph of Article 4(4) thereof, After consulting the Advisory Committee on the Development and Conversion of Regions, the Committee on Agricultural Structures and Rural Development and the Management Committee for Fisheries and Aquaculture, Whereas: (1) Point 2 of the first subparagraph of Article 1 of Regulation (EC) No 1260/1999 provides that Objective 2 of the Structural Funds is to support the economic and social conversion of areas facing structural difficulties.