Histoire De Saint Python
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
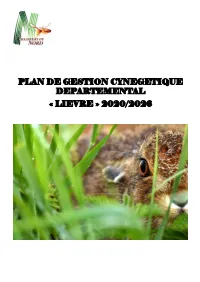
PGCA Lièvre 2020-2026
PLAN DE GESTION CYNEGETIQUE DEPARTEMENTAL « LIEVRE » 2020/2026 Un plan de gestion cynégétique lièvre existe sur l’ensemble du département du Nord depuis 2009. En 2015, et à partir des cartes d’attributions et de réalisations des 6 premières années d’exercice, la Fédération des Chasseurs du Nord a divisé le département en 20 unités de gestion cohérentes de l’espèce tout en respectant les limites des régions agricoles. Suite aux résultats positifs de ce dispositif de gestion au cours du PGCA 2015-2020 (cf graphique d’évolution des attributions départementales ci-dessous et indicateurs de suivi détaillés dans chacune des unités de gestion ci-après), nous proposons de maintenir ce découpage géographique pour les 6 prochaines années d’exercice. Evolution des attributions de bracelets de lièvres sur le département du Nord 70000 65200 65000 62423 60000 57638 55248 56399 53585 55000 50000 45000 40000 35000 30000 Année Année Année Année Année Année 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 20 unités de gestion lièvres dans le département : - Flandre maritime : UGL1, - Flandre intérieure: UGL2, UGL3, UGL4 et UGL5, - Plaine de la Lys : UGL6, - Région de Lille : UGL7, - Pévèle : UGL8, - Plaine de la Scarpe et de l’Escaut : UGL9 et UGL10, - Cambrésis : UGL12, UGL13 et UGL14, - Hainaut : UGL11, UGL15, UGL16, UGL17 et UGL18, - Thiérache : UGL19 et UGL20. Éligibilité du plan de gestion lièvre Le plan de gestion départemental « Lièvre » décliné sur chaque unité de gestion est approuvé pour six années par un arrêté préfectoral après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS). -

Tryptique Plateforme-Sante 2017.Pdf
ASSOCIATION ACTION : 7, rue du 19 mars 1962 SITUATION S DE S ANTÉ PRÉCAIRE ET /OU 59129 Avesnes les Aubert OB S TACLE S À L’EMPLOI : N ACCOMPAGNEMENT DAN S LA PRI S E Téléphone : 03.27.82.29.82 - Télécopie : 03.27.82.29.89 PROJET EMPLOI PLATEFORME SANTÉ U Courriel : [email protected] EN COMPTE ET LA RÉ S OLUTION . Site Internet : www.association-action.org La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Plateforme Santé - Territoire d'intervention 2017 LEGENDE : Limite de Communauté (Constitutions - 1946) Limite de Commune SOMMAING VENDEGIES UTPAS Cambrai Marcoing SUR ECAILLON HEM BERMERAIN AUBENCHEUL PAILLENCOURT UTPAS Avesnes- Solesmes LENGLET AU BAC FRESSIES SAINT MARTIN ESTRUN SAULZOIR CAPELLE UTPAS Caudry-Le Cateau SUR ECAILLON ACTION ABANCOURT BANTIGNY THUN VILLERS MONTRECOURT IWUY L'EVEQUE EN CAUCHIES ESCARMAIN BLECOURT THUN HAUSSY Réalisation CUVILLERS SAINT MARTIN ESWARS VERTAIN SANCOURT HAYNECOURT SAINT AUBERT CC du Pays du Solesmois RAMILLIES NAVES RIEUX SAILLY TILLOY ROMERIES SAINT LEZ CAMBRAI LEZ CAMBRAI SAINT-VAAST PYTHON RAILLENCOURT ESCAUDOEUVRES AVESNES-LES- STE OLLE NEUVILLE CAGNONCLES AUBERT SAINT-HILAIRE ST REMY LEZ CAMBRAI BEAURAIN SOLESMES FONTAINE CAUROIR BOUSSIERES NOTRE DAME CARNIERES CAMBRAI MOEUVRES BEVILLERS QUIEVY ANNEUX PROVILLE AWOINGT VIESLY BRIASTRE ESTOURMEL CANTAING CA de Cambrai BETHENCOURT /ESCAUT BOURSIES NOYELLES NIERGNIES BEAUVOIS /ESCAUT CATTENIERES NEUVILLY DOIGNIES RUMILLY FONTAINE AU BEAUMONT FLESQUIERES -

ARC-EN-CIEL 2020 Schematique A2
vers vers Libercourt 203 206 vers Lille 201 vers Villeneuve d'Ascq vers Valenciennes BREBIERES CORBEHEM COURCHELETTES LAMBRES Lille LEZ DOUAI 207 vers Orchies RÉSEAU D’AUTOCARS DOUAI COROT DES HAUTS-DE-FRANCE 320 325 ABSCON Lycée SECTEUR NORD Polyvalent 6 MariannesEscaudainPlace StadeMarceauClg Félicien1/4 de CitéJoly6 heures HeurteauEgliseCambrésisMerrheimSalle (Forge) BaudinCheminCollège LatéralGare Bayard duErnestine NordDenain311 Hôpital Place Gare de Somain CAMBRÉSIS-SOLESMOIS Cité BonDéchetterie secoursLe ParcPlace Citédes hérosBrisseRésidenceSupermarché MolièreFaconSalle rue du desGrand pont SportsPlace CarréAxter StadeTennisMairieClémenceauSaint-AméLe Châtelier BoulevardRue Pasteur de ParisDe Gaulle Place Carnot Lycée Kästler CAUDRÉSIS-CATÉSIS Edmond Labbé Place ESCAUDAIN HORNAING DENAIN Pont de l'enclos septembre 2020 311 Les Baillons Saint-Pé Rue de Férin 4 Chemins Gare Place 4 Chemins Rond Point 1 Place Bocca Mairie FAMARS UNIVERSITÉ Gare de Douai Delforge Joliot Curie ANICHE 341 EMERCHICOURT SOMAIN Barbusse 303303E 303 333 420 RN vétérinaire Porte de Lycée Église 201 311 DENAIN Monsieur GayantRimbaud MONCHECOURT Collège E Litrée du Raquet FENAIN DOUCHY LES MINES ESPACE VILLARS FAMARS Marbrier VITRY Église BOUCHAIN PLACE ANICHE Mairie Annexe EN ARTOIS DECHY MARCQ EN 340 BOUCHAIN Parrain 311 334 Mineur Mairie COLLÈGE MONOD Maréchal Foch GOUY SOUS DOUAI OSTREVENT Centre Place 341 rue Pasteur NOYELLES SUR SELLE Rue de sailly BELLONNE SIN Église Wignolle LedieuPlace Moulin Cimetière Les 3 Bouleaux Rue Férin LE NOBLE Place Suzanne -

Parc Éolien Chemin D'avesnes-À-Iwuy
Parc éolien Chemin d’Avesnes-à-Iwuy Commune de Iwuy Investissez dans une énergie propre, produite et consommée localement, financée par une épargne citoyenne. Le financement participatif, qu’est-ce que c’est ? Aussi appelé « crowdfunding », il permet aux particuliers de soutenir des initiatives et de donner du sens à leur épargne en finançant des projets à impact positif. Pourquoi prendre part au financement participatif ? Impliquez-vous dans le développement durable de votre territoire, Valorisez votre épargne responsable, Bénéficiez directement en tant que citoyen des retombées du parc éolien. Les habitants d’Avesnes-le-Sec et Iwuy ont la priorité ! - Accès réservé pendant 15 jours dès le 1er mai* - Bénéficiez d’un taux préférentiel Rendez-vous sur www.lumo-france.com/projets/vents-d-avesnes Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! *Ouvert ensuite à partir du 15 mai aux communes environnantes de Avesnes les Aubert, Paillencourt, Estrun, Thun L'Eveque, Eswars, Ramillies, Escaudoeuvres, Cauroir, Cagnoncles, Carnières, Boussieres en Cambrésis, Saint Hilaire lez Cambrai, Saint Vaast en Cambrésis, Saint Aubert, Rieux en Cambrésis, Naves, Thun Saint Martin, Hordain, Lieu Saint Amand, Villers en Cauchies, Saulzoir, Montrécourt, Haspres, Noyelles sur Selle, Wavrechain sous Faulx, Bouchain, Wasnes sur Bac, Neuville sur Escaut, Douchy les Mines. Un projet éolien participatif Un projet en faveur de la transition énergétique Iwuy , Hauts-de-France (59) 4 nouvelles éoliennes La collecte Vents d’Avesnes 43 000 000 kWh énergie produite / an Objectif : 3 440 tonnes eq. CO2 évitées / an 300 000 € Montant de l’investissement : Ces nouvelles éoliennes permettront d’alimenter de 50 € à 7 000 € nouveaux foyers en électricité verte par an ! Durée de l’investissement 4 ans Qui peut investir ? Les particuliers. -

Cadre D'action Stratégique
SOMMAIRE Département du Nord – Cambrésis Cadre d’Action Stratégique Contrat d'Aménagement et de Développement Durables du Cambrésis SOMMAIRE SOMMAIRE Signé à Caudry, SOMMAIRE le 24/ 02/ 2011 Bernard DEROSIER François-Xavier VILLAIN Jacques OLIVIER Président du Conseil général du Nord Président de la Communauté Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai de Communes Espace Sud Cambrésis Maire de CAMBRAI Maire de BERTRY 4 Gérard DEVAUX Marc DUFRENNE Président de la Communauté Président de la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis de Communes de Haute Sambre - Bois l’Evêque Maire de BEAUVOIS-EN-CIS Maire de LE POMMEREUIL Anne-Marie DUCHEMIN Gérard ALLART Présidente de la Communauté Président de la Communauté de Communes de l’Enclave de Communes des Hauts du Cambrésis Maire de MŒUVRES Maire de VILLERS-GUISLAIN SOMMAIRE Yves MARECAILLE Colette DESSAINT Francis ALDEBERT Président de la Communauté Présidente de la Communauté Président de la Chambre de Commerce de Communes de l’Ouest Cambrésis de Communes de la Vacquerie et d’Industrie Nord de France Maire de BANTIGNY Maire de MASNIERES 5 Michel WALLERAND Marcel DUCHEMIN Jean-Bernard BAYARD Président de la Communauté Président de la Communauté Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Communes du Pays du Solesmois de Communes de la Vallée de Vinchy du Nord-Pas-de-Calais Maire de VENDEGIES-SUR-ECAILLON Maire de LES-RUES-DES-VIGNES Jacques DENOYELLE François-Xavier VILLAIN Alain GRISET Président de la Communauté Président du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis Président -

Horaires Valables Du 01/09/2016 Au 31/08/2017
En correspondance avec les réseaux Horaires valables du 01/09/2016 au 31/08/2017 TARIFS 301 Le Cateau - Cambrai Retrouvez la gamme tarifaire sur www.arcenciel3.fr Course numéro 1 3 5 7 9 11 13 25 15 17 19 23 21 sur le site internet du Département du Nord lenord.fr L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me Jours de circulation DF DF M DF ou contactez-nous au J V J V S J V S J V J V S J V S J V J V J V S Particularités le 15/08 LE CATEAU CAMBRESIS Gare 05:45 06:30 07:00 07:35 08:35 12:55 09:00 14:00 14:00 17:00 Achetez vos titres LE CATEAU CAMBRESIS Octroi Boyer 05:46 06:31 07:01 07:36 08:36 12:56 09:01 14:01 14:01 17:01 TITRES DE TRANSPORT LE CATEAU CAMBRESIS Gare routière 05:50 06:40 07:10 07:45 08:45 13:0517:15 17:15 18:15 09:08 14:08 14:08 17:08 Pour recharger vos supports sans contact Pass Pass et rechargez votre carte pass pass nominative en ligne LE CATEAU CAMBRESIS Faubourg de Cambrai 05:53 06:43 07:13 07:48 08:48 13:08 17:18 17:18 18:18 09:10 14:10 14:10 17:10 (carte nominative, déclarative, anonyme TROISVILLES Carrefour 06:5007:20 07:55 08:55 13:1517:25 17:25 18:25 09:17 14:17 14:17 17:17 ou billet sans contact) en vous connectant TROISVILLES Eglise 06:5107:21 07:56 08:56 13:1617:26 17:26 18:26 09:18 14:18 14:18 17:18 ou obtenir un billet sans contact, rendez-vous sur arcenciel3.fr dans l’un des points de vente Arc en Ciel 3 suivants : TROISVILLES Chapelle 06:5207:22 07:57 08:57 13:1717:27 17:27 18:27 09:19 14:19 14:19 17:19 INCHY Eglise 05:58 06:5807:28 08:04 09:04 13:2317:33 17:34 18:33 09:23 14:23 14:23 -

LISTE-DES-ELECTEURS.Pdf
CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE N° Ordinal MADAME ABBAR AMAL 830 A RUE JEAN JAURES 59156 LOURCHES 62678 MADAME ABDELMOUMEN INES 257 RUE PIERRE LEGRAND 59000 LILLE 106378 MADAME ABDELMOUMENE LOUISA 144 RUE D'ARRAS 59000 LILLE 110898 MONSIEUR ABU IBIEH LUTFI 11 RUE DES INGERS 07500 TOURNAI 119015 MONSIEUR ADAMIAK LUDOVIC 117 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE 80384 MONSIEUR ADENIS NICOLAS 42 RUE DU BUISSON 59000 LILLE 101388 MONSIEUR ADIASSE RENE 3 RUE DE WALINCOURT 59830 WANNEHAIN 76027 MONSIEUR ADIGARD LUCAS 53 RUE DE LA STATION 59650 VILLENEUVE D ASCQ 116892 MONSIEUR ADONEL GREGORY 84 AVENUE DE LA LIBERATION 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 12934 CRF L'ESPOIR DE LILLE HELLEMMES 25 BOULEVARD PAVE DU MONSIEUR ADURRIAGA XIMUN 59260 LILLE 119230 MOULIN BP 1 MADAME AELVOET LAURENCE CLINIQUE DU CROISE LAROCHE 199 RUE DE LA RIANDERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL 43822 MONSIEUR AFCHAIN JEAN-MARIE 43 RUE ALBERT SAMAIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35417 MADAME AFCHAIN JACQUELINE 267 ALLEE CHARDIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35416 MADAME AGAG ELODIE 137 RUE PASTEUR 59700 MARCQ EN BAROEUL 71682 MADAME AGIL CELINE 39 RUE DU PREAVIN LA MOTTE AU BOIS 59190 MORBECQUE 89403 MADAME AGNELLO SYLVIE 77 RUE DU PEUPLE BELGE 07340 colfontaine 55083 MONSIEUR AGNELLO CATALDO Centre L'ADAPT 121 ROUTE DE SOLESMES BP 401 59407 CAMBRAI CEDEX 55082 MONSIEUR AGOSTINELLI TONI 63 RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT 59750 FEIGNIES 115348 MONSIEUR AGUILAR BARTHELEMY 9 RUE LAMARTINE 59280 ARMENTIERES 111851 MONSIEUR AHODEGNON DODEME 2 RUELLE DEDALE 1348 LOUVAIN LA NEUVE - Belgique121345 MONSIEUR -

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Ce Document Complète Le Cahier Des Clauses Administratives Générales « Prestations Intellectuelles »
1 ETUDE INTERCOMMUNALE POUR LA VALORISATION DU CADRE DE VIE EN PAYS SOLESMOIS CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Ce document complète le Cahier des Clauses Administratives Générales « Prestations intellectuelles » Novembre 2011 Cahier des Clauses Particulières / étude intercommunale pour la valorisation du cadre de vie en Pays Solesmois –CCPS – Novembre 2011 2 CONTEXTE DE L’ETUDE PRESENTATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES Situation géographique et composition La Communauté de Communes du Pays Solesmois (CCPS) est située dans la partie sud du département du Nord, à l’est de l’arrondissement de Cambrai. Elle a vu le jour dans sa configuration actuelle le 1 er janvier 2003 et regroupe 15 communes qui sont partie intégrante du canton de Solesmes : Beaurain, Bermerain, Capelle, Escarmain, Haussy, Montrécourt, Romeries, Saint Martin sur Ecaillon, Saint Python, Saulzoir, Solesmes, Sommaing, Vendegies sur Ecaillon, Vertain, Viesly. La population totale est de plus de 14 700 habitants. Le territoire a intégré le Pays du Cambrésis à l’échelle duquel un schéma de cohérence territoriale, un schéma « Trame verte et bleue » et un Plan climat territorial sont mis en œuvre. Le SCOT du Cambrésis, en phase d’arrêt de projet, impose depuis plusieurs années une réflexion sur la consommation d’espaces qui se traduit par l’attribution d’un « compte foncier » aux communes. Ce dernier pourrait âtre mutualisé à l’échelle communautaire dans le cadre de l’élaboration d’un PLU intercommunal (voir plus loin). La compétence « Gestion des PLU » et les actions menées La Communauté de communes du Pays Solesmois assure la compétence « Elaboration, révision et modification des Plan Locaux d’Urbanisme et des cartes communales » depuis sa création. -

Communes Par Taille
Liste des communes éligibles au volet "voirie communale" de l'ADVB Pop municipale Arrondisseme Nom commune au 1er janvier EPCI nt 2019 ABANCOURT Cambrai 461 CAC - CA de Cambrai AIX-LEZ-ORCHIES Douai 1 185 CCPC - CC Pévèle- Carembault AMFROIPRET Avesnes 228 CCPM - CC du Pays de Mormal ANHIERS Douai 904 DA - Douaisis Agglo ANNEUX Cambrai 279 CAC - CA de Cambrai ARTRES Valenciennes 1 053 CAVM - CA Valenciennes Métropole AUBENCHEUL-AU-BAC Cambrai 530 CAC - CA de Cambrai AUBIGNY-AU-BAC Douai 1 184 DA - Douaisis Agglo AUBRY-DU-HAINAUT Valenciennes 1 651 CAVM - CA Valenciennes Métropole AUCHY-LEZ-ORCHIES Douai 1 532 CCPC - CC Pévèle- Carembault AUDIGNIES Avesnes 357 CCPM - CC du Pays de Mormal AVESNES-LE-SEC Valenciennes 1 470 CAPH - CA de la Porte du Hainaut AWOINGT Cambrai 844 CAC - CA de Cambrai BACHY Lille 1 690 CCPC - CC Pévèle- Carembault BAIVES Avesnes 165 CCSA - CC du Sud Avesnois BANTEUX Cambrai 341 CAC - CA de Cambrai BANTIGNY Cambrai 507 CAC - CA de Cambrai BANTOUZELLE Cambrai 420 CAC - CA de Cambrai BAS-LIEU Avesnes 353 CCCA - CC Coeur de l'Avesnois BAZUEL Cambrai 533 CA2C - CA du Caudrésis et du Catésis BEAUDIGNIES Avesnes 563 CCPM - CC du Pays de Mormal BEAUMONT-EN-CAMBRESIS Cambrai 448 CA2C - CA du Caudrésis et du Catésis BEAURAIN Cambrai 231 CCPS - CC du Pays Solesmois BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE Avesnes 257 CCCA - CC Coeur de l'Avesnois BEAURIEUX Avesnes 165 CCCA - CC Coeur de l'Avesnois BELLAING Valenciennes 1 225 CAPH - CA de la Porte du Hainaut BELLIGNIES Avesnes 833 CCPM - CC du Pays de Mormal BERELLES Avesnes 149 CCCA - CC Coeur -
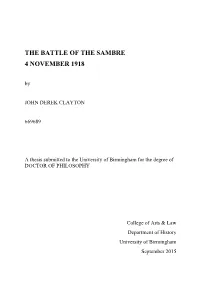
THE BATTLE of the SAMBRE 4 NOVEMBER 1918 By
THE BATTLE OF THE SAMBRE 4 NOVEMBER 1918 by JOHN DEREK CLAYTON 669689 A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY College of Arts & Law Department of History University of Birmingham September 2015 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Acknowledgements The completion of a PhD thesis can be at times a solitary occupation: the completion of this one would never have been possible, however, without help from a number of sources on the way. My thanks go particularly to my supervisor, Dr John Bourne, for his direction, support, encouragement and unfailingly wise counsel. I would also thank Professor Peter Simkins who supervised my MA dissertation and then suggested the Battle of the Sambre as a subject ripe for further study. He then kindly supplied data on the performance of divisions in the Hundred Days and permitted me to use it in this work. Thanks must also go to the staffs of the National Archive, the Imperial War Museum and the Bundesarchiv – Militärarchiv in Freiburg. Fellow PhD students have been a constant source of friendship and encouragement: my grateful thanks to Geoff Clarke, who allowed me to use some of his doctoral research on logistics, and to Trevor Harvey, Peter Hodgkinson, Alison Hine and Michael LoCicero. -

ÉTÉ 2021 Bouchain
MINI-CAMPS Ouverture uniquement en fonction de l’évolution de la crise sanitaire Centre Départemental du Bassin Rond (9-11 ans)* Dates des mini-camps de juillet Du 19 au 21 Du 21 au 23 Du 26 au 28 Accueils de Loisirs du Pays Solesmois De 3 à 15 ans Saint-Python Viesly Haussy Escarmain Solesmes Saulzoir Bermerain source .facebook.com/bassin.rond .facebook.com/bassin.rond source Labellisé Ecole Française de Voile (E.F.V.), le centre et son parc verdoyant sont situés à ÉTÉ 2021 Bouchain. Activités dominantes : Initiation à la voile et au kayak, séance de tir à l’arc, soirées à thèmes, jeux de plein air… Camping à la Base de loisirs de la Frette (12-15 ans) * Du 12 au 30 juillet Dates des mini-camps de juillet Du 12 au 16 Du 19 au 23 Du 26 au 30 Haussy Viesly Solesmes Saulzoir Bermerain Saint-Python Escarmain 7 structures d’accueils Avec un vaste plan d’eau de 32 hectares navigable en totalité, une plage de sable blanc De 9h à 17h avec restauration de 20 000 m2, un toboggan aquatique et des jeux pour petits et grands, la base de loisirs (Possibilité de garderies matin et soir) de la Frette dispose de tous les plaisirs de l’eau dans un environnement préservé au cœur de l’Aisne ! Activités dominantes : Initiation au Catamaran, Pédalo, Mini golf Fonctionnement Hébergement sous tentes légères de deux ou trois places. Les repas sont cuisinés par l’équipe selon la réglementation en vigueur. Les journées se terminent par une veillée. -

Rapport De Présentation PLU Solesmes
P.L.U. de SOLESMES Rapport de présentation PREAMBULE Le Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans le cadre des documents d’urbanisme prévus par les lois n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, n°2003-590, du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat et par le décret n°2004-531 du 9 juin 2004. Le Plan d’Occupation des Sols de Solesmes a été approuvé le 08 août 1979. Il a depuis lors fait l’objet de plusieurs procédures de révision générale, mise à jour, modification et révision simplifiée. Compte tenu des dispositions offertes par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, le Département, la Région et l’État, le conseil municipal a décidé, le 13 décembre 2001, de lancer l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune, celui-ci s’inscrit donc dans les dispositions du Grenelle I de l’Environnement. Cités et Paysages 4 P.L.U. de SOLESMES Rapport de présentation PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’E NVIRONNEMENT Cités et Paysages 5 P.L.U. de SOLESMES Rapport de présentation SECTION I : DONNEES DE BASES ET ANALYSE DE L ’E XISTANT Cités et Paysages 6 P.L.U. de SOLESMES Rapport de présentation SITE ET SITUATION I.) Situation La commune de Solesmes se localise dans le département du Nord. Elle s’étend sur une superficie de 2325 ha dans l’est du Cambrésis.