Jacques Mesrine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download Press Notes
Strand Releasing presents CECILE DE FRANCE - PATRICK BRUEL - LUDIVINE SAGNIER JULIE DEPARDIEU - MATHIEU AMALRIC A SECRET A FILM BY CLAUDE MILLER Based on the Philippe Grimbert novel "Un Secret" (Grasset & Fasquelle), English translation : "Memory, A Novel" (Simon and Schuster) Winner : 2008 César Award for Julie Depardieu (Best Actress in a Supporting Role) Grand Prix des Amériques, 2007 Montreal World Film Festival In French with English subtitles 35mm/1.85/Color/Dolby DTS/110 min NY/National Press Contact: LA/National Press Contact: Sophie Gluck / Sylvia Savadjian Michael Berlin / Marcus Hu Sophie Gluck & Associates Strand Releasing phone: 212.595.2432 phone: 310.836.7500 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Please download photos from our website: www.strandreleasing.com/pressroom/pressroom.asp 2 CAST Tania Cécile DE FRANCE Maxime Patrick BRUEL Hannah Ludivine SAGNIER Louise Julie DEPARDIEU 37-year-old François Mathieu AMALRIC Esther Nathalie BOUTEFEU Georges Yves VERHOEVEN Commander Beraud Yves JACQUES Joseph Sam GARBARSKI 7-year-old Simon Orlando NICOLETTI 7-year-old François Valentin VIGOURT 14-year-old François Quentin DUBUIS Robert Robert PLAGNOL Hannah's mother Myriam FUKS Hannah's father Michel ISRAEL Rebecca Justine JOUXTEL Paul Timothée LAISSARD Mathilde Annie SAVARIN Sly pupil Arthur MAZET Serge Klarsfeld Eric GODON Smuggler Philippe GRIMBERT 2 3 CREW Directed by Claude MILLER Screenplay, adaptation, dialogues by Claude MILLER and Natalie CARTER Based on the Philippe -

A Dangerous Method
A David Cronenberg Film A DANGEROUS METHOD Starring Keira Knightley Viggo Mortensen Michael Fassbender Sarah Gadon and Vincent Cassel Directed by David Cronenberg Screenplay by Christopher Hampton Based on the stage play “The Talking Cure” by Christopher Hampton Based on the book “A Most Dangerous Method” by John Kerr Official Selection 2011 Venice Film Festival 2011 Toronto International Film Festival, Gala Presentation 2011 New York Film Festival, Gala Presentation www.adangerousmethodfilm.com 99min | Rated R | Release Date (NY & LA): 11/23/11 East Coast Publicity West Coast Publicity Distributor Donna Daniels PR Block Korenbrot Sony Pictures Classics Donna Daniels Ziggy Kozlowski Carmelo Pirrone 77 Park Ave, #12A Jennifer Malone Lindsay Macik New York, NY 10016 Rebecca Fisher 550 Madison Ave 347-254-7054, ext 101 110 S. Fairfax Ave, #310 New York, NY 10022 Los Angeles, CA 90036 212-833-8833 tel 323-634-7001 tel 212-833-8844 fax 323-634-7030 fax A DANGEROUS METHOD Directed by David Cronenberg Produced by Jeremy Thomas Co-Produced by Marco Mehlitz Martin Katz Screenplay by Christopher Hampton Based on the stage play “The Talking Cure” by Christopher Hampton Based on the book “A Most Dangerous Method” by John Kerr Executive Producers Thomas Sterchi Matthias Zimmermann Karl Spoerri Stephan Mallmann Peter Watson Associate Producer Richard Mansell Tiana Alexandra-Silliphant Director of Photography Peter Suschitzky, ASC Edited by Ronald Sanders, CCE, ACE Production Designer James McAteer Costume Designer Denise Cronenberg Music Composed and Adapted by Howard Shore Supervising Sound Editors Wayne Griffin Michael O’Farrell Casting by Deirdre Bowen 2 CAST Sabina Spielrein Keira Knightley Sigmund Freud Viggo Mortensen Carl Jung Michael Fassbender Otto Gross Vincent Cassel Emma Jung Sarah Gadon Professor Eugen Bleuler André M. -

The Phenomenological Aesthetics of the French Action Film
Les Sensations fortes: The phenomenological aesthetics of the French action film DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Matthew Alexander Roesch Graduate Program in French and Italian The Ohio State University 2017 Dissertation Committee: Margaret Flinn, Advisor Patrick Bray Dana Renga Copyrighted by Matthew Alexander Roesch 2017 Abstract This dissertation treats les sensations fortes, or “thrills”, that can be accessed through the experience of viewing a French action film. Throughout the last few decades, French cinema has produced an increasing number of “genre” films, a trend that is remarked by the appearance of more generic variety and the increased labeling of these films – as generic variety – in France. Regardless of the critical or even public support for these projects, these films engage in a spectatorial experience that is unique to the action genre. But how do these films accomplish their experiential phenomenology? Starting with the appearance of Luc Besson in the 1980s, and following with the increased hybrid mixing of the genre with other popular genres, as well as the recurrence of sequels in the 2000s and 2010s, action films portray a growing emphasis on the importance of the film experience and its relation to everyday life. Rather than being direct copies of Hollywood or Hong Kong action cinema, French films are uniquely sensational based on their spectacular visuals, their narrative tendencies, and their presentation of the corporeal form. Relying on a phenomenological examination of the action film filtered through the philosophical texts of Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Mikel Dufrenne, and Jean- Luc Marion, in this dissertation I show that French action cinema is pre-eminently concerned with the thrill that comes from the experience, and less concerned with a ii political or ideological commentary on the state of French culture or cinema. -

Quelques Réflexions Autour De La Littérature-Mesrine Benoît Denis
Document generated on 09/28/2021 3:05 a.m. Études françaises Faire de sa vie une oeuvre d’art paralittéraire Quelques réflexions autour de la littérature-Mesrine Benoît Denis Les exceptions françaises (1958-1981) Article abstract Volume 47, Number 1, 2011 Shot down on the Day of the Dead in 1979 by the anti-gang brigade of Commissioner Broussard, gangster Jacques Mesrine has long made headlines URI: https://id.erudit.org/iderudit/1002521ar and is currently a mythic figure. One of the reason for this posterity is DOI: https://doi.org/10.7202/1002521ar doubtless due to the gangster’s capacity to place himself in the center of an intense textual production, the core being his own autobiography, significantly See table of contents titled L’instinct de mort (1974). Mesrine’s trajectory, devised by the protagonist as a choice turning his life into a destiny whose end is immediately known, and the constant staging of himself that accompanies it, submits fully to a pre-existing collective narrative, a vast paraliterary intertext that Foucault Publisher(s) calls the “monotonous saga of major criminals.” The aim of this contribution is Les Presses de l’Université de Montréal to show that in the specific circumstances of the Giscardian and Pompidolian years, the “Mesrine-novel” mobilizes two opposing figures : that of the “outlaw,” presented as the ultimate incarnation of the romantic adventurer, ISSN and that of the “public enemy,” which transforms individual revolt into a 0014-2085 (print) political cause. 1492-1405 (digital) Explore this journal Cite this article Denis, B. (2011). Faire de sa vie une oeuvre d’art paralittéraire : quelques réflexions autour de la littérature-Mesrine. -

Deuxième Secrétaire De La Conférence Le Procès De Mesrine, L
1 RENTREE SOLENNELLE DE LA CONFERENCE DU STAGE 21 NOVEMBRE 2003 DISCOURS DE M. SÉBASTIEN BONO Deuxième Secrétaire de la Conférence Le Procès de Mesrine, l’homme que vous aimerez détester A Mme Stéphane Haziza, Aux Seconds Secrétaires, A la promotion 2003 de la Conférence Il y a les hommes que l’on aime. Il y a les hommes que l’on déteste. Et puis, il y a l’homme que vous aimerez détester. Mais cet homme-là, comment l’imaginez-vous ? Sur la photo de son passeport, Porte-t-il la barbiche des grands soirs, cheveux en bataille sur blouson de cuir noir ? Serait-il bien plus haïssable crâne chauve, tempes chenues, lunettes aux carreaux clairs sur complet bleu ? Le voyez-vous plutôt bacchantes élégantes, cheveux bruns coupés ras, mâchoires volontaires sur col roulé de laine sombre ? Aurait-il davantage le faciès d’un impresario argentin. Fumant cigarillo, cheveux gominés tombant sur le cou, chemise blanche, cravate de soie havane et argent ? Vous le voulez… libre, col ouvert, ténébreux, moustache broussailleuse, épaisse, généreuse, gauloise qui ne connaît pas le feu du rasoir ? L’imaginez-vous plutôt furtif et fugitif dans le brouillard, en gabardine, col relevé. Impression d’élégance, noir et blanc, impeccable et insaisissable ? Méfiez-vous… Méfiez-vous… Méfiez-vous encore et toujours ! 2 Car l’homme que vous aimerez détester a tous ces visages. Il a vos gestes, vos traits, vos manies. Il peut voir le monde par cent yeux à la fois mais il n’est pas de votre monde. Il appartient à l’autre partie de l’humanité, Terra incognita, celle de l’ombre, de la face cachée de ces mille visages… Vous, Monsieur le Maire de Paris1, Mesdames et messieurs les Magistrats, Monsieur le Bâtonnier, Mesdames et Messieurs, Mes Chers confrères, Et vous, amis, Vous savez, qu’il n’est pas besoin de juges pour que deux avocats qui prennent la parole, choisissent leur camp et tentent de vous convaincre de leur parti. -

To Our Friends-The Invisible Committe
To our friends The Invisible Committe October 2014 Contents 1: Merry Crisis and Happy New Fear 8 1. Crisis Is a Mode of Government. ................................ 8 2. The Real Catastrophe Is Existential and Metaphysical. .................... 9 3. The Apocalypse Disappoints .................................. 12 2: They Want to Oblige Us to Govern. We Won’t Yield to that Pressure 15 1. Characteristic Features of Contemporary Insurrections. ................... 15 2. There’s No Such Thing as a Democratic Insurrection. .................... 18 3. Democracy Is Just Government in Its Pure State. ....................... 22 4. Theory of Destitution. ...................................... 25 3: Power is Logistic. Block Everything! 28 1. Power Now Resides in Infrastructures. ............................ 28 2. On the Difference Between Organizing and Organizing Oneself. 30 3. On Blockage. ........................................... 31 4. On Investigation. ........................................ 32 4: Fuck Off Google 35 1. There are no “Facebook revolutions”, but there is a new science of government, cybernetics . 35 2. War against all things smart! .................................. 38 3. The Poverty of Cybernetics .................................... 40 4. Techniques against Technology. ................................. 41 5: let’s disappear 45 1: A Strange Defeat ........................................ 45 2. Pacifists and Radicals - an infernal couple ........................... 46 3. Government as counter-insurgency ............................. -
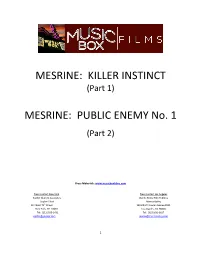
Killer Instinct Mesrine
MESRINE: KILLER INSTINCT (Part 1) MESRINE: PUBLIC ENEMY No. 1 (Part 2) Press Materials: www.musicboxfilms.com Press Contact New York Press Contact Los Angeles Sophie Gluck & Associates Marina Bailey Film Publicity Sophie Gluck Marina Bailey 124 West 79th Street 1615 North Laurel Avenue #201 New York, NY 10024 Los Angeles, CA 90046 Tel: (212) 595-2432 Tel: (323) 650-3627 [email protected] [email protected] 1 MESRINE: KILLER INSTINCT (Part 1) Winner – 3 César Awards Best Actor, Best Director, Best Sound Starring - Vincent Cassel, Gérard Depardieu, Cécile de France, Roy Dupuis, Gilles Lellouche, Elena Anaya, Ludivine Sagnier Based on the Book L’instinct de mort by Jacques Mesrine Screenplay by Abdel Raouf Dafri Written by Jean-François Richet and Abdel Raouf Dafri Produced by Thomas Langmann Directed by Jean-François Richet Running Time: Part 1 – 113 minutes MPAA Rating: R (for strong brutal violence, some sexual content and language) SYNOPSIS Across Canada, the United States and Spain, through France and Algeria, Mesrine: Killer Instinct tells the story of the incredible rise of one of history’s greatest gangsters. Always on the run, a renegade existence only a bullet can stop. MESRINE: KILLER INSTINCT - the first of two parts - charts the outlaw odyssey of Jacques Mesrine (Vincent Cassel), the legendary French gangster of the 1960s and 1970s who came to be known as French Public Enemy No. 1 and The Man of a Thousand Faces. Infamous for his bravado and outrageously daring prison escapes, Mesrine carried out numerous robberies, kidnappings and murders in a criminal career that spanned continents until he was shot dead in 1979 by France's notorious anti- gang unit. -

Stigmata Actions & Performances 1976-2016
\ \ PRESS RELEASE JAN FABRE - › › EXHIBITION STIGMATA — ACTIONS & PERFORMANCES 1976-2016 30.09.16 - 15.01.17 PERFORMANCE ON 29.09.16 WITH EDDY MERCKX AND RAYMOND POULIDOR ACTIONS & — PERFORMANCES 1976-2016 STIGMATA JAN fAbRE Jan Fabre, Sangu is / Manti s, 2001 #janfabrelyon View Sangu is / Manti s performance. 22 May 2001, Subsistances, Lyon Photo: Maarten Vanden Abeele Courtesy Angelos bvba © Adagp, Paris 2016 Musée d’art contemporain T +33 (0)472691717 Press contacts Cité internationale F +33 (0)472691700 Muriel Jaby/Élise Vion-Delphin 81 quai Charles de Gaulle [email protected] T +33 (0)4 72 69 17 05/25 69006 LYON www.mac-lyon.com [email protected] 300 dpi images available on request JAN FABRE, STIGMATA – ACTIONS & PERFORMANCES 1976-2016 83 glass table tops, 800 objects (drawings, photographs, artefacts, costumes, maquettes): 40 years of performances and actions! FROM 30 SEPTEMBER 2016 TO 15 JANUARY 2017 NEW PERFORMANCE ‘An attempt to not beat the world hour record set by Eddy Merckx in Mexico City in 1972 (or how to remain a dwarf in a land of giants)’, with commentary and live fi lming. THURSDAY 29 SEPTEMBER 2016 at 6.00 pm SUMMARY INTRODUCTION BY THIERRY RASPAIL 3 A NEW PERFORMANCE BY JAN FABRE 4 THE EXHIBITION 5 JAN FABRE IN 25 DATES 6 - 7 JAN FABRE: SELECTION OF EXHIBITIONS 8 -9 SELECTION OF WORKS 10 - 16 DOCTOR FABRE WILL CURE YOU BY PIERRE COULIBEUF 17 SIMULTANEOUSLY: 3 EXHIBITIONS 18 PRACTICAL INFORMATION 19 INTRODUCTION BY THIERRY RASPAIL 3 Jan Fabre, the story of the performance, his exhibition, and the world hour record set by Eddy Merckx. -

Kill Jacques, Mesrine, L'instinct De Mort
Kill Jacques, Mesrine, L’Instinct de mort (Crimes écrits 5) – ... https://diacritik.com/2017/07/28/kill-jacques-mesrine-linstinc... ! " + $ " % & Christine Marcandier / 28 juillet 2017 / Crimes écrits (littérature et faits divers), Les mains dans les poches, Livres Kill Jacques, Mesrine, L’Instinct de mort (Crimes écrits 5) Le Parisien 1 sur 13 14/04/2018 à 20:45 Kill Jacques, Mesrine, L’Instinct de mort (Crimes écrits 5) – ... https://diacritik.com/2017/07/28/kill-jacques-mesrine-linstinc... Instinct de mort, mémoires d’outre-tombe de Jacques Mesrine, est publié pour la première fois en 1977 chez Jean-Claude Lattès, du vivant de ! L’ Mesrine donc (il tombera sous les balles de la brigade anti-gangs le 2 novembre 1979) puis en 1984 chez Champ libre. Le texte était devenu introuvable, sinon en version plus ou moins pirate sur Internet. Flammarion l’a ressorti en 2008 à l’occasion de la sortie des deux films de Jean-François Richet, L’Instinct de mort et L’Ennemi public n°1. Il est désormais disponible en poche chez Pocket. L’instinct de mort ou des mémoires d’outre-tombe, donc, puisque les pages de cette autobiographie — dans lesquelles Mesrine crache sa haine d’une société qui ne sait que condamner et de ses lois sur lesquelles il « dégueule » — se donnent comme une vérité, celle d’un homme qui se sait condamné et écrit déjà de l’au-delà. « Je me décidais à écrire un livre sur ma vie en comprenant les graves conséquences qu’il prendrait au moment de mes procès. Mais, ayant atteint le « point zéro » et n’ayant plus rien à perdre, je m’y étais décidé ; [ma fille] m’encouragea à jeter « ma vérité » à la face de la société qui dans peu de temps serait chargée de me juger. -
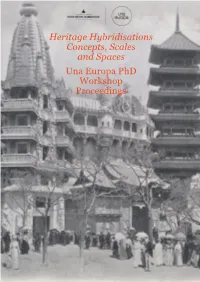
Proceedings of the First Una Europa
Heritage Hybridisations Concepts, Scales and Spaces Una Europa PhD Workshop Proceedings Heritage Hybridizations Conceps, Scales and Spaces Una Europa PhD Workshop Paris 1 Panthéon-Sorbonne May 10-12, 2021 Una Europa: Freie Universität Berlin Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie University of Edinburgh Helsingin Yliopisto KU Leuven Universidad Complutense de Madrid Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Texts sumited by their authors. Editing: Maria Gravari-Barbas & Isidora Stanković Graphic design: Isidora Stanković Paris, May 2021 9 Introductions Explaining the Framework Maria Gravari-Barbas, Alain Duplouy, Dominique Poulot and 10 Isidora Stanković Heritage Hybridizations 13 Maria Gravari-Barbas and Dominique Poulot Inaugural Lecture Conservation, Conversation, and Conflict. Unpacking Hybridity and the Making of Heritage 16 Noémie Étienne 21 Papers of PhD Candidates (i) Political, transnational and community negotiations and 22 heritage hybridisation Far-right Populist PEGIDA and Dresden’s Cultural Heritage: Politics, Ideology, and Hybridization 23 Sabine Volk Presenting the national history of Lebanon after a civil conflict: a heritage hybridisation? 28 Zoé Vannier Prospected heritage manifested through translation criticism – the case of Rocznik Literacki [The Literary Annual] 1932- 1938 32 Joanna Sobesto Terroir as heritage: protected geographical indications and anchoring the Intangible in the race for authenticity 36 Jenny L. Herman “Nos Ancêtres les Aztèques” Representations of the Pre-Columbian past and hybrid national and heritage narratives in 19th century Parisian 40 World Fairs Susana Stüssi Garcia Archiving as Resistance: Remembering Feminist Heritage in the Feminist Art Program 46 Verena Kittel The collection of pre-Columbian artefacts in the Public Museums of Argentina. 51 María Agustina Arnulfo The emergence of a preservation framework for Ottoman architectural vestiges in interwar Greece. -

Autographes Correspondance De Jacques Mesrine
J.J. MATHIAS BARON RIBEYRE & Associés FARRANDO LEMOINE Commissaire-Priseur Judiciaire Commissaires-Priseurs Judiciaires Commissaires-Priseurs Judiciaires S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496 S.V.V. agrément n° 2001-19 S.V.V. agrément n° 2002-074 5, rue de Provence - 75009 PARIS 5, rue de Provence - 75009 PARIS 30Bis, rue Bergère - 75009 PARIS Tél. : 01 47 70 00 36 Tél. : 01 42 46 00 77 Tél. : 01 47 70 50 11 Fax : 01 47 70 22 42 Fax : 01 45 23 22 92 Fax : 01 47 70 19 32 [email protected] [email protected] [email protected] Vente aux enchères publiques Autographes Correspondance de Jacques Mesrine Le Samedi 30 janvier 2010 À 14 heures Salle 8 Paris - Drouot Richelieu Experts : Frédéric et Maryse CASTAING 30, rue Jacob - 75006 Paris Tél. : 01 43 54 91 71 Exposition privée chez l’expert dès la parution du catalogue, sur rendez-vous Contact : SVV BARON RIBEYRE – tél. 01 42 46 00 77 EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’HÔTEL DROUOT : Vendredi 29 janvier de 11 h à 18 heures Samedi 30 janvier de 11 h à 12 heures Samedi 30 janvier 2010 – 1 RR&B_Mesrine_01_2010_32p.indd&B_Mesrine_01_2010_32p.indd 1 88/01/10/01/10 111:24:561:24:56 1 ANNUNZIO (Gabriele d’) écrivain italien (1863-1938) Billet autographe signé à M. Schurmann, son impresario, (s.l.n.d.) 13/10cm. 80/100€ « Bon pour une place. 2me Gioconda (à Mr Schürmann) ». Sa pièce la Joconde fut écrite en 1899. 2 ANOUILH (Jean) (1910-1987) L.A.S. Arcachon, (s.d.) 1p1/2. -

Jacques Vergès, the Devil's Advocate
Jacques Vergès, Devil’s Advocate A Psychohistory of Vergès’ Judicial Strategy Faculty of Law, McGill University, Montreal April 2012 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Civil Law © Jonathan Widell, 2012 Abstract This study undertakes a psychohistory of French criminal defence lawyer Jacques Vergès’ judicial strategy. .His initial articulation of his judicial strategy in his book De la stratégie judiciaire in 1968 continues to inform his legal career, in which he has defended a number of controversial clients, most notably that of Gestapo officer Klaus Barbie in the 1987 trial. Vergès distinguished two types of judicial strategy in his 1968 book: rupture and connivence. Both strategies should be understood out of Vergès’ Marxist influences. This study looks into the coherence of his career in light of his initial articulation of judicial strategy and explores the shift in emphasis of his strategy from the defence of a cause to that of a person. The study adopts a three-level approach. It considers, first, Vergès’ discourse of his strategy, second, the world politics that shaped his discourse, and third, Vergès’ biography. First, Vergès’ strategy grew out of the duality of rupture and connivence and transformed into what we call devil’s advocacy, in which Vergès pits an accused (as an individual) against the justice system. Devil’s advocacy culminated in his defence of Barbie. After his defence of Barbie, Vergès pitted himself against the justice system so that his own notoriety was reflected to his clients rather than the other way around.