Thoueïbat DJOUMBE UN AUTRE ASPECT DE LA FRANCOPHONIE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Centre Souscentreserie Numéro Nom Et Prenom
Centre SousCentreSerie Numéro Nom et Prenom MORONI Chezani A1 2292 SAID SAMIR BEN YOUSSOUF MORONI Chezani A1 2293 ADJIDINE ALI ABDOU MORONI Chezani A1 2297 FAHADI RADJABOU MORONI Chezani A4 2321 AMINA ASSOUMANI MORONI Chezani A4 2333 BAHADJATI MAOULIDA MORONI Chezani A4 2334 BAIHAKIYI ALI ACHIRAFI MORONI Chezani A4 2349 EL-ANZIZE BACAR MORONI Chezani A4 2352 FAOUDIA ALI MORONI Chezani A4 2358 FATOUMA MAOULIDA MORONI Chezani A4 2415 NAIMA SOILIHI HAMADI MORONI Chezani A4 2445 ABDALLAH SAID MMADINA NABHANI MORONI Chezani A4 2449 ABOUHARIA AHAMADA MORONI Chezani A4 2450 ABOURATA ABDEREMANE MORONI Chezani A4 2451 AHAMADA BACAR MOUKLATI MORONI Chezani A4 2457 ANRAFA ISSIHAKA MORONI Chezani A4 2458 ANSOIR SAID AHAMADA MORONI Chezani A4 2459 ANTOISSI AHAMADA SOILIHI MORONI Chezani D 2509 NADJATE HACHIM MORONI Chezani D 2513 BABY BEN ALI MSA MORONI Dembeni A1 427 FAZLAT IBRAHIM MORONI Dembeni A1 464 KASSIM YOUSSOUF MORONI Dembeni A1 471 MOZDATI MMADI ADAM MORONI Dembeni A1 475 SALAMA MMADI ALI MORONI Dembeni A4 559 FOUAD BACAR SOILIHI ABDOU MORONI Dembeni A4 561 HAMIDA IBRAHIM MORONI Dembeni A4 562 HAMIDOU BACAR MORONI Dembeni D 588 ABDOURAHAMANE YOUSSOUF MORONI Dembeni D 605 SOIDROUDINE IBRAHIMA MORONI FoumboudzivouniA1 640 ABDOU YOUSSOUF MORONI FoumboudzivouniA1 642 ACHRAFI MMADI DJAE MORONI FoumboudzivouniA1 643 AHAMADA MOUIGNI MORONI FoumboudzivouniA1 654 FAIDATIE ABDALLAH MHADJOU MORONI FoumbouniA4 766 ABDOUCHAKOUR ZAINOUDINE MORONI FoumbouniA4 771 ALI KARIHILA RABOUANTI MORONI FoumbouniA4 800 KARI BEN CHAFION BENJI MORONI FoumbouniA4 840 -
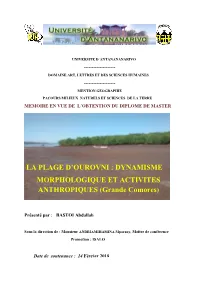
Grande Comores)
UNIVERSITE D`ANTANANANARIVO -------------------- DOMAINE ART, LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES -------------------- MENTION GEOGRAPHIE PACOURS MILIEUX NATURELS ET SCIENCES DE LA TERRE MEMOIRE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER LA PLAGE D’OUROVNI : DYNAMISME MORPHOLOGIQUE ET ACTIVITES ANTHROPIQUES (Grande Comores) Présenté par : BASTOI Abdallah Sous la direction de : Monsieur ANDRIAMIHAMINA Mparany, Maître de conférence Promotion : ISALO Date de soutenance : 14 Février 2018 i UNIVERSITE D`ANTANANANARIVO -------------------- DOMAINE ART, LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES -------------------- MENTION GEOGRAPHIE PACOURS MILIEU NATUREL SCIENCE DE LA TERRE MEMOIRE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER Intitulé LA PLAGE D’OUROVENI : DYNAMISME MORPHOLOGIQUE ET ACTIVITES ANTROPIQUES (Grande Comores) Présenté par : BASTOI Abdallah Devant le jury composé de : Président : James RAVALISON,Professeur Rapporteur : Monsieur ANDRIAMIHAMINA Mparany, Maître de conférences Juge : RALINRINA Fanja, Maître de conférences Promotion : ISALO Date de soutenance : 14 Février 20 ii REMERCIEMENTS Nous ne saurions introduire ce mémoire, sans remercier très sincèrement, et du fond du cœur, certaines personnes. Si ce travail a pu atteindre sa fin, c'est parce qu’il a bénéficié de l'aide et du soutien de gens, que je tiens à remercier. Notre gratitude s'adresse à tous les professeurs de la section de géographie, aussi bien à l'université d’Antananarivo. Vos conseils pratiques et critiques nous ont permis de mener à bon terme ce mémoire. Sensible à vos marques de sympathie et de dévouement sans cesse constantes, nous tenons à vous exprimer toute notre sincère reconnaissance. Nous remercions aussi notre directeur de mémoire, Monsieur ANDRIAMIHAMINA Mparany, pour tout ce qu’il a déployé comme efforts pour le bon déroulement de ce travail. -

Arret N°16-016 Primaire Ngazidja
H h ~I'-I courcon5t~liorwr~ UNION DES COMORES Olll\;I\IHliWif,!' Unité - Solidarité - Développement ARRET N° 16-016/E/P/CC PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DE L'ELECTION PRIMAIRE DE L'ILE DE NGAZIDJA La Cour constitutionnelle, VU la Constitution du 23 décembre 200 l, telle que révisée; VU la loi organique n° 04-001/ AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour constitutionnelle; VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique n° 14-016/AU du 26juin 2014; VU la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13 de la Constitution, modifiée par la loi organ ique n? 10-019/ AU du 06 septembre 2010 ; VU la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral; VU le décret n° 15- 184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles autonomes; VU l'arrêt n? 16-001 /E/CC du 02 janvier 2016 portant liste définitive des candidats à l'élection du Président de l'Union de 2016; VU l'arrêté n° 15- 130/MIIDIICAB du 01 décembre 2015 relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles Autonomes; VU le circulaire n? 16-037/MIIDIICAB du 19 février 2016 relatifau vote par procuration; VU la note circulaire n° 16-038/MIIDIICAB du 19 février -

Remerciements
SOWO LA MKOßE signifie « voie publique » en shikomor ancien. YA MKOßE est le nom du premier fe (doyen d’un clan et magistrat d’une chefferie) à avoir aménagé et entretenu des chemins pour relier les villages de la côte Est de Ngazidja entre Malé et Hantsindzi. Damir BEN ALI REMERCIEMENTS Ce numéro de ya mkoþe est le fruit d'un partenariat modèle développé entre deux institutions scientifiques, le CNDRS (Centre National de Docu- mentation et de Recherche Scientifique, Moroni) et le LACITO du CNRS (UMR 7107 “Langues et Civilisations à Tradition Orale”), Paris. L’appui financier du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l’Ambassade de France à Moroni a permis la formation d'une secrétaire d'édition, sous la direction de Madame Françoise LE GUENNEC-COPPENS et l’encadrement technique de Madame Françoise PEETERS, respectivement chercheur et ingénieur au LACITO, ainsi que l'acquisition d'un équipement informatique en vue de l’édition de nos prochains numéros. Par l'intérêt qu'il a toujours témoigné à l'égard de la recherche et du développement, Monsieur Gérard SOURNIA, chef de Service de Coopération, a joué un rôle clef dans l’octroi des subventions nécessaires à la réalisation de ce projet. Je lui adresse mes plus chaleureux remerciements. Nous remercions également KomEdit pour son travail de promotion et de diffusion de la revue. Enfin que Mohamed AHMED-CHAMANGA accepte notre reconnaissance pour son aide bienveillante et désintéressée. ya mkoþe est publié par le Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique des Comores (CNDRS), sous la direction du Directeur Général de l’Institution. -

RNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement
UNIONRNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement Vice-Présidence en charge du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme Direction Générale de l’Environnement et des Forêts Draft Stratégie d’Expansion du Système National des Aires Protégées Aux Comores 2017 – 2021 26 octobre 2017 Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du PNUD, du GEF, ni du Gouvernement Comorien. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Fouad ABDOU RABI Coordinateur du projet RNAP, PNUD/ GEF [email protected] Youssouf Elamine Y. MBECHEZI Directeur Général de l’Environnement et des forêts (DGEF) Directeur du Projet RNAP-Comores (PNUD/ GEF) [email protected] Eric LACROIX AT projet RNAP [email protected] ; [email protected] Publié par : DGEF-PNUD/ GEF Comores Droits d’auteur : ©DGEF-PNUD/ GEF Comores. © Parcs nationaux des Comores. La reproduction de cette publication à des fins non commerciales, notamment éducatives, est permise et même encouragée sans autorisation écrite préalable du détenteur des droits d’auteur à condition que la source soit dûment citée. Page de garde : Photo 1,: Îlot de la Selle, Parc national Shisiwani. © Eric Lacroix PNC Citation : DGEF Comores (2017). Stratégie d’expansion du système national des aires protégées aux Comores. 2017 - 2021. Vice-Présidence en charge du Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Direction générale de l’environnement et des forêts. Projet PNUD/ GEF : Système national des aires protégées aux Comores. 158 p + Annexes 16 p. -

Cas De La Ville De Mitsoudje
UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE MEMOIRE DE MAITRISE Présenté ASSAINISSEMENTpar : DAMIR Houmadi ET ADDUCTION D’EAU Président du jury :……………………………………. Professeur RapporteurPOTABLE : James RAVALISON EN GRANDE, Professeur COMORE : CAS DE LA Juge : ………………………………………………….VILLE DE MITSOUDJE Maître de Conférences Présenté par : Monsieur Mohamed MZE Rapporteur : Madame Josélyne RAMAMONJISOA, Professeur titulaire 3 octobre 2014 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE FORMATION GENERALE MÉMOIREDE FIN D’ETUDES POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME DE MAITRISE ASSAINISSEMENT ET ADDUCTION D’EAU POTABLE EN GRANDE COMORE : CAS DE LA VILLE DE MITSOUDJE Présenté par : Monsieur : Mohamed MZE Président du jury : Simone RATSIVALAKA, Professeur titulaire Rapporteur : Josélyne RAMAMONJISOA, Professeur titulaire Juge : Vololonirainy RAVONIARIJAONA, Maitre conférence 3 octobre 2014 AVANT-PROPOS La collectivité de Mitsoudjé est administrée librement par un Comité de Développement (CODEM) selon les dispositions prises le 08 Juin 1997. Il est dit le CODEM intervient dans l’ensemble de la commune, à travers l’élaboration et à la mise en œuvre des schémas d’action villageois résultant des demandes de la population de nature technique, économique, sociale et organisationnelle dans l’ensemble des domaines pertinents du développement de la ville. Depuis quelques années, de nombreux projets de développements ont été menés à Mitsoudjé dans le secteur de l’hydraulique. Ce dispositif présente certes des lacunes, mais il convient de rappeler qu’il est régulièrement cité en référence comme l’un des plus avancés en matière de gestion d’adductions d’eau potable dans l’archipel des Comores. Dans le même temps les modes d’intervention de CODEM ont beaucoup évolué, notamment dans le secteur d’hygiène. -

Evaluation of Dubai Cares' Support to Quality Basic
VALUATION OF UBAI ARES E D C ’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS FINAL REPORT JANUARY 2015 EVALUATION OF DUBAI CARES’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS Contents Acronyms and abbreviations ........................................................................................................ 4 Executive summary ...................................................................................................................... 6 Brief program description and context ............................................................................................... 6 Purpose and expected use of the evaluation ..................................................................................... 6 Objectives of the evaluation ............................................................................................................... 6 Evaluation methodology ..................................................................................................................... 6 Principal findings and conclusions ...................................................................................................... 7 Key recommendations ........................................................................................................................ 7 Lessons learned for future programs .................................................................................................. 8 I. Audience and use of the evaluation ................................................................................... -

A Habitat Suitability Analysis at Multi-Spatial Scale of Two Sympatric
Biodivers Conserv https://doi.org/10.1007/s10531-018-1544-8 ORIGINAL PAPER A habitat suitability analysis at multi‑spatial scale of two sympatric fying fox species reveals the urgent need for conservation action Mohamed Thani Ibouroi1,2,3 · Ali Cheha3,4 · Guillelme Astruc1 · Said Ali Ousseni Dhurham3 · Aurélien Besnard1 Received: 4 May 2017 / Revised: 26 March 2018 / Accepted: 10 April 2018 © Springer Science+Business Media B.V., part of Springer Nature 2018 Abstract In this study we used a multi-spatial scale approach to investigate habitat suitability, roosting characteristics, and ecological niche in two fying fox species on the Comoros Islands—Pteropus livingstonii and Pteropus seychellensis comorensis. At a broad scale, we assessed the ecological niche and habitat suitability for both species using the Species Distribution Modeling method based on the recent ensembles of small models (ESM) approach. At a fne scale, Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) was applied to assess habitat selection by each species. Direct observation was used at each roost to esti- mate the total number of individuals and to identify the roost characteristics. At both broad and fne scales, the analyses highlighted clear niche partitioning by the two species. We found that P. livingstonii has a very limited distribution, restricted to steep, high-elevation slopes of the islands’ remaining natural forests, and the patterns were the same for roost- ing, foraging sites and the entire habitat. By contrast, P. s. comorensis has a relatively large geographic range that extends over low-elevation farmlands and villages and it was nega- tively correlated to natural forest across the entire area and all roosting sites, but its forag- ing areas were positively correlated to natural forest and high elevation areas. -

Communauté De Simboussa Badjini
UNION DES COMORES __________ ILE AUTONOME DE LA GRANDE - COMORE ___________ CREDIT / IDA 3868 - COM Fonds d'Appui au Développement Communautaire (FADC) Secrétariat Exécutif Régional BP 2494 – Moroni – Quartier Mahandi - Bd Karthala Tél. : (269) 73 28 89/73 28 78 - Fax : 73 28 89 Email : [email protected] ______________________________________________________ Communauté de Simboussa Badjini P LAN DE D EVELOPPEMENT L OCAL 2010 – 2015 1 Sommaire Chapitre I : Introduction : Chapitre II : Résumé du rapport Chapitre III : Analyse des données socio - économiques 1. Localisation 2. Aperçu historique 3. Situation Administrative 4. Situation Démographique 5. Organisations Sociales 6. Les Organisations extérieures opérantes dans le village 7. Environnement 8. La situation des services sociaux et des infrastructures de base 9. Activités économiques Chapitre IV : Plan d’investissement du village 10. Le plan quinquennal d’investissement du village ANNEXES Annexe 1 : Fiches de collecte de données socio - économiques Annexe 2 Les abré viations Annexe 3 : Adresses des partenaires au développement 2 I NTRODUCTION 1 - C ONTEXTE GENERAL Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la communauté de Simboussa. C’est un village situé dans la région de Badjini dans la préfecture du Sud Est de l’île Autonome de la Grande - Comore. Ce document est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données socio - économiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes, femmes, homme s, notables et personnes vulnérables. Le travail a été fait 3 mois durant et consist ait à identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à dégager les solutions pour relever le défi en matière de développement communautair e. -

La Fonction Du « Grand Mariage » Dans La Politique Comorienne : Cas Des Maires-Notables Des Communes En Grande-Comore
FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE ------------------------- DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE ------------------------- MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES D.E.A La fonction du « Grand mariage » dans la politique comorienne : cas des Maires-notables des communes en Grande-Comore . Présenté par : CHAKIRA Ibouroi Soilihi Le 15 Janvier 2014 Membres du jury : Présidente du jury : Professeur RAMANDIMBIARISON Noeline Juge : Docteur ETIENNE Stefano Raherimalala Sous la direction de : Pr RAMANDIMBIARISON Jean Claude Année universitaire : 2012 – 2013 La fonction du « Grand mariage » dans la politique comorienne : cas des Maires-notables des communes en Grande-Comore . REMERCIEMENTS Avant d’adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce travail de mémoire, je tiens à remercier DIEU tout puissant de m’avoir donné force et santé depuis le début de mes études jusqu’à maintenant. Je témoigne mes remerciements à : Monsieur ANDRIAMAMPANDRY Todisoa, Chef de Département Sociologie, qui n’a pas ménagé ses efforts et ses conseils pour la réussite de notre formation. Mes vifs remerciements vont à l’endroit : Des membres de Jury, qui ont eu l’obligeance de me consacrer une partie de leur temps, que je sais précieux, pour parcourir ce document et y apporter leurs avis. Des membres du corps enseignant et administratif de la filière Sociologie de la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie (DEGS) de l’Université d’Antananarivo. Ils ont su partager généreusement leur savoir et leur compétence ci chère. Mes profondes gratitudes s’adressent à : Monsieur le Professeur RAMANDIMBIARISON Jean Claude , Directeur du présent mémoire, pour ses conseils précieux et ses orientations bénéfiques à sa réalisation. -
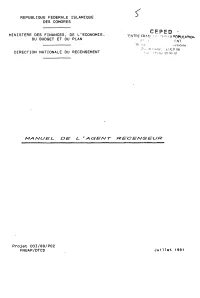
Com-1991-Rec-M1 Manuel Recenseur.Pdf
REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES CEPED -- MINISTERE DES FINANCES, DE L'ECONOMIE, 'ENTRé FRI\~)( ..... ,(',.Q 1 A POPUlAT'CM. DU BUDGET ET DU PLAN ::1 rfoNT 1~;. :1), , •. >(j(lcme 7'" lU rJl..\t\I:: .tlJ[X 06 DIRECTION NATIONALE DU RECENSEMENT l ,,1 11 \ c!r; Ti (lo 111 MANUEL DE L'AGENT RECENSEUR Projet COI/89/P02 FNUAP/DTCD Juillet 1991 A V A N T PRO P 0 S Ce manuel a pour but de vous guider dans votre tâche d'agent recen seur. Il contient les instructions concernant la manière dont vous devez exécuter votre travail. Vous ne devez donc rien ignorer de son contenu. Pour cela, lisez-le attentivement. Si certaines parties de ce manuel vous semble peu claires, posez des questions à votre contrôleur. Les instructions contenues dans ce manuel doivent être exécutées à la lettre. Référez-vous à votre contrôleur chaque fois que, sur le ter rain, vous rencontrez des difficultés pour appliquer ces instructions. Le succès final de ce recensement de la population et de l'habitat repose sur vous. Travaillez donc consciencieusement, rapidement et bien; écrivez très lisiblement sur les questionnaires. PLA N D U MAN U E L CHAPITRE 1 - PRESENTATION DU RECENSEMENT . 1.1 - QU'EST QU'UN RECENSEMENT DE LA POPULATION 1.2 - OBJECTIF DU RECENSEMENT ....... 1.3 - ORGANISATION DE LA COLLECTE ..... 1.3.1 - Personnel chargé du recensement. 1 1.3.2 - Le matériel de l'agent recenseur 2 1.3.3 - la méthode de collecte ... 2 CHAPITRE II - INSTRUCTIONS GENERALES . .. ..... 3 2.1 - MISSION ET COMPORTEMENT DE L'AGENT RECENSEUR 3 2.2 - OBLIGATIONS DE L'AGENT RECENSEUR. -

Recul Et Persistance Du Paludisme En Union Des Comores
Recul et persistance du paludisme en Union des Comores : une approche géographique pour déterminer l’importance des facteurs environnementaux et sociaux dans son maintien Attoumane Artadji To cite this version: Attoumane Artadji. Recul et persistance du paludisme en Union des Comores : une approche géo- graphique pour déterminer l’importance des facteurs environnementaux et sociaux dans son maintien. Géographie. Université de la Réunion, 2019. Français. NNT : 2019LARE0003. tel-02172231 HAL Id: tel-02172231 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02172231 Submitted on 3 Jul 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Université de La Réunion Ecole Doctorale Lettres et Sciences Humaines UMR 228 ESPACE-DEV Thèse de Doctorat en Géographie Recul et persistance du paludisme en Union des Comores : une approche géographique pour déterminer l’importance des facteurs environnementaux et sociaux dans son maintien Présentée et soutenue publiquement par : ARTADJI ATTOUMANE Le 8 Février 2019 La Réunion Membres du jury : Jean Gaudart, Professeur, PU-PH, Université