Guide Technique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2020 Annual Noise Contour Report
Minneapolis St. Paul International Airport (MSP) 2020 Annual Noise Contour Report Comparison of the 2020 Actual and the 2007 Forecast Noise Contours February 2021 MAC Community Relations Office and HNTB Corporation MSP 2020 Annual Noise Contour Report Metropolitan Airports Commission Table of Contents ES EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................. 1 ES.1 BACKGROUND ...................................................................................................................... 1 ES.2 AIRPORT NOISE LITIGATION AND CONSENT DECREE .............................................................. 1 ES.3 MSP 2020 IMPROVEMENTS EA/EAW ..................................................................................... 2 ES.4 THE AMENDED CONSENT DECREE ......................................................................................... 2 ES.5 2020 NOISE CONTOURS ......................................................................................................... 3 ES.6 AMENDED CONSENT DECREE PROGRAM ELIGIBILITY ............................................................. 3 ES.7 AMENDED CONSENT DECREE PROGRAM MITIGATION STATUS ............................................. 3 1. INTRODUCTION AND BACKGROUND ................................................................................. 8 1.1 CORRECTIVE LAND USE EFFORTS TO ADDRESS AIRCRAFT NOISE ............................................ 8 1.2 2007 FORECAST CONTOUR ................................................................................................. -

79952 Federal Register / Vol
79952 Federal Register / Vol. 75, No. 244 / Tuesday, December 21, 2010 / Rules and Regulations Unsafe Condition DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 1601 Lind Avenue, SW., Renton, (d) This AD was prompted by an accident Washington 98057–3356; telephone and the subsequent discovery of cracks in the Federal Aviation Administration (425) 227–1137; fax (425) 227–1149. main rotor blade (blade) spars. We are issuing SUPPLEMENTARY INFORMATION: 14 CFR Part 39 this AD to prevent blade failure and Discussion subsequent loss of control of the helicopter. [Docket No. FAA–2009–0864; Directorate We issued a supplemental notice of Compliance Identifier 2008–NM–202–AD; Amendment 39–16544; AD 2010–26–05] proposed rulemaking (NPRM) to amend (e) Before further flight, unless already 14 CFR part 39 to include an AD that done: RIN 2120–AA64 would apply to the specified products. (1) Revise the Limitations section of the That supplemental NPRM was Airworthiness Directives; DASSAULT Instructions for Continued Airworthiness by published in the Federal Register on AVIATION Model Falcon 10 Airplanes; establishing a life limit of 8,000 hours time- July 27, 2010 (75 FR 43878). That Model FAN JET FALCON, FAN JET in-service (TIS) for each blade set Remove supplemental NPRM proposed to FALCON SERIES C, D, E, F, and G each blade set with 8,000 or more hours TIS. correct an unsafe condition for the Airplanes; Model MYSTERE-FALCON (2) Replace each specified serial-numbered specified products. The MCAI states: 200 Airplanes; Model MYSTERE- blade set with an airworthy blade set in During maintenance on one aircraft, it was accordance with the following table: FALCON 20–C5, 20–D5, 20–E5, and 20– F5 Airplanes; Model FALCON 2000 and discovered that the overpressure capsules were broken on both pressurization valves. -

DASSAULT AVIATION Model Falcon 10 Airplanes
43878 Federal Register / Vol. 75, No. 143 / Tuesday, July 27, 2010 / Proposed Rules Applicability New Requirements of This AD: Actions Bulletin SBF100–27–092, dated April 27, (c) This AD applies to Fokker Services B.V. (h) Within 30 months after the effective 2009; and Goodrich Service Bulletin 23100– Model F.28 Mark 0100 airplanes, certificated date of this AD, do the actions specified in 27–29, dated November 14, 2008; for related in any category, all serial numbers. paragraphs (h)(1) and (h)(2) of this AD information. concurrently. Accomplishing the actions of Issued in Renton, Washington, on July 21, Subject both paragraphs (h)(1) and (h)(2) of this AD 2010. (d) Air Transport Association (ATA) of terminates the actions required by paragraph Jeffrey E. Duven, America Code 27: Flight Controls. (g) of this AD. (1) Remove the tie-wrap, P/N MS3367–2– Acting Manager, Transport Airplane Reason 9, from the lower bolts of the horizontal Directorate, Aircraft Certification Service. (e) The mandatory continuing stabilizer control unit, in accordance with the [FR Doc. 2010–18399 Filed 7–26–10; 8:45 am] airworthiness information (MCAI) states: Accomplishment Instructions of Fokker BILLING CODE 4910–13–P Two reports have been received where, Service Bulletin SBF100–27–092, dated April during inspection of the vertical stabilizer of 27, 2009. F28 Mark 0100 aeroplanes, one of the bolts (2) Remove the lower bolts, P/N 23233–1, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION that connect the horizontal stabilizer control of the horizontal stabilizer control unit and unit actuator with the dog-links was found install bolts, P/N 23233–3, in accordance Federal Aviation Administration broken (one on the nut side & one on the with the Accomplishment Instructions of Goodrich Service Bulletin 23100–27–29, head side). -

Vol. 86 Friday, No. 42 March 5, 2021 Pages 12799–13148
Vol. 86 Friday, No. 42 March 5, 2021 Pages 12799–13148 OFFICE OF THE FEDERAL REGISTER VerDate Sep 11 2014 22:07 Mar 04, 2021 Jkt 253001 PO 00000 Frm 00001 Fmt 4710 Sfmt 4710 E:\FR\FM\05MRWS.LOC 05MRWS jbell on DSKJLSW7X2PROD with FR_WS II Federal Register / Vol. 86, No. 42 / Friday, March 5, 2021 The FEDERAL REGISTER (ISSN 0097–6326) is published daily, SUBSCRIPTIONS AND COPIES Monday through Friday, except official holidays, by the Office PUBLIC of the Federal Register, National Archives and Records Administration, under the Federal Register Act (44 U.S.C. Ch. 15) Subscriptions: and the regulations of the Administrative Committee of the Federal Paper or fiche 202–512–1800 Register (1 CFR Ch. I). The Superintendent of Documents, U.S. Assistance with public subscriptions 202–512–1806 Government Publishing Office, is the exclusive distributor of the official edition. Periodicals postage is paid at Washington, DC. General online information 202–512–1530; 1–888–293–6498 Single copies/back copies: The FEDERAL REGISTER provides a uniform system for making available to the public regulations and legal notices issued by Paper or fiche 202–512–1800 Federal agencies. These include Presidential proclamations and Assistance with public single copies 1–866–512–1800 Executive Orders, Federal agency documents having general (Toll-Free) applicability and legal effect, documents required to be published FEDERAL AGENCIES by act of Congress, and other Federal agency documents of public Subscriptions: interest. Assistance with Federal agency subscriptions: Documents are on file for public inspection in the Office of the Federal Register the day before they are published, unless the Email [email protected] issuing agency requests earlier filing. -

The Indonesia Dassault Falcon 7X Wu Zhendong Metrics & Mood Jets & Helicopters
FOURTH QUARTER 2015 THE INDONESIA PERSPECTIVE THE CHECKUP : DASSAULT FALCON 7X INDUSTRY INSIDER: WU ZHENDONG ASIA-PACIFIC OUTLOOK: METRICS & MOOD CURRENT MARKET SUMMARIES: JETS & HELICOPTERS THE WORLD STANDARD Intercontinental range, record-setting speed, advanced technology, unrivaled utility and top-rated worldwide product support. The World Standard™ isn’t just a company tagline, it’s a benchmark by which all others must be measured. BEIJING (北京): +86 10 8535 1866 HONG KONG (香港): +852 2918 1600 SINGAPORE (新加坡): +65 6572 7777 GULFSTREAM.COM G650ER, G650, G600, G500, G550, G450, G280 and G150 are trademarks or registered trademarks of Gulfstream Aerospace Corporation in the U.S. and other countries. THE WORLD STANDARD Intercontinental range, record-setting speed, advanced technology, unrivaled utility and top-rated worldwide product support. The World Standard™ isn’t just a company tagline, it’s a benchmark by which all others must be measured. BEIJING (北京): +86 10 8535 1866 HONG KONG (香港): +852 2918 1600 SINGAPORE (新加坡): +65 6572 7777 GULFSTREAM.COM G650ER, G650, G600, G500, G550, G450, G280 and G150 are trademarks or registered trademarks of Gulfstream Aerospace Corporation in the U.S. and other countries. TWO WAYS TWO WAYS TO CONQUER THE WORLD. TO CONQUER THE WORLD. 广告 two ways to conquer the world. Now you have two choices for superior, ultra-long-range capability. The 5,950 nm Falcon 7X—the fastest selling Falcon ever (and with Now you have two choices for superior, ultra-long-range capability. The 5,950 nm Falcon 7X—the fastest selling Falcon ever (and with good reason). Or the new, 6,450 nm Now you have two choices for superior, ultra-long-range capability.good Thereason). -

Avions Civils
SOMMAIRE DU VOLUME I LA CONDUITE DES PROGRAMMES CIVILS AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS........................................................................... 3 PREFACE.............................................................................................................................. 5 PRESENTATION GENERALE ............................................................................................. 9 CHAPITRE 1 PRESENTATION DE L’ACTIVITE...................................................................................... 11 LE MARCHE DU TRANSPORT AERIEN .................................................................................. 11 Le passager et l’évolution du trafic.......................................................................................... 11 Les compagnies et la flotte d’avions ....................................................................................... 13 LA CONSTRUCTION DES AVIONS CIVILS .............................................................................. 14 Les caractéristiques de l’activité.............................................................................................. 14 La compétition et son évolution............................................................................................... 18 La dimension économique et monétaire ................................................................................. 20 L’ ADMINISTRATION ET SES MISSIONS ................................................................................. 22 La tutelle militaire de -
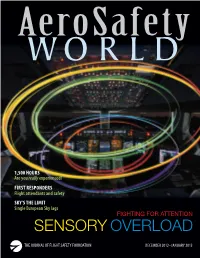
Sensory Overload
AeroSafety WORLD 1,500 HOURS Are you really experienced? FIRST RESPONDERS Flight attendants and safety SKY’S THE LIMIT Single European Sky lags FIGHTING FOR ATTENTION SENSORY OVERLOAD THE JOURNAL OF FLIGHT SAFETY FOUNDATION DECEMBER 2012–JANUARY 2013 AIR ad2 v1a.pdf 1 2012-11-16 12:55 PM The AIR Group Specializing in Safety Systems Product Development and Aircraft Accident Investigation Consultancy Affordably Priced - Highly Capable Flight Analysis System (FASET Animation) Our Animation System is based on over twenty years of R&D in the field of aircraft accident/incident, Flight Data Monitoring and flight simulation, flight visualization technology. It was developed by industry leaders in flight animation systems. Seamlessly integrate into existing third party flight analysis systems or as a stand alone product. FASET will meet your needs and exceed your expectations. C M Y CM MY CY Thinking of adding animation or upgrading your current system, think FASET CMY K Flight Data Monitoring (FDM/FOQA) Services The AIR Group can assist with: • Full implementation of a managed service, eliminating the need for highly specialized internal FDM technical expertise. • Customized service to suit client specific operations. • Investigative assistance for significant flight safety events. • Producing standard or customized reports • Highly qualified experts who can design new measurements and assist with staff training. Aircraft Accident and Serious Incident support services • Post-Accident and Incident Reconstruction • Data Integration and Reconstruction • Technical Reporting, Critical Commentary • Safety and Defect Analysis Applied Informatics and Research Inc. / Accident Investigation and Research Inc. All Operators believe they are safe; however, the AIR Group offers comprehensive safety tools and capabilities to help you to confirm that you are safe. -

Gulfstream G550 Spotlight
ASIAN SKY QUARTERLY FIRST QUARTER 2016 INDIA COUNTRY PROFILE GULFSTREAM G550 SPOTLIGHT BJÖRN NÄF METROJET INTERVIEW ASIA-PACIFIC OUTLOOK METRICS & MOOD FIRST QUARTER 2016 CURRENT MARKET SUMMARIES JETS & HELICOPTERS OUR SIGHTS ARE SET HIGHER BUSINESSAIRCRAFT.BOMBARDIER.COM Bombardier, Learjet, Challenger, Global and The Evolution of Mobility are trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries. © 2016 Bombardier Inc. All rights reserved. FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT SUMIT PANDEY | +91 22 6124 1810 | [email protected] NILESH PATTANAYAK | +91 99 6706 6247 | [email protected] 11882-BBA-Family-AsianSky-DPS-AD-420x297.indd 1 31/03/2016 18:38 OUR SIGHTS ARE SET HIGHER BUSINESSAIRCRAFT.BOMBARDIER.COM Bombardier, Learjet, Challenger, Global and The Evolution of Mobility are trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries. © 2016 Bombardier Inc. All rights reserved. FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT SUMIT PANDEY | +91 22 6124 1810 | [email protected] NILESH PATTANAYAK | +91 99 6706 6247 | [email protected] 11882-BBA-Family-AsianSky-DPS-AD-420x297.indd 1 31/03/2016 18:38 PUBLISHER’S NOTE Special thanks to our contributors: Here we are with Asian Sky Quarterly’s Issue #2, trying to avoid the sophomore jink which I believe we’ve been successful in doing. This issue is bigger, more comprehensive and has generated even more interest than the inaugural issue. Response to our market survey was even higher. As promised, we would try to make each issue better than the last, so you will hopefully notice some positive changes. These include an expanded “Mood & Intentions” survey questions and analysis with responses up and from a better cross section across the Asia Pacific region, a bolstered “Economics” data and outlook provided by Morgan Stanley Research, an expanded and better segregated “OEM Activity” section, an adjusted “Market Dynamics” segment to dampen the sensitivity of underlying assumptions, and a visually-improved presentation format for our “Market Summary”. -

7 Latreilleville Avions Civils I Texte
SOMMAIRE DU VOLUME I LA CONDUITE DES PROGRAMMES CIVILS AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS........................................................................... 3 PREFACE.............................................................................................................................. 5 PRESENTATION GENERALE ............................................................................................. 9 CHAPITRE 1 PRESENTATION DE L’ACTIVITE...................................................................................... 11 LE MARCHE DU TRANSPORT AERIEN .................................................................................. 11 Le passager et l’évolution du trafic.......................................................................................... 11 Les compagnies et la flotte d’avions ....................................................................................... 13 LA CONSTRUCTION DES AVIONS CIVILS .............................................................................. 14 Les caractéristiques de l’activité.............................................................................................. 14 La compétition et son évolution............................................................................................... 18 La dimension économique et monétaire ................................................................................. 20 L’ADMINISTRATION ET SES MISSIONS ................................................................................. 22 La tutelle militaire de l’industrie -

Richland County Special Called Meeting Agenda
RICHLAND COUNTY SPECIAL CALLED MEETING AGENDA Tuesday, AUGUST 31, 2021 6:00 PM COUNCIL CHAMBERS 1 of 142 2 of 142 RICHLAND COUNTY COUNCIL 2021 Bill Malinowski Derrek Pugh Yvonne McBride District 1 District 2 District 3 Blythewood 2018-2022 2020-2024 2020-2024 White Rock Dutch Fork Ballentine Irmo Dentsville Pontiac St. Andrews Arcadia Lakes Paul Livingston Allison Terracio Joe Walker III Forest Acres District 4 District 5 District 6 Columbia 2018-2022 2018-2022 2018-2022 Horrell Hill Eastover Hopkins Gretchen Barron Overture Walker Jesica Mackey Gadsden District 7 District 8 District 9 2020-2024 2020-2024 2020-2024 Cheryl English Chakisse Newton District 10 District 11 2020-2024 2018-2022 Richland County Special Called Meeting August 31, 2021 - 6:00 PM Council Chambers 2020 Hampton Street, Columbia, SC 29201 1. CALL TO ORDER The Honorable Paul Livingston a. Roll Call 2. INVOCATION The Honorable Cheryl English 3. PLEDGE OF ALLEGIANCE The Honorable Cheryl English 4. APPROVAL OF MINUTES The Honorable Paul Livingston a. Regular Session: July 20, 2021 [PAGES 9-21] b. Zoning Public Hearing: July 27, 2021 [PAGES 22-24] c. Special Called Meeting: July 27, 2021 [PAGES 25-31] d. Special Called Meeting: August 16, 2021 [PAGES 32-33] 5. ADOPTION OF AGENDA The Honorable Paul Livingston 6. PRESENTATION OF PROCLAMATION The Honorable Cheryl English a. A Proclamation Recognizing the Life and Work of Jim Staskowski 7. REPORT OF ACTING COUNTY ATTORNEY FOR Elizabeth McLean, EXECUTIVE SESSION ITEMS Acting County Attorney After Council returns to open session, Council may take action on any item, including any subsection of any section, listed on an executive session agenda or discussed in an Executive Session during a properly noticed meeting. -

Air Travel, Life-Style, Energy Use and Environmental Impact
Air travel, life-style, energy use and environmental impact Stefan Kruger Nielsen Ph.D. dissertation September 2001 Financed by the Danish Energy Agency’s Energy Research Programme Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Building 118 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark http://www.bvg.dtu.dk 2001 DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from the best available original document Report BYG DTU R-021 2001 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-076-9 Executive summary This summary describes the results of a Ph.D. study that was carried out in the Energy Planning Group, Department for Civil Engineering, Technical University of Denmark, in a three-year period starting in August 1998 and ending in September 2001. The project was funded by a research grant from the Danish Energy Research Programme. The overall aim of this project is to investigate the linkages between energy use, life style and environmental impact. As a case of study, this report investigates the future possibilities for reducing the growth in greenhouse gas emissions from commercial civil air transport, that is passenger air travel and airfreight. The reason for this choice of focus is that we found that commercial civil air transport may become a relatively large energy consumer and greenhouse gas emitter in the future. For example, according to different scenarios presented by Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), commercial civil air transport's fuel burn may grow by between 0,8 percent a factor of 1,6 and 16 between 1990 and 2050. The actual growth in fuel consumption will depend on the future growth in airborne passenger travel and freight and the improvement rate for the specific fuel efficiency. -

Simulation Programs Using Concurrent Computer Systems
SIMULATION PROGRAMS USING CONCURRENT COMPUTER SYSTEMS US AIR FORCE PROGRAMS US NAVY PROGRAMS OTHER GOVERNMENT PROGRAMS JAPAN FIGHTER AIRCRAFT Coast Guard HH-60 Jayhawk Active Phased Array Radar FIGHTER AIRCRAFT F-117A Nighthawk AH-1S Cobra F-14B/A Tomcat NASA Space Shuttle SMS F-15 Eagle C-1 Trader F/A-18 Hornet NASA X-29 US101 Helicopter C-130 Hercules BOMBER AIRCRAFT ATTACK AIRCRAFT F-15J WST INTERNATIONAL MILITARY PROGRAMS B-1B Lancer ERS A-6E Intruder FS-X/F-2 Avionics Development B-2 Spirit ATD Crew Trainer AUSTRALIA JSDF Anti-aircraft Artillery ELECTRONIC WARFARE B-52 Stratofortress WST Collins-class Submarine CCS OH-1 Ninja EA-6B Prowler F-111 Aardvark Avionics Development P-3C Orion NEWTS Patriot Missile Defense ATTACK AIRCRAFT CZECKOSLOVAKIA P-3C Orion SH-60K Sea Hawk A-10 Thunderbolt L-159 ALCA S-3 Viking T-4 Trainer AC-130U Gunship FRANCE Agusta 129 Helicopter T-5 Trainer RESEARCH T-90 Tank MISSILES LEAP Program Airbus A400M CALCM Cruise E-2C Hawkeye TC-90 Trainer U-125A Peace Krypton HELICOPTERS Eurocopter US-1A Kai CARGO AIRCRAFT CH-46 Sea Knight Exocet Missile KOREA C-12F Huron CH-53 Sea Stallion Mirage 2000 Fighter F-16K Avionics Development C-130 Hercules MH-60R LAMPS Mistral Missile Hawk 60 Trainer C-17 Globemaster III SURFACE/SUBSURFACE Rafale Fighter KC-135 Stratotanker NETHERLANDS AGSS class sub GERMANY F-16 Eagle AGG2 Gepard Tank Tomahawk ACM Missile SAUDI ARABIA ELECTRONIC WARFARE C-160 Transall E-2C AWACS F-5 Tiger GENERAL TRAINERS CH-53G Helicopter EC-135 Looking Glass SINGAPORE 20F16 Tactical Command E-3A AWACS