Services De L'eau En Algerie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Journal Officiel Algérie
N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

Rapport Sur Les Priorités Et La Planification Année 2021
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Ressources en Eau Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Octobre/ 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................4 1.1 Message du ministre ...................................................................................................4 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................5 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................6 2.1 La mission ...................................................................................................................6 - Production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées Épurées ;6 2.2 Le ministère ................................................................................................................7 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................9 Gestionnaire responsable : Ministre des Ressources en Eau ...............................................9 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...........................................................11 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ......................................................12 -

L'algérie Legendaire
L’ALGÉRIE LEGENDAIRE EN PÈLERINAGE ÇÀ & LÀ aux Tombeaux des principaux Thaumaturges de l’Islam (Tell et Sahara) PAR LE COLONEL C. TRUMELET COMMANDEUR DE L’ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR OFFICIER DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES DE LA SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE ET DE STATISTIQUE DE LA DRÔME ETC. ETC. Visitez les tombes des saints du dieu puissant : Elles sont parées de vêtements imprégnés de musc, Que sillonnent des éclairs d’or pur. SIDI KHALIL ALGER LIBRAIRIE ADOLPHE JOURDAN IMPRIMEUR-LIBRAIRE-ÉDITEUR 4, PLACE DU GOUVERNEMENT, 4 1892 Augustin CHALLAMEL, ÉDITEUR 17, Rue Jacob, PARIS Livre numérisé en mode texte par : Alain Spenatto. 1, rue du Puy Griou. 15000 AURILLAC. D’autres livres peuvent être consultés ou téléchargés sur le site : http://www.algerie-ancienne.com Ce site est consacré à l’histoire de l’Algérie. Il propose des livres anciens, (du 14e au 20e siècle), à télécharger gratuitement ou à lire sur place. AVANT-PROPOS Nous avons démontré, dans un de nos pré- cédents ouvrages, l’intérêt que pouvait présenter l’étude des mœurs religieuses des groupes musul- mans dont nous avions charge des corps, sinon des âmes, dans les pays de l’Afrique septentrionale que nous avions conquis, et dans ceux où nous pousse- ront encore irrésistiblement les besoins de la politi- que, du commerce et de la civilisation, voire même la curiosité, et cette force d’expansion que nous avons tous au cœur, et qui nous fait affronter tous les dangers avec la foi des premiers martyrs. Or, pour acquérir cette force de pénétration sans laquelle tout nous serait et ferait obstacle, il nous faut d’abord étudier les choses cachées, les mys- térieuses pratiques des groupes que nous sommes exposés à rencontrer sur notre route ténébreuse, si- lencieuse, muette. -
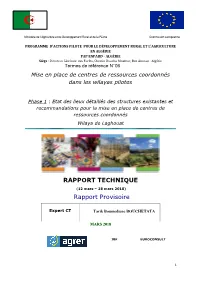
RAPPORT TECHNIQUE Rapport Provisoire
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche Commission européenne PROGRAMME D’ACTIONS PILOTE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET L’AGRICULTURE EN ALGÉRIE PAP ENPARD - ALGÉRIE Siège : Direction Générale des Forêts, Chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun Algérie Termes de référence N°06 Mise en place de centres de ressources coordonnés dans les wilayas pilotes Phase 1 : Etat des lieux détaillés des structures existantes et recommandations pour la mise en place de centres de ressources coordonnés Wilaya de Laghouat RAPPORT TECHNIQUE (12 mars – 28 mars 2018) Rapport Provisoire Expert CT Tarik Boumediene BOUCHETATA MARS 2018 IBF EUROCONSULT 1 Remerciements Nos remerciements à - Mohammed Ben Messaoud, point focal de la conservation des forêts - Djamal Ben Linani, point focal de la DSA - Abderrahmane Khirani, directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers -Mustapha Bondjemaâ, point focal de la direction du tourisme ; -Omar Rahmani secrétaire général de Chambre d’agriculture Notre respect et notre grande considération à Mr le conservateur des forêts de la wilaya de Laghouat qui nous a apporté son aide et son soutien pour le bon déroulement de la mission. Un grand merci à Sid Ali Taouati et Mohamed Khelaif pour leur assistance à la réussite de la mission. Tarik BOUCHETATA 2 Table des matière .................................................................................................................................................. 3 Sigle et acronymes ................................................................................................................................................ -

Memoire De Master 2
UNIVERSITE SAAD DAHLEB DE BLIDA 1 INSTITUT D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME Memoire de Master 2 Option : ARCHITECTURE VILLE ET TERRITOIRE Thème Démarche Cognitive pour la Revitalisation du Quartier Zgag El-Hedjadj du Ksar de Laghouat Présenté par : - Mlle ZIREGUE Meriem Encadré par : - Dr. Arch. SAIDI Mohamed Année universitaire 2017/2018 Je remercie dieu le tout puissant qui nous a donné le courage et la volonté de mener à bien notre travail. Ma familles de nous avoir soutenu pendant notre cursus universitaire. Je tiens à remercier mon encadreur Dr SAIDI Mohammed pour le suivi et l’encadrement qui m'a apporté. Sans oublier de remercier mes chers enseignants de l'université de Laghouat qui n'ont cessé de me aider et de m'orienter, Mr Benarfa Kamel grand merci, Mm Bouchareb Zahra, Mr Takhi Belkacem, Mr Korkaz Harzallah, Mr Hadj Kadour. A tout le groupe des enseignants et étudiants de l’option Arviter classique. A toutes personnes qui nous a aidés de près ou de loin. ZIREGUE MERIEM Je dédie ce modeste travaille : A ma très chère mère Affable, honorable, adorable : tu représentes pour moi le symbole de la bonté par excellence, la source de tendresse et l’exemple du dévouement qui n’a pas cessé de m’encourager et de prier pour moi. Ta prière et ta bénédiction m’ont été d’un grand secours pour mener à bien mes études. Aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer ce que tu mérites pour tous les sacrifices que tu n’as cessé de me donner depuis ma naissance, durant mon enfance et même à l’âge de l’adolescence. -

10 19 Joumada Ethania 1432 22 Mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 29 Annexe Compétence Territoriale
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 Joumada Ethania 1432 10 22 mai 2011 Annexe Compétence territoriale des tribunaux administratifs Tribunaux administratifs Communes Adrar - Bouda - Ouled Ahmed Timmi - Tsabit - Sebaâ - Fenoughil - Temantit - Temest - Adrar Timimoun - Ouled Saïd - Ouled Aïssa - Aougrout - Deldoul - Charouine - Metarfa - Tinerkouk - Talmine - Ksar Kaddour - Reggane - Sali - Bordj Badji Mokhtar - Timiaouine - Zaouiet Kounta - In Zghmir - Aoulef - Timekten - Akabli - Tit. Chlef - Sendjas - Oum Drou - Labiod Medjadja - El Hadjadj - Boukadir - Ouled Ben Abdelkader - Oued Sli - Sobha - Ténès - Abou El Hassan - El Marsa - Beni Haoua - Sidi Chlef Akkacha - Souk El Bagar - Talassa - Moussadek - Oued Goussine - Breira - Ouled Farès - Chettia - Bouzeghaïa - Tadjena - Zeboudja - Benaïria - Aïn Merane - Taougrite - Herenfa - Dahra. Aïn Defla - Rouina - El Amra - Arib - Djelida - Bourached - Zeddine - Mekhatria - Djemaâ Ouled Chikh - Bathia - El Attaf - Ouled Abbès - Béni Bouateb - Harchoun - El Abadia - Aïn Defla Tiberkanine - El Maïne - Belass - Aïn Bouyahia - Tacheta Zougagha - Beni Rached - El Karimia - Oued Fodda - Miliana - Ben Allel - Hammam Righa - Aïn Benian - Aïn Torki - Hoceinia - Khemis Miliana - Tarik Ibn Ziad - Sidi Lakhdar - Bir Ould Khelifa - Bordj Emir Khaled - Djendel - Oued Chorfa - Barbouche - Oued Djemaâ - Aïn Lechiakh - Aïn Sultan - El Hassania - Bou Medfaâ. Laghouat - Ksar El Hirane - Mekhareg - Sidi Makhelouf - Hassi Delaâ - Hassi R'Mel - Aïn Laghouat Madhi - Tadjmout - El Assafia - El Houaïta -

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Octobre 2018
N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

Officines De Pharmacie 1
Officines de pharmacie 1 N° et date N° Nom Prénom Adresse Commune Téléphone E-mail d’agrément 1 KAOUKA REGUIA MARCHE COUVERT EL-GHARBIA Laghouat 029-93-17-16 N :035/17-01-1998 02 REZZOUG REDHA RUE TELIDJI EL-GHARBIA // 029-90-43-56 N :037/06-11-1989 03 DALI KHEIRA RUE DE LAMOSQUE EL-GHARBIA // 029-90-33-49 N :004/16-01-1988 04 ADI SOUAD AV. DE L’INDEPENDANCE LAGHT // 029-93-21-64 N :027/03-06-1997 05 YOUCEFI KAWTHAR RUE OASIS NORD LAGHT // 029-90-54-96 N :014/31-10-1995 06 BOUZIDI BACHIR PLACE KHEMISTI LAGHOUAT // 029-93-49-98 N :210/22-06-1982 07 CHATTA NADJET AV. 1 ER NOVEMBRE LAGHOUAT // 029-92-26-06 N :051/28-11-1990 08 CHETTIH SOUAD AV. 1 ER NOVEMBRE LAGHOUAT // 029-90-20-16 N :151/03-05-1999 09 BOUZIANI ALI AV. 1 ER NOVEMBRE LAGHOUAT // 029-90-34-76 N :217/19-02-1985 10 DALI NAWAL RUE MAHBOUB MOH SELLIS LAGH // 029-92-90-72 N :022/24-07-1989 11 BOUSSEBSI MUSTAPHA RUE MAHBOUB MOH SELLIS // 029-93-43-42 N :387/10-07-2001 12 TIHAMI AMEUR AV. PASTEUR LAGHOUAT // 029-90-42-45 N :004/18-02-1990 13 LACHKHEM TOUFIK RUE DR SAADANE LAGH // 029-93-44-30 N :018/27-05-1990 14 HELLI AZIZA RUE AHMED BENSALEM LAGHT // 029-92-97-84 N :034/17-01-1998 15 BOUDERBALA HAMZA CITE BOUAMEUR MAMOURAH // 029-93-11-20 N :024/24-07-1989 16 YAGOUBI AMEL QUARTIER SOUFI MAMOURAH // 029-92-94-10 N :036/17-01-1998 17 BENMILOUD AICHA CITE EL – MAKAM LAGHOUAT // 029-92-85-53 N :008/27-03-1989 18 BENARFA MALIKA CITE 482 LOGTS LAGHOUAT // 029-93-39-96 N :030/07-09-1992 19 ZENEKHRI ASSIA OASIS NORD LAGHOUAT // 029-92-29-99 N :574/06-12-1998 Officines de pharmacie 2 E- -

Bréves Du Centre
L’Algérie profonde / Actualités L’Algérie profonde Bréves du centre Boumerdès : Bientôt un laboratoire régional de la qualité et de la conformité < La wilaya de Boumerdès sera bientôt dotée d’un laboratoire régional d’analyses pour le contrôle de la qualité et de la conformité a-t-on appris d’une source crédible. Ce projet d’envergure entre dans le cadre du plan quinquennal 2010/2012 et sera réalisé au chef-lieu, sur une assiette foncière d’une superficie de 1 000 m2. La même source affirme que cette structure financière, la première du genre à Boumerdès, offrira pas moins de 50 postes d’emploi et aura pour principale mission l’analyse expérimentale et le contrôle de la qualité de différents produits et substances alimentaires, agricoles et industrielles. Ce laboratoire aura aussi à contrôler les matériaux de construction et articles d’habillement en vue de vérifier leur conformité aux normes en vigueur. Le coût global de la réalisation de ce projet a été estimé à 150 millions de dinars. Par ailleurs, on vient d’apprendre que les travaux de réhabilitation de l’ancien marché couvert de détail de la ville des Issers auraient été entamés au grand damde la population . Nacer Zerrouki LAGHOUAT : Un plan sécuritaire préventif “Spécial Ramadhan” mis en place < Alors que les daïras de Qsar-El Hirane, Brida et Sidi-Makhlouf, disposent uniquement de siège de sûreté de daïra, le responsable de la communication de la Sûreté de wilaya de Laghouat a précisé que la couverture en infrastructures de police, urbaine et sûreté de daïra, concerne jusque-là les agglomérations de Laghouat, Aflou et Hassi-R’mel. -

Metlili, Atlas Saharien Central (Laghouat – Algerie)
N° d’ordre: Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université d’Oran Faculté des sciences de la Terre, de Géographie et d’Aménagement du territoire Mémoire Présenté pour l’obtention du grade de Magister en Science de la terre Option : Hydrogéologie CARTOGRAP HIE ET PROTECTION QUALITATIVE DES EAUX SOUTERRAI NES EN ZONE ARIDE, CAS DE MILOK - METLILI, ATLAS SAHARIEN CENTRAL (LAGHOUAT – ALGERIE) Par Atallah CHENAFI Soutenu le 03 juillet 2013 devant la commission d’examen STAMBOUL M. Maître de conférences Université de Laghouat Président MANSOUR. H Professeur Université d’Oran Rapporteur HASSANI. M.I Professeur Université d’Oran Examinateur SAFA. A Maître de conférences Université d’Oran Examinateur FOUKRACHE. M Maître assistant Université d’Oran Invité Année universitaire 2012 - 2013 RESUME Le travail de recherche en question consiste à l’étude hydrogéologique de la région du Milok mekhareg, sur laquelle les différentes unités seront individualisées par leurs paramètres hydrodynamiques, d’établir une cartographie piézométrique récente et la comparer avec les campagnes antérieures à des fins d’analyse spatio-temporelle du système hydrogéologique Metlili-Milok. Le dernier volet est consacré à l'évolution de la chimie des eaux en tenant compte du contexte environnemental propre à la région, dont on citera particulièrement l'existence d'un périmètre agricole de plus de 500 ha où l’utilisation abusive d’engrais est mise en évidence ainsi que l’importance de la station de service NAFTAL située au niveau du carrefour RN23-RN01, de la station de compression de gaz de Milok, de la station de pompage SONATRACH, de l'usine de mise en bouteille de l'eau minérale MILOK et du champ captant du synclinal de la dakhla. -
Etude De La Variabilité Spatiale Et Temporelle Du Chimisme Des Eaux
N°d’ordre : 26/012- M/GC REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DES SIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENNE FACULTE DE GENIE CIVIL MEMOIRE Présenté pour l’obtention du diplôme de MAGISTER En : Génie civil Spécialité : Hydraulique Par ROUIGHI Mustapha Thème Étude de la variabilité spatiale et temporelle du chimisme des eaux de la nappe libre de la région de Laghouat Soutenu publiquement, Le 08 Juillet 2012 , Devant le jury composé de : Mme. Doudja SOUAG MCA à l’USTHB Présidente Mme. Souaâd BOUZID-LAGHA Professeur à L’USTHB Directrice de thèse Mr. Abdallah AIDAOUI Professeur à L’ENSA Examinateur Mr. Med Salah BENCHEIKH LEHOCINE MCA à L’USDB Examinateur Remerciement Au terme de ce travail, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire et en particulier : Pr. Souaâd BOUZID-LAGHA, Professeur à l’université des sciences et de la Technologie Houari Boumedienne, qui a accepté de diriger ce travail, je lui exprime mon profond respect. Dr. Doudja SOUAG, Maitre de conférence à l’université des sciences et de la Technologie Houari Boumedienne, qui a la bienveillance d’accepter de juger ce travail et de le présider. Je tiens à lui exprimer toute ma gratitude. Pr. Abdallah AIDAOUI, Professeur à l’école nationale supérieure de l’agronomie pour sa participation de juger ce travail. Dr. Med Salah BENCHEIKH LEHOCINE, Maître de conférence à l’université de Blida, pour avoir bien voulu juger ce travail. Mes plus vifs remerciements vont plus particulièrement à mes chers parents et frères (Larbi,Mohamed,Tahar,Kouidre ). -
Combined Effect of Temperature, Ph and Salinity Variation on the Growth Rate of Gloeocapsa Sp
EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci 14, 7101-7109 (2020) Combined effect of temperature, pH and salinity variation on the growth rate of Gloeocapsa sp. in batch culture method using Aiba and Ogawa medium Houria Bouazzara 1,2*, Farouk Benaceur 1,2, Rachid Chaibi 1,2, Ibtihel Boussebci 2, Laura Bruno 3 1 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Amar Telidji, 03000 Laghouat, ALGERIA 2 Laboratory of Biological and Agricultural Sciences (LSBA), Amar Thelidji university, Laghouat (UATL), 03000, ALGERIA 3 LBA-Laboratory of Biology of Algae, Dept. of Biology, University of Rome “Tor Vergata”, via Cracovia 1, 00133 Rome, ITALY *Corresponding author: [email protected] Abstract The development of cyanobacterial cultures is influenced by many environmental factors. In this analysis, the effect of pH, salinity and temperature on the growth of Gloeocapsa sp. isolated from Tadjmout dam, Laghouat province (Algeria) was investigated. The axenic cultures were maintained in sterilized culture media (Aiba and Ogawa). pH of the media was adjusted to 6, 7 and 10 using NaOH and HCl, while salinity was adjusted to 0.1%, 0.3%, 0.6% and 0.9% by varying the amount of NaCl in the media. The effect of temperature was studied by incubating the cultures at 25˚C, and 50˚C. The growth of Gloeocapsa sp. were determined by measuring its optical density and its chlorophyll-a content. Gloeocapsa sp. preferred alkaline pH. Low pH levels adversely affect the growth of Gloeocapsa sp. and substantially decreased at pH 6 despite sustained low biomass growth at pH 6 and 7.