Dossier De Demande D'extension D'autorisation D'exploiter Societe
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Impact of Overtaking Bans for Heavy Goods Vehicles
DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES STRUCTURAL AND COHESION POLICIESB POLICY DEPARTMENT AgricultureAgriculture and Rural and Development Rural Development STRUCTURAL AND COHESION POLICIES B CultureCulture and Education and Education Role The Policy Departments are research units that provide specialised advice Fisheries to committees, inter-parliamentary delegations and other parliamentary bodies. Fisheries RegionalRegional Development Development Policy Areas TransportTransport and andTourism Tourism Agriculture and Rural Development Culture and Education Fisheries Regional Development Transport and Tourism Documents Visit the European Parliament website: http://www.europarl.europa.eu/studies PHOTO CREDIT: iStock International Inc., Photodisk, Phovoir DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES TRANSPORT AND TOURISM THE IMPACT OF OVERTAKING BANS FOR HGVs ON TWO-LANE HIGHWAYS, ON TRAFFIC FLOWS AND ROUTES OF TRANSPORT NOTE This document was requested by the European Parliament's Committee on Transport and Tourism. AUTHORS TRL Limited* RESPONSIBLE ADMINISTRATOR Mr Piero Soave Policy Department B: Structural and Cohesion Policies European Parliament B-1047 Brussels E-mail: [email protected] EDITORIAL ASSISTANCE Ms Angélique Lourdelle LINGUISTIC VERSIONS Original: EN Translations: DE, ES, FR, IT, NL, RO ABOUT THE EDITOR To contact the Policy Department or to subscribe to its monthly newsletter please write to: [email protected] Manuscript completed in March 2010. Brussels, © European Parliament, 2010. This document is available on the Internet at: http://www.europarl.europa.eu/studies DISCLAIMER The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the author and do not necessarily represent the official position of the European Parliament. -
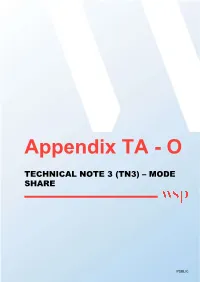
Appendix TA - O
Appendix TA - O TECHNICAL NOTE 3 (TN3) – MODE SHARE PUBLIC THE LONDON RESORT WSP Project No.: 70063529 | Our Ref No.: 70063529 December 2020 London Resort Company Holdings Ltd London Resort Company Holdings Ltd THE LONDON RESORT Technical Note 3: Mode Share 70063529 NOVEMBER 2020 CONFIDENTIAL London Resort Company Holdings Ltd THE LONDON RESORT Technical Note 3: Mode Share TYPE OF DOCUMENT (VERSION) CONFIDENTIAL PROJECT NO. 70063529 OUR REF. NO. 70063529 DATE: NOVEMBER 2020 WSP Mountbatten House Basing View Basingstoke, Hampshire RG21 4HJ Phone: +44 1256 318 800 Fax: +44 1256 318 700 WSP.com CONFIDENTIAL QUALITY CONTROL Issue/revision First issue Revision 1 Revision 2 Revision 3 Updates following Remarks Confidential Draft consultee response Date June 2020 November 2020 Prepared by P Moss P Moss / A Smith Signature Checked by A Smith A Smith Signature D Dixon / R D Dixon / R Authorised by Hutchings Hutchings Signature Project 70063529 70063529 number Report number \\Uk.Wspgroup.Com\Central Data\Projects\700635xx\70063529 - London Paramount Resort\03 WIP\TP File reference Transport Planning\05 Reports\TECHNICAL NOTES\TN3_Modeshare\20201126_LR_TN3_Mode Share_Update V1.3.Docx THE LONDON RESORT CONFIDENTIAL | WSP Project No.: 70063529 | Our Ref No.: 70063529 November 2020 London Resort Company Holdings Ltd CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY 1 UPDATES FOLLOWING CONSULTATION 1 THE LONDON RESORT 2 REVIEW OF EXISTING DATA SOURCES 2 FORECAST VISITOR MODE SHARE AND TRAVEL DEMAND 3 REVIEW OF EXISTING DATA SOURCES – STAFF TRAVEL 3 1 INTRODUCTION 4 1.1 INTRODUCTION -

Information Destination De Voyage Hapimag Houseboats Alsace
Information destination de voyage Hapimag Houseboats Alsace Arrivée Voiture Depuis Lyon/Dijon (A31) : quittez l’autoroute A31 en direction de Metz/Nancy à la sortie n° 11, puis roulez en direction de Neuves-Maisons/Colombey-Les-Belles sur la D974 pendant env. 1,3 km jusqu’à Allain. Tournez à droite sur la D331 en direction de Thuilley-aux-Groseilles/Neuves-Maisons/Nancy. À Ludres, au rond-point, tournez à droite dans la rue Pasteur, puis à gauche après env. 300 m et prenez l’autoroute A330/E23. Après env. 17 km, prenez l’A33 (plus loin la voie rapide N333) et continuez en direction de Strasbourg/Lunéville/Zone industrielle Fléville. Après 20 km, prenez la sortie en direction de Marainvillier et roulez sur la D99/D400. À Marainvillier, tournez à droite sur la D161. À Emberménil, tournez à gauche sur la D19. Après env. 7 km, à Vancourt, continuez sur la D89 A en direction de Lagarde. À Lagarde, passez le pont du canal et tournez à gauche après env. 100 m en direction du port. Depuis Luxembourg (A31/E25) en passant par Metz (A4/E25) : entrée en France en passant par Luxembourg via l’A31/E25. Passez Thionville et suivez l’A4/E25/E50 en direction de Metz-Est/Saarbrücken/Strasbourg. Puis, continuez sur l’A315 en direction de Metz-Est/Château-Salins/Technopole Metz 2000. Prenez la N431 en direction de Nancy/Château-Salins/Aéroport régional/Centre Foires et Congrès/Technopôle. Après env. 13 km, au rond-point, prenez la D955 en direction de Strasbourg/Mohrange/Château-Salins/Aéroport régional/Centre Foires et Congrès. -

Information Destination De Voyage Hapimag Houseboats Alsace
Information destination de voyage Hapimag Houseboats Alsace Arrivée Voiture Depuis Lyon/Dijon (A31) : quittez l’autoroute A31 en direction de Metz/Nancy à la sortie n° 11, puis roulez en direction de Neuves-Maisons/Colombey-Les-Belles sur la D974 pendant env. 1,3 km jusqu’à Allain. Tournez à droite sur la D331 en direction de Thuilley-aux-Groseilles/Neuves-Maisons/Nancy. À Ludres, au rond-point, tournez à droite dans la rue Pasteur, puis à gauche après env. 300 m et prenez l’autoroute A330/E23. Après env. 17 km, prenez l’A33 (plus loin la voie rapide N333) et continuez en direction de Strasbourg/Lunéville/Zone industrielle Fléville. Après 20 km, prenez la sortie en direction de Marainvillier et roulez sur la D99/D400. À Marainvillier, tournez à droite sur la D161. À Emberménil, tournez à gauche sur la D19. Après env. 7 km, à Vancourt, continuez sur la D89 A en direction de Lagarde. À Lagarde, passez le pont du canal et tournez à gauche après env. 100 m en direction du port. Depuis Luxembourg (A31/E25) en passant par Metz (A4/E25) : entrée en France en passant par Luxembourg via l’A31/E25. Passez Thionville et suivez l’A4/E25/E50 en direction de Metz-Est/Saarbrücken/Strasbourg. Puis, continuez sur l’A315 en direction de Metz-Est/Château-Salins/Technopole Metz 2000. Prenez la N431 en direction de Nancy/Château-Salins/Aéroport régional/Centre Foires et Congrès/Technopôle. Après env. 13 km, au rond-point, prenez la D955 en direction de Strasbourg/Mohrange/Château-Salins/Aéroport régional/Centre Foires et Congrès. -

Transports ; Direction Routes, Circulation Routière (1968-1981) - Direction Routes (1982) (1975-1984)
Transports ; Direction routes, circulation routière (1968-1981) - Direction routes (1982) (1975-1984) Répertoire (19860556/1-19860556/131) Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1986 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_013195 Cet instrument de recherche a été encodé en 2010 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 19860556/1-19860556/131 Niveau de description fonds Intitulé Transports ; Direction routes, circulation routière (1968-1981) - Direction routes (1982) Intitulé SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART Date(s) extrême(s) 1975-1984 Nom du producteur • Direction générale des routes Localisation physique Pierrefitte DESCRIPTION Présentation du contenu Sommaire Art 1-131 (R 3143-3273) : Surveillance et entretien des ouvrages d'art, rapports, notes et dossiers techniques, 1975-1984. Art 1-10 : Dossiers généraux, dossiers par autoroute. Art 11-131 : Dossiers classés par région puis par département. Type de classement Classement par département, par région TERMES D'INDEXATION route; pont; ouvrage d'art; autoroute; plan; étude; plan; dossier technique; financement; étude; contrôle technique 3 Archives nationales (France) Répertoire (19860556/1-19860556/131) 19860556/1-19860556/10 R 3143-R 3152 AUTOROUTES 19860556/1 R 3143 - Dossier Général : rapport entre l'Etat et les sociétés d'autoroutes A1 - Département du Nord (59) . Roncq : Viaduc. 1977-82 - Pas de Calais (62) . Izel les Esquerchin : (franchissement de l'A1 par le CD40. -

Gîtes De La « Forêt D'argonne »
Gîtes de la « Forêt d’Argonne » « Les Sentiers du Bois » Capacité 6-8 personnes TARIFS 2019 Week-end Semaine Semaine (vendredi 15h au (lundi 16h au Nuitée complète (lundi Mois lundi 10h) vendredi 10h) 16h au lundi 10h) Saison haute (juin à septembre) 150€ 280€ 400€ 550€ 1950€ Saison basse (octobre à mai) 120€ 250€ 350€ 500€ 1700€ Location de draps de lit : 7€ / Prestation ménage : 50€ EQUIPEMENTS : - 3 chambres (1 lit double), - 1 salon – salle à manger (canapé, 2 fauteuils, table basse, buffet, TV, table, chaises), - 1 petit salon (clic-clac, 3 fauteuils, table basse, buffet, TV), - 2 cuisines (four traditionnel, four micro-ondes, bouilloire, cafetière, plaque de cuisson induction, réfrigérateur-freezer, congélateur, lave-vaisselle, grille-pain, vaisselle,…), - 1 lingerie (lave-linge, sèche-linge, fer à repasser, table à repasser, panière,…), - 2 salles d’eau (douche à l’italienne,…), - 2 WC. Extérieur : - 1 jardin (salon de jardin, vue sur la forêt de la Haute Chevauchée) SITUATION COMMERCES SERVICES : Situation : Le gîte se situe à 35 km de Verdun et 10 km de Sainte-Menehould. Par l’autoroute A4 (autoroute de l’Est : Paris-Reims-Metz-Strasbourg), prendre la sortie 29 (à Auzéville-en-Argonne, direction Clermont-en- Argonne, Les Islettes) La gare de Meuse TGV se situe à 24 km. Commerces et services : - Dans le village de Les Islettes situé à 3 km du gîte vous trouverez une boulangerie, une épicerie et une pizzeria. - Dans la commune de Clermont-en-Argonne situé à 5km du gîte vous trouverez une boulangerie, un petit supermarché, des stations essence, des restaurants, une pharmacie, un médecin, une banque, un garage, des producteurs locaux et un office de tourisme. -

Mise En Page 1
La Halle du Boulingrin REIMS, LA VILLE MODERNE ET FLAMBOyANTE Ville emblématique de la tradition champenoise, Reims a su préserver tous les trésors d’un patrimoine architectural et culturel qui font encore aujourd’hui sa renommée internationale. La ville des Sacres invite à la flânerie aux détours des rues du centre historique magnifié par la cathédrale Notre-Dame, où le style gothique flamboyant exprime à jamais le raffinement d’une cité en constante recherche d’excellence. Du Palais du Tau à l’Abbaye Saint-Rémi , du musée des Beaux- Arts aux Halles du Boulingrin , des squares, parcs et promenades aux nombreuses manifestations et festivals, Reims est un musée à ciel ouvert et une source inépuisable d’activités et de loisirs. La cathédrale Notre-Dame de Reims Le tramway Le Parc de la Patte d’Oie L’ange de la Victoire Son dynamisme économique et sa situation stratégique, à la croisée des grandes villes de l’est de la France, de la Belgique et de l’Allemagne, participent au développement de cette agglomération de plus d’un million d’habitants, devenue un véritable pôle d’attractivité pour les étudiants et les investisseurs. A moins de quarante minutes de Paris et de l’aéroport de Roissy grâce au TGV, Reims l’européenne, concilie de façon remarquable les richesses de son prestigieux héritage avec les exigences de la modernité. Une ville à vivre sans modération. 136-140 rue des Capucins - 51100 Reims ESPACE DE VENTE 24 rue Chanzy - 51100 Reims INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 7 JOURS SUR 7 0 811 855 550 (prix d’un appel local depuis un poste fixe ) RETROUVEZ CE PROGRAMME SUR WWW.REIMS-CAPUCINS.COM LE CLOS DES CAPUCINS, point de départ de toutes vos envies. -

Les Risques Majeurs a Hochfelden
LES RISQUES MAJEURS A HOCHFELDEN DOCUMENT D'INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS DICRIM 1 SOMMAIRE PRÉSENTATION DE LA COMMUNE ...................................................................................................................................................................... 4 GLOSSAIRE ................................................................................................................................................................................................................ 5 LE MOT DU MAIRE .................................................................................................................................................................................................. 6 PRÉSENTATION DU RISQUE MAJEUR ................................................................................................................................................................. 7 INFORMATION PRÉVENTIVE ................................................................................................................................................................................ 9 CADRE LÉGISLATIF ............................................................................................................................................................................................. 9 LES DOCUMENTS D'INFORMATION .............................................................................................................................................................. 10 LES ÉCOLES ........................................................................................................................................................................................................ -

Rapport Annuel VINCI 2010
Rapport annuel 2010 Pro!l Dates clés 1891 Années 1990 Premier groupe mondial de concessions Création des Grands Plusieurs opérations Travaux de Marseille de croissance externe et de construction, VINCI emploie près (GTM). donnent à la SGE une de 180 000 col laborateurs dans une dimension européenne. 1899 centaine de pays. Son métier est de Création de la société 1996 Girolou (centrales La SGE se réorganise en concevoir, construire, !nancer et gérer et réseaux électriques, quatre pôles de métiers : concessions). concessions, énergies, des équipements qui améliorent la vie routes, construction. de chacun : infrastructures de transport, 1908 Création, au sein 2000 bâtiments publics et privés, de Girolou, de la Société Vivendi (ex-Compagnie Générale d’Entreprises Générale des Eaux) aménagements urbains, réseaux d’eau, (SGE). achève son désengagement d’énergie et de communication. 1946 du capital de la SGE. La SGE, très présente OPA amicale sur GTM : VINCI met sa performance de groupe privé dans l’électricité jusqu’à la fusion SGE-GTM au service de l’aménagement de la ville la nationalisation de donne naissance à ce secteur, se redéploie VINCI, premier groupe et du développement des territoires. dans le bâtiment et mondial de concessions, les travaux publics. de construction et de Son modèle intégré de concessionnaire- services associés. 1966 constructeur conjugue ainsi les enjeux La Compagnie Générale 2002 de court terme de l’activité de ses d’Électricité prend VINCI entre au CAC 40. le contrôle de la SGE. entreprises et les enjeux de long terme 2006 1970 VINCI acquiert ASF, de ses réalisations. La SGE participe à la premier création de Co!route, concessionnaire qui !nance, construit et autoroutier français. -

Bifurcation De Vendenheim Resume Non Technique
AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM RESUME NON TECHNIQUE CHAPITRE 2 : RESUME NON TECHNIQUE 13 AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM RESUME NON TECHNIQUE SOMMAIRE 1. Description de l'état initial du site et de son environnement 17 2. Présentation du projet et raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, la solution présentée a été retenue 24 3. Analyse des effets du projet sur l'environnement et mesures pour réduire, supprimer ou compenser ces effets 26 4. Les effets du projet sur la santé 32 5. Coûts collectifs des pollutions et nuisances, avantages induits pour la collectivité et bilan énergétique 33 15 RESUME NON TECHNIQUE AUGMENTATIO1. NDESCRIPTIO DE LAN CAPACIT ÉDE DE L'ETA LAT BIFURCATIO NINITIA DLE VENDENHEI DUM1.2 . SITLA ERESSOURC ETE EN EADUE SON ENVIRONNEMENT Hvdroqraphie : L'aire d'étude est comprise dans le Bassin Rhin-Meuse. Ce dernier s'étend sur la totalité de la région alsacienne. Sa superficie est d'environ 32 700 km^ soit 5,7 % du territoire national pour une population de 4 millions d'habitants (soit 7 % de la population française). 1.1. LE MILIEU PHYSIQUE L'aire d'étude est soumise aux prescriptions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse, approuvé le 15 novembre 1996. Ce SDAGE fixe les grandes orientations d'une te contexte climatique : Le climat du Bas-Rhin est de type continental humide. II est marqué par des hivers gestion équilibrée de la ressource en eau sur l'ensemble du bassin. L'aire d'étude s'étend également dans les rigoureux froids et secs (température de 4,6'C et précipitations de 120,4mm en moyenne) et des étés chauds et limites du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) lll-Nappe-Rhin. -

Valuation Report EIF Staarwood 1 Dec 2014
VALUATION REPORT European Industrial Fund – France, Germany and Netherlands Starwood Capital Europe Advisers LLP Bank of America Merrill Lynch International Limited 2 King Edward St London, EC1A 1HQ Date of Valuation: 1 December 2014 TABLE OF CONTENTS 1 EXECUTIVE SUMMARY 2 VALUATION REPORT 3 PROPERTY REPORTS 4 MARKET COMMENTARY 5 LETTER OF INSTRUCTION EXECUTIVE SUMMARY 2 1 EXECUTIVE SUMMARY EXECUTIVE SUMMARY 3 EXECUTIVE SUMMARY The Properties Address: 32 properties located in France (27), Germany (3) and Netherlands (2) Main Use: Industrial The European Industrial Fund comprises a total of 32 properties located in France (27), Germany (3) and Netherlands (2). The total portfolio is approximately 223,000 sq m. Tenure Freehold Tenancies and Covenant Strengths Details are provided in the individual property reports in Section 3. Valuation Methodology Investment Valuation Methodology – Traditional Approach. We have used Argus Valuation Capitalisation software. Valuation Summary A summary of our valuation figures for the overall portfolio and by country are set out below. Market Value €130,437,000 (ONE HUNDRED AND THIRTY MILLION, FOUR HUNDRED AND THIRTY SEVEN THOUSAND EUROS) VALUATION SUMMARY - EUROPEAN INDUSTRIAL FUND - 1 DECEMBER 2014 COUNTRY TOTAL AREA (SQM) VACANT AREA (SQM) GROSS RENT NET RENT GROSS ERV VACANT ERV CAPEX COSTS GROSS MULTIPLIER NIY GROSS VALUE MARKET VALUE France 167,176 27,764 €9,654,696 €8,681,448 €10,733,679 €1,547,655 €2,849,225 11.2 x 7.34% €118,282,071 €107,832,000 Germany 41,703 0 €2,344,361 €2,264,283 €1,877,550 -

Driving to Résidence Laforêt from Calais/Boulogne Shopping En Route & on Return Journey
[LTZ1] Driving to Résidence Laforêt from Calais/Boulogne Shopping en route & on return journey. Departing and getting onto the Autoroute at Riddes See also website «www.laforet35.ch» Disclaimer: This document is intended as informative only. The reader is solely responsible for judging the driving abilities, preferences, vehicle capability etc. for their journey. Roads and route details may change subsequent to publication. All liability for accuracy is disclaimed. The nominal drive time to la Tzoumaz from Calais is 8½ hours excluding breaks. This assumes reasonable weather and the use of motorways for the majority of the journey. There are essentially two routes, either all-motorway, or a more direct one that uses A-Roads for the middle part of the journey. You must have a Swiss Motorway Vignette displayed on the windscreen (CHF 40) if you use the Swiss Autoroutes. A Vignette can be obtained in advance form the Swiss Travel Centre in London (www.stc.co.uk), at the border, or at most motorway petrol stations. The police are very hot on picking up drivers without a vignette. Without it, using only minor roads will add over 2 hours to your journey. French Autoroute Toll Tag We rent a French SANEF motorway screen tag which allows us to drive straight through the reserved ‘T’ lanes on French Autoroutes. Tolls are debited from our UK bank account. See https://www.saneftolling.co.uk/?gclid=CMvs-7HOtbwCFYcSwwodBh8ANA Note the comments on winter tyres and chains at the end of the document. A more detailed guide to winter tyres is available. The Route There are four segments to the journey 1.