RABEMANANTSOA Fredo Omar PROTECTION DES ABEILLES
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plan De Développement De La Filière Apiculture Selon La Démarche Clustering : Cas De La Région Analamanga
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO _____________________ Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie ________________ Département : ECONOMIE MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS) EN DEVELOPPEMENT LOCAL ET GESTION DE PROJETS PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE APICULTURE SELON LA DEMARCHE CLUSTERING Cas de la Région Analamanga Impétrant : RANAIVOANDRIAMANANANTENA Tiahanitra Hermona Encadreur pédagogique : Monsieur ANDRIAMALALA Mamisoa Fredy Maître de Conférences ; Département Economie de la Faculté DEGS Encadreur professionnel : Monsieur ANDRIANARIVELO Alain Consultant Animateur Cluster au sein du Programme PROSPERER Analamanga Date de soutenance : 23 Mai 2012 Décembre 2011 REMERCIEMENTS « Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! Mon âme, bénis l’Eternel. Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! » Psaume 104 : 1-2 Je tiens également à exprimer ma gratitude à : - Monsieur Le Chef du département Economie ; FANJAVA Refeno ; ainsi qu’à tout le corps enseignant en DESS ; option Développement Local et Gestion des Projets. - Monsieur RAMIARAMANANA Jeannot, Directeur des études en DESS, option Développement Local et Gestion des Projets. - Monsieur le Coordonateur Régional du programme PROSPERER Analamanga, ANDRIAMIHAMITSOA RASAMOELY de m’avoir donné l’opportunité d’effectuer le stage au sein du programme PROSPERER Analamanga. - Monsieur ANDRIAMALALA Mamisoa Fredy ; maître de Conférences ; Département Economie de la Faculté DEGS; mon encadreur pédagogique ; pour avoir accepté l’encadrement de ce travail ; ses pertinences recommandations et sa disponibilité malgré ses multitudes d’occupations. - Monsieur ANDRIANARIVELO Alain ; mon encadreur professionnel ; Animateur Cluster au sein du programme PROSPERER Analamanga; avec qui j’ai l’honneur et le plaisir d’achever vivement ce travail. -
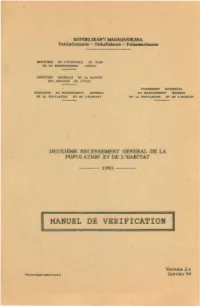
[ Manuel De Verification'i
~POBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahanâ - Fahamarinana YIN1ST~RB DE L' ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRBSSBMENT SOCIAL DIRBCTION' GBNERALE DE LA BANQUE DES DON NEES DE L'BTAT COMMISSION N'ATIONALE DIRECTION DV RECENSEMBNT GENERAL- DU iECBNSENENT ~ENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DB LA 1'OPULATION ST J)E L'HABITAT ,. DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1993 --- 1 / [ MANUEL DE VERIFICATION ' I Version 2.s . fO\<l.ocrsph\lIIanveT2.8 Janvier 94 REPOBLlKAN'I MADAGASlKARA 'farundrazalla - Fahafahana - Fahamarinana UINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRESSEMENT SOCIAL DIRECTIO:-: GENERALE DE LA BANQUE DES DONNEES DE L'ETAT COMMISSION NATIONALE DIREC1ION Dl! RECENSEMENT GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POP U LATIO:i ET DE l' HABITAT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DEUXIEME RECENSEMEl\rrr GEN]~RAL DE LA POPULATION Err DE L ~HA,BI'TAT 1993 MANUEL DE VERIFICATION 1 Il Version 2.s fb\docrBPh\manver2.s Janvier 94 SOI\.iMA1RE INTRODUCTIO~~ . 2 l - GENERALITES SUR LA VERIFICATION 1.1 - LA SECTION V"ERIFICATION ..•.........' , . ,........... 2 1.2 - LE TR~ VAIL DU \lt:RlFICATEUR ..................... 2 1.3 - L'IDEN1IFICATION DES QUESTIONNAIRES .. ,.... ~, ...... 3 1.4- LES QUESTIOl'.~.AIRES-SUITE ...................... 5 ,2 '- METIIODE DE'VERIFICATION o - MILIEU ..............................••........ 5 l - 'FARITA.N1" 2 - F IVONDRONA1\fPOK0l'41 Al"\""l , 3 - FIRAISM1POKONTMry· ..............•...•..........• 5 4 -. N°DE LA ZONE 5 - N e DU S EGME?\l . ~ . .. .... 6 6 "- FOKONTAl~l'· 7 - LOCALITE .... ' .....•..............•..... la ••' • • • • • • 8 8 - N ~ 'DU B.ATIMEr1T .•..-. _ .....•.. ~ ..••.•' .•••.•..•• · • 8 . 9 - TI'1>E' D'UTILISATION . '........................ · . 8 , <> DU ,..,.-c.... TAGE .. 9 ,~ 10. ~ _N Ir}...!::..l'" .• • . -

Universite D'antananarivo
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO _______________________________ FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE ____________________________ DEPARTEMENT GESTION MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME DE MAITRISE EN GESTION OPTION FINANCES ET COMPTABILITE PROJET DE CRÉATION D’UNE UNITÉ D’APICULTURE DANS LA RÉGION D’A MBATO MENA M ANJA KANDRIANA Présenté par : RAMINOMANANA Ny Andosoa Hiainana Miaro Zo Sous l’encadrement de : Encadreur pédagogique : Monsieur RALISON ROGER Encadreur professionnel : Monsieur RANDRIANARIVELO Frédéric Année Universitaire 2004/2005 Session : 07 décembre 2005 Promotion Kinga REMERCIEMENTS : J’adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail. Je dois une gratitude particulière à : - Monsieur RALISON Roger, Maître de conférence, Chef de Département Gestion de la Faculté DEGS, mon encadreur pédagogique. - Monsieur RANDRIANARIVELO Frédéric, Maître de conférence, Enseignant chercheur à l’école Polytechnique de Madagascar, Université d’Antananarivo, mon encadreur professionnel. J’exprime mes remerciements à tous les professeurs enseignants du Département Gestion ; J’adresse aussi mes gratitudes à : - Mes chers Parents, pour leurs grande affection et sacrifices que j’arrive à ce stade ; - Mes frères et soeurs qui n’ont cessé de m’encourager. LISTE DES TABLEAUX Tableau N°1 : Exportation de miel en 2004 Tableau N°2 : Recensement estimatif 2004 Tableau N°3 : Répartition de la population selon leur activité Tableau N°4 : Répartition -

Penser Développement, En Signant Pour La Forêt
Les Cahiers d’Outre-Mer Revue de géographie de Bordeaux 257 | Janvier-Mars 2012 Enjeux et moyens d'une foresterie paysanne contractualisée Penser développement, en signant pour la forêt La Loi Gelose « activée » dans la commune rurale de Merikanjaka (district de Manjakandriana, bordure orientale de l’Imerina) Hervé Rakoto Ramiarantsoa Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/com/6550 DOI : 10.4000/com.6550 ISSN : 1961-8603 Éditeur Presses universitaires de Bordeaux Édition imprimée Date de publication : 1 janvier 2012 Pagination : 157-185 ISBN : 978-2-86781-789-2 ISSN : 0373-5834 Référence électronique Hervé Rakoto Ramiarantsoa, « Penser développement, en signant pour la forêt », Les Cahiers d’Outre- Mer [En ligne], 257 | Janvier-Mars 2012, mis en ligne le 01 janvier 2015, consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/com/6550 ; DOI : 10.4000/com.6550 © Tous droits réservés Les Cahiers d’Outre-Mer, 2012, n° 257, p. 157-185. Penser développement, en signant pour la forêt : la Loi Gelose « activée » dans la commune rurale de Merikanjaka (district de Manjakandriana, bordure orientale de l’Imerina) Hervé RAKOTO RAMIARANTSOA1 I – Une extension particulière des transferts, en tâche d’huile 1 – Une forêt au sein d’une région difficile d’accès, et d’économie pluriactive Merikanjaka, chef-lieu de la commune rurale du même nom, se trouve sur la bordure orientale de l’Imerina (fig. 1), à environ 80 km au sud-est de Tananarive. L’accès, depuis Tananarive, est difficile. Il se fait par une piste réhabilitée sur laquelle deux taxis brousse quotidiens mettent, en dehors de la saison des pluies où la piste se trouve momentanément coupée par les grosses averses, quatre heures de temps pour arriver à la capitale. -
Hardi Du Mois
HHAARRDDII DDUU MMOOIISS Mai 2010 Bulletin des activités 2010 Guichet foncier : outil d’aide à la décision pour la communautaire Après la mise en place du guichet foncier, la Commune de Miadanandriana et l’ONG HARDI ont fixé l’objectif d’utiliser le service comme un outil de développement local. Dans cet axe de collaboration, l’amélioration de la fiscalité foncière locale et l’amélioration de la gestion du territoire ont été définies comme ligne d’intervention. Au niveau de la gestion du territoire, la réactualisation du Plan Communal de Développement figure parmi les priorités de la Commune. Afin d’intégrer la communauté locale dans tous les processus de décision, des consultations par hameau ont été entreprises pour faire sortir des Projets de Développement de Quartier. L’objectif, outre la participation, est la responsabilisation de la population par rapport à l’amélioration de leur condition de vie. Plan Local d’Occupation Foncière (PLOF) : base de décision communautaire Dans cette démarche, le guichet foncier a été fortement sollicité par rapport à son rôle de gestionnaire des bases de données de la Commune. En effet, les outils utilisés pour la confection des projets communautaires sont composés par : - Une Carte de situation générale des hameaux imprimés au format A3 (avec image satellite) - Un extrait du Plan Local d’Occupation Foncière correspondant à la limite des hameaux - Un extrait du Plan d’Occupation Foncière confectionné lors du cadastre citoyen de 2007 La disponibilité des fonds de carte du guichet foncier a permis à la population de Tableau 1 : Liste des projets adoptés par la communauté faire un état de lieu plus précis de la locale Projet taux situation de chaque hameau. -

L'influence De La Capitale Nationale Sur Le
DOMAINE ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES MENTION GEOGRAPHIE PARCOURS ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MEMOIRE DE MASTER EN GEOGRAPHIE L’INFLUENCE DE LA CAPITALE NATIONALE SUR LE DEVELOPPEMENT DU DISTRICT DE MANJAKANDRIANA Présenté par Herizo RAZANAKOTOARIMANANA Sous la direction de Gabriel RABEARIMANANA, Maître de Conférences Février 2018 DOMAINE ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES MENTION GEOGRAPHIE PARCOURS ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MEMOIRE DE MASTER EN GEOGRAPHIE L’INFLUENCE DE LA CAPITALE NATIONALE SUR LE DEVELOPPEMENT DU DISTRICT DE MANJAKANDRIANA Présenté par Herizo RAZANAKOTOARIMANANA Sous la direction de Gabriel RABEARIMANANA Maître de Conférences Membres du jury Président : M. James RAVALISON, Professeur titulaire Rapporteur : M. Gabriel RABEARIMANANA, Maître de Conférences Juge : Mme. Ravoniarijaona VOLOLONIRAINY, Maître de Conférences 26 février 2018 REMERCIEMENTS Pour la réalisation de ce dossier, nos sincères remerciements, pour le Domaine de Formation Arts, Lettres et Sciences Humaines qui nous a permis de faire ce travail, y compris le Département de Géographie et à tous les enseignants chercheurs qui ont contribué à notre formation pour arriver à ce cursus. En outre, notre reconnaissance s’adresse spécialement aux jurys qui auront une grande responsabilité pour ce dossier - M. James RAVALISON, Professeur titulaire. - Mme. Ravoniarijaona VOLOLONIRAINY, Maître de Conférences. Nous remercions, particulièrement de son aide précieux, le Directeur de Recherche Gabriel RABEARIMANANA, Maître de Conférences, qui a appuyé à l’élaboration de ce dossier. Enfin et non le moindre, nos vifs remerciements aux acteurs de cette recherche, nos familles, nos amis qui nous ont soutenu durant la préparation de ce travail. Veuillez recevoir l’expression de nos sincères remerciements. i SOMMAIRE REMERCIEMENTS ................................................................................................................ -

Commune : Ambato
RESULTAT PROVISOIRE PAR COMMUNE DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 Région :ANALAMANGA District :AMBOHIDRATRIMO COMMUNE : AMBATO Inscrits : 4 948 Rajout(s) : 1 Votants : 2 636 Taux de participation: 53,27% Blancs et Nuls : 45 soit : 1,71% Suffrages exprimés : 2 591 soit : 98,29% N° d'ordre Nom du Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 Andry Nirina RAJOELINA 802 30,95% 25 RAVALOMANANA Marc 1 789 69,05% Total des voix : 2 591 RESULTAT PROVISOIRE PAR COMMUNE DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 Région :ANALAMANGA District :AMBOHIDRATRIMO COMMUNE : AMBATOLAMPY Inscrits : 9 848 Rajout(s) : 1 Votants : 5 635 Taux de participation: 57,22% Blancs et Nuls : 402 soit : 7,13% Suffrages exprimés : 5 523 soit : 98,01% N° d'ordre Nom du Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 Andry Nirina RAJOELINA 2 351 42,57% 25 RAVALOMANANA Marc 3 172 57,43% Total des voix : 5 523 RESULTAT PROVISOIRE PAR COMMUNE DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 Région :ANALAMANGA District :AMBOHIDRATRIMO COMMUNE : AMBOHIDRATRIMO Inscrits : 13 981 Rajout(s) : 7 Votants : 6 771 Taux de participation: 48,43% Blancs et Nuls : 124 soit : 1,83% Suffrages exprimés : 6 647 soit : 98,17% N° d'ordre Nom du Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 Andry Nirina RAJOELINA 3 161 47,56% 25 RAVALOMANANA Marc 3 486 52,44% Total des voix : 6 647 RESULTAT PROVISOIRE PAR COMMUNE DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 Région :ANALAMANGA District :AMBOHIDRATRIMO COMMUNE : AMBOHIMANJAKA Inscrits : 2 794 Rajout(s) : 0 Votants : 1 423 Taux de participation: 50,93% -

Madagascar Cyclone Enawo
Moramanga Manjakandriana Antananarivo Avaradrano Antananarivo Atsimondrano ! ! ! ! ! ! MA002 Ambatofotsy Ambohitraina Ambohitromby Ambohijatovo ! ! Miadanandriana Andandemy Antanetikely Gare ! ! ! ! Tsararivotra(Tsiafahy) Soamanandray Mahatsara Ambohipeno ! Andraihoja ! Ampanataovana ! Ambohijanaka(Moratsiazo) Ambohijato ! Tsiafahy ! ! Ankarefo Fihasinana Ambohimanjaka Anosibe ! ! Ambohibihy ! ! Tsiafahy ! Ambohibary Ambohidahy Ambohitrandriamanitra ! !! Ambohaja ! Ambohitsararay Morarano Ambohitrinibe Miadanandriana Zafimbazahakely Ambohimamory ! ! ! ! Manankasina ! Ambodiala Ankazobe ! Ambohidraondriana Antanetikely AMBALAVAO ! Ankadinandriana Ambohitrandriamanitra Ambohitraivo ! Lohamandry ! ! Ambohijafy Angodongodona Ambohidavenona ! ! Atsinanana Falefika Andriampamaky ! ! Ambohitsilazaina Talatan'Ambatofahavalo ! Antamboho Ambalavao ! ! ! ! Miorikampoza Antanimasaka Amboniandrefana ! Ankadimbavy Ambohimanantsoa ! ! Ambohibarikely Ambatofahavalo ! ! Ambohibe Ambohinaorina ! ! Faravohitra !Ambatofahavalo Ampangabe ! Ambohibary ! Ambahinia Miarinarivo ! ! Ambohidraisolo Ambohimahatsinjo ! ! Antanitsara Tsinjony ! MERIKANJAKA ! Amboronosy Merikanjaka ! Ankorona Ampataka Behenjy ! ! Ambodivato ! Ambohijafy ! Mandrosoa Anosibe Andohariana Trimoloharano Morarano Ieranana Mandrosoa ! ! Ambohitsoa Tsiazompaniry Andrefana ! ! ! Ambohinanjakana Ambohimanjaka Ambohimiadana ! ! ! ! Sabotsy Ambohitrandraina Tsarazaza ! Manjakavahoaka Mahatsinjo Atsinanana Andramasina Ambalavao ! Firaisana Anosibe ! Andramasina Trimoloharano Andriatsiazo ! ! Andrere -

Essai De Cartographie Bioclimatique À Madagascar
A. CORNET NOTICE EXPLICATIVE N” 55 ESSAI DE CARTOGRAPHIE BIOCLIMATIQUE A MADAGASCAR OFFICEDE LA RECHERCHE WENTIFIOUE ETTECHNIOUE OUTRE-MER PARIS. 1974 I NOTICE EXPLICATIVE No 55 ESSAIDE CARTOGRAPHIE BIOCLIMATIQUE A MADAGASCAR A, CORNET Laboratoire de botanique Mission OKSTOM de Tananarive .......a.. II La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 'I 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les copies ou reproductions 'I strictement réservéesP l'usage privé du copiste et non destinées P une utilisation collective" et,d'autre part,que les analyses et les " courtes citations dansuq but d'exemple et d'illustration, "toute I' représentation ou reproduction intégrale,ou partielle, faite sans 'I le consentement de l'auteur ou de ses ayants droitou ayants cause, I' est illicite" (alinéa ler de l'article 40). '1 Cettereprésentation ou reproduction,parquelque procédé que II ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnéeles par I' articles 425 et suivants du Code Pénal". .......... @ORSTOM I 974 ISBN 2-7099-0339-3 SOMMAIRE INTRODUCTION A- LES GRANDS TRAITSDU CLIMAT MALGACHE Déterminisme du climat deMadagascar Types de temps B- CHOIX DES CRITERES'D'ANALYSE ET DE CLASSIFICATION 6 c- TRAITEMENT DES DONNEES IO Calcul de 1'ETP IO Température minimale 16 D- CLASSIFICATION DES TYPES DE BIOCLIMATS MALGACHES 18 Types de bioclimats 18 Répartition géographique 21 Réalisation dela carte 21 E- DISCUSSION ET RESERVES 22 CONCLUSION 25 BIBLIOGRAPHIE 27 TABLEAUX ANNEXES INTRODUCTION "Décrire,cZasser, expliquer ont toujours été Zes démarehes primordiaZes des sciences de la nature.kclimatologie n'échappe pas à ces processus dela pens&" . VIERS - 1968 aussi,nombreux sont ceux qui,pour une régionou pour le monde entier ont tenté de donner une classification des climats.En fait,aucune classifi-- cation n'est exhaustive,ni satisfaisante pour toutes les disciplines (pédologie,botanique,mEdecine ...).C'est pourquoi,il faut une classifica- tion adaptée au point de vue considéré. -

REPOBLIKAN'i MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ————— LOI N°
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ————— LOI N° 2014-020 Relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. EXPOSE DES MOTIFS Consécutivement à l’adoption de la loi organique régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, qui définit les principes généraux en matière de décentralisation, il s’avère utile de clarifier certaines de ses dispositions. La présente loi détermine les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement, aux pouvoirs, aux compétences et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées, qui se fondent sur le principe de la libre administration. La Constitution prévoit trois niveaux de Collectivités Territoriales Décentralisées. A cet effet, des nouvelles répartitions s’imposent afin d’harmoniser les attributions des organes des Collectivités Territoriales Décentralisées. La décentralisation effective visant la responsabilisation de la population dans la gestion des affaires locales, la présente loi intègre le système de redevabilité sociale dans le mode de gestion des Collectivités. Page 1/168 Dans ce sens, l’article 3 de la Constitution dispose que "la République de Madagascar est un Etat reposant sur un système de Collectivités Territoriales Décentralisées composées de Communes, de Régions et de Provinces", et le Fokonolona, conformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, "organisé en Fokontany est la base du développement et de la cohésion socioculturelle et environnementale". Les responsables des Fokontany participent à l’élaboration du programme de leur Commune. -

Etude De Construction D'une Nouvelle Route Reliant Alarobia Et L'aéroport
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTANANARIVO DEPARTEMENT BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS MEMOIRE DE FIN D’ETUDE EN VUE D’OBTENTION DU DIPLOME MASTER II, TITRE INGENIEUR EN BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ETUDE DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ROUTE RELIANT ALAROBIA ET L’AEROPORT INTERNATIONAL D’IVATO Présenté par : ANDRIANARIVELO Safidy Nirina Rapporteur : RABENATOANDRO Martin, Maître de Conférences Date de soutenance : 16 Avril 2015 Promotion 2014 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTANANARIVO DEPARTEMENT BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS MEMOIRE DE FIN D’ETUDE EN VUE D’OBTENTION DU DIPLOME MASTER II, TITRE INGENIEUR EN BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ETUDE DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ROUTE RELIANT ALAROBIA ET L’AEROPORT INTERNATIONAL D’IVATO Présenté par ANDRIANARIVELO Safidy Nirina Rapporteur : RABENATOANDRO Martin, Maître de Conférences Président du jury : RAJOELINANTENAINA Solofo, Maître de Conférences Examinateurs : RANDRIANTSIMBAZAFY Andrianirina, Maître de Conférences RAJAONARY Veroniaina, Maître de Conférences RAVAOHARISOA Lalatiana, Enseignant Chercheur Promotion 2014 Etude de construction d’une nouvelle route reliant Alarobia et l’aéroport International d’Ivato REMERCIEMENTS Tout d’abord, je remercie le Seigneur Tout Puissant car par sa Grace, je suis ce que je suis. Il a veillé sur moi depuis toujours, me donne la santé, la force et le courage pour mener à terme mes études avec la réalisation de cet ouvrage. Ensuite, j’adresse également mes sincères remerciements aux personnes suivantes : -

Ministere De L'environnement, Des Forets Et Du Tourisme
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005.