VISAGES DE FAUST AU Xxe SIÈCLE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

17 Literaturverzeichnis
212 17 Literaturverzeichnis 17 Literaturverzeichnis 17 Literaturverzeichnis 17 Literaturverzeichnis 17.1 Unveröffentlichte Quellen Le Carnaval des revues, Zensurlibretto (Archives nationales de France, F/18/1151). Coucou ! Ah ! La voilà ! Revue de l’année 1861, Zensurlibretto (Archives nationales de France, F/18/981) Fonds Nuitter/149 Pièce 3 (4ff) (Bibliothèque nationale de France). Lohengrin (Lohengrin-Tardy), Zensurlibretto (Centre de documentation des musées Gadagne, Fonds Léopold Dor 13). Lohengrin à l’Alcazar, Zensurlibretto (Archives nationales de France, F/18/1410). Lohengrin à l’Eldorado, Zensurlibretto (Archives nationales de France, F/18/1426). Monsieur Lohengrin, Zensurlibretto (Archives nationales de France, F/18/1162). Paris qui roule, Zensurlibretto (Archives nationales de France, F/18/1447). Le petit Lohengrin, Libretto (Bibliothèque royale de Bruxelles, ms II 6797). Trois jours à Bayreüth, Zensurlibretto (Archives nationales de France, F/18/1372). 17.2 Zeitungen und Periodika 17.2.1 Französischsprachige Zeitungen 17.2.1.1 Paris Annales politiques et littéraires L’Art lyrique et le music-hall : journal indépendant des cafés-concerts, concerts et théâtres Le Bien public : journal politique quotidien Les Chansons illustrées La Cocarde Le Constitutionnel L’Écho de Paris La France : politique, scientifique et littéraire Le Figaro Le Fin de siècle Le Gaulois Gazette anecdotique, littéraire, artistique et bibliographique Gazette nationale ou le Moniteur universel Gil Blas Le Grelot L’Intransigeant Journal des débats politiques -

Sir Hervé the Knight Errant Sets out to Conquer the Bouffes-Parisiens
Pascal BLANCHET, « Sir Hervé the Kniht Errant sets out to conquer the Bouffes-Parisiens » Octobre 2015 Sir Hervé the Knight Errant sets out to conquer the Bouffes-Parisiens Pascal BLANCHET ‘It is one of my best scores, but the public doesn’t always crown the best things with success . .’ Such is the humble view expressed by Hervé in his Notes pour servir à l’histoire de l’opérette, a memoir he wrote in 1881 for the dramatic critic Francisque Sarcey. In the course of a long career marked by dazzling successes and resounding flops, the composer had had many opportunities to cultivate a philosophical frame of mind. The above quotation concerns his opéra-bouffe Alice de Nevers, but he might have said the same of Les Chevaliers de la Table ronde: Alice was a complete fiasco at its premiere in 1875, Les Chevaliers received a lukewarm reception when it was first given in 1866. In both cases, we are dealing with works that deserve to be reassessed – Hervé was right! Yes, these valiant Chevaliers who return today from a long exile are worthy of enjoying a rebirth. For the work is a more important one than it may at first seem. Why? Because it constitutes a turning point, not only in Hervé’s career but in the history of operetta: with it, the so-called ‘Crazy Composer’ (le Compositeur toqué), who is regarded as the father of operetta, wrote his first full-scale opéra-bouffe in three acts, and he intended it for the Théâtre des Bouffes-Parisiens, the stronghold of his rival Jacques Offenbach. -

NITOUCHE for ALL ETERNITY Pascal Blanchet
NITOUCHE FOR ALL ETERNITY Pascal Blanchet Lovers of Hervé who decide to take a stroll through his home town of Houdain (in the Pas-de-Calais département) may go to pay their respects at no.36 rue Roger Salengro, where the house in which the composer was born in 1825 is still standing. Having read the plaque piously affixed to these venerable walls, the traveller need only go a few steps farther to reach the corner of rue Jean Jaurès. There one has the surprise of finding oneself face to face with Hervé, or at least with his statue, which rises at the centre of a pretty square that bears his name. The musician, standing behind a music desk, arms raised and baton in hand, is conducting one of his scores. By craning one’s neck slightly, one can manage to read the title: Mam’zelle Nitouche. Thus, for all eternity, Hervé will conduct this work that remains his best-known, more even than Le Petit Faust, his other great success, or the other three instalments of his ‘tetralogy’, L’Œil crevé, Chilpéric and Les Turcs. Yet it is not a work unanimously approved of by ‘Hervéistes’, some of whom denigrate it as a score of lesser stature, lacking in those large-scale ensembles that allowed Hervé to give full rein to his talent. Does this relative disdain for a piece that refuses to die have any justification? And has the time come to rehabilitate Mam’zelle Nitouche? Operetta as autobiography ‘In 1847 I was engaged as a singing actor at the Théâtre de Montmartre, then under the direction of Daudé. -

Le Faust De Goethe Dans La Musique Romantique
Le Faust de Goethe dans la musique romantique Hélène Cao En 1587, Johann Spies imprima l’anonyme Historia von D. Johann Fausten , premier ouvrage littéraire consacré à un certain docteur Faust, mort vers 1540. Si le personnage inspira aussi Marlowe, Klinger, Chamisso, Lenau ou encore Heine, Goethe seul l’éleva au rang de mythe. Au milieu des années 1770, il commença à travailler sur ce qui allait l’obséder toute sa vie. En 1808, il publia son Faust I . En 1832, peu avant sa mort, il acheva le Faust II , édité à titre posthume. La pièce fascina d’emblée les musiciens par sa concentration de thèmes romantiques (quête d’un idéal inaccessible, figure de « l’éternel féminin », folie, ton populaire, scènes fantastiques), sa dramaturgie non linéaire, mais aussi par l’importance qu’y occupe la musique : près d’un cinquième du Faust I consiste en chansons et chœurs, plus d’un quart dans le Faust II . Que faire cependant de ce drame dont les deux parties comportent res - pectivement 4614 et 1 2111 vers ? De cette intrigue discontinue qui entre - lace épisodes humoristiques, références mythologiques et réflexion métaphysique ? En incitant à l’art total, Goethe provoqua en fait la frag - mentation et la mise en musique de passages isolés. Mais ce faisant, les compositeurs s’engagèrent sur des voies inédites. 31 charles gounod : faust miniatures faustiennes En 1774, Goethe écrivit Es war ein König in Thule (« Il était un roi de Thulé »), poème publié en 1782 puis inséré dans le Faust I , qui – juste retour des choses – inspira une centaine de lieder isolés (dont ceux de Reichardt, Zelter, Schubert et Liszt). -

Faust Au Théâtre, À L’Opéra Et Sur La Scène Littéraire
Coulisses Revue de théâtre 43 | Automne 2011 Reviviscences de Faust Au théâtre, à l’opéra et sur la scène littéraire Julia Peslier (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/coulisses/197 DOI : 10.4000/coulisses.197 ISSN : 2546-9460 Éditeur Presses universitaires de Franche-Comté Édition imprimée Date de publication : 31 décembre 2011 ISBN : 978-2-84867-404-9 ISSN : 1150-594X Référence électronique Julia Peslier (dir.), Coulisses, 43 | Automne 2011, « Reviviscences de Faust » [En ligne], mis en ligne le 30 novembre 2016, consulté le 22 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/coulisses/ 197 ; DOI : https://doi.org/10.4000/coulisses.197 Ce document a été généré automatiquement le 22 septembre 2020. Coulisses 1 « Leurs Faust », une revue (non exhaustive) de l’actualité faustienne au théâtre, à l’opéra et dans nos bibliothèques Archéologie, intempestivité ou (in)actualité de Faust ? De quel temps Faust est-il le contemporain ? Du monde médiéval ? De celui de Goethe et de Marlowe ? Ou bien est-ce du nôtre qu’il faut le tirer, afin d’en cartographier les enjeux contemporains ? Souvent identifié comme dernier mythe hérité du monde médiéval, Faust trouve une vivacité remarquable dans les arts, de la littérature à l’opéra, du théâtre au cinéma. Ces nouvelles (ré)créations faustiennes sont motif à s’interroger sur la figure, quand Faust totalise un savoir sur le monde et sur le livre, sur la science et sur l’art. Alliant les réflexions d’écrivains, de compositeurs et de chercheurs, ce numéro se propose de dresser une revue (non exhaustive) de « Leurs Faust », appliquant à tous le mot de Valéry, du XIXe au XXIe siècles. -

Orchestre Symphonique
VIBRER Parcourez le monde avec Arts et Vie, le n°1 du voyage culturel Voyages accompagnés - Petits groupes - Guides francophones - Programmes culturels complets Découvrez notre collection de voyages sur www.artsetvie.com Brochure sur simple demande au 01 40 43 20 27 CD, DVD, HI-FI & CONCERTS: TOUTE L’ACTUALITÉ CLASSIQUE & JAZZ PHILHARMONIE DE PARIS ZComment elle bouleverse les codes du classique ZPetits et grands secrets ZChif res et témoignages exclusifs € - Grèce 8,10 € - Allemagne 8,40 € - TOM/S 1 050 CFP - Canada 11,99 $C - Suisse 13,40 FS - Maroc 85 MAD - RD E 7,90 F: France métropolitaine 7,90€ - Belgique 8,10 € - Luxembourg 8,10 € - DOM 8,10 € - Espagne 8,10 € - Italie 8,10 € - Portugal 8,10 N°205 - Septembre 2018 ET AUSSI : LA CHRONIQUE D’ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT • PAUL BADURA-SKODA PAR - 205 - OLIVIER BELLAMY • DANS L’INTIMITÉ DU QUATUOR HAGEN • VANESSA WAGNER... M 03813 15 millions d’épargnants français c’est 15 millions d’épargnants défendus par l’Afer Chaque jour, l’Afer milite pour préserver OHFDGUHMXULGLTXHHWȴVFDOGHOȇDVVXUDQFHYLH *ȂMDQYLHU Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger le 16/01/2018 et édité par l’Afer AssociationFrançaised’ÉpargneetdeRetraite-Associationrégieparlaloidu1erjuillet1901- 36,ruedeChâteaudun-75009Paris Contratcollectifd’assuranceviemultisupportAfer,souscritparl’Afer,auprèsdeAvivaVieetAviva EpargneRetraite:AvivaVie-SociétéAnonymed’assurancevieetdecapitalisationaucapitalde 1205528532,67euros-EntrepriserégieparleCodedesassurances-Siègesocial:70avenuede l’Europe-92270Bois-Colombes-732020805R.C.S.Nanterre.AvivaÉpargneRetraite-Société -

Le Petit Duc
Dossier artistique – Compagnie Les Frivolités Parisiennes LE PETIT DUC Opéra-comique en 3 actes de Charles Lecocq sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy « Nous voudrions faire redécouvrir à un large public ce répertoire, subtil mélange de musique et de théâtre, trait d’union entre culture populaire et musique savante. C’est pourquoi, nous recréons des spectacles et développons des actions pédagogiques avec les écoles ». Benjamin El Arbi et Mathieu Franot, fondateurs de la Compagnie des Frivolités Parisiennes Opéra-comique en 3 actes de Charles Lecocq Durée 2h30 avec entracte Ouvrage créé le 25 janvier 1878 au Théâtre de la Renaissance L'équipe artistique Direction musicale : Nicolas Simon Chef de chant : Nicolas Chesneau Conseiller musical : Pierre Girod Mise en scène : Edouard Signolet Assistante metteur en scène : Isabelle Monier-Esquis Création lumière : Virginie Galas Création costumes et scénographie : Laurianne Scimemi Del Francia Maquillage : Nadège Garnier La distribution Raoul de Parthenay : Sandrine Buendia Blanche de Cambry : Marion Tassou Nicolas Frimousse : Rémy Poulakis Montlandry : Jean-Baptiste Dumora Diane de Château-Lansac : Mathieu Dubroca Seigneurs, soldats & marmitons / Pages, demoiselles nobles de Lunéville & cantinières :12 choryphées Et l’Orchestre des Frivolités Parisiennes. Production de la Compagnie Les Frivolités Parisiennes en co-production avec le Théâtre de Dreux, leThéâtre de Saint-Dizier et l’Opéra de Reims. Avec le soutien de la Fondation Singer-Polignac, de la Ville de Paris et de la Fondation Orange. La Compagnie des Frivolités Parisiennes Benjamin El Arbi et Mathieu Franot C’est au cœur de l’opéra-comique et de l’opéra-bouffe que voyage la compagnie des Frivolités Parisiennes. -
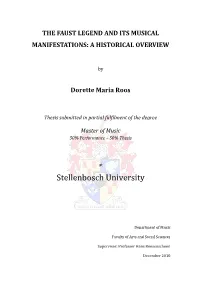
Final Thesis Dorette Roos
THE FAUST LEGEND A ND ITS MUSICAL MANIFEST ATIONS : A HISTORICAL OVERVIEW by Dorette Maria Roos Thesis su bmitted in partial fulfilment of the degree Master of Music 50% Performance – 50% Thesis at Stellenbosch University Department of Music Faculty of Arts and Social Sciences Supervisor: Professor Hans Roosenschoon December 2010 Declaration I, the undersigned, hereby declare that the work contained in this thesis is my own original work and that I have not previously in its entirety or in part, submitted it at any university for a degree. D.M. Roos _____________________________________ Signature Dorette Maria Roos Student Number 15491668 01 / 09 / 2010 Copyright © 2010 Stellenbosch University All rights reserved 2 Acknowledgements I would like to express my gratitude to my supervisor, Professor Hans Roosenschoon, for his guidance, mentorship and encouragement throughout this study. A particular acknowledgement is extended to Miss Esmeralda Tarentaal in the Stellenbosch Music Library for her help and skills. I would like to express my sincere appreciation to my family for their motivation and assistance with this thesis – not forgetting their continuous love, inspiration, proof- reading and suggestions. Lastly, a special word of thanks to my friend Babette, for her constant positivity and enthusiasm. 3 Abstract This thesis explores the Faust legend and its musical manifestations since the 19 th century. The objective is to provide a thorough background to the legend, before drawing up an account of compositions inspired by the Faust legend. Firstly, the origin of the legend is investigated, followed by a brief summary of the most important literary works on the subject of Faust . -
Inocentes O Culpables
Juan Antonio Argerich Inocentes o culpables 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Juan Antonio Argerich Inocentes o culpables Prólogo Ideas muy altas han presidido la composición de INOCENTES O CULPABLES. Ignoro de la manera como será recibida por el público esta novela; pero confío en que todos los hombres rectos y de buena voluntad me harán justicia, y verán que mi obra no es más que una nota, una vibración de verdadero patriotismo, inspirada por nobles aspiraciones del presente que tienden a prever dolores del futuro. Si fuera dable adicionar con notas un trabajo literario, no me sería difícil robustecer cada página con citas científicas y estadísticas. Pero no ha sido mi propósito escribir una obra didáctica, sino llevar la propaganda de ideas fundamentales al corazón del pueblo, para que se hagan carne en él y se despierte su instinto de propia conservación que parece estar aletargado. En los límites que permite el romance realista moderno, he estudiado muchas de las causas que obstan al incremento de la población, el tema más vital e importante para la -II- América del Sur, lo que es decir algo, ya que por nuestra incipiencia cada arista implica un problema en esta parte del continente. He estudiado una familia de inmigrantes italianos, y los resultados a que llego no son excepciones, sino casos generales; los cuales pueden ser constatados por cualquier observador desapasionado. Nuestra población se mantiene estacionaria; y sin embargo, pocos pueblos del mundo ofrecen iguales ventajas por su clima y extensión para que crezca y se expanda en progresión incalculada. -
Faust De Charles Gounod
DOSSIER PÉDAGOGIQUE FAUST DE CHARLES GOUNOD CONTACTS ACTION CULTURELLE Marjorie Piquette / 01 69 53 62 16 / [email protected] Eugénie Boivin / 01 69 53 62 26 / [email protected] 1 FAUST DE CHARLES GOUNOD répétition générale : mercredi 8 novembre 2017 à 20h30 vendredi 10 novembre 2017 à 20h dimanche 12 novembre 2017 à 16h Livret de Jules Barbier et Michel Carré. Création le 19 mars 1859 au Théâtre-Lyrique de Paris. Direction musicale Cyril Diederich Mise en scène Nadine Duffaut Assistant à la mise en scène Franck Licari Décors Emmanuelle Favre Costumes Gérard Audier Eclairages Philippe Grosperrin Chef de choeur Aurore Marchand Chef de Chant Hélène Blanic Marguerite Ludivine Gombert Dame Marthe Jeanne-Marie Lévy Faust Thomas Bettinger Vieux Faust Antoine Normand Méphistophélès Jérôme Varnier Valentin Régis Mengus Siébel Rémy Mathieu Wagner Philippe Ermelier Orchestre National d’Île-de-France Chœur de l’Opéra d’Avignon, Chœurs de l’Opéra de Massy NOTE DE MISE EN SCÈNE “Le fruit de toute une vie”, ainsi Gérard de Nerval parlait de sa traduction du Faust de Goethe. A mon tour, et certes de façon plus modeste, je reprendrai cette formule pour mon propre compte. Je crois sincèrement que l’envie de tout recommencer différemment ne peut advenir qu’à un âge avancé et que le retour sur soi arrive avec une réflexion “vieillissante”. Ce n’est plus le temps de l’action, de la construction, c’est l’état qui précède la mort, plus ou moins long, plus ou moins intense. Ainsi, ai-je essayé de capter les derniers instants de Faust où la réalité et la déformation le plongent dans un univers contrarié. -
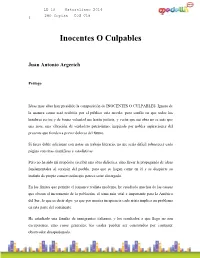
Inocentes O Culpables
1 Inocentes O Culpables Juan Antonio Argerich Prólogo Ideas muy altas han presidido la composición de INOCENTES O CULPABLES. Ignoro de la manera como será recibida por el público esta novela; pero confío en que todos los hombres rectos y de buena voluntad me harán justicia, y verán que mi obra no es más que una nota, una vibración de verdadero patriotismo, inspirada por nobles aspiraciones del presente que tienden a prever dolores del futuro. Si fuera dable adicionar con notas un trabajo literario, no me sería difícil robustecer cada página con citas científicas y estadísticas. Pero no ha sido mi propósito escribir una obra didáctica, sino llevar la propaganda de ideas fundamentales al corazón del pueblo, para que se hagan carne en él y se despierte su instinto de propia conservación que parece estar aletargado. En los límites que permite el romance realista moderno, he estudiado muchas de las causas que obstan al incremento de la población, el tema más vital e importante para la América del Sur, lo que es decir algo, ya que por nuestra incipiencia cada arista implica un problema en esta parte del continente. He estudiado una familia de inmigrantes italianos, y los resultados a que llego no son excepciones, sino casos generales; los cuales pueden ser constatados por cualquier observador desapasionado. 2 Nuestra población se mantiene estacionaria; y sin embargo, pocos pueblos del mundo ofrecen iguales ventajas por su clima y extensión para que crezca y se expanda en progresión incalculada. Actúan aquí causas muy complejas y esta es una cuestión tan ardua que requiere la colaboración de muchos cerebros. -

Pantomime-Ballet on the Music-Hall Stage: the Popularisation of Classical Ballet in Fin-De-Siècle Paris
Pantomime-Ballet on the Music-Hall Stage: The Popularisation of Classical Ballet in Fin-de-Siècle Paris Sarah Gutsche-Miller Schulich School of Music McGill University A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Ph.D. in musicology April 2010 © Sarah Gutsche-Miller 2010 TABLE OF CONTENTS Abstract and Résumé iii Acknowledgements iv Introduction 1 Chapter 1. The Origins of Parisian Music-Hall Ballet 19 Opéra Ballet 19 The Legal Backdrop 24 Ballet in Popular Theatres 26 English Music-Hall Ballet 37 Chapter 2. Elegant Populism: The Venues and the Shows 45 The Folies-Bergère, 1872-1886 47 Marchand’s Folies-Bergère, 1886-1901 54 The Casino de Paris 81 The Olympia 92 Chapter 3. Music-Hall Ballet’s Creative Artists 105 Librettists 107 Composers 114 Choreographers 145 Chapter 4. The Music-Hall Divertissement 163 The 1870s: The Popular Divertissement 164 The 1880s: From “Divertissement” to “Ballet” 171 The 1890s: From Divertissement to Pantomime-Ballet 189 Chapter 5. Popular Ballet’s Conventions 199 A Traditional Structure 200 Music as Storyteller 229 Chapter 6. Up-to-Date Popular Spectacles 253 Pantomime-Ballet Librettos: Conventions and Distortions 254 The Popular Surface 275 Chapter 7. The Music of Popular Ballet 319 Popular Ballet Music at its Height 348 Conclusion 363 Appendix A 371 Appendix B 387 Bibliography 403 ii ABSTRACT This dissertation explores the history and aesthetic of ballet in Parisian music halls at the turn of the twentieth century. Although the phenomenon is now long forgotten, ballet was for more than four decades a popular form of entertainment for a large audience.