Cahiers De Sambre Et Meuse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Simon Schmitt-Www .Glob Alview
GROUPS GROUPS EN Simon Schmitt-www.globalview.be WELCOME © B. D’Alimonte - OTN © B. D’Alimonte THEME 2020 : NATURE Nestling at the confluence of the Sambre and the Meuse rivers, the Capital of Wallonia invites you to come and explore, stroll around, relax or enjoy an adventure! You are sure to be captivated by its generosity, its gastronomy and its rich heritage. Namur is also a city of nature. Go and meet the elements. The Citadel, green and undulating, awaits you. Explore its trails and superb views over the capital. The city gardens will reveal their secrets and their stories through their different themes: colours, fragrances, berries, and more. While walks along waymarked paths will take you roaming through farming and forest landscapes... Sail along the Meuse and the Sambre rivers and extend your outing with a riverside meal. You will find nature on your plate, as well! Savour the taste of plants thanks to ‘wild’ culinary walks or enjoy a gourmet stroll to discover local products. Would you like to organise a day for your association or your group? Are you looking for an original team- building idea? Are you planning to offer your pupils a day of activities, each more fun and exciting than the other? In Namur, everything is possible! Throughout the year, the professional, multilingual team at the Tourist Office is ready to listen to you and offers you a personalised, free service. Whatever your budget, your centres of interest, the age of the group members and the type of formula you would like (package deal or à la carte), you will find just what you are looking for! amur N In this brochure, we offer you the best of Namur to be experienced as a group and without limits, from the most traditional to the unusual. -
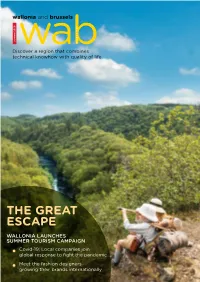
Wabmagazine Discover a Region That Combines Technical Knowhow with Quality of Life
wallonia and brussels summer 2020 wabmagazine Discover a region that combines technical knowhow with quality of life THE GREAT ESCAPE WALLONIA LAUNCHES SUMMER TOURISM CAMPAIGN Covid-19: Local companies join global response to fight the pandemic Meet the fashion designers growing their brands internationally .CONTENTS 6 Editorial The unprecedented challenge of Covid-19 drew a sharp Wallonia and Brussels - Contact response from key sectors across Wallonia. As companies as well as individuals took action to confront the crisis, www.wallonia.be their actions were pivotal for their economic survival as www.wbi.be well as the safety of their employees. For audio-visual en- terprise KeyWall, the combination of high-tech expertise and creativity proved critical. Managing director Thibault Baras (pictured, above) tells us how, with global activities curtailed, new opportunities emerged to ensure the com- pany continues to thrive. Investment, innovation and job creation have been crucial in the mobilisation of the region’s biotech, pharmaceutical and medical fields. Our focus article on page 14 outlines their pursuit of urgent research and development projects, from diagnosis and vaccine research to personal protec- tion equipment and data science. Experts from a variety of fields are united in meeting the challenge. Underpinned by financial and technical support from public authori- ties, local companies are joining the international fight to Editor Sarah Crew better understand and address the global pandemic. We Deputy editor Sally Tipper look forward to following their ground-breaking journey Reporters Andy Furniere, Tomáš Miklica, Saffina Rana, Sarah Schug towards safeguarding public health. Art director Liesbet Jacobs Managing director Hans De Loore Don’t forget to download the WAB AWEX/WBI and Ackroyd Publications magazine app, available for Android Pascale Delcomminette – AWEX/WBI and iOS. -

Conodont Stratigraphy and Palaeontology of the Namurian of Belgium
Mémoires pour servir à l'explication Toelichtende Verhandelingen des Cartes géologiques et minières voor de Geologische kaart en Mijnkaart de la Belgique van België MÉMOIRE No 10 VERHANDELING Nr 10 CONODONT STRATIGRAPHY AND PALAEONTOLOGY OF THE NAMURIAN OF BELGIUM BY A. C. HIGGINS and J. BOUCKAERT Department of Geology Service Géologique de Belgique University of Sheffield MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ADMINISTRATION DES MINES BESTUUR VAN HET MIJNWEZEN Service Géologique de Belgique Aardkundige Dienst van België 13, Rue Jenner, 13 13, Jennerstraat, 13 BRUXELLES 4 BRUSSEL 4 Mém. Expl. Cartes Géologiques et Minières de la Belgique. 1968 N° 10 64 p 6 pl. Toelicht. Verhand. Geologische kaart en Mijnkaart van België. SERVICE GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE MÉMOIRE N° 10 CONODONT STRATIGRAPHY AND PALAEONTOLOGY OF THE NAMURIAN OF BELGIUM BY A. C. HIGGINS and J. BOUCKAERT Department of Geology Service Géologique de Belgique University of Sheffield BRUXELLES IMPRIMERIE HAYEZ, s. p. r. 4, rue Fin 1968 SUMMARY The sequence of conodont faunas in the Namurian of Belgium is described and compared with faunas of the same age in North America, western Europe and Japan. The faunas exhibit major changes within the Namurian in the Chokerian {HI), Alportian (H2) and Kinderscoutian (Ri) sub-stages involving the appearance of new species and genera and the disappearance of many pre-existing ones. These changes take place at approximately the position of the Mississippian- Pennsylvanian boundary in North America. The palaeontology of these faunas is dealt with in detail and 47 species and sub-species have been recognised amongst which Angulodus simplex, Lonchodina bischoffi, Idiognathoides sulcata sulcata, Idiognathoides sulcata parva, Idiognathoides minuta, Streptognathodus lateralis and Gnathodus bilineatus bollandensis are considered new. -

Fluorescent Minerals from Belgian Localities
Fluorescent minerals from Belgian localities In the collection of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences Richard Loyens [email protected] Antwerp, 2014 translation Vic Vanrusselt Being a collector of Belgian minerals and having a special interest in fluorescence, I went on a personal quest to find out how many different species of fluorescent minerals can be found within the borders of the country I call home, Belgium. As a member of the MKA and the FMS, I, armed with my trusty UV light, had the privilege of investigating other people’s collections up close. However, the total number of fluorescent species I ended up with was rather low. Moreover, the number of species that these people had personally collected was also very limited, even though the literature clearly stated that several more species were to be – or once had been – found in Belgium. That is why I hatched the idea to make a complete list of Belgian mineral species that (could) exhibit fluorescence. It would only be a matter of finding an extensive collection to do my fluorescence research on. That is when the RBINS’ collection came into view. In 1991, I contacted Professor R. Van Tassel, who at that time was associated with the mineralogy department of that institute. Professor Van Tassel referred me to Michel Deliens, the then curator of the institute’s mineral collection. After a few meetings and after explaining to him what I wanted to achieve, I myself, together with a few of my fellow “fluorescence aficionados”, got permission to do our research on the RBINS’ collection of Belgian minerals. -
The Province of Namur at the Heart of the Great War
THE PROVINCE OF NAMUR AT THE HEART OF THE GREAT WAR Axel Tixhon Mélodie Brassinne Philippe Bragard VISITOR’S GUIDE ENGLISH 2 Provincial monument, Namur. EDITORIAL “Under the leadership of his command, Captain- Commander Lentrée has opposed the enemy attacks with a valiant defense, in which the garrison showed bravery and firmness. The fortified structure only fell after the complete destruction of all its cupolas by enemy artillery”. Fort of Saint Héribet, Province of Namur, 1919 (Citation in the Order of the Army). The First World War has left traces of violence and 3 suffering, but also of support and solidarity, and it left a long-lasting imprint in History. The traces of the conflict across the province, though often overlooked, are very present. Cemeteries, forts, headstones, memorials, street names or places invite the visitor, regardless of age or nationality, to get back into history, to touch the names of victims engraved in marble and set in stone with his fingers. Through this contribution, the Province of Namur and its Tourism Federation want to commemorate this part of history that is becoming eroded by time. The making of this guide is part of the numerous regional, local, provincial, and federal projects that will emerge in the commemoration events from 2014 to 2018, as as many actions against oblivion: exhibitions, shows, activities for the youth, educational trips, etc. In decades to come, the memory of those, known and unknown, who died for peace, will be honored. It is for this same peace that the Province of Namur is mobilizing now. The provincial College INTRODUCTION Between 1914 and 1945, Europe experiences one of the most tragic episodes in its history. -

Plan Communal De Mobilite De La Commune De Anhee
PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE LA COMMUNE DE ANHEE PHASE I: ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC Commune de Anhée Place communale, 6 5537 Anhée Document final Bureau d’études AVRIL2007 Survey & Aménagement Rue de Chenu, 2-4 7090 RONQUIERES TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES............................................................................................................................................................ 1 PARTIE I - DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE D’ANHEE................................................................................................................ 2 1. UNE COMMUNE RURALE A VOCATION TOURISTIQUE… ................................................................................................... 2 1.1. La composante urbaine et géographique.................................................................................................................... 2 1.2 La composante démographique.................................................................................................................................. 4 1.3 La composante économique........................................................................................................................................ 8 2. AUX PROBLEMATIQUES CENTREES SUR L’ACCESSIBILITE ET LA SECURITE MULTIMODALES ............................................. 13 2.1 Le niveau d’équipement par mode de transport .......................................................................................................... 13 2.2 Réseau et trafic routier : La prépondérance de -

Groups 2019 © B
EN GROUPS 2019 © B. D’Alimonte - OTN © B. D’Alimonte WELCOME © B. D’Alimonte - OTN © B. D’Alimonte 2019, ”ALONG THE WATER” Nestling at the confluent of the Sambre and the Meuse rivers, the Capital of Wallonia invites you to come and explore, stroll around, relax or enjoy an adventure! You are sure to be captivated by its generosity, its gastronomy and its rich heritage. Along its rivers and watercourses, Namur reveals it glories and beckons to you. Would you like to see a superb view over the majestic Citadel? Come and admire it from the Meuse thanks to a wide range of activities: boats that do not require a permit, a stand-up paddle or even, for the more daring, a blob jump! After a pleasant cruise or a walk along the quays, make the most of your stay by savouring a delicious meal or sipping a drink at the edge, or even on the water! At the end of the day, enjoy a pleasant yet unusual night on board one of our comfortably equipped barges. Would you like to organise a day for your association or your group? Are you looking for an original team- building idea? Are you planning to offer your pupils a day of activities, each more fun and exciting than the other? In Namur, everything is possible! Throughout the year, the professional, multilingual team at the Tourist Office is ready to listen to you and offers you a personalised, free service. Whatever your budget, your centres of interest, the age of the group members and the type of formula you would like (package deal or à la carte), you will find just what you are looking for! amur In this brochure, we offer you the best of Namur to be experienced as a group and without limits, from the most N traditional to the unusual. -

G.Ologie Congr.S.Qxd
Miocene cryptokarsts Christian DUPUIS (1) of Entre-Sambre-et-Meuse Dominique NICAISE (2) and Condroz plateaus. Thierry DE PUTTER (1) Alain PERRUCHOT (3) Paleoenvironment, evolution Muriel DEMARET (4) and weathering processes Emile ROCHE (4) Géologie de la France, 2003, n° 1, 27-31, 2 fig. Key words: Paleokarsts, Karst filling, Miocene, Pliocene, Halloysite, Paleoweathering, Entre-Sambre-et-Meuse, Condroz, Belgium. Introduction Perruchot et al., 1997; Nicaise, 1998; De Putter et al.1996; De Putter et al., 2002). Complementary paleoenvironmental The Dinantian limestones of Entre-Sambre-et-Meuse and chronological data were obtained through carpological (ESEM) and Condroz plateaus are scattered with numerous and palynological studies (Fairon-Demaret, 1992; 1994; (>350 recensed) large karstic cavities filled with sands, Russo Ermolli, 1991). Currently these karsts are used as clays, gravels and lignite of Eo-Oligocene and Mio- case studies to model surface geochemical processes related Pliocene ages. The extraction of raw materials in quarries with the migration of cold acid fluids and correlative or in underground mines revealed uncommon dimensions sequences of mineral neogenesis. for such karstic cavities, up to 500 m in diameter, around 70-150 m in depth. Since the 19th century geologists have Trapped sediments, paleoenvironments drawn attention to these “vallées d’effondrement” (Van and ages Den Broeck et Rutot, 1888), for example Bayet, 1896; Briart, 1888; d’Halloy, 1841; Lohest, 1887, 1896. The first unit of the paleokarst infilling is the sandy Onhaye Formation, the variable thickness of which (~0- During the first half of the 20th century, when the 20 m) is related to erosion and/or lateral variations. -

2017-2019 PROVINCE ET COMMUNE Un Partenariat Durable Au Cœur De Votre Formation
Au cœur de votre Commune 2017-2019 PROVINCE ET COMMUNE Un partenariat durable Au cœur de votre formation DOMAINE : FORMATION ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION D’UN PLAN DE FORMATION POUR LE PERSONNEL COMMUNAL ET DES CPAS, INTERCOMMUNALES ET ASSOCIATION CHAPITRE XII ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION D’UN PLAN DE FORMATION POUR LE PERSONNEL FICHE 1 COMMUNAL ET DES CPAS, INTERCOMMUNALES ET ASSOCIATION CHAPITRE XII 1 CONTEXTE ET JUSTIFICATIFS En plus de fournir des services de qualité aux citoyens, les communes doivent gérer la multiplicité et la complexité croissante des matières ainsi que l’introduction progres- sive de nouveaux modes de gestion et de fonctionnement. Dans ce contexte, les agents sont demandeurs d’un développement professionnel dy- namisé, le développement de leurs compétences est un objectif d’intérêt général. Bien plus qu’un outil de gestion administrative du personnel, le plan de formation est un outil de gestion et de développement des compétences, et aussi, indirectement, de motivation du personnel. DESCRIPTIF DE L’OFFRE Conseiller et soutenir la commune dans la réalisation de son plan de formation : notions méthodologiques, démarches préalables, planification du projet, dispositifs de com- munication avec la ligne hiérarchique, réalisation de l’outil, mise en œuvre et suivi de ce dernier (relais avec les opérateurs de formation). OBJECTIFS En disposant d’un plan de formation, votre administration se dote d’un outil d’optimali- sation de ses ressources humaines (développement et suivi des compétences, connais- sances et habiletés des agents) pour qu’elles contribuent à l’atteinte des objectifs stra- tégiques et opérationnels de votre organisation. PUBLICS CIBLES - le Directeur général, - le Service de Gestion des ressources humaines et ou Service du Personnel - le Relais local à la formation. -

Phytostratigraphie Et Paléoenvironnements Du Néogène De L'entre-Sambre-Et- Meuse Et Du Condroz (Belgique). Evolution Paléocl
Geo-Eco-Trop, 2008, 32: 101 - 130 Phytostratigraphie et paléoenvironnements du Néogène de l'Entre-Sambre-et- Meuse et du Condroz (Belgique). Evolution paléoclimatique du subtropical humide au tempéré froid. Neogene phytostratigraphy and palaeoenvironments of Entre-Sambre-et-Meuse and Condroz areas (Belgium). Palaeoclimatic shift from humid-subtropical to cold-temperate conditions. 1 2 3 Emile ROCHE , Christian DUPUIS , Sondes STAMBOULI - ESSASSI , Elda RUSSO - 4 5 6 4 ERMOLLI , Thierry De PUTTER , Dominique NICAISE et Muriel FAIRON-DEMARET Abstract: Available palaeobotanical data from significant karstic depressions of Entre-Sambre-et-Meuse and Condroz areas (Belgium) are reviewed. Drawing up of about forty stratigraphically significant taxa results in a phytostratigraphy of the continental Neogene supporting correlations with surrounding areas. Meorover, palaeoenvironmental and palaeoclimatic evolution of the studied areas are clarified while the phytostratigraphic framework evidences two major steps in the karst formation. Keywords: Belgium, Entre-Sambre-et-Meuse, Condroz, Cryptokarsts, Neogene, Phytostratigraphy, Palaeoenvironments, Palaeoclimates. Résumé: Les données paléobotaniques disponibles provenant principalement d'une dizaine de sites particulièrement significatifs des cryptokarsts néogènes de l'Entre-Sambre-et-Meuse et du Condroz (Belgique) ont été révisées. L'établissement de la distribution verticale d'une quarantaine de taxons marqueurs débouche sur une phytostratigraphie du Néogène continental régional qui supporte la discussion de corrélations avec les régions voisines. En parallèle, elle précise l'évolution paléoenvironnementale et paléoclimatique du Néogène « ardennais » et documente le comportement exacerbé des cryptokarsts au cours du Miocène. Mots-Clés : Belgique, Entre-Sambre-et-Meuse, Condroz, Cryptokarsts, Néogène, Phytostratigraphie, Paléoenvironnements, Paléoclimats. INTRODUCTION De longue date, les dépôts continentaux néogènes de la Haute Belgique ont suscité l'intérêt des géologues. -

PDF Viewing Archiving 300
WARNANT by M. LALOUX, E. GROESSENS, P. OVERLAU [(, H. P1RLET ~ru 100m &.--J Ane.Abbaye de Moulins t2 Maredsous EGR87 Figure 1. Localization 1. LOCALIZATION CONIL, R. & LYS, M. in 1964 and 1965 • 1966 OVERLAU, P. : unpublished DSc . A. Abandonned underground quarry of dissertation (University of "Bleu Belge" marble known as DEJAIFFE Louvain). Macr9sedimentologi quarry. cal study and detailled log 500 m S.W. of the church. of the quarry (pl. 30 : car. Ref erence : documents of the Geolo DEJAIFFE n° 53/3-7). gical Survey of Belgium • 1968 PIRLET, H. : Study of the rhythmic 166W151. Upper Visean sedimentation. documents of R. CONIL • 1970 CONIL, R. & PIRLET, H. : Descrip Bioul 7. tion of paleontological outline Type section of Upper Warnantian of the transition beds (point 5, (fig. 2). fig. 3) • 1974 CONIL, R. & PIRLET, H. : Excurions B. Abandonned railway trench, S.E. of AS in BOUCKAERT, J. & STREEL, M. the quarry (railway Warnant-St ed. - Symposium of Namur. Gérard). • 1977 CONIL, R., GROESSENS, E. & PIRLET, 600 m South of the church. H. : Definition of Warnantian. Reference : documents of the Geolo- • 1983 NZIBA, M. : 3rd cycle doctorat gical Survey of Belgium thesis - University of Lille 166 w 149. (France) : Radiometrical ano documents of R. CONIL malies" Bioul 39 (fig. 3). • 1983 PAPROTH, E., CONIL, R. etaZ.: Definition of the formation 2. LITERATURE "Couches de Warnant" - p. 226. • 19 23 .MAROTE, E. : Description of the 3. SHORT DESCRIPTION marble quarry (fig. 45) • 1934 DE.MANET, F. : first description From the bottom to the top (abandon of the transition beds and ned railway, abandonned quarry, shaft their macrofauna and upper trench) . -

Paleopedology and Stratigraphy on the Condrusian Peneplain (Belgium)
4//f Pi*/ ^ r*>6 C° P. Buurman Paleopedology and stratigraphy on the Condrusian peneplain (Belgium) with ajeconstructio n of a paleosol BIBLIOTHEEK DER NDBOUTCHOGESCHOOL EN. FOULKESWEG 1» WAGENINGEN NN08201,506 Paleopedology and stratigraphy on the Condrusian peneplain (Belgium) In the original version the title contained the indication 'Ardennes peneplain', wich proved to be lesscorrect . It wasno t possible to make this correction throughout the text. When 'Ardennes peneplain' is used, the whole area between the Sambre-Meuse valley in the north and the Mesozoiccove r of the Paris basin in the south ismeant . Dit proefschrift met stellingen van Peter Buurman, landbouwkundig ingenieur, geboren teArnhe m op2 3 oktober 1943,i sgoedgekeur d door depromotor , dr.ir .L .J . Pons,hoogleraa r ind eregional e bodemkundee n decopromotor , dr. L. van der Plas. DeRecto rMagnificu sva nd eLandbouwhogeschoo l J.M .Pola k Wageningen, 14 december197 1 P. Buurman Paleopedology and stratigraphy on the Condrusian peneplain (Belgium) with a reconstruction of a paleosol Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de landbouwwetenschappen, op gezag van de Rector Magnificus, Mr. J. M. Polak, hoogleraar in de rechts- en staatswetenschappen van de westerse gebieden, te verdedigen tegen de bedenkingen van een commissie uit de Senaat van de Landbouwhogeschool te Wageningen op vrijdag 25 februari 1972t e 16uu r 1972 Centrefor AgriculturalPublishing andDocumentation Wageningen Abstract BUURMAN, P. (1972) Paleopedologyan d stratigraphy on the Condrusian peneplain (Belgium), with a reconstruction of a paleosol.Agric .Res .Rept s (Versl.landbouwk . Onderz.) 766. (viii) + 67p. , 129 refs,3 app., 22figs, 2 tables.Eng . summary.