Articles Du 61
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

B E N I N Benin
Birnin o Kebbi !( !( Kardi KANTCHARIKantchari !( !( Pékinga Niger Jega !( Diapaga FADA N'GOUMA o !( (! Fada Ngourma Gaya !( o TENKODOGO !( Guéné !( Madécali Tenkodogo !( Burkina Faso Tou l ou a (! Kende !( Founogo !( Alibori Gogue Kpara !( Bahindi !( TUGA Suroko o AIRSTRIP !( !( !( Yaobérégou Banikoara KANDI o o Koabagou !( PORGA !( Firou Boukoubrou !(Séozanbiani Batia !( !( Loaka !( Nansougou !( !( Simpassou !( Kankohoum-Dassari Tian Wassaka !( Kérou Hirou !( !( Nassoukou Diadia (! Tel e !( !( Tankonga Bin Kébérou !( Yauri Atakora !( Kpan Tanguiéta !( !( Daro-Tempobré Dammbouti !( !( !( Koyadi Guilmaro !( Gambaga Outianhou !( !( !( Borogou !( Tounkountouna Cabare Kountouri Datori !( !( Sécougourou Manta !( !( NATITINGOU o !( BEMBEREKE !( !( Kouandé o Sagbiabou Natitingou Kotoponga !(Makrou Gurai !( Bérasson !( !( Boukombé Niaro Naboulgou !( !( !( Nasso !( !( Kounounko Gbangbanrou !( Baré Borgou !( Nikki Wawa Nambiri Biro !( !( !( !( o !( !( Daroukparou KAINJI Copargo Péréré !( Chin NIAMTOUGOU(!o !( DJOUGOUo Djougou Benin !( Guerin-Kouka !( Babiré !( Afekaul Miassi !( !( !( !( Kounakouro Sheshe !( !( !( Partago Alafiarou Lama-Kara Sece Demon !( !( o Yendi (! Dabogou !( PARAKOU YENDI o !( Donga Aledjo-Koura !( Salamanga Yérémarou Bassari !( !( Jebba Tindou Kishi !( !( !( Sokodé Bassila !( Igbéré Ghana (! !( Tchaourou !( !(Olougbé Shaki Togo !( Nigeria !( !( Dadjo Kilibo Ilorin Ouessé Kalande !( !( !( Diagbalo Banté !( ILORIN (!o !( Kaboua Ajasse Akalanpa !( !( !( Ogbomosho Collines !( Offa !( SAVE Savé !( Koutago o !( Okio Ila Doumé !( -
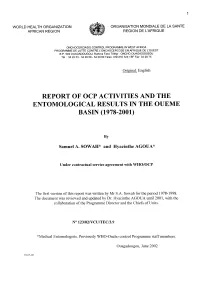
REPORT of OCP ACTIVITIES and the ENTOMOLOGICAL RESULTS in the OUEME Basrn (1978-2001)
1 WORLD HEALTH ORGANIZATION ORGANISATION TVIONDIALE DE LA SANTE AFRICAN REGION REGION DE L'AFRIQUE ONCHOCERCIASIS CONTROL PROGRAMME IN WEST AFRICA PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE EN AFRIQUE DE L'OUEST B P. 549 OUAGADOUGOU, Burkrna Faso Télégr . ONCHO OUAGADOUGOU Tél : 34 29 53 - 34 29 59 - 3429 60 Télex. ONCHO 5241 BF Fax' 34 2875 Original. English REPORT OF OCP ACTIVITIES AND THE ENTOMOLOGICAL RESULTS IN THE OUEME BASrN (1978-2001) By Samuel A. SOWAH* and Hyacinthe AGOUA* Under contractual service agreement with WHO/OCP The first version of this report was written by Mr S.A. Sowah for the period 1978-1998. The document was reviewed and updated by Dr. Hyacinthe AGOUA until2001, with the collaboration of the Programme Director and the Chiefs of Units. N" 123|02NCUTEC/3.9 *Medical Entomologists. Previously WHO-Oncho control Programme staff members Ouagadougou, June 2002 30-07 -02 2 CONTENTS I. INTRODUCTION 2. OVERVIEW OF THE ONCHOCERCIASIS CONTROL PROGRAMME IN WEST AFRICA -) DESCRIPTION OF THE OUEME BASIN AREA 4 ENTOMOLOGICAL ACTIVITIES (EVALUATION AND VECTOR CONTROL) 4.1. Entomologicalsurveillance. 4.1.1. Breeding sites. 4.1.2. Catching points. 4.1.3. Entomological prospections. 4.2. History on larviciding. 4.2.1. Aerial larviciding. 4.2.2. Ground larviciding. 4.2.3. Insecticides used (Insecticides rotation) 4.3. Entomological results. 4.3.1 Vectors concerned. 4.3.2 Parasites concerned. 4.3.3 Transmission. 4.3.4 Special studies on S. soubrense Beffa form. 4.3.5 Entomological results on 3 1 -12-2001. 5. SURVEILLANCE OF AQUATIC FAUNA 6. EPIDEMIOLOGICAL EVALUATIONS 6.1. -

Rapport-Mémoire
1 PROGRAMME DE FORMATION AU DIPLOME D’ETUDE SUPERIEURE SPECIALISEE EN GESTION DES PROJETS ET DEVELOPPEMENT LOCAL (DESS/GPDL) Rapport-Mémoire Le fnancement des collectivités locales par la coopération décentralisée : l’expérience du Fonds de Développement des Territoires du Programme de Promotion du Développement Local du département des Collines. i La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires. Elles doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. Le mémoire est un essai d’application des méthodes et outils acquis au cours de la formation. Il ne saurait donc être considéré comme un travail achevé auquel l’Université conférerait un label de qualité qui l’engagerait. Ce travail est considéré a priori comme un document confdentiel qui ne saurait être diffusé qu’avec le double accord de son signataire et du PDL/Collines. ii TABLE DES MATIERES Pages REMERCIEMENTS .................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ERREUR ! REFERENCE DE LIEN HYPERTEXTE NON VALIDE. CHAPITRE I – LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES 6 I-1- LES SOURCES DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES .................. 6 Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. I.1.1.1- Les ressources fscales locales .................................................... 7 Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. I.1.2- Ressources externes .......................................................................... 9 1.1.2.1- Transferts fnanciers de l’Etat ................................................... -

State Making and the Politics of the Frontier in Central Benin
State Making and the Politics of the Frontier in Central Benin Pierre-Yves Le Meur ABSTRACT Kopytoff’s model of the African frontier has opened room for renewed ap- proaches to settlement history, politics, ethnicity and cultural reproduction in pre-colonial Africa. This interpretative framework applies well to central Benin (Ouess`e). Over the long term, mobility has been a structural feature of the regional social history, from pre-colonial times onwards. Movements of people, resources, norms and values have been crucial in the production and reproduction of the social and political order. The colonial intrusion and its post-colonial avatars gave way to renewed relations between mobility and locality, in particular in the form of a complex articulation between control over labour force, access to land and natural resources, and out- and in- migrations. This article argues that the political frontier metaphor provides a useful heuristic device to capture the logic of state making, as the changing outcome of organizing practices taking place inside and outside state and non-state organizations and arenas. Governmentality in post-colonial cen- tral Benin thus results from the complex interplay of mobility, control over resources and state-led forms of ‘villagization’. Igor Kopytoff’s internal frontier thesis has opened room for renewed approaches to settlement history, ethnicity and cultural reproduction in pre- colonial Africa. In his seminal book The African Frontier (1987), he proposes a general interpretative model placing mobility at the centre stage as a struc- tural feature in the production of the social and political order. ‘The African frontier we focus on consists of politically open areas nestling between organized societies but “internal” to the larger regions in which they are found — what might be called an “internal” or “interstitial frontier”’ (ibid.: 9). -

Projet D'électrification Rurale Du Bénin-Rapport EIES Lot2 BAD.Pdf
REPUBLIQUE DU BENIN ************** MINISTERE DE L’ENERGIE (ME) ************** Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (ABERME) ************** PROJET D’ELECTRIFICATION DE 100 LOCALITES RURALES DU BENIN FINANCÉ PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD) ETUDE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL APPROFONDIE DU LOT 2 : 30 LOCALITES RAPPORT FINAL CONSULTANCY FITILA 2019 E- Mail : consulfitila_cf04yahoo.fr / Mobile : 97339762 SOMMAIRE LISTE DES FIGURES ............................................................................................................... 4 LISTE DES TABLEAUX .......................................................................................................... 5 LISTE DES SIGLES ACRONYMES ........................................................................................ 6 1. RESUME ANALYTIQUE .................................................................................................. 7 2. INTRODUCTION ............................................................................................................... 9 3. APPROCHE METHODOLOGIQUE ............................................................................... 11 3.2. Réunion de cadrage ...................................................................................................... 11 3.3. Démarche spécifique à la réalisation de la mission ...................................................... 12 4. CADRE STRATEGIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF .................................... 15 4.1. Cadre législatif et -

Liste Des Candidats Inscrits Pour Le Corps Inspecteurs D'action Sanitaire
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE REPUBLIQUE DU BENIN Fraternité - Justice - Travail ********** DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DIRECTION CHARGEE DU RECRUTEMENT DES AGENTS DE L'ETAT Communiqué 002/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRAE/STCD/SA du 26 mars 2021 CENTRE: CEG HUBERT MAGA LISTE D'AFFICHAGE DES CANDIDATS N° TABLE. NOM ET PRENOMS DATE ET LIEU DE NAISSANCE CORPS SALLE 0214-B08-1908179 Mlle ABDOULAYE Raïssatou 29/01/1994 à Cotonou Inspecteurs d'Action Sanitaire B 8 (A3):Epidémiologie 0336-B12-1908171 Mlle ABDOULAYE Zouléha 1995 à Kandi Inspecteurs d'Action Sanitaire (A3):Infirmiers et B 12 Infirmières Diplômés d'Etat 0351-B12-1908171 M. ABDOURAMANE Abdou Karim 1996 à Banikoara Inspecteurs d'Action Sanitaire (A3):Infirmiers et B 12 Infirmières Diplômés d'Etat 0385-B13-1908171 Mlle ABOE Missimahou Chrystelle Nadège 19/10/1999 à Parakou Inspecteurs d'Action Sanitaire (A3):Infirmiers et B 13 Infirmières Diplômés d'Etat 0376-B13-1908171 Mlle ABORODE Orotola Titilayo Stéphanie-Inès 10/09/1998 à Ouèssè Inspecteurs d'Action Sanitaire (A3):Infirmiers et B 13 Infirmières Diplômés d'Etat 0223-B08-1908179 Mlle ACHAFA Maurichidath Adébayo Abiodoun 07/04/1995 à Porto-Novo Inspecteurs d'Action Sanitaire B 8 Achabi (A3):Epidémiologie 0444-B15-1908170 Mlle ADA Zénabou 23/07/1996 à Dakèrèrou (Péhunco) Inspecteurs d'Action Sanitaire (A3):Sages- B 15 Femmes Diplômées d'Etat 0013-B01-1908114 Mlle ADADJA Houénadjè Marjolaine 27/05/1992 à Cotonou Pharmaciens diplômés d'Etat B 1 0477-B16-1908170 Mlle ADAKAMOUN Montayo Florence Ida 04/10/1999 à Kodowari Inspecteurs d'Action Sanitaire (A3):Sages- B 16 Femmes Diplômées d'Etat 0432-B15-1908170 Mlle ADAM Barikissou 1995 à Gnindarou (Banikoara) Inspecteurs d'Action Sanitaire (A3):Sages- B 15 Femmes Diplômées d'Etat 0276-B10-1908171 M. -

Monographie Des Départements Du Zou Et Des Collines
Spatialisation des cibles prioritaires des ODD au Bénin : Monographie des départements du Zou et des Collines Note synthèse sur l’actualisation du diagnostic et la priorisation des cibles des communes du département de Zou Collines Une initiative de : Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Objectifs de Développement Durable (DGCS-ODD) Avec l’appui financier de : Programme d’appui à la Décentralisation et Projet d’Appui aux Stratégies de Développement au Développement Communal (PDDC / GIZ) (PASD / PNUD) Fonds des Nations unies pour l'enfance Fonds des Nations unies pour la population (UNICEF) (UNFPA) Et l’appui technique du Cabinet Cosinus Conseils Tables des matières 1.1. BREF APERÇU SUR LE DEPARTEMENT ....................................................................................................... 6 1.1.1. INFORMATIONS SUR LES DEPARTEMENTS ZOU-COLLINES ...................................................................................... 6 1.1.1.1. Aperçu du département du Zou .......................................................................................................... 6 3.1.1. GRAPHIQUE 1: CARTE DU DEPARTEMENT DU ZOU ............................................................................................... 7 1.1.1.2. Aperçu du département des Collines .................................................................................................. 8 3.1.2. GRAPHIQUE 2: CARTE DU DEPARTEMENT DES COLLINES .................................................................................... 10 1.1.2. -

The Cross-Border Transhumance in West Africa Proposal for Action Plan
Food and Agricultural Organization of the United Nations in collaboration with Economic Community of West African States The cross-border transhumance in West Africa Proposal for Action Plan June 2012 TABLE OF CONTENT TABLE OF CONTENT ...................................................................................................................................... 2 EXECUTIVE SUMMARY.................................................................................................................................. 5 Acronyms and Abbreviations ....................................................................................................................... 7 1. Introduction ........................................................................................................................................ 10 2. Background of livestock in West Africa .................................................................................................. 12 2.1. Increasing livestock numbers .......................................................................................................... 12 2.2. Many animal breeds but some endangered ................................................................................... 12 2.3. Livestock production systems in West Africa .................................................................................. 15 2.3.1. Pastoral systems ....................................................................................................................... 15 2.3.2. Urban and peri-urban livestock -

ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 8(11), 125-136
ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 8(11), 125-136 Journal Homepage: - www.journalijar.com Article DOI: 10.21474/IJAR01/11984 DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/11984 RESEARCH ARTICLE DIFFICULTY OF ACCESS TO DRINKING WATER AND STATE OF HEALTH OF THE POPULATIONS OF GLAZOUÉ IN BENIN Charles L. Babadjide Teacher-Researcher at the Department of Sociology-Anthropology, University of Abomey-Calavi (UAC) / Benin Associate Professor / CAMES. …………………………………………………………………………………………………….... Manuscript Info Abstract ……………………. ……………………………………………………………… Manuscript History Drinking water is a basic resource for all living things. Its quality Received: 01 September 2020 influences the life of living beings. The present research aims to Final Accepted: 05 October 2020 analyze the difficulties linked to access to drinking water in the Published: November 2020 municipality of Glazoué and the state of health of the populations.The methodological approach used consisted in using documentary research Key words:- Glazoué, Drinking Water, Difficulty Of techniques, interviews, observation, analysis of the water collected and Access, Population Health compared with WHO standards. For this research of a mixed nature, 110 actors were surveys, 4 water sources analyzed and statistics of water sick people collected. The data were processed and analyzed by comparison and the PEIR analysis model made it possible to analyze the harmful effects caused by the consumption of unhealthy water on a predominantly rural population with low and limited income with its socio-economic consequences.The populations of Glazoué are confronted with a water deficit in this case during the dry season. The majority of wells dry up during the dry season and thus expose populations to the risk of water contamination due to the fact that the water from these types of wells is filled with sand and microorganisms. -

Historique De L'évolution Anthropique Et Dynamique Du Couvert Végétal Dans La Commune De Bantè Au Bénin History of Anthro
Available online at http://www.ifgdg.org Int. J. Biol. Chem. Sci. 12(1): 180-194, February 2018 ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print) Original Paper http://ajol.info/index.php/ijbcs http://indexmedicus.afro.who.int Historique de l’évolution anthropique et dynamique du couvert végétal dans la commune de Bantè au Bénin K. Innocent AKOBI1*, Ernest AMOUSSOU2, Ibouraima YABI1 et Michel BOKO1 1 Département de Géographie et Aménagement du Territoire de l’Université d’Abomey Calavi (UAC), Laboratoire Pierre PAGNEY, Abomey Calavi, Bénin. 2 Département de Géographie et Aménagement du Territoire de l’Université de Parakou (UP) Parakou, Bénin. *Auteur correspondant ; E-mail: [email protected], Tel : (+229) 97 48 55 10 RESUME Le couvert végétal de la commune de Bantè subit de forte pression anthropique. L’objectif visé a été d’analyser l’influence de la pression humaine sur l’évolution spatio-temporelle des unités paysagiques. Les données utilisées concernent les statistiques démographiques de l’INSAE des années1979, 1992, 2002 et 2013, l’historique de l’installation des populations dans le temps et dans l’espace, les cartes planimétriques et les images Landsat TM de 1986, Landsat ETM+ de 2000 et Landsat OLI-TIRS de 2016 de la commune de Bantè. La cartographie des unités d’occupation des terres sur la base des données de la télédétection et leur étude diachronique ont été les principales méthodes utilisées. La cartographie des changements spatio-temporels du couvert végétal a révélé que la superficie des formations végétales naturelles est passée de 93,63% dans la Commune en 1986 à 92,92% en 2000 et à 38,83% en 2016 au profit des champs et des jachères dont la superficie est passée de 6,19% en 1986 à 6,68% en 2000 et à 33,15% en 2016. -

2021 Liste Des Candidats Mathi
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE REPUBLIQUE DU BENIN Fraternité - Justice - Travail ********** DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DIRECTION CHARGEE DU RECRUTEMENT DES AGENTS DE L'ETAT Communiqué 002/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRAE/STCD/SA du 26 mars 2021 CENTRE: LYCéE MATHIEU BOUKé LISTE D'AFFICHAGE DES CANDIDATS N° TABLE. NOM ET PRENOMS DATE ET LIEU DE NAISSANCE CORPS SALLE 0468-A16-1907219 Mlle ABDOU Affoussath 19/11/1997 à Parakou Contrôleurs des Services Financiers (B3) A 16 0533-A18-1907218 Mlle ABDOU Rissikath 17/08/1988 à Lokossa Secrétaires des Services Administratifs(B3) A 18 0219-A08-1907213 M. ABDOULAYE Mohamadou Moctar 05/11/1987 à Niamey Techniciens Supérieurs de la Statistique A 8 0406-A14-1907219 Mlle ABIOLA Adéniran Adélèyè Taïbatou 30/06/1989 à Savè Contrôleurs des Services Financiers (B3) A 14 0470-A16-1907219 M. ABISSIN Mahugnon Judicaël 04/04/1998 à Allahé Contrôleurs des Services Financiers (B3) A 16 0281-A10-1907220 Mlle ABOUBOU ALIASSOU Silifatou 04/10/1990 à Ina Contrôleurs de l'Action Sociale (B1) A 10 0030-A01-1907189 M. ADAM Abdouramane 22/02/1988 à Penelan Administrateurs:Gestion des Marchés A 1 Publics 0233-A08-1907213 M. ADAM Ezéchiel 05/06/1997 à Parakou Techniciens Supérieurs de la Statistique A 8 0177-A06-1907203 M. ADAMOU Charif 20/11/1995 à Parakou Attachés des Services Financiers A 6 0448-A15-1907219 M. ADAMOU Kamarou 18/01/1996 à Kandi Contrôleurs des Services Financiers (B3) A 15 0135-A05-1907203 M. ADAMOU Samadou 20/02/1989 à Nikki Attachés des Services Financiers A 5 0568-A19-1907216 Mlle ADAMOU Tawakalith 03/05/1991 à Lozin Techniciens d'Hygiène et d'Assainissement A 19 0584-A20-1907216 M. -

Plan Directeur D'electrification Hors Réseau
Plan Directeur d’Electrification Hors Réseau Prévision de la demande - 2018 Annexe 3 Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification hors-réseau Présenté par : Projet : Accès à l’Électricité Hors Réseau Activité : Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification hors-réseau Contrat n° : PP1-CIF-OGEAP-01 Client : Millennium Challenge Account-Bénin II (MCA-Bénin II) Financement : Millennium Challenge Corporation (MCC) Gabriel DEGBEGNI - Coordonnateur National (CN) Dossier suivi par : Joel AKOWANOU - Directeur des Opérations (DO) Marcel FLAN - Chef du Projet Energie Décentralisée (CPED) Groupement : IED - Innovation Energie Développement (Fr) PAC - Practical Action Consulting Ltd (U.K) 2 chemin de la Chauderaie, 69340 Francheville, France Consultant : Tel: +33 (0)4 72 59 13 20 / Fax: +33 (0)4 72 59 13 39 E-mail : [email protected] / [email protected] Site web: www.ied-sa.fr Référence IED : 2016/019/Off Grid Bénin MCC Date de démarrage : 21 nov. 2016 Durée : 18 mois Rédaction du document : Version Note de cadrage Version 1 Version 2 FINAL Date 26 juin 2017 14 juillet 2017 07 septembre 2017 17 juin 2017 Rédaction Jean-Paul LAUDE, Romain FRANDJI, Ranie RAMBAUD Jean-Paul LAUDE - Chef de projet résident Relecture et validation Denis RAMBAUD-MEASSON - Directeur de projet Off-grid 2017 Bénin IED Prévision de la Demande Localités non électrifiées Scenario 24h Première année Moyen-terme Horizon Population Conso. Pointe Part do- Conso. (kWh) Pointe Part do- Conso. Pointe Part do- Code Localité