La Cité D'affrique De Messein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
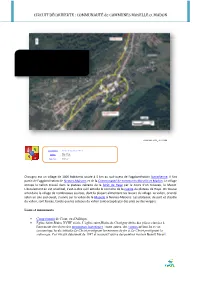
Circuit-Decouverte-Chavigny.Pdf
ÉCOUVERTE : COMMUNAUTÉ CIRCUIT D de COMMUNES MOSELLE et MADON Circuit découverte de CHAVIGNY Départ : parking espace Chardin Temps de parcours : 2h environ Distance : de 1.3 à 3.5 km ©IGN BD 2009_ © CCMM Coordonnées 48° 37′ 48″ nord,6° 07′ 30″ est Min. 248 m Altitude Max. 418 m Superficie 6,69 km2 Chavigny est un village de 1800 habitants située à 5 km au sud-ouest de l'agglomération Nancéienne. Il fait partie de l'agglomération de Neuves-Maisons et de la Communauté de communes Moselle et Madon. Le village occupe le vallon creusé dans le plateau calcaire de la forêt de Haye par le cours d'un ruisseau, le Mazot. L'écoulement en est anaclinal, c'est-à-dire qu'il entaille la corniche de la cuesta du plateau de Haye. On trouve ainsi dans le village de nombreuses sources, dont la plupart alimentent les lavoirs du village. Le vallon, orienté selon un axe sud-ouest, s'ouvre sur la vallée de la Moselle à Neuves-Maisons. Les plateaux, de part et d'autre du vallon, sont boisés, tandis que les coteaux du vallon sont occupés par des prés ou des vergers. Lieux et monuments Camp romain de César, ou d'Affrique. Église Saint-Blaise XVIIIe siècle. L'église saint-Blaise de Chavigny abrite des pièces classées à l'inventaire des objets des monuments historiques : entre autres, des vitraux mêlant foi et vie économique locale intitulés Le Christ protégeant les mineurs de fer et Le Christ protégeant la sidérurgie. Ces vitraux dateraient de 1947 et seraient l'œuvre des peintres verriers Benoît frères8. -

Voie Verte Des Boucles De La Moselle Villey-Saint-Etienne Le Pavillon Bleu (Km69)
Boucle de la Moselle Frouard - Nancy - Neuves Maisons - Toul - Liverdun De Frouard (54) www.lorvelo.fr à Frouard (54) 80 kms Boucle de la Moselle Un peu d’histoire Le canal de la Marne au Rhin Mon avis de cyclotouriste a été mis en service en 1853. Il Un parcours un peu difficile, mais très relie Vitry-le-François à intéressant et très varié. On suit : Strasbourg. -la Meurthe de Frouard à Malzéville, avec le canal de l’Est relie la Meuse un parcours champêtre au départ, et (Givet) et la Moselle à la urbain à partir de Champigneulles Saone (Corre). il a été mis en -le canal de la Marne au Rhin de service en 1887. Depuis 2003, Malzéville à Laneuveville-devant-Nancy, la portion Neuves-Maisons- une partie animée tout autour jusqu’à Corre est dénommée canal des Jarville, plus tranquille sur la fin Vosges. -le canal de jonction de Laneuveville- La boucle de la Moselle se devant-Nancy à Messein : superbe sur compose d’un enchainement plus de 10kms,un calme apprécié malgré de voies vertes, de pistes des zones très actives toutes proches cyclables et de routes. -le canal des Vosges de Messein à Neuves-Maisons -la Moselle de Neuves-Maisons à Frouard, avec un parcours très pittoresque de Neuves-Maisons à Pierre-la-Treiche (plus de 15kms) Points d’intérêt sur le parcours - Frouard : le port -Nancy : la place Stanislas, le port Saint-Georges, les jardins d’eau -Messein :la turbine, le plan d’eau -Neuves-Maisons : l’usine et le début du canal des Vosges -Toul : la cathédrale et -Villey-saint-Etienne : le village de Maron à Pierre-la-Treiche -canal -

Ligne-B-Horaires-Septembre-2020.Pdf
B sens FLAVIGNY-SUR-MOSELLE vers PONT-SAINT-VINCENT LIGNE DU LUNDI AU VENDREDI Uniquement mercredi Sauf mercredi LE SAMEDI LES CORRESPONDANCES FLAVIGNY-SUR-MOSELLE • Rue d’Epinal 06:45 07:15 09:15 11:15 – 14:15 15:47 16:56 – 18:20 Tennis 06:46 07:16 09:16 11:16 – 14:16 15:48 16:57 – 18:21 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE • Rue d’Epinal 09:10 11:10 13:45 16:20 18:20 O.H.S 06:47 07:17 09:17 11:17 – 14:17 15:49 16:58 – 18:22 Tennis 09:11 11:11 13:46 16:21 18:21 PONT-SAINT-VINCENT Boulangerie 06:49 07:19 09:19 11:19 – 14:19 15:51 17:00 – 18:24 O.H.S 09:12 11:12 13:47 16:22 18:22 • • • • Café des pêcheurs 06:50 07:20 09:20 11:20 – 14:20 15:52 17:01 – 18:25 Boulangerie 09:14 11:14 13:49 16:24 18:24 SEXEY-AUX-FORGES • Les deux épis 06:52 07:22 09:22 11:22 – 14:22 15:54 17:03 – 18:27 Café des pêcheurs 09:15 11:15 13:50 16:25 18:25 MARON • B RICHARDMENIL • Paquis 06:53 07:23 09:23 11:23 – 14:23 15:55 17:04 – 18:28 Les deux épis 09:17 11:17 13:52 16:27 18:27 Horaires Roses 06:54 07:24 09:24 11:24 – 14:24 15:56 17:05 – 18:29 RICHARDMENIL • Paquis 09:18 11:18 13:53 16:28 18:28 CHALIGNY • • A partir du 31 août 2020 Mairie 06:55 07:25 09:25 11:25 – 14:25 15:57 17:06 – 18:30 Roses 09:19 11:19 13:54 16:29 18:29 NEUVES-MAISONS • • • • • PONT-SAINT-VINCENT Vert Village 06:56 07:26 09:26 11:26 – 14:26 15:58 17:07 – 18:31 Mairie 09:20 11:20 13:55 16:30 18:30 MESSEIN • • LUDRES • Cinéma 07:00 – 09:30 11:30 – 14:30 16:02 17:11 – 18:35 Vert Village 09:21 11:21 13:56 16:31 18:31 SEXEY-AUX-FORGES LUDRES • • MESSEIN • Milleries 07:05 – 09:35 11:35 – 14:35 16:07 17:16 – 18:40 -

INFOS CHANTIERS Sem 08 CD 54.Pdf
AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER DE MEURTHE ET MOSELLE SEMAINE 08 CHANTIERS CD 54 et RESTRICTIONS DE CIRCULATION du 22/02 au 28/02/2021 (SOUS RESERVE DES INFORMATIONS CONNUES, DE REPORT OU D'ANNULATION) CHANTIERS CHAUSSEES / ACCOTEMENTS NATURE DES DATES RD AXE ROUTIER TERRITOIRE RESTRICTION TRAVAUX CHANTIER 06/02 - 16/04/2021 RD400 "les Baraques" PROTECTION 199 VDL les nuits de 19h00 à ROUTE BARREE DEVIATION CAMPIGNEULLES AMPHIBIENS 7h30 TRONDES vers MENIL-LA- EN ATTENTE TERRES DE 101 TOUR lieu dit "L'Aulnois et 26/01 - 02/07/2021 LIMITATION DE VITESSE A 50 km/h D'AMENAGEMENT LORRAINE la Tuilerie" CHANTIERS OUVRAGES D'ART DATES RD AXE ROUTIER IDENTIFIANT TERRITOIRE RESTRICTION CHANTIER # ## ## ## ## ## AUTRES RESTRICTIONS RD AXE ROUTIER OBJET TERRITOIRE DATES RESTRICTION LARGEUR DE CHAUSSEE REDUITE TOUL - BICQUELEY / TERRAIN INSTABLE TERRES DE 3/05/2019 - 904 CIRCULATION ALTERNEE PIERRE-LA-TREICHE côte Chapiron LORRAINE 15/05/2021 LIMITATION A 50 km/h ANDILLY DEGRADATION TERRES DE 10E 05/10 - 01/10/2021 LIMITATION DE VITESSE A 70km/h FRANCHEVILLE CHAUSSEE LORRAINE DEVIATION USAGERS PL: 1/sens MEREVILLE vers MESSEIN MESURE DE MEREVILLE, RD 331 vers giratoire PROTECTION "mauvais lieu", RD 331 vers VITERNE, pont sur la Moselle sortie "NEUVES-MAISONS" par D 331A, MEREVILLE vers TERRES DE 115 B EN PERMANENCE suivre RD 115 vers MESSEIN MESSEIN / RICHARDMENIL LORRAINE RESTRICTIONS : 2/sens MESSEIN vers MEREVILLE 3,5 TONNES et MESSEIN, RD 331 vers giratoire 2,50m HAUTEUR "mauvais lieu", RD 331 vers VITERNE sortie "MEREVILLE" par D 331B, suivre RD 115 B vers MEREVILLE AUTRES INFOS : travaux communaux, manifestations, chantiers.. -

Calendrier-Collecte-2020.Pdf
Calendrier de collecte Ordures ménagères et emballages recyclables 2020 CHANGEMENT DU JOUR ET DE LA FRÉQUENCE DE COLLECTE « Jetez mieux, jetez moins » : la devise du programme de prévention des déchets et la mise en place de la tarification incitative portent leurs fruits. Vous sortez beaucoup moins vos bacs d’ordures ménagères, vous triez massivement vos déchets. Bravo ! Pour vous simplifier la vie et vous aider à poursuivre et amplifier vos efforts, les collectes s’adaptent à vos nouvelles habitudes. Ordures ménagères Chaligny Maizières Bainville-sur-Madon Chavigny Viterne Neuves-Maisons Pont-Saint-Vincent 06 et 20 janvier 07 et 21 janvier 09 et 23 janvier 03 et 17 février 04 et 18 février 06 et 20 février 02, 16 et 30 mars 03, 17 et 31 mars 05 et 19 mars 14* et 27 avril 14 et 28 avril 02, 16 et 30 avril Bacs noirs avec 11 et 25 mai 12 et 26 mai 14 et 28 mai poignée coté rue 08 et 22 juin 09 et 23 juin 11 et 25 juin et sacs spécifiques 06 et 20 juillet 07 et 21 juillet 09 et 23 juillet à sortir la veille 03, 17 et 31août 04 et 18 août 06 et 20 août après 19h. 14 et 28 septembre 01, 15 et 29 septembre 03 et 17 septembre Collecte toutes 12 et 26 octobre 13 et 27 octobre 01, 15 et 29 octobre les 2 semaines 09 et 23 novembre 10 et 24 novembre 12 et 26 novembre 07 et 21 décembre 08 et 22 décembre 10 et 24 décembre * Pas de collecte Marthemont Frolois Flavigny-sur-Moselle les jours fériés Pierreville Maron Méréville Thélod Richardménil Messein Si jour férié lundi, Xeuilley Sexey-aux-Forges Pulligny mardi, mercredi ou jeudi 13 et 27 janvier 14 et 28 janvier 16 et 30 janvier > rattrapage le jour 10 et 24 février 11 et 25 février 13 et 27 février suivant. -

Meurthe-Et-Moselle
2015 MISE À JOUR PARTIELLE 2016 TLAS DÉPARTEMENTAL MEURTHE-ET-MOSELLE 3 ’Atlas départemental est un outil d’information et de connaissance de la Meurthe-et-Moselle. Il s’adresse aux élus, aux agents du conseil départemental ainsi qu’aux partenaires dont certains ont contribué à son ÉDITO élaboration. L’Atlas est en effet le fruit d’un travail collaboratif, mené à partir Ldes données statistiques et des analyses fournies par les services et partenaires du Département. Mise à jour de 75 indicateurs en 2016 L’Atlas départemental fait l’objet cette année d’une mise à jour de 75 indicateurs sur les 250 que contenait la version 2015. L’actualisation concerne les principaux indicateurs associés aux politiques publiques de la collectivité, les plus dynamiques et ceux dont l’évolution par rapport à 2015 présente un réel intérêt. La sélection couvre un grand nombre de thématiques : démographie, niveau de vie, emploi, économie solidaire et insertion, services à la population, solidarité, aménagement… La prochaine version complète de l’Atlas, avec l’ensemble des indicateurs, paraîtra en 2017. Comme pour les versions précédentes, les indicateurs 2016 sont illustrés par des graphiques, courbes et tableaux déclinés à l’échelle des six territoires d’action du Département ainsi que par des cartes permettant de compléter et de visualiser les éléments statistiques présentés. Un texte synthétique identifie les spécificités territoriales marquantes et permet la comparaison avec les tendances observées au sein de l’ancienne région Lorraine, de la nouvelle région Grand Est et de la France métropolitaine. Des définitions permettent en outre d’éclairer le lecteur sur les notions-clés pour chacune des thématiques. -

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Édition N° 6 Du 22 Janvier 2021
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Édition n° 6 du 22 janvier 2021 Le acte dans "eur int#$ralit# %euvent &tre !onsult# à "a pr#(ecture ou aupr) de ervi!e !on!ern# * Le recuei" %eut au si &tre !onsu"t# + • ur "e ite Internet de ervi!e de ",État en Meurt-e.et.Mo e""e + ///*0eurthe.et.0o e""e*$ouv*(r RECUEIL N° 6 22 janvier 2021 S O M M A I R E ARRÊTÉS, DÉCISIONS, CIRCULAIRES........................................................................................................................................................................................................2 PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE................................................................................................................................................................................................2 CABINET DU PRÉFET.....................................................................................................................................................................................................................................2 DIRECTION DES SÉCURITÉS................................................................................................................................................................................................................2 Bureau de la représentation de l'Etat.....................................................................................................................................................................................................2 Arrêté préfectoral N° 2021 – 01 accordant la -

Semaine 26 Rd Axe Routier Nature Des Travaux Territoire Dates Chantier Restriction Rd Axe Routier Identifiant Territoire Dates
CHANTIERS CD 54 et RESTRICTIONS DE CIRCULATION SEMAINE 26 (SOUS RESERVE DES INFORMATIONS CONNUES, DE REPORT OU D'ANNULATION) CHANTIERS CHAUSSEES / ACCOTEMENTS NATURE DES DATES RD AXE ROUTIER TERRITOIRE RESTRICTION TRAVAUX CHANTIER FORCELLES-SOUS- RD 50 FERMEE : DEVIATION GUGNEY TRAVAUX DE TERRES DE FORCELLES-SOUS-GUGNEY, 50 JUSQU'AU 2/07/2018 vers FRAISNES-EN- CHAUSSEE LORRAINE RD 56 C, GUGNEY, RD 56, RD 50 SAINTOIS vers FRAISNES EN SAINTOIS FERMETURE PONCTUELLE : TRAVAUX DE TERRES DE JUSQU'AU 331 MAIZIERES / VITERNE DEVIATION PAR RD 974 CHAUSSEE LORRAINE 12/07/2018 vers VITERNE ou MAIZIERES CHANTIERS OUVRAGES D'ART DATES RD AXE ROUTIER IDENTIFIANT TERRITOIRE RESTRICTION CHANTIER DEMOLITION ET RD 400 FERMEE RECONSTRUCTION à compter du VL: DEVIATION LOCALE VARANGEVILLE - 400 PONT SUR CANAL LUNEVILLOIS 2/11/2017 - PL: déviation par A33 entre échangeur DOMBASLE SUR MEURTHE MARNE AU RHIN durée : 1 an n°7 "Lunéville-Château / Dombasle" et "pont des écluses " n°4 "St Nicolas de Port / Varangéville" INSPECTION LUNEVILLE DETAILLEE LUNDI 25/06/2018 31 dir. CHÂTEAU-SALINS LUNEVILLOIS ALTERNAT PAR FEUX ouvrage "pont blanc " de 8h00 à 18h00 bd Georges Pompidou sur la Vezouze FRAIMBOIS - REFECTION ALTERNAT PAR FEUX 148 échangeur RN 59 ETANCHEITE LUNEVILLOIS 18/04 - 20/07/2018 LIMITATION A 50 KM/H "jetée de Pierres " pont sur la Meurthe AUTRES RESTRICTIONS RD AXE ROUTIER OBJET TERRITOIRE DATES RESTRICTION LARGEUR DE CHAUSSEE REDUITE TOUL - BICQUELEY / TERRAIN INSTABLE TERRES DE JUSQU'AU 904 CIRCULATION ALTERNEE PIERRE-LA-TREICHE côte Chapiron LORRAINE -

Arrêté N°D321261AT Portant Sur Une Restriction De Circulation
Arrêté n°D321261AT Portant sur une restriction de circulation sur la RD n° D115B STAM Terres de Lorraine LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE, VU le code de la route ; VU le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 3221-3 et L 3221-4 ; VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 et tous ses modificatifs sur la signalisation des routes et autoroutes ; VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie -signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel modifié ; VU l'arrêté temporaire n° D321260AT du 08 juillet 2021 ; VU l'arrêté permanent n° 11/CG/399/DIRAT du 29 novembre 2011 ; VU l'avis favorable du service Gestion Technique des Routes en date du 07/06/2021, autorisant à titre temporaire la levée de l'interdiction PL sur la RD50B ; SUR la demande du STAM Terres de Lorraine en date du 08/07/2021 ; CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la sécurité des usagers à l'occasion de travaux de réparation de l'Ouvrage d'Art référencé D115B-025 "pont sur le canal de fuite" sur la RD115B du PR1+568 à 1+665, sur le territoire de la commune de Méréville, pour le compte du département de Meurthe-et-Moselle ; CONSIDERANT les travaux d'entretien, sur l'ouvrage "Pont sur le Madon" référencé D50A-015, situé sur l'itinéraire de déviation de l'arrêté n° D321144AT ; SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; STAM Terres de Lorraine 230 rue de l'Esplanade du Génie 54200 TOUL Tel. -

Semaine 21 Rd Axe Routier Nature Des Travaux
CHANTIERS CD 54 et RESTRICTIONS DE CIRCULATION SEMAINE 21 (SOUS RESERVE DES INFORMATIONS CONNUES, DE REPORT OU D'ANNULATION) CHANTIERS CHAUSSEES / ACCOTEMENTS NATURE DES DATES RD AXE ROUTIER TERRITOIRE RESTRICTION TRAVAUX CHANTIER SECURISATION TERRES DE 974 ALLAIN vers THUILLEY 24/04 - 29/09/2017 LIMITATION A 70 KM/H ACCES CHANTIER LORRAINE TRAVAUX DE RD 20 C fermée : DEVIATION CHAUSSEE CIREY-SUR-VEZOUZE - CIREY-SUR-VEZOUZE, RD 993, 20 C LUNEVILLOIS jusqu'au 24/05/2017 HARBOUEY FREMONVILLE, BLÂMONT, RD 20, MISE EN ŒUVRE BARBAS, RD 20C, HARBOUEY D'ENROBES CHANTIERS OUVRAGES D'ART DATES RD AXE ROUTIER IDENTIFIANT TERRITOIRE RESTRICTION CHANTIER DEVIATION: RD 914, échangeur N4 en direction de NANCY, sortie échangeur LUNEVILLE RECONSTRUCTION "Lunéville-Château / Dombasle" suivre 31 vers CHÂTEAU-SALINS LUNEVILLOIS 3/04 - 30/11/2017 pont sur la Vezouze D400, HUDIVILLER, ANTHELUPT, boulevard Pompidou VITRIMONT, LUNEVILLE, RD 914 vers CHÂTEAU-SALINS CONFLANS EN JARNISY LIMITATION A 30 KM/H 603 → pont sur l'Orne BRIEY jusqu'au 30/06/2017 ALTERNAT PAR FEUX EN 24/24 JEANDELIZE LESMENILS vers VAL DE LARGEUR DE CHAUSSEE REDUITE 910 pont sur A31 27/03 - 27/06/2017 CHEMINOT LORRAINE LIMITATION A 50 KM/H EN APPROCHE DU CHANTIER: BOUXIERES SOUS LIMITATION A 50 KM/H VAL DE 42 A FROIDMONT vers pont sur A31 20/03 - 27/06/2017 AU NIVEAU DE L'OUVRAGE: LORRAINE LESMENILS LIMITATION A 30 KM/H ALTERNAT PAR FEUX MARON vers pont sur Moselle TERRES DE 92 2/05 -2/06/2017 ALTERNAT PAR FEUX SEXEY-AUX-FORGES canalisée LORRAINE ponts sur la Crusnes 618 LONGUYON vers -

Les Nouvelles De Rosières
Les nouvelles de Rosières n° 29 — OCTOBRE 2017 SOMMAIRE Chères Rosiéroises, chers Rosiérois, Editorial L’élection de Thibault BAZIN, en tant que Député est un honneur pour notre VIE MUNICIPALE localité et surtout une reconnaissance pour tout le travail qu’il a accompli Actualités Page 2 lors de ses différents engagements locaux. Sous son égide, notre commune a progressivement changé de visage pour le bien-être de tous. Je tiens à le Grand projet : remercier au nom de la commune pour tout ce qu’il nous a apporté et lui « La PASSERELLE » Page 3 souhaiter pleine et entière réussite dans ses nouvelles et nombreuses missions. Nouvelle organisation du Conseil Municipal J’ai donc été conduit à représenter notre ville comme Maire, depuis début Pages 4-5 juillet. La tâche qui m’a été dévolue sera en priorité de mener à bien les Grands projets en cours de programmes qui ont été lancés. Les travaux actuellement engagés et ceux à réalisation Page 6 venir sont ou seront gênants et même handicapants pour beaucoup d’entre nous mais ils contribueront à l’amélioration de notre cadre de vie. Je vous Travaux réalisés par les remercie pour votre compréhension devant les désagréments occasionnés. services Page 7 Nous allons poursuivre nos efforts, nous inscrire dans une démarche de Sécurité Page 8 continuité mais aussi dans une démarche de développement. Pour réaliser ces objectifs, j’ai à mes côtés, une équipe d’élus de grande qualité, Vie des services Page 9 dynamique, impliquée ainsi que plusieurs équipes d’agents communaux tout aussi impliqués. Le travail que chacun d’entre eux doit accomplir est Animations municipales important, prenant. -

Et-Madon Cc De Moselle
RÉSEAU SUB AU 31 AOÛT 2020 326 MONTENOY Petit Verger LIGNE 321 Champigneulles – Bellefontaine ‹—› Nancy – Place Carnot Fontaine LIGNE 322 Bouxières-aux-Dames – Téméraire ‹—› Nancy – Place Carnot MONTENOY Pré Fourot LIGNE 323 Frouard – Le Nid ‹—› Nancy – Place Carnot VERBÆ AGENCE MALLELOY Mairie LIGNE 324 Pompey – Les Vannes ‹—› Nancy – Place Carnot Libération Moulin LIGNE 325-10 Pompey – Fonds de Lavaux ‹—› Vandœuvre-lès-Nancy – Brabois Santé Centre Uniquement le dimanche (Poirel desservi au départ de République) FAULX Moulin LIGNE 326 Pompey – La Ruche / Montenoy – Petit Verger ‹—› Nancy – République CUSTINES Collège Louis Marin LIGNE 100 Villers-lès-Nancy – Lycée Stanislas ‹—› Pont-Saint-Vincent – “Pont-Saint-Vincent” Cimetière LIGNE 23 Vandœuvre-lès-Nancy – Vélodrome ‹—› Dombasle-sur-Meurthe – Saulcy Chaumière LIGNE 24 Art-sur-Meurthe – “Art-sur-Meurthe” ‹—› Dombasle-sur-Meurthe – Saulcy Guingot René II Saint Louis Arrêts Arrêts communs à plusieurs lignes Terminus Champs des Loups POMPEY 325 Tassigny Fonds de Lavaux Itinéraire bis boucle d’itinéraire L5 L6 Aciéries SNCF C.C. DU BASSIN DE POMPEY Centre Socio Culturel CORRESPONDANCES PÉRIMÈTRES DES TERRITOIRES L6 L5 L4 Autres réseaux Limite L1 Arcades 326 POMPEY des communautés 10 Septembre Ferme La Ruche L1 Ligne 1 T1 Tempo 1 de communes Gasser Marronniers Gambetta Narvannes L2 Ligne 2 T2 Tempo 2 Communes Leclerc L1 POMPEY Bellevue traversées Hôtel de Ville L3 Ligne 3 T3 Tempo 3 M’ par le réseau SUB René Thibaut Lasalle Abattoirs Saint Antoine L4 Ligne 4 T4 Tempo 4 N La Navette CCPSV Mairie Lavoir L5 Ligne 5 BOUXIÈRES- Clairjoie Étoile L6 Ligne 6 Place Nationale AUX-DAMES Jean Moulin L2 S4 Services Arrêt Pixerécourt (Malzéville) connexion Marronniers Douaire 322 BOUXIÈRES Point Central S5 scolaires *avec la ligne 16 du réseau Stan Écoles Téméraire POMPEY 324 Les Vannes La Source FROUARD 323 Munch Le Nid FROUARD LAY-ST- C.