World Bank Document
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE Appel Pour Une Réponse À L’Échelle Des Besoins
TCHAD : CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE Appel pour une réponse à l’échelle des besoins Janvier 2018 © OCHA/Naomi Frerotte 3 POINTS CLÉS La situation alimentaire et 1 nutritionnelle se détériore. La chronicité de la crise requiert une 2 nouvelle façon de travailler associant interventions humanitaires et de développement. En 2018, US$ 282,5 millions sont 3 nécessaires pour sauver les vies des personnes les plus affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle au Tchad. APERÇU DE LA 4 millions SITUATION Personnes en situation d’insécurité alimentaire Au Tchad, plus de 4 millions de personnes sont affectées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition chaque année. Ne pouvant subvenir à leurs besoins alimentaires, et dans un contexte 2ème position où l’accès aux services sociaux de base est extrêmement limité, dans l’indice mondial leur santé, en particulier leur statut nutritionnel, peut se détériorer de la faim rapidement. La période de soudure agricole, de mai à septembre, lors de laquelle les nouveaux produits agricoles ne sont pas encore 200 000 disponibles sur les marchés alors que les stocks alimentaires issus Cas prévus de de la campagne agricole précédente sont épuisés, et la saison malnutrition aigüe des pluies qui détruit de nombreuses cultures de juillet à octobre sévère en 2018 sont un moment critique pour les populations tchadiennes les plus vulnérables. Pendant et après ces périodes, de nombreux ménages, en situation de précarité, n’arrivent plus à s’alimenter correctement et peuvent adopter des stratégies de survie néfastes pour leur santé et leur état nutritionnel. En 2018, près de 900 000 personnes se retrouveront dans une situation d’insécurité alimentaire sévère au Tchad pendant la période de soudure, nécessitant des interventions d’urgence d’assistance alimentaire et d’appui aux moyens d’existence. -

SALAMAT TANDJILE CHARI BAGUIRMI GUERA LOGONE ORIENTAL MANDOUL MOYEN CHARI CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Legend
TCHAD:REGION DU MOYEN-CHARI Juin 2010 E E E E " " " " 0 0 0 0 ' ' ' ' 0 0 0 0 ° ° ° ° 7 8 9 0 1 1 1 2 Seaba BAGUIRMI Chinguil Kiéké Matègn Maïra Al Bidia Chinguil Baranga Zan Ndaba Cisi Madi Balo Djomal Ségué Badi Biéré Am Kiféou Chérif Boubour Bankéri Djouna Djouna Mogo Bao Gouri Djember Gadang-gougouri Barao Tiolé Kadji Barlet Gofena Boumbouri Bilabou Karo Al Fatchotchoy Al Oubana Aya Hour Bala Tieau Djoumboul Timan Méré Banker GUE R A Djogo Goudak Aya I BARH BAHR Lagouay SIGNAKA Djimèz Am Biringuel LOUG CHARI Gamboul Djadja Al Itéin AZOUM Miltou Kourmal Tor CHA R I B A GU I RM I Gangli Komo Djigel Karou Siho Tiguili Boum Dassik Gou Tilé Kagni Kabir Takalaou Bibièn Nougar Bobèch Boum Kabir Baranga Lagoye Moufo Al Frèch Kébir Bir El Tigidji Souka Rhala Kané Damraou Délou Djiour Tari Gour Kofé Bouni Djindi Gouaï Béménon Dogoumbo Sarabara Tim Ataway Bakasao Nargon Damtar N N " Korbol " 0 Bar 0 ' ' 0 0 ° ° 0 Korbol Malé Dobo Dipkir 0 1 Kalmouna Sali 1 Lour Dik Guer Malbom Sakré Bouane Kouin BAHR KOH Délèb Migna Tousa Dongo Direk Wok Guéléhé SALAMAT Guélé Kalbani Singako Kwaloum Kagnel Tchadjaragué Moula Kouno Gourou Niou Balétoundou Singako Koniène Alako Biobé Kindja Ndam Baltoubay Alako Yemdigué Ndam Kalan Bahitra Baltoubaye Balé Dène Balékolo Balékoutou Niellim Ala Danganjin Kidjokadi Gaogou Mirem Ngina Pongouo Tchigak Moul Boari Kokinio Koubatiembi Roukou TANDJILE EST Palik Bébolo Roro Koubounda Gori Koulima Korakadja Simé Djindjibo Bari Kaguessem Gotobé Balé Dindjebo Gounaye Tolkaba Gilako Béoulou Yanga Ladon Mandjoua Gabrigué Hol Bembé -

020918-EIES-Final-Voirie-Bedaya
Public Disclosure Authorized REPUBLIQUE DU TCHAD ---------- MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DU DESENCLAVEMENT ET DU TRANSPORT ----------------- PROJET DE MOBILITE ET DE CONNECTIVITE RURALE (PMCR) --------------- Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE L’AXE BEDAYA-MOINSSALA (75 KM) Public Disclosure Authorized VERSION FINALE SEPTEMBRE 1 2018 Table des matières SIGLES ET ABREVIATIONS .................................................................................................. 5 LISTE DES TABLEAUX .......................................................................................................... 7 LISTE DES CARTES ................................................................................................................ 8 LISTE DES PHOTOS ................................................................................................................ 8 LISTE DES ANNEXES ............................................................................................................. 8 RESUME NON TECHNIQUE ................................................................................................ 10 NON-TECHNICAL SUMMARY............................................................................................ 16 1. INTRODUCTION ............................................................................................................ 21 1.1. Contexte ....................................................................................................................... -

The Difficult Relationship Between Faith-Based Health Care Organisations and the Public Sector in Sub-Saharan Africa
The difficult relationship between faith-based health care organisations and the public sector in sub-Saharan Africa The case of contracting experiences in Cameroon, Tanzania, Chad and Uganda Delphine Boulenger and Bart Criel Studies in Health Services Organisation & Policy, 29, 2012 We dedicate this work to the late Professor Dr. Harry Van Balen, former Head of the Public Health Department of the Institute of Tropical Medicine in Antwerp, and former Chairman of the network organisation Medicus Mundi International. 4 Studies in HSO&P, 2012 Studies in Health Services Organisation & Policy, 29, 2012 Series editors: G. Kegels, V. De Brouwere, B. Criel ©ITGPress, Nationalestraat 155, B-2000 Antwerp, Belgium. E-mail: [email protected] Delphine Boulenger and Bart Criel The difficult relationship between faith-based health care organisations and the public sector in sub-Saharan Africa The case of contracting experiences in Cameroon, Tanzania, Chad and Uganda D/2012/0450/1 ISBN 9789076070391 EAN 9789076070391 2 Studies in HSO&P, 2012 Table of contents TABLE OF CONTENTS ........................................................................ 1 ACRONYMS .......................................................................................... 5 ACKNOWLEDGMENTS……………………………………………………………… 9 EXECUTIVE SUMMARY .................................................................... 11 INTRODUCTION ........................................................................................ 11 BACKGROUND ......................................................................................... -

Participatory Action Research on Community Mechanisms Linking Child Protection with Social Cohesion
PARTICIPATORY ACTION RESEARCH ON COMMUNITY MECHANISMS LINKING CHILD PROTECTION WITH SOCIAL COHESION BASELINE REPORT BURUNDI/CHAD ! Dr. Philip Cook, IICRD Executive Director Dr. Marisa O. Ensor, IICRD Associate Dr. Natasha Blanchet-Cohen, IICRD Senior Associate TABLE OF CONTENTS ! BASELINE$FINDINGS$ 3! 1.$INTRODUCTION$ 3! 2.$CONCEPTUAL$AND$METHODOLOGICAL$FRAMEWORKS$ 4! 2.1! RESEARCH!DESIGN! 6! 2.2! RESEARCH!METHODS! 7! 2.3! RESEARCH!SITES! 10! 2.4! BACKGROUND!AND!HISTORICAL!ANTECEDENTS! 11! 3.$FINDINGS$INFORMING$SOCIAL$COHESION$AND$CHILD$PROTECTION:$RISK$AND$PROTECTIVE$FACTORS$ 16! 3.1$$$$KEY$FINDINGS$IN$BURUNDI! 17! 3.1.1! Internal!Displacement!and!Refugee!Repatriation! 17! 3.1.2!!!!!Land!Issues,!Food!Insecurity!and!Constrained!Livelihood!Options! 19! 3.1.3!!!!!Poverty! 20! 3.1.4! Family!Relations!and!Social!Support! 22! 3.1.5! Education!and!Schooling! 23! 3.1.6! Unmarried!Mothers!and!Unwanted!Pregnancies! 24! 3.1.7! Orphans! 25! 3.1.8! Violence! 27! 3.1.9! Groups!and!Associations! 27! 3.2$ $KEY$FINDINGS$IN$CHAD! 29! 3.2.1! Poverty! 29! 3.2.2! Child!Trafficking! 29! 3.2.3! The!Worst!Forms!of!Child!Labor! 30! 3.2.4! Violence! 32! 3.2.5! Early!Marriages! 33! 3.2.6! Female!Genital!Mutilation!(FGM;!excision\clitoridectomy)! 34! 3.2.7! Limited!Birth!Registration! 35! 4.! ADDITIONAL$CONSIDERATIONS$ 36! 5.! CONCLUDING$THOUGHTS$ 39! 6.! RECOMMENDATIONS$ 41! 7.! REFERENCES$ 42! ! ! ! Baseline Findings: Participatory Action Research on Community Mechanisms, Child Protection and Social Cohesion in Burundi and Chad Page!2!of!46$! ! PARTICIPATORY ACTION RESEARCH ON COMMUNITY MECHANISMS, CHILD PROTECTION AND SOCIAL COHESION IN BURUNDI AND CHAD BASELINE FINDINGS 1.#INTRODUCTION# Community based child protection mechanisms have become a common approach to protecting children in conflict and post-conflict settings. -

Resultats Definitifs Par Sous-Prefecture
RÉPUBLIQUE DU TCHAD UNITE - TRAVAIL – PROGRES ------------------ MINISTÈRE DU PLAN, DE L’ÉCONOMIE ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ------------------ INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET DÉMOGRAPHIQUES (INSEED) DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT (RGPH2, 2009) RESULTATS DEFINITIFS PAR SOUS-PREFECTURE Février 2012 CARTE ADMINISTRATIVE DU TCHAD Source : INSEED 1 SOMMAIRE CARTE ADMINISTRATIVE DU TCHAD …………………………………………….. 1 AVANT-PROPOS .............................................................................................................. 4 INTRODUCTION .............................................................................................................. 6 LISTE DES TABLEAUX Tableau 01: Répartition de la population totale par région, par département et par sous- préfecture de recensement selon le sexe …………………………. 8 Tableau 02 : Population recensée et effectif estimé de la population non recensée dans des zones inaccessibles des régions de Sila et de Tibesti par département et par sous-préfecture selon le sexe ………………………………………… 16 Tableau 03 : Répartition de la population totale recensée par région, par département et par sous-préfecture de recensement selon le sexe ……………………… 17 Tableau 04 : Répartition de la population totale recensée par région, par département et par sous-préfecture de recensement selon le mode de vie (Nomade/Sédentaire) …………………………………………………….. 25 Tableau 05 : Répartition des ménages ordinaires recensés par région, par département et par sous-préfecture -
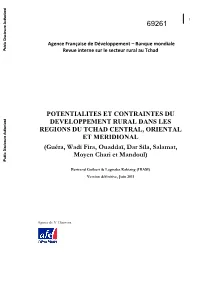
Banque Mondiale Revue Interne Sur Le Secteur Rural Au Tchad
1 69261 Agence Française de Développement – Banque mondiale Public Disclosure Authorized Revue interne sur le secteur rural au Tchad Public Disclosure Authorized POTENTIALITES ET CONTRAINTES DU DEVELOPPEMENT RURAL DANS LES REGIONS DU TCHAD CENTRAL, ORIENTAL ET MERIDIONAL (Guéra, Wadi Fira, Ouaddaï, Dar Sila, Salamat, Moyen Chari et Mandoul) Public Disclosure Authorized Bertrand Guibert & Lagnaba Kakiang (IRAM) Version définitive, Juin 2011 Public Disclosure Authorized Agence de N’ Djamena 2 3 Sommaire SOMMAIRE 1 LISTE DES SIGLES 5 1. CADRE ET DEROULEMENT DE LA MISSION 6 1.1 Cadre prévu de cette mission d’identification 6 1.2 Objectif et finalité 6 1.3 Déroulement 7 2. RESULTATS DE L’ÉTUDE 9 2.1. Considérations générales 9 2.2. La région du Guéra 9 2.2.1. Grandes caractéristiques de la région 9 2.2.2. Potentialités et contraintes majeures 11 2.2.3. Recommandations spécifiques du Guéra 13 2.3. La région du Wadi Fira 14 2.3.1. Grandes caractéristiques de la région 14 2.3.2. Potentialités et contraintes majeures 15 2.3.3. Recommandations spécifiques à la région du Wadi Fira 17 2.4. La région du Ouaddai 18 2.4.1. Grandes caractéristiques de la région 18 2.4.2. Potentialités et contraintes majeures 19 2.4.3. Recommandations spécifiques au Ouaddai 21 2.5. La région du Dar Sila 22 2.5.1. Grandes caractéristiques de la région 22 2.5.2. Potentialités et contraintes majeures 23 2.5.3. Recommandations spécifiques du Dar Sila 25 2.6. La région du Salamat 26 2.6.1. -

Diseases, Refugees
ANNUAL REPORT OF ON THE USE OF CERF GRANTS IN CHAD 2011 COUNTRY CHAD RESIDENT/HUMANITARIAN Thomas Gurtner COORDINATOR I. SUMMARY OF FUNDING IN 2011 – US$ 1. Total amount required for the humanitarian 535,276,140 response 2.1 CERF 22,553,084 2.2 COMMON HUMANITARIAN FUND/ EMERGENCY RESPONSE FUND (if 2. Breakdown of total response funding received applicable) by source 2.3 OTHER (Bilateral/Multilateral) 2.4 TOTAL Underfunded Funding Funding 1. First Round 8,039,204 3. Breakdown of funds received by window 2. Second Round Rapid Response 14,513,880 4.1 Direct UN agencies/IOM implementation 14, 959, 331.36 4.2 Funds forwarded to NGOs for 4. Please provide the breakdown of CERF funds 6,822,928,54 by type of partner implementation 4.3 Funds forwarded to government partners 770,824,1 4.4 TOTAL 22,553,084 II. SUMMARY OF BENEFICIARIES PER EMERGENCY Total number of individuals affected by the crisis Individuals Female 7,229,872 Male 7,410,949 Total number of individuals reached with CERF funding Total individuals (Female and male) 14,640,821* Of total, children under 5 2,652,145 * Please note that some beneficiaries are counted for 1 and/or 2 crises MENINGITIS AND MEASLES OUTBREAK Total number of individuals affected by the crisis Individuals 3,351,443 Female 793,724 Male 762,598 Total number of individuals reached with CERF funding Total individuals (Female and male) 1,556,322 Of total, children under 5 283,251 CHOLERA OUTBREAK – JULY AND OCTOBER 2011 Total number of individuals affected by the crisis Individuals Female 6,416,148 Male 6,598,351 Total number of individuals reached with CERF funding Total individuals (Female and male) 13,014,499 Of total, children under 5 2,368,894 CRISIS IN LIBYA - UNHAS Total number of individuals affected by the crisis Individuals 70,000 Female 50,000 Male 2,0000 Total number of individuals reached with CERF funding Total individuals (Female and male) 70,000 Of total, children under 5 2 III. -

A Cost Analysis of Tsetse Control in the Mandoul Sleepin
Rayaisse et al. Parasites Vectors (2020) 13:419 https://doi.org/10.1186/s13071-020-04286-w Parasites & Vectors RESEARCH Open Access Delivering ‘tiny targets’ in a remote region of southern Chad: a cost analysis of tsetse control in the Mandoul sleeping sickness focus Jean‑Baptiste Rayaisse1, Fabrice Courtin2,5, Mahamat Hisséne Mahamat3, Mahamat Chérif3, Wilfrid Yoni1, Nadmba M. O. Gadjibet3, Mallaye Peka4, Philippe Solano5, Steve J. Torr6 and Alexandra P. M. Shaw7,8* Abstract Background: Since 2012, the World Health Organisation and the countries afected by the Gambian form of human African trypanosomiasis (HAT) have been committed to eliminating the disease, primarily through active case‑fnding and treatment. To interrupt transmission of Trypanosoma brucei gambiense and move more rapidly towards elimina‑ tion, it was decided to add vector control using ‘tiny targets’. Chad’s Mandoul HAT focus extends over 840 km2, with a human population of 39,000 as well as 14,000 cattle and 3000 pigs. Some 2700 tiny targets were deployed annually from 2014 onwards. Methods: A protocol was developed for the routine collection of tsetse control costs during all feld missions. This was implemented throughout 2015 and 2016, and combined with the recorded costs of the preliminary survey and sensitisation activities. The objective was to calculate the full costs at local prices in Chad. Costs were adjusted to remove research components and to ensure that items outside the project budget lines were included, such as administrative overheads and a share of staf salaries. Results: Targets were deployed at about 60 per linear km of riverine tsetse habitat. -

AMP Conference Call Minutes: 7Th December 2016
AMP Conference call minutes: www.allianceformalariaprevention.com 7th December 2016 Dial-in number: +1-213-787-0529 USA toll-free: 888-808-6929 Access Code: 3904916 If you wish to be added to or taken off of this mailing list please contact: [email protected] Do you have a topic / issue / country specific update to share with the AMP partnership? Send a summary of the topic you would like to discuss to: [email protected] or [email protected] and we will schedule your update at the start of an upcoming AMP conference call. Agenda – December 7th AMP conference call Chair : Melanie Caruso Rapporteur : Melanie Caruso . Introductions . Country Updates . Working Group Updates . AOB Next conference call: Wednesday, 14th December 2016 10:00 EST, 14:00 GMT / UTC, 16:00 CET Participants: ALMA : AMF: AMP participants : Melanie Caruso, John Ngum, Jean-Marc Grégoire, Yves Cyaka, Eric Phollet, Dr. Filemon (Benin PNLP coordinator), Hamisu Hassan BASF: Alex Heimsch Buy a Net: CDC / PMI: David Gittelman, Chantelle Owens, Gabriel Ponce-de-Leon CRS: Disease Control Technologies: Global Fund: Sussan Nasr Global Health Partners: IFRC: Marcy Erskine Independent participants: Kevin Starace Intelligent Insect Control: IPHA: JC Flowers Foundation: JHU Centre for Communications: Hannah Koenker JSI: MCDI: Milliner Global Associates: John Milliner AMP The Alliance for Malaria Prevention / conference call minutes / 7th December 2016 Nets for Life: PLAN Canada: PSI: Cedric Mingat, Charlotte Eddis Real Relief Health: Rotarians Action Group on Malaria: Drake Zimmerman RTI: Sumitomo: Tana Netting: UMCOR: UNICEF: UN Foundation: USAID / PMI: Megan Fotheringham VF: WHO: Stefan Hoyer World Vision: Gagik Karapetyan General updates: AMP 2017 Partners’ meeting - The dates of the 2017 partners meeting have been fixed to 6-7th February prior to the VCWG meeting scheduled 8-10th February and will take place at the Movenpick Hotel in Geneva. -

LET4CAP Law Enforcement Training for Capacity Building CHAD
Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union LET4CAP Law Enforcement Training for Capacity Building CHAD Downloadable Country Booklet DL. 2.5 (Version 1.2) 1 Dissemination level: PU Let4Cap Grant Contract no.: HOME/ 2015/ISFP/AG/LETX/8753 Start date: 01/11/2016 Duration: 33 months Dissemination Level PU: Public X PP: Restricted to other programme participants (including the Commission) RE: Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission) Revision history Rev. Date Author Notes 1.0 18/05/2018 Ce.S.I. Overall structure and first draft 1.1 25/06/2018 Ce.S.I. Second draft 1.2 30/11/2018 Ce.S.I. Final version LET4CAP_WorkpackageNumber 2 Deliverable_2.5 VER WorkpackageNumber 2 Deliverable Deliverable 2.5 Downloadable country booklets VER 1.2 2 CHAD Country Information Package 3 This Country Information Package has been prepared by Elisa Sguaitamatti External contributor to Ce.S.I. – Centre for International Studies Within the framework of LET4CAP and with the financial support to the Internal Security Fund of the EU LET4CAP aims to contribute to more consistent and efficient assistance in law enforcement capacity building to third countries. The Project consists in the design and provision of training interventions drawn on the experience of the partners and fine-tuned after a piloting and consolidation phase. © 2018 by LET4CAP…. All rights reserved. 4 Table of contents 1. Country Profile 1.1 Country in Brief 1.2 Modern and Contemporary History of Chad 1.3 Geography 1.4 Territorial and Administrative Units 1.5 Population 1.6 Ethnic Groups, Languages, Religion 1.7 Health 1.8 Education and Literacy 1.9 Country Economy 2. -

Evaluación Del Abastecimiento De Agua Mediante Bombas Manuales En El Sur De Chad
Evaluación del abastecimiento de agua mediante bombas manuales en el sur de Chad Carlos Benítez Gimeno Grupo de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial – Universidad Politécnica de Madrid. [email protected] Julia Recio Aguilera Grupo de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo. ETSIDI - UPM [email protected] José Antonio Mancebo Piqueras Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial. ETSIDI - UPM [email protected] Resumen Este proyecto surge de la colaboración entre el Centro de Innovación en Tecnología para el desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM) y Oxfam Intermón (OI) para realizar la evaluación del funcionamiento y la gestión del acceso al agua mediante bombas manuales instaladas en pozos en la región de Mandoul, al sur del Chad. El objetivo final, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), busca identificar las causas que provocan el mal funcionamiento de las bombas para poder plantear métodos y tecnologías con los que mejorar el mantenimiento y sostenibilidad de estas, y con ello, el acceso al agua de forma sostenible y justa, de las poblaciones beneficiarias. Para ello, la realización de este estudio se ha compuesto de tres etapas: una fase inicial de estudio e investigación, una de trabajo en terreno para recoger datos necesarios y finalmente, una fase de tratamiento de la información recabada para la detección de problemas de diferente índole que afectan al buen funcionamiento de las bombas. Teniendo en cuenta la información analizada, los principales resultados obtenidos señalan problemas técnicos en las bombas manuales; de gestión en los comités de agua; de aprovisionamiento y calidad de piezas de repuesto y la dependencia que aún se mantiene por parte de las poblaciones con las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) establecidas en la región.