Unitaires Actrices 1929-1944
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dossier De Presse ECLAIR
ECLAIR 1907 - 2007 du 6 au 25 juin 2007 Créés en 1907, les Studios Eclair ont constitué une des plus importantes compagnies de production du cinéma français des années 10. Des serials trépidants, des courts-métrages burlesques, d’étonnants films scientifiques y furent réalisés. Le développement de la société Eclair et le succès de leurs productions furent tels qu’ils implantèrent des filiales dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Devenu une des principales industries techniques du cinéma français, Eclair reste un studio prisé pour le tournage de nombreux films. La rétrospective permettra de découvrir ou de redécouvrir tout un moment essentiel du cinéma français. En partenariat avec et Remerciements Les Archives Françaises du Film du CNC, Filmoteca Espa ňola, MoMA, National Film and Television Archive/BFI, Nederlands Filmmuseum, Library of Congress, La Cineteca del Friuli, Lobster films, Marc Sandberg, Les Films de la Pléiade, René Chateau, StudioCanal, Tamasa, TF1 International, Pathé. SOMMAIRE « Eclair, fleuron de l’industrie cinématographique française » p2-4 « 1907-2007 » par Marc Sandberg Autour des films : p5-6 SEANCE « LES FILMS D’A.-F. PARNALAND » Jeudi 7 juin 19h30 salle GF JOURNEE D’ETUDES ECLAIR Jeudi 14 juin, Entrée libre Programmation Eclair p7-18 Renseignements pratiques p19 La Kermesse héroïque de Jacques Feyder (1935) / Coll. CF, DR Contact presse Cinémathèque française Elodie Dufour - Tél. : 01 71 19 33 65 - [email protected] « Eclair, fleuron de l’industrie cinématographique française » « 1907-2007 » par Marc Sandberg Eclair, c’est l’histoire d’une remarquable ténacité industrielle innovante au service des films et de leurs auteurs, grâce à une double activité de studio et de laboratoire, s’enrichissant mutuellement depuis un siècle. -

De Luis Bunuel Avec Georges Marchal, Lucia Bose
"CELA S’APPELLE L’AURORE" (1956) de Luis Bunuel avec Georges Marchal, 1 70/100 Lucia Bose. Affiche de Jean Mascii. Les Films Marceau. "UN MILLION D'ANNÉES AVANT J.C." (1966) de Don Chaffey avec Raquel Welch, John 40/80 2 Richardson. Affichette. Seven Arts Hammer. 20th Century Fox. "APOCALYPSE NOW" (1979) de Francis Ford Coppola avec Marlon Brando, 3 Affiche de B. Peak. Palme d’or festival de Cannes. 40/80 "LA GRANDE PARADE DU RIRE" (1967) Film de montage de Robert Youngson 50/90 4 Période burlesque américain. Affiche. MGM. "LES FRUITS DE LA PASSION" (1981) de Shuji Terayama avec Klaus Kinski, 5 Arielle 30/70 Dombasle. Affiche dessinée par Roland Topor. "GUET-APENS" (1980) de Sam Peckinpah avec Steve Mac Queen, et Ali Mac Graw. 40/90 6 Affiche. Film Warner Columbia. "PEAU D’ANE" (1970) de Jacques Demy avec Catherine Deneuve, Jean Marais. 70/100 7 Affiche de Jim Leon. Films Paramount. "LE SPECTRE DU PROFESSEUR HICHCOCK" (1963) de Robert Hampton (Riccardo Freda) avec Barbara Steele, Peter 70/120 8 Baldwin. Afiche de C. Belinsky. "PLAYTIME" (1967) de et, avec Jacques Tati. 9 Affichette de Baudin. Dessin de Ferracci 40/90 "BOULEVARD DE PARIS" (1955) de Mitchell Leisen avec Anne Baxter, Steve Forest, 200/300 10 Raymond Bussières. Affiche entoilée. Dessin de Roger Soubie. "LA FILLE DANS LA VITRINE" (1961) de Luciano Emmer avec Lino Ventura, 100/150 11 Marina Vlady. Affiche de Jean Mascii. Discifilm. "ASTÉRIX CHEZ LES BRETONS" (1986) d’après l’album de Goscinny et, Uderzo. 40/80 40/80 12 Affiche. -

Grande Vente Aux Enchères Publiques D'affiches De
GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D’AFFICHES DE CINÉMA À L’OMNIA MERCREDI 05 DÉCEMBRE 2018 à 18h30 200 lots d’affiches de collection mis en vente Sous le contrôle de Maître Bruno MARESCHAL, commissaire-priseur habilité EURL DEAUVILLE ENCHERES (agrément 056-2014) Siège social : 16, rue du Général Leclerc - 14800 DEAUVILLE - Tél : 02 31 88 42 91 - [email protected] ENTRÉE LIBRE (SALLE N°2 DE L’OMNIA) Paiement des lots d’affiches sur place (+ 22% TTC frais vente acheteurs en sus) Estimations en € "INDIANA JONES ET, LA DERNIÈRE CROISADE" (1989) de Steven Spielberg avec 1 Harrison Ford, Sean Connery. 40/80 Affiche 1,20 x 1,60. Dessin de Drew. "LES DIX COMMANDEMENTS" (1956) de Cecil B. de Mille avec Charlton Heston. 2 Affiche 1,20 x 1,60. Réédition. Films Paramount. 30/70 "VOYAGE À DEUX" (1967) de Stanley Donen avec Audrey Hepburn, Albert Finney. 3 Affiche 1,20 x 1,60. Dessin de Grinsson. 30/80 "HÔTEL DES AMÉRIQUES" (1981) de André Téchiné avec Catherine Deneuve, 4 Patrick Dewaere. 20/60 Affiche 1,20 x 1,60 de Ferracci. "ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR" (1985) de Paul et, Gaetan Brizzi. 5 Dessin de Albert Uderzo. Affichette 0,80 x 0,60. 20/50 "BOEING BOEING" (1965) de John Rich avec Jerry Lewis, Tony Curtis, Dany Saval. 6 Affiche 1,20 x 1,60. Dessin de Landi. 40/80 "RAN" (1985) de Akira Kurosawa. 7 Affiches 1,20 x 1,60. 2 modèles par Benjamin Baltimore 30/80 "SUR UN ARBRE PERCHÉ" (1970) de Serge Korber avec Louis de Funès et, 8 Geraldine Chaplin. -

Boxoffice Barometer (March 6, 1961)
MARCH 6, 1961 IN TWO SECTIONS SECTION TWO Metro-Goldwyn-Mayer presents William Wyler’s production of “BEN-HUR” starring CHARLTON HESTON • JACK HAWKINS • Haya Harareet • Stephen Boyd • Hugh Griffith • Martha Scott • with Cathy O’Donnell • Sam Jaffe • Screen Play by Karl Tunberg • Music by Miklos Rozsa • Produced by Sam Zimbalist. M-G-M . EVEN GREATER IN Continuing its success story with current and coming attractions like these! ...and this is only the beginning! "GO NAKED IN THE WORLD” c ( 'KSX'i "THE Metro-Goldwyn-Mayer presents GINA LOLLOBRIGIDA • ANTHONY FRANCIOSA • ERNEST BORGNINE in An Areola Production “GO SPINSTER” • • — Metrocolor) NAKED IN THE WORLD” with Luana Patten Will Kuluva Philip Ober ( CinemaScope John Kellogg • Nancy R. Pollock • Tracey Roberts • Screen Play by Ranald Metro-Goldwyn-Mayer pre- MacDougall • Based on the Book by Tom T. Chamales • Directed by sents SHIRLEY MacLAINE Ranald MacDougall • Produced by Aaron Rosenberg. LAURENCE HARVEY JACK HAWKINS in A Julian Blaustein Production “SPINSTER" with Nobu McCarthy • Screen Play by Ben Maddow • Based on the Novel by Sylvia Ashton- Warner • Directed by Charles Walters. Metro-Goldwyn-Mayer presents David O. Selznick's Production of Margaret Mitchell’s Story of the Old South "GONE WITH THE WIND” starring CLARK GABLE • VIVIEN LEIGH • LESLIE HOWARD • OLIVIA deHAVILLAND • A Selznick International Picture • Screen Play by Sidney Howard • Music by Max Steiner Directed by Victor Fleming Technicolor ’) "GORGO ( Metro-Goldwyn-Mayer presents “GORGO” star- ring Bill Travers • William Sylvester • Vincent "THE SECRET PARTNER” Winter • Bruce Seton • Joseph O'Conor • Martin Metro-Goldwyn-Mayer presents STEWART GRANGER Benson • Barry Keegan • Dervis Ward • Christopher HAYA HARAREET in “THE SECRET PARTNER” with Rhodes • Screen Play by John Loring and Daniel Bernard Lee • Screen Play by David Pursall and Jack Seddon Hyatt • Directed by Eugene Lourie • Executive Directed by Basil Dearden • Produced by Michael Relph. -

Luis Buñuel : Un Souffle De Liberté
LUIS BUÑUEL : UN SOUFFLE DE LIBERTÉ DU 2 AU 15 AOÛT, 6 FILMS RESTAURÉS DE LA « PÉRIODE FRANÇAISE » DU CINÉASTE SURRÉALISTE LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE LA VOIE LACTÉE TRISTANA LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR CINÉMA LE LOUXOR 170 Boulevard de Magenta, 75010 Paris M° : Barbès-Rochechouart www.cinemalouxor.fr LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE 1964 - 1h38 Avec Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli Fin des années 20. Un train s'arrête dans une petite gare normande. Célestine, la nouvelle bonne du vénérable monsieur Rabour, en descend. Joseph, un domestique antipathique, la mène en carriole jusqu'à la propriété bourgeoise du prieuré. Bientôt, Célestine n'ignore plus rien des travers de chacun. Horaires : « Point d’entrée idéal dans l’œuvre du cinéaste, il détient Mer 02/08, Ven 11/08 : 14h pourtant une énigme de taille, proprement insoluble : Jeu 03/08, Sam 05/08, Mer 09/08, Sam 12/08 : 16h Ven 04/08, Lun 14/08 : 18h l’impénétrable Célestine, personnage de petite bonne Dim 06/08, Jeu 10/08 : 22h d’une ambiguïté complète, magistralement interprété par Lun 07/08, Mar 15/08 : 20h Jeanne Moreau. » Mathieu Macheret, critique de cinéma. LA VOIE LACTÉE 1969 - 1h41 Avec Laurent Terzieff, Delphine Seyrig, Georges Marchal Six mystères ou dogmes du catholicisme sont illustrés à travers deux vagabonds, Pierre et Jean, qui pour se faire un peu d'argent se rendent à Saint-Jacques-de-Com- postelle. « Regardez La voie lactée tourné par Luis Buñuel en 1968 (pas n’importe quelle date). -
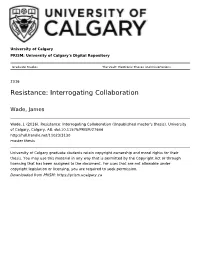
Resistance: Interrogating Collaboration
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies The Vault: Electronic Theses and Dissertations 2016 Resistance: Interrogating Collaboration Wade, James Wade, J. (2016). Resistance: Interrogating Collaboration (Unpublished master's thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/27644 http://hdl.handle.net/11023/3130 master thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Resistance: Interrogating Collaboration By James Wade A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS GRADUATE PROGRAM IN DRAMA CALGARY, ALBERTA JUNE 2016 © James Wade 2016 Abstract RESISTANCE: INTERROGATING COLLABORATION By James Wade The following manuscript and accompanying artist’s statement are the complete academic materials pertaining the writing of the full-length play Resistance. The artist’s statement will describe the process of adapting elements of the life and work of film director Jean-Pierre Melville. I will discuss issues related to Melville’s biography, his singular style, the development of the character of Dominique and the script’s treatment of “truth”. ii Acknowledgments I would like to take this opportunity to thank my supervisor, Clem Martini, for his guidance and continued support in the writing of this play. -

Lumière D'été (1943) “Our Soul,” Bachelard Posits, “Is an Abode
Program Notes: Lumière d'été (1943) “Our soul,” Bachelard posits, “is an abode. And by remembering ‘houses’ and ‘rooms,’ we learn to ‘abide’ Director: Jean Grémillon within ourselves. [Thus] the house images move in both Scenarists: Jacques Prévert and Pierre Laroche directions: they are in us as much as we are in them.” Cinematographer: Louis Page The dyadic dance of these two directions affects Music: Alexis Roland-Manuel the nature of how a house is figured on the page, in poetic Actors: Madeleine Renaud, Pierre Brasseur, Madeleine and literary renderings that serve Bachelard “as a tool for Robinson, Paul Bernard, Georges Marchal analysis of the human soul.” In this context, great French, B&W, 110min. symbolic significance is given to the figuration of houses as “vertical beings.” A house “rises upward” along its “A house is imagined as a vertical being. It rises upward. vertical axis; “it differentiates itself in terms of its It differentiates itself in terms of its verticality. It is one verticality.” By experiencing such differentiation, we of the appeals to our consciousness of verticality” – come to realize “our consciousness of verticality,” which Gaston Bachelard imaginatively constructs internal life as a structure, one floor on top of another. Our five-film series at the French Institute, titled Within the vertical enmeshment of human soul “Interiors: Cinema & the Home”, takes its inspiration and “the soul of the house,” Bachelard places an from Gaston Bachelard’s seminal treatise, The Poetics of emphasis on “the polarity of cellar and attic,” which Space (1958), whose first Hebrew edition has come out echoes the opposition between irrational id and rational recently, through the loving translation of Mor ego (respectively). -

Viewed One of the First “Films Parlants” in 1930 in London
FROM GOLDEN AGE TO SILVER SCREEN: FRENCH MUSIC-HALL CINEMA FROM 1930-1950 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Rebecca H. Bias, M.A. * * * * * The Ohio State University 2005 Dissertation Committee: Approved by Professor Judith Mayne, Advisor Professor Diane Birckbichler _________________________ Advisor Professor Charles D. Minahen Graduate Program in French and Italian Copyright by Rebecca H. Bias 2005 ABSTRACT This dissertation examines French music-hall cinema from 1930-1950. The term “music-hall cinema” applies to films that contain any or all of the following: music-hall performers, venues, mise en scène, revues, and music- hall songs or repertoire. The cinema industry in France owes a great debt to the music-hall industry, as the first short films near the turn of the century were actually shown as music-hall acts in popular halls. Nonetheless, the ultimate demise of the music hall was in part due to the growing popularity of cinema. Through close readings of individual films, the dynamics of music-hall films will be related to the relevant historical and cultural notions of the period. The music-hall motif will be examined on its own terms, but also in relation to the context or genre that underlies each particular film. The music-hall motif in films relies overwhelmingly on female performers and relevant feminist film theory of the 1970s will help support the analysis of female performance, exhibition, and relevant questions of spectatorship. Music-hall cinema is an important motif in French film, and the female performer serves as the prominent foundation in these films. -

Le Cinéma De Jean Anouilh Christophe Mercier
Document generated on 09/28/2021 11:54 p.m. Études littéraires Le cinéma de Jean Anouilh Christophe Mercier Anouilh aujourd’hui Article abstract Volume 41, Number 1, printemps 2010 Jean Anouilh’s cinematic output is not easy to figure out. In addition to those movies he scripted in full and whose text one would love to see published, URI: https://id.erudit.org/iderudit/044577ar much like Giraudoux’s, he was involved in adapting or contributing some or DOI: https://doi.org/10.7202/044577ar many scenes or dialogues to a number of other movies. While these other productions were not his, he still manages to shine through. Let us not forget See table of contents La citadelle du silence (Lherbier, 1937), which involved Anouilh’s participation, nor Piège pour Cendrillon or the haunting Temps de l’amour. These will probably resurface in a few years, and yield their share of discoveries. Indeed, there remains much to explore in Jean Anouilh’ cinema. Publisher(s) Département des littératures de l'Université Laval ISSN 0014-214X (print) 1708-9069 (digital) Explore this journal Cite this document Mercier, C. (2010). Le cinéma de Jean Anouilh. Études littéraires, 41(1), 157–170. https://doi.org/10.7202/044577ar Tous droits réservés © Université Laval, 2010 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. -

Download Program (PDF)
Tickets and Passes Available at SIFF.NET FESTIVAL PASS: $150 / $100 SIFF MEMBERS • INDIVIDUAL FILM ADMISSION: $15 / $10 SIFF MEMBERS SCHEDULE TUESDAY, FEBRUARY 18 6:00 PM … AND THE FIFTH HORSEMAN IS FEAR 35MM 8:30 PM FRIDAY, FEBRUARY 14 90 DEGREES IN THE SHADE 5:45PM Music by The Ben Thomas Trio before screening WEDNESDAY, FEBRUARY 19 6:30 PM THE BEAST MUST DIE 35MM 6:00 PM 9:15 PM THE HOUSEMAID THE BLACK VAMPIRE 8:30 PM BLACK HAIR SATURDAY, FEBRUARY 15 THURSDAY, FEBRUARY 20 Seattle-based writers Vince and Rosemarie Keenan (Vince is managing editor of NOIR CITY e-magazine) take over hosting duties for Eddie Muller on Saturday, February 15. 5:15PM Music by the Dmitri Matheny Group before screening 12:30 PM 6:00 PM PANIC THE DEVIL STRIKES AT NIGHT 35MM 3:00 PM 8:30 PM RAZZIA BLACK GRAVEL 6:00 PM FINGER MAN 8:30 PM ANY NUMBER CAN WIN 35MM SUNDAY, FEBRUARY 16 12:30 PM A COLT IS MY PASSPORT 3:00 PM BRANDED TO KILL 6:00 PM PALE FLOWER 35MM 8:30 PM RUSTY KNIFE MONDAY, FEBRUARY 17 The Film Noir Foundation is a 12:30 PM non-profi t public benefi t THE FACTS OF MURDER corporation created by Eddie 3:15 PM Muller in 2005 as an educational A WOMAN’S FACE resource regarding the cultural, 6:00 PM NEVER LET GO 35MM historical, and artistic signifi cance 8:30 PM of fi lm noir as an original VICTIM 35MM cinematic movement. The Czar of Noir Even if you haven’t experienced NOIR CITY before, you may recognize Eddie Muller from the dark corridors of TCM’s Noir Alley. -

Gérard Philipe, “Le” Jeune Premier De L’Après-Seconde Guerre Mondiale (1946-1958) Camille Beaujeault
Histoire culturelle d’une star de cinéma en France : Gérard Philipe, “le” jeune premier de l’après-Seconde Guerre mondiale (1946-1958) Camille Beaujeault To cite this version: Camille Beaujeault. Histoire culturelle d’une star de cinéma en France : Gérard Philipe, “le” jeune premier de l’après-Seconde Guerre mondiale (1946-1958). Histoire. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2018. Français. NNT : 2018PA01H048. tel-02117816v2 HAL Id: tel-02117816 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02117816v2 Submitted on 6 May 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE U.F.R. d’Histoire de l’art, École doctorale d’Histoire de l’art (ED 441) Thèse de doctorat en histoire du cinéma Présentée et soutenue publiquement le 26 octobre 2018 Histoire culturelle d’une star de cinéma en France Gérard Philipe, « le » jeune premier dans l’après-Seconde Guerre mondiale (1946-1958) VOLUME 1 Camille BEAUJEAULT Sous les directions de Sylvie LINDEPERG, Dimitri VEZYROGLOU et Geneviève SELLIER JURY M. Christophe GAUTHIER, Directeur d’études, École Nationale de Chartres Mme Myriam JUAN, Maîtresse de conférences, Université de Caen Mme Sylvie LINDEPERG, Professeure, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Mme Geneviève SELLIER, Professeure émérite, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 M. -

Tricks of the Light
Tricks of the Light: A Study of the Cinematographic Style of the Émigré Cinematographer Eugen Schüfftan Submitted by Tomas Rhys Williams to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Film In October 2011 This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. Signature: ………………………………………………………….. 1 Abstract The aim of this thesis is to explore the overlooked technical role of cinematography, by discussing its artistic effects. I intend to examine the career of a single cinematographer, in order to demonstrate whether a dinstinctive cinematographic style may be defined. The task of this thesis is therefore to define that cinematographer’s style and trace its development across the course of a career. The subject that I shall employ in order to achieve this is the émigré cinematographer Eugen Schüfftan, who is perhaps most famous for his invention ‘The Schüfftan Process’ in the 1920s, but who subsequently had a 40 year career acting as a cinematographer. During this time Schüfftan worked throughout Europe and America, shooting films that included Menschen am Sonntag (Robert Siodmak et al, 1929), Le Quai des brumes (Marcel Carné, 1938), Hitler’s Madman (Douglas Sirk, 1942), Les Yeux sans visage (Georges Franju, 1959) and The Hustler (Robert Rossen, 1961).