A INTRODUCTION Les Formes De Relief Constituent L'assiette De Toute
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plan-Stratégique 2019-2023 De L'ong ABDH
: PLAN STRATEGIQUE 2019-2023 DE L’ASSOCIATION DE BIENFAISANCE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN (ABDH-ONG) B.P : (641) TEL : +229-97 72 94 50 FAX : +229-23611009 E-mail : [email protected] Site Web : www.abdhong.org QUARTIER ZONGO ZENON PARAKOU – REPUBLIQUE DU BENIN Page 1 Table des matières I. MESSAGE DU PRESIDENT ............................................................................................. 3 II. CONTEXTE DU PAYS ..................................................................................................... 4 III. VISION ........................................................................................................................... 5 IV. MISSION ........................................................................................................................ 5 V. VALEURS .......................................................................................................................... 6 VI. ZONE D’INTERVENTION ET ORGANIGRAMME ................................................... 7 VII. ORGANIGRAMME ..................................................................................................... 11 VIII. METHODOLOGIE DE TRAVAIL .............................................................................. 12 IX. ANALYSE SITUATIONNELLE ................................................................................. 12 X. OBJECTIF GENERAL ..................................................................................................... 13 XI. AXES ET OBJECTIFS STRATEGIQUES ................................................................. -

Rapport ADEGNIKA Adunkè Gloria Fildahus.Pdf
REPUBLIQUE DU BENIN ******** MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ******** UNIVERSITE D’ABOMEY CALAVI (UAC) ******** ECOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-CALAVI (EPAC) ******** DEPARTEMENT DE GENIE DE L’ENVIRONNEMENT (GEn) ******** Option : Aménagement et Protection de l’Environnement Rapport de fin de Formation pour l’Obtention du Diplôme de Licence Professionnelle THEME : CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA GESTION DE LA RETENUE D’EAU DE ODO-OTCHERE DANS L’ARRONDISSEMENT DE KERE, COMMUNE DE DASSA-ZOUME (BENIN) Présenté par : Adunkè Gloria Fildahus ADEGNIKA Sous la direction de SUPERVISEUR : MAITRE DE STAGE : Prof. Dr Jacques Boco ADJAKPA Monsieur Moussa OUOROU Maître de Conférences des Universités du CAMES Ingénieur Hydrogéologue/ Chef Service de l’Eau des Collines Enseignant-Chercheur EPAC/UAC Année Académique : 2013 – 2014 Contribution à l’amélioration de la gestion de la retenue d’eau d’ODO-OTCHERE dans l’arrondissement de Kèrè, commune de Dassa-Zoumè (Bénin) DEDICACE A Ma mère Ayaba Catherine SENOU & Mon père Abel Ambaliou ADEGNIKA Rédigé par Adunkè Gloria Fildahus ADEGNIKA Page i Contribution à l’amélioration de la gestion de la retenue d’eau d’ODO-OTCHERE dans l’arrondissement de Kèrè, commune de Dassa-Zoumè (Bénin) REMERCIEMENTS Je remercie l’Eternel Dieu tout puissant pour son amour, sa miséricorde, sa fidélité et sa protection tout au long du stage et de la phase de rédaction et pour les nombreuses grâces qu’il a accomplies dans ma vie. Le présent travail n’aurait pas pu être réalisé sans la contribution de près ou de loin de certaines personnes. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes sincères remerciements : au Professeur. -

Programme D'actions Du Gouvernement 2016-2021
PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT 2016-2021 ÉTAT DE MISE EN œuvre AU 31 MARS 2019 INNOVATION ET SAVOIR : DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE DE L’INNOVATION ET DU SAVOIR, SOURCE D’EMPLOIS ET DE CROISSANCE – © BAI-AVRIL 2019 A PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT 2016-2021 ÉTAT DE MISE EN œuvre AU 31 MARS 2019 2 Sommaire 1. Avant-propos p. 4 2. Le PAG en bref p. 8 3. État d’avancement des réformes p. 14 4. Mise en œuvre des projets p. 26 TOURISME p. 30 AGRICULTURE p. 44 INFRASTRUCTURES p. 58 NUMÉRIQUE p. 74 ÉLECTRICITÉ p. 92 CADRE DE VIE p. 110 EAU POtaBLE p. 134 PROTECTION SOCIALE p. 166 CITÉ INTERNatIONALE DE L’INNOVatION ET DU SaVoir – SÈMÈ CITY p. 170 ÉDUCatION p. 178 SPORT ET CULTURE p. 188 SaNTÉ p. 194 5. Mobilisation des ressources p. 204 6. Annexes p. 206 Annexe 1 : ÉLECTRICITÉ p. 210 Annexe 2 : CADRE DE VIE p. 226 Annexe 3 : EAU POTABLE p. 230 SOMMAIRE – © BAI-AVRIL 2019 3 1 4 RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES MENÉES – © BAI-AVRIL 2019 Avant-propos RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES MENÉES – © BAI-AVRIL 2019 5 Avant-propos Les équipes du Président Patrice TALON poursuivent du PAG. Il convient de souligner que ces fonds ont été résolument la mise en œuvre des projets inscrits dans affectés essentiellement au financement des infrastruc- le Programme d’Actions du Gouvernement PAG 2016– tures nécessaires pour impulser l’investissement privé 2021. Dans le présent document, l’état d’avancement (énergie, routes, internet haut débit, attractions, amé- de chacun des projets phares est fourni dans des fiches nagement des plages,…). -

En Téléchargeant Ce Document, Vous Souscrivez Aux Conditions D’Utilisation Du Fonds Gregory-Piché
En téléchargeant ce document, vous souscrivez aux conditions d’utilisation du Fonds Gregory-Piché. Les fichiers disponibles au Fonds Gregory-Piché ont été numérisés à partir de documents imprimés et de microfiches dont la qualité d’impression et l’état de conservation sont très variables. Les fichiers sont fournis à l’état brut et aucune garantie quant à la validité ou la complétude des informations qu’ils contiennent n’est offerte. En diffusant gratuitement ces documents, dont la grande majorité sont quasi introuvables dans une forme autre que le format numérique suggéré ici, le Fonds Gregory-Piché souhaite rendre service à la communauté des scientifiques intéressés aux questions démographiques des pays de la Francophonie, principalement des pays africains et ce, en évitant, autant que possible, de porter préjudice aux droits patrimoniaux des auteurs. Nous recommandons fortement aux usagers de citer adéquatement les ouvrages diffusés via le fonds documentaire numérique Gregory- Piché, en rendant crédit, en tout premier lieu, aux auteurs des documents. Pour référencer ce document, veuillez simplement utiliser la notice bibliographique standard du document original. Les opinions exprimées par les auteurs n’engagent que ceux-ci et ne représentent pas nécessairement les opinions de l’ODSEF. La liste des pays, ainsi que les intitulés retenus pour chacun d'eux, n'implique l'expression d'aucune opinion de la part de l’ODSEF quant au statut de ces pays et territoires ni quant à leurs frontières. Ce fichier a été produit par l’équipe des projets numériques de la Bibliothèque de l’Université Laval. Le contenu des documents, l’organisation du mode de diffusion et les conditions d’utilisation du Fonds Gregory-Piché peuvent être modifiés sans préavis. -

Cahier Des Villages Et Quartiers De Ville Du Departement Des Collines (Rgph-4, 2013)
REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT &&&&&&&&&& INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& CAHIER DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU DEPARTEMENT DES COLLINES (RGPH-4, 2013) Août 2016 REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& CAHIER DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU DEPARTEMENT DES COLLINES Août 2016 Prescrit par relevé N°09/PR/SGG/REL du 17 mars 2011, la quatrième édition du Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-4) du Bénin s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire national en mai 2013. Plusieurs activités ont concouru à sa réalisation, parmi lesquelles la cartographie censitaire. En effet la cartographie censitaire à l’appui du recensement a consisté à découper tout le territoire national en de petites portions appelées Zones de Dénombrement (ZD). Au cours de la cartographie, des informations ont été collectées sur la disponibilité ou non des infrastructures de santé, d’éducation, d’adduction d’eau etc…dans les villages/quartiers de ville. Le présent document donne des informations détaillées jusqu’au niveau des villages et quartiers de ville, par arrondissements et communes. Il renseigne sur les effectifs de population, le nombre de ménages, la taille moyenne des ménages, la population agricole, les effectifs de population de certains groupes d’âges utiles spécifiques et des informations sur la disponibilité des infrastructures communautaires. Il convient de souligner que le point fait sur les centres de santé et les écoles n’intègre pas les centres de santé privés, et les confessionnels, ainsi que les écoles privées ou de type confessionnel. -

(Cos Lepi) Departement : Collines Commune
CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS LEPI) DEPARTEMENT : COLLINES COMMUNE : BANTE ARRONDISSEMENT : AGOUA FICHE DES DELEGUES D'ARRONDISSEMENT A L'ACTUALISATION (DAA) RETENUS N° NOM ET PRENOMS DATENAIS. VIL./QTIER DIPLOME RENA/LEPI EXPERIEN. TEL OBS. 1 ATCHADE FIRMIN 2 DJAKPA Robert 01/05/1981 N'TCHON MAîTRISE E OUI MIRENA/LEP 97364690/95278925 3 FAMONMI Adélaide 20/12/1988 LICENCE OUI LEPI 97364769/64518747 CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS LEPI) DEPARTEMENT : COLLINES COMMUNE : BANTE ARRONDISSEMENT : AKPASSI FICHE DES DELEGUES D'ARRONDISSEMENT A L'ACTUALISATION (DAA) RETENUS N° NOM ET PRENOMS DATENAIS. VIL./QTIER DIPLOME RENA/LEPI EXPERIEN. TEL OBS. 1 DOSSA FELIX 2 FAGBEMI A. GERAUD 01/01/1988 AKPASSI MAITRISE S NON 95836095 3 SOUROU JEAN OGOUBI 23/10/1983 ILLARE DIPLôME D\ OUI 95269565/96258069 CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS LEPI) DEPARTEMENT : COLLINES COMMUNE : BANTE ARRONDISSEMENT : ATOKOLIBE FICHE DES DELEGUES D'ARRONDISSEMENT A L'ACTUALISATION (DAA) RETENUS N° NOM ET PRENOMS DATENAIS. VIL./QTIER DIPLOME RENA/LEPI EXPERIEN. TEL OBS. 1 AMAGBEGNON Ayéfounin Jean-Baptiste 19/12/1990 ATOKOLIBE LICENCE NON 96847852/64538363 2 DAHATO Codjo Daniel 15/10/1988 AGBON BAC D NON RENA/LEPI 97363765/97482891 3 ODOH Dominique 19/11/1984 ATOKOLIBE MAïTRISE OUI MIRENA 97327021/95270389 CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS LEPI) DEPARTEMENT : COLLINES COMMUNE : BANTE ARRONDISSEMENT : BANTE FICHE DES DELEGUES D'ARRONDISSEMENT A L'ACTUALISATION (DAA) RETENUS N° NOM ET PRENOMS DATENAIS. VIL./QTIER DIPLOME RENA/LEPI EXPERIEN. TEL OBS. 1 ABIDO ABALLO 31/12/1982 ADJANTE MAITRISE NON 95137591 2 LAOUROU SOUROU EVRAD 04/03/1982 BASSON LICENCE SJ OUI 97054163 3 MAMAH BRUNO 17/09/1989 BANTE BAC + 2 OUI 96108304 CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS LEPI) DEPARTEMENT : COLLINES COMMUNE : BANTE ARRONDISSEMENT : BOBE FICHE DES DELEGUES D'ARRONDISSEMENT A L'ACTUALISATION (DAA) RETENUS N° NOM ET PRENOMS DATENAIS. -

Liste Des Elus Communaux Du Bloc Republicain
LISTE DES ELUS COMMUNAUX DU BLOC REPUBLICAIN N° DEPARTEMENTS COMMUNES ARRONSDISSEMENT NOM et PRENOMS 1 BIO Ali FOUNOUGBO 2 SANNI Idrissou 3 BANIKOARA GOMPAROU IBRAHIM Bassirou 4 KOKEY ADAM BAKARI Moussa 5 SOMPEROUKOU SABERI Kome 6 BAGOU SEKO DRAMANE Bachirou 7 TIDJANI MOHAMED Seydou Bary GOGOUNOU 8 GOUNOU Lafia 9 ASSAN Adam GOUNAROU 10 GOGOUNOU DANTOROU Boni 11 YAROU GOUDOU Soumaila SORI 12 ISSIAKA Allassane 13 ALIBORI SOUGOU-KPAN-TROS BIO ZATO Yarou 14 WARA BAGUIRI Thomas 15 KANDI DONWARI SARE Bouraima 16 MEDAWA Oumarou 17 BIRNI LAFIA SOULE Issifou 18 DOUASSOU Ousseni 19 BOGO-BOGO HIMA Zibo 20 MAMAN BELLO Moussa KARIMAMA 21 MOUSSA Alassane KARIMAMA 22 BONKANON Amadou KOMPA ALIBORI LISTE DES ELUS COMMUNAUX DU BLOC REPUBLICAIN KARIMAMA N° DEPARTEMENTS COMMUNES ARRONSDISSEMENT NOM et PRENOMS KOMPA 23 SIBO Amadou 24 GUIWA IBRAHIM Abdoulaye MONSEY 25 BASSAROU Adamou 26 GADO Guidami GAROU 27 IBRAHIM NOUFOU Mazou 28 SALIFOU Youssoufa GUENE 29 BAKOUA ISSA Bassalou 30 DANDAKO Inoussa MEDECALI 31 DOBI MASSOU Danlanso 32 MALANVILLE GOUMIAN Mohamadou Awal 33 BIO Halirou MALANVILLE 34 YACOUBOU Zakari 35 MOUSSA Nouhoum 36 TOUMBOUTOU ALIDOU Salam 37 LIBOUSSOU BANI SAMARI Saidou 38 SEGBANA KAOULA Atikou SEGBANA 39 OROU BATA Ibrahim 40 BOUKOUMBE YANDOTA N'koupin Clément 41 NAMBIME Yate Richard DIPOLI 42 DOUTE N'tcha Jean BOUKOUMBE 43 MANTA N'kouami Benoit 44 NATA M'PO Natta Mathias 45 TABOTA NAMBI Ludovic ATACORA LISTE DES ELUS COMMUNAUX DU BLOC REPUBLICAIN N° DEPARTEMENTS COMMUNES ARRONSDISSEMENT NOM et PRENOMS 46 YOKOUA NAMBIMA Laurent 47 KAUCLEY Yves COBLY 48 M'BOMA YAOUMBE Roger 49 SANBIENOU yahable Dominique COBLY 50 DATORI SANHONGOU Nieme Evariste 51 KOUTORI MOUTOUAMA M. -

Villages Arrondissement D~GARADEBOU: 14 Villages 1
REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 2013-05 DU 27 MAI2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 15 février 2013. Suite la Décision de conformité à la Constitution DCC 13-051 du 16 mai 2013, Le Président de la République Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, la commune est démembrée en unités administratives locales sans personnalité juridique ni autonomie financière. Ces unités administratives locales qui prennent les dénominations d'arrondissement, de village ou de quartier de ville sont dotées d'organes infra communaux fixés par la présente loi. Article 2 : En application des dispositions des articles 40 et 46 de la loi citée à l'article 1er, la présente loi a pour objet : 1- de déterminer les conditions dans lesquelles les unités administratives locales mentionnées à l'article 1er sont créées; 2- de fixer la formation, le fonctionnement, les compétences du conseil d'arrondissement et du conseil de village ou quartier de ville d'une part et le statut et les attributions du chef d'arrondissement, du chef de village ou quartier de ville d'autre part. Article 3: Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, la commune est divisée en arrondissements. -

LISTE N°2 DES FORMATEURS 28-03-2019.Xlsx
LISTE N°2 DES FORMATEURS DEPARTEMENTAUX DES AGENTS ELECTORAUX N° DEPARTEMENT COMMUNE ARRONDISSEMENT NOMS & PRENOMS KPINKPONSOUHOU 1 ALIBORI BANIKOARA FOUNOUGO NOUGBOGNON BARTHÉLÉMY 2 ALIBORI BANIKOARA GOMPAROU IGARI Mathieu 3 ALIBORI BANIKOARA GOUMORI IBRAHIM MERE Moumouni 4 ALIBORI BANIKOARA KOKEY HOUNZA VIVIANE AYABA 5 ALIBORI BANIKOARA OUNET BIO BAGOU Saliou 6 ALIBORI BANIKOARA SOMPEROUKOU GOUNOU TAMOU Daouda 7 ALIBORI BANIKOARA SOROKO IDOHOU Blaise VITCHOEKE SEMAKO 8 ALIBORI BANIKOARA TOURA PATRICE 9 ALIBORI GOGOUNOU BAGOU DJARA GOUMIDRO Orou Aziz 10 ALIBORI GOGOUNOU GOGOUNOU AZONHIN ENAGAN 11 ALIBORI GOGOUNOU GOUNAROU BIO YO Moussa 12 ALIBORI GOGOUNOU SORI MORA KPAÏ Abdoulaye Page 1 de 37 SOUGOU-KPAN- 13 ALIBORI GOGOUNOU ADEBARY Fabrice Emaus TROSSI 14 ALIBORI KANDI ANGARADEBOU LOUGOUDOU Charles 15 ALIBORI KANDI BENSEKOU BADA Safiatou 16 ALIBORI KANDI DONWARI HOWANOU AIME AYONOU Tchémagnihodé 17 ALIBORI KANDI KANDI 1 Germain ODOUBOUROU KOLAWOLE 18 ALIBORI KANDI KANDI 3 AIME 19 ALIBORI KANDI SAAH ALBORA MAHMED BIO OSSENI 20 ALIBORI KANDI SAM BONI MOUSSA Madougou 21 ALIBORI KANDI SONSORO BOUKARI Ibrahim 22 ALIBORI KARIMAMA BIRNI LAFIA MAHAMBI YACOUBOU Moussa 23 ALIBORI KARIMAMA BOGO-BOGO MEYAKI Libaba 24 ALIBORI KARIMAMA KARIMAMA SONSARE MOUHAMADOU 25 ALIBORI KARIMAMA KOMPA ANAGONOU Désiré 26 ALIBORI MALANVILLE GAROU BAGNAN KOSSOUKPE Yessouf Page 2 de 37 27 ALIBORI MALANVILLE GUENE BAGNAN Yacoubou 28 ALIBORI MALANVILLE MADECALI DOHOU Eugène 29 ALIBORI MALANVILLE MALANVILLE LASSISSI SALAOU AYOUBA 30 ALIBORI SEGBANA LIBANTE SAMARI Lucins -
Apoderamento Da Comunidade, Saneamento Básico, Uso Da Água E Doenças De Veiculação Hídrica Em Benim, África
APODERAMENTO DA COMUNIDADE, SANEAMENTO BÁSICO, USO DA ÁGUA E DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA EM BENIM, ÁFRICA. Komlan Yves Assogba Presidente Prudente/SP: Maio de 2019 1 Komlan Yves Assogba APODERAMENTO DA COMUNIDADE, SANEAMENTO BÁSICO, USO DA ÁGUA E DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA EM BENIM, ÁFRICA. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp com parte dos requisitos para obtenção do Grau de Mestre em Geografia. Orientador: Dr. Raul Borges Guimarães Presidente Prudente/SP: Maio de 2020 2 3 4 5 A meu pai Detondji Assogba, minha mãe Félicité Ogousedji e minha filha Olivia Alessio Assogba 6 AGRADECIMENTO A redação desta dissertação foi feita com a valiosa colaboração de pessoas de quem estamos particularmente orgulhosos. Como diz o ditado: "as palavras voam, apenas os escritos permanecem ..." Estou, portanto, muito felizes por termos a oportunidade de testemunhar a cada uma dessas pessoas únicas, e isso permanentemente, minha gratidão por todo o seu apoio. É neste espírito que essas últimas linhas nos dão a oportunidade de cumprir um dever: dar a cada uma dessas pessoas a parte que lhes pertence neste trabalho que, certamente, não teria sido possível sem elas. Mas se é mais sensato nomear cada um deles, o grande número de contribuintes seria bastante dissuasivo. Portanto, eu gostaria de expressar do fundo do meu coração a minha gratidão e agradecimento a todas essas pessoas por suas valiosas contribuições, e pedir desculpas para todos aqueles cujos nomes não aparecem nestas linhas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o meu orientador de pesquisa, o professor titular Dr. -
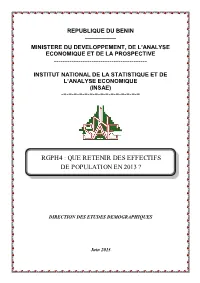
Resultats Definitifs RGPH4.Pdf
REPUBLIQUE DU BENIN _____________ MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L’ANALYSE ECONOMIQUE ET DE LA PROSPECTIVE ------------------------------------------ INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= RGPH4 : QUE RETENIR DES EFFECTIFS DE POPULATION EN 2013 ? DIRECTION DES ETUDES DEMOGRAPHIQUES Juin 2015 La nécessité de disposer de données pertinentes, fiables, diversifiées et désagrégées jusqu’au niveau géographique le plus fin et à jour, est unanimement reconnue par la communauté internationale. Appréciant ce besoin d’information, de nombreuses opérations statistiques se réalisent dans le but de disposer de données fiables facilitant une prise de décision éclairée, tant au niveau des décideurs politiques, qu’au niveau de la communauté scientifique et économique. Au titre de ces opérations, le Recensement Général de la Population et de l’Habitation est la source qui permet de disposer de façon exhaustive des données jusqu’aux plus petites unités administratives. Les travaux de dénombrement du RGPH4 au Bénin se sont déroulés du 11 au 31 Mai 2013 sur toute l’étendue du territoire national. Cette grosse opération a mobilisé près de 17.500 agents de terrain : agents recenseurs, chefs d’équipes, contrôleurs et superviseurs. En dehors des ressources du Budget National, elle a bénéficié de l’appui des partenaires au développement du Bénin, notamment la Coopération Suisse, la Banque Mondiale, l’UNICEF et l’UNFPA. A la suite de la collecte, les travaux de traitement ont démarré avec l’archivage des questionnaires, la vérification, la codification, la saisie et l’apurement des données. Après plusieurs étapes de validation par le Conseil Scientifique de l’INSAE, le Conseil des Ministres en sa séance du jeudi 21 mai 2015 a adopté les résultats définitifs du RGPH4. -

Portant Création, Organisation, Attributions Et Fonctionnement Des Unités Administratives Locales En République Du Bénin. L'
/' REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 2013-05 DU 27 MAI 2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 15 février 2013. Suite la Décision de conformité à la Constitution DCC 13-051 du 16 mai 2013, Le Président de la République Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, la commune est démembrée en unités administratives locales sans personnalité juridique ni autonomie financière. Ces unités administratives locales qui prennent les dénominations d'arrondissement, de village ou de quartier de ville sont dotées d'organes infra communaux fixés par la présente loi. Article 2: En application des dispositions des articles 40 et 46 de la loi citée à l'article 1er, la présente loi a pour objet: 1- de déterminer les conditions dans lesquelles les unités administratives locales mentionnées à l'article 1er sont créées; 2- de fixer la formation, le fonctionnement, les compétences du conseil d'arrondissement et du conseil de village ou quartier de ville d'une part et le statut et les attributions du chef d'arrondissement, du chef de village ou quartier de ville d'autre part. Article 3: Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi nO 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, la commune est divisée en arrondissements.