Un Demi-Siecle D'aeronautique En
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MS – 204 Charles Lewis Aviation Collection
MS – 204 Charles Lewis Aviation Collection Wright State University Special Collections and Archives Container Listing Sub-collection A: Airplanes Series 1: Evolution of the Airplane Box File Description 1 1 Evolution of Aeroplane I 2 Evolution of Aeroplane II 3 Evolution of Aeroplane III 4 Evolution of Aeroplane IV 5 Evolution of Aeroplane V 6 Evolution of Aeroplane VI 7 Evolution of Aeroplane VII 8 Missing Series 2: Pre-1914 Airplanes Sub-series 1: Drawings 9 Aeroplanes 10 The Aerial Postman – Auckland, New Zealand 11 Aeroplane and Storm 12 Airliner of the Future Sub-series 2: Planes and Pilots 13 Wright Aeroplane at LeMans 14 Wright Aeroplane at Rheims 15 Wilbur Wright at the Controls 16 Wright Aeroplane in Flight 17 Missing 18 Farman Airplane 19 Farman Airplane 20 Antoinette Aeroplane 21 Bleriot and His Monoplane 22 Bleriot Crossing the Channel 23 Bleriot Airplane 24 Cody, Deperdussin, and Hanriot Planes 25 Valentine’s Aeroplane 26 Missing 27 Valentine and His Aeroplane 28 Valentine and His Aeroplane 29 Caudron Biplane 30 BE Biplane 31 Latham Monoplane at Sangette Series 3: World War I Sub-series 1: Aerial Combat (Drawings) Box File Description 1 31a Moraine-Saulnier 31b 94th Aero Squadron – Nieuport 28 – 2nd Lt. Alan F. Winslow 31c Fraser Pigeon 31d Nieuports – Various Models – Probably at Issoudoun, France – Training 31e 94th Aero Squadron – Nieuport – Lt. Douglas Campbell 31f Nieuport 27 - Servicing 31g Nieuport 17 After Hit by Anti-Aircraft 31h 95th Aero Squadron – Nieuport 28 – Raoul Lufbery 32 Duel in the Air 33 Allied Aircraft -
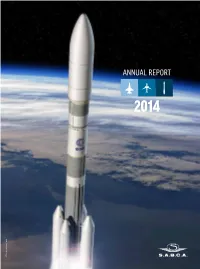
SABCA 1 Automated Warehouse A350 - Flap Support
S.A.B.C.A. ANNUAL REPORT 2014 © ESA–D.© ESA–D. Ducros, Ducros, 2014 2014 ANNUAL REPORT ANNUAL 2014 Gulfstream G650 Horizontal Stabilizer Skin (CFRP) – Assembly 2014 Annual Report of the Board of Directors Annual General Meeting, 28 May 2015 MANAGEMENT REPORT Group profile ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 Statutory bodies ............................................................................................................................................................................................................................................................... 4 Message of the Chairman and the Chief Executive Officer ........................................................................................................................... 6 Principal activities in 2014 .............................................................................................................................................................................................................................. 9 Business Environment and Outlook .................................................................................................................................................................................................. 21 Research and Development .......................................................................................................................................................................................................................... -

Home at Airbus
Journal of Aircraft and Spacecraft Technology Original Research Paper Home at Airbus 1Relly Victoria Virgil Petrescu, 2Raffaella Aversa, 3Bilal Akash, 4Juan M. Corchado, 2Antonio Apicella and 1Florian Ion Tiberiu Petrescu 1ARoTMM-IFToMM, Bucharest Polytechnic University, Bucharest, (CE), Romania 2Advanced Material Lab, Department of Architecture and Industrial Design, Second University of Naples, 81031 Aversa (CE), Italy 3Dean of School of Graduate Studies and Research, American University of Ras Al Khaimah, UAE 4University of Salamanca, Spain Article history Abstract: Airbus Commerci al aircraft, known as Airbus, is a European Received: 16-04-2017 aeronautics manufacturer with headquarters in Blagnac, in the suburbs of Revised: 18-04-2017 Toulouse, France. The company, which is 100% -owned by the industrial Accepted: 04-07-2017 group of the same name, manufactures more than half of the airliners produced in the world and is Boeing's main competitor. Airbus was Corresponding Author: founded as a consortium by European manufacturers in the late 1960s. Florian Ion Tiberiu Petrescu Airbus Industry became a SAS (simplified joint-stock company) in 2001, a ARoTMM-IFToMM, Bucharest subsidiary of EADS renamed Airbus Group in 2014 and Airbus in 2017. Polytechnic University, Bucharest, (CE) Romania BAE Systems 20% of Airbus between 2001 and 2006. In 2010, 62,751 Email: [email protected] people are employed at 18 Airbus sites in France, Germany, the United Kingdom, Belgium (SABCA) and Spain. Even if parts of Airbus aircraft are essentially made in Europe some come from all over the world. But the final assembly lines are in Toulouse (France), Hamburg (Germany), Seville (Spain), Tianjin (China) and Mobile (United States). -

The Coastwatcher
13 JUN-CTWG Op Eval TRANEX TBA-JUL CTWG Encampment 21-23 AUG-CTWG/USAF Evaluation Missions for 15-23 AUG-NER Glider Academy@KSVF America 26-29 AUG-CAP National Conference Semper vigilans! 12 SEP-Cadet Ball-USCGA Semper volans! CADET MEETING REPORT The Coastwatcher 24 February, 2015 Publication of the Thames River Composite Squadron Connecticut Wing Maj Roy Bourque outlined the Squadron Civil Air Patrol Rocketry Program and set deadlines for Cadet submission of plans. 300 Tower Rd., Groton, CT http://ct075.org . The danger of carbon monoxide poisoning was the subject of the safety meeting. C/2dLt Jessica LtCol Stephen Rocketto, Editor Carter discussed the prevention and detection of [email protected] this hazardous gas and opened up the forum to comments and questions from the Cadets. C/CMSgt Virginia Poe, Scribe C/SMSgt Michael Hollingsworth, Printer's Devil C/CMSgt Virginia Poe delivered her Armstrong Lt David Meers & Maj Roy Bourque, Papparazis Lecture on the “The Daily Benefits of the Hap Rocketto, Governor-ASOQB, Feature Editor Aerospace Program.” Vol. IX 9.08 25 February, 2015 Maj Brendan Schultz delivered his Eaker Lecture explaining the value of leadership skills learned in SCHEDULE OF COMING EVENT the Cadet Program and encouraged Cadets to apply their learning to the world outside of CAP. 03 MAR-TRCS Staff Meeting 10 MAR-TRCS Meeting C/SrA Thomas Turner outlined the history of 17 MAR-TRCS Meeting rocket propulsion from Hero's Aeopile to the 21 MAR-CTWG WWII Gold Medal Ceremony landing on the moon. He then explained each of 24 MAR-TRCS Meeting Newton's Three Laws of Dynamics and showed 31 MAR-TRCS Meeting their applications to rocketry. -

3-VIEWS - TABLE of CONTENTS to Search: Hold "Ctrl" Key Then Press "F" Key
3-VIEWS - TABLE of CONTENTS To search: Hold "Ctrl" key then press "F" key. Enter manufacturer or model number in search box. Click your back key to return to the search page. It is highly recommended to read Order Instructions and Information pages prior to selection. Aircraft MFGs beginning with letter A ................................................................. 3 B ................................................................. 6 C.................................................................10 D.................................................................14 E ................................................................. 17 F ................................................................. 18 G ................................................................21 H................................................................. 23 I .................................................................. 26 J ................................................................. 26 K ................................................................. 27 L ................................................................. 28 M ................................................................30 N................................................................. 35 O ................................................................37 P ................................................................. 38 Q ................................................................40 R................................................................ -

79952 Federal Register / Vol
79952 Federal Register / Vol. 75, No. 244 / Tuesday, December 21, 2010 / Rules and Regulations Unsafe Condition DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 1601 Lind Avenue, SW., Renton, (d) This AD was prompted by an accident Washington 98057–3356; telephone and the subsequent discovery of cracks in the Federal Aviation Administration (425) 227–1137; fax (425) 227–1149. main rotor blade (blade) spars. We are issuing SUPPLEMENTARY INFORMATION: 14 CFR Part 39 this AD to prevent blade failure and Discussion subsequent loss of control of the helicopter. [Docket No. FAA–2009–0864; Directorate We issued a supplemental notice of Compliance Identifier 2008–NM–202–AD; Amendment 39–16544; AD 2010–26–05] proposed rulemaking (NPRM) to amend (e) Before further flight, unless already 14 CFR part 39 to include an AD that done: RIN 2120–AA64 would apply to the specified products. (1) Revise the Limitations section of the That supplemental NPRM was Airworthiness Directives; DASSAULT Instructions for Continued Airworthiness by published in the Federal Register on AVIATION Model Falcon 10 Airplanes; establishing a life limit of 8,000 hours time- July 27, 2010 (75 FR 43878). That Model FAN JET FALCON, FAN JET in-service (TIS) for each blade set Remove supplemental NPRM proposed to FALCON SERIES C, D, E, F, and G each blade set with 8,000 or more hours TIS. correct an unsafe condition for the Airplanes; Model MYSTERE-FALCON (2) Replace each specified serial-numbered specified products. The MCAI states: 200 Airplanes; Model MYSTERE- blade set with an airworthy blade set in During maintenance on one aircraft, it was accordance with the following table: FALCON 20–C5, 20–D5, 20–E5, and 20– F5 Airplanes; Model FALCON 2000 and discovered that the overpressure capsules were broken on both pressurization valves. -

DASSAULT AVIATION Model Falcon 10 Airplanes
43878 Federal Register / Vol. 75, No. 143 / Tuesday, July 27, 2010 / Proposed Rules Applicability New Requirements of This AD: Actions Bulletin SBF100–27–092, dated April 27, (c) This AD applies to Fokker Services B.V. (h) Within 30 months after the effective 2009; and Goodrich Service Bulletin 23100– Model F.28 Mark 0100 airplanes, certificated date of this AD, do the actions specified in 27–29, dated November 14, 2008; for related in any category, all serial numbers. paragraphs (h)(1) and (h)(2) of this AD information. concurrently. Accomplishing the actions of Issued in Renton, Washington, on July 21, Subject both paragraphs (h)(1) and (h)(2) of this AD 2010. (d) Air Transport Association (ATA) of terminates the actions required by paragraph Jeffrey E. Duven, America Code 27: Flight Controls. (g) of this AD. (1) Remove the tie-wrap, P/N MS3367–2– Acting Manager, Transport Airplane Reason 9, from the lower bolts of the horizontal Directorate, Aircraft Certification Service. (e) The mandatory continuing stabilizer control unit, in accordance with the [FR Doc. 2010–18399 Filed 7–26–10; 8:45 am] airworthiness information (MCAI) states: Accomplishment Instructions of Fokker BILLING CODE 4910–13–P Two reports have been received where, Service Bulletin SBF100–27–092, dated April during inspection of the vertical stabilizer of 27, 2009. F28 Mark 0100 aeroplanes, one of the bolts (2) Remove the lower bolts, P/N 23233–1, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION that connect the horizontal stabilizer control of the horizontal stabilizer control unit and unit actuator with the dog-links was found install bolts, P/N 23233–3, in accordance Federal Aviation Administration broken (one on the nut side & one on the with the Accomplishment Instructions of Goodrich Service Bulletin 23100–27–29, head side). -

1914/1918 : Nos Anciens Et Le Développement De L' Aviation
1914/1918 : Nos Anciens et le Développement de l’aviation militaire René Couillandre, Jean-Louis Eytier, Philippe Jung 06 novembre 2018 - 18h00 Talence 1914/1918 : Nos Anciens et le développement de l’ aviation militaire Chers Alumnis, chers Amis, Merci d’être venus nombreux participer au devoir de mémoire que toute Amicale doit à ses diplômés. Comme toute la société française en 1914, les GADZARTS, à l’histoire déjà prestigieuse, et SUPAERO, née en 1909, ont été frappés par le 1er conflit mondial. Les jeunes diplômés, comme bien d’autres ont été mobilisés pour répondre aux exigences nationales. Le conflit que tous croyaient de courte durée s’est révélé dévoreur d’hommes : toute intelligence, toute énergie, toute compétence fut mise au service de la guerre. L’aviation naissante, forte de ses avancées spectaculaires s’est d’abord révélé un service utile aux armes. Elle a rapidement évolué au point de devenir indispensable sur le champ de bataille et bien au-delà, puis de s’imposer comme une composante essentielle du conflit. Aujourd’hui, au centenaire de ce meurtrier conflit, nous souhaitons rendre hommage à nos Anciens qui, avec tant d’autres, de façon anonyme ou avec éclat ont permis l’évolution exceptionnelle de l’aviation militaire. Rendre hommage à chacun est impossible ; les célébrer collectivement, reconnaître leurs sacrifices et leurs mérites c’est nourrir les racines de notre aéronautique moderne. Nous vous proposons pour cela, après un rappel sur l’ aviation en 1913, d’effectuer un premier parcours sur le destin tragique de quelques camarades morts au champ d’honneur ou en service aérien en les resituant dans leur environnement aéronautique ; puis lors d’un second parcours, de considérer la présence et l’apport d’autres diplômés à l’évolution scientifique, technique, industrielle ou opérationnelle de l’ aviation au cours de ces 4 années. -

Avions Civils
SOMMAIRE DU VOLUME I LA CONDUITE DES PROGRAMMES CIVILS AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS........................................................................... 3 PREFACE.............................................................................................................................. 5 PRESENTATION GENERALE ............................................................................................. 9 CHAPITRE 1 PRESENTATION DE L’ACTIVITE...................................................................................... 11 LE MARCHE DU TRANSPORT AERIEN .................................................................................. 11 Le passager et l’évolution du trafic.......................................................................................... 11 Les compagnies et la flotte d’avions ....................................................................................... 13 LA CONSTRUCTION DES AVIONS CIVILS .............................................................................. 14 Les caractéristiques de l’activité.............................................................................................. 14 La compétition et son évolution............................................................................................... 18 La dimension économique et monétaire ................................................................................. 20 L’ ADMINISTRATION ET SES MISSIONS ................................................................................. 22 La tutelle militaire de -

Los Motores Aeroespaciales, A-Z
Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA ISBN 978-84-608-7523-9 < aeroteca.com > Depósito Legal B 9066-2016 Título: Los Motores Aeroespaciales A-Z. © Parte/Vers: 1/12 Página: 1 Autor: Ricardo Miguel Vidal Edición 2018-V12 = Rev. 01 Los Motores Aeroespaciales, A-Z (The Aerospace En- gines, A-Z) Versión 12 2018 por Ricardo Miguel Vidal * * * -MOTOR: Máquina que transforma en movimiento la energía que recibe. (sea química, eléctrica, vapor...) Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA ISBN 978-84-608-7523-9 Este facsímil es < aeroteca.com > Depósito Legal B 9066-2016 ORIGINAL si la Título: Los Motores Aeroespaciales A-Z. © página anterior tiene Parte/Vers: 1/12 Página: 2 el sello con tinta Autor: Ricardo Miguel Vidal VERDE Edición: 2018-V12 = Rev. 01 Presentación de la edición 2018-V12 (Incluye todas las anteriores versiones y sus Apéndices) La edición 2003 era una publicación en partes que se archiva en Binders por el propio lector (2,3,4 anillas, etc), anchos o estrechos y del color que desease durante el acopio parcial de la edición. Se entregaba por grupos de hojas impresas a una cara (edición 2003), a incluir en los Binders (archivadores). Cada hoja era sustituíble en el futuro si aparecía una nueva misma hoja ampliada o corregida. Este sistema de anillas admitia nuevas páginas con información adicional. Una hoja con adhesivos para portada y lomo identifi caba cada volumen provisional. Las tapas defi nitivas fueron metálicas, y se entregaraban con el 4 º volumen. O con la publicación completa desde el año 2005 en adelante. -Las Publicaciones -parcial y completa- están protegidas legalmente y mediante un sello de tinta especial color VERDE se identifi can los originales. -
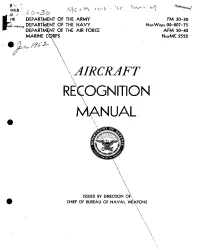
\Aircraft Recognition Manual
Jf V t 9fn I 4-'!- Vw'^ ' 'o | ^ renai; 408.$ /•> ,A1.AI / -3o FM DEPARTMENT OF THE ARMY FM 30-30 DEPARTMENT OF THE NAVY NavWeps 00-80T-75 DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AFM 50-40 MARINE CORPS NavMC 2522 \AIRCRAFT RECOGNITION MANUAL SI ISSUED BY DIRECTION OF\ CHIEF OF BUREAU OF NAVAL WEAPONS \ \ I 4 DEPARTMENT OF THE ARMY FM 30-30 DEPARTMENT OF THE NAVY NavWeps 00-80T-75 DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AFM 50-40 MARINE CORPS NavMC 2522 AIRCRAFT RECOGNITION MANUAL •a ISSUED BY DIRECTION OF CHIEF OF BUREAU OF NAVAL WEAPONS JUNE 1962 DEPARTMENTS OF THE ARMY, THE NAVY AND THE AIR FORCE, WASHINGTON 25, D.C., 15 June 1962 FM 30-30/NAVWEPS 00-80T-75/AFM 50-40/NAVMC 2522, Aircraft Recognition Manual, is published for the information and guidance of all concerned. i BY ORDER OF THE SECRETARIES OF THE ARMY, THE NAVY, AND THE AIR FORCE: G. H. DECKER, General, Umted States Army, Official: Chief of Staff. J. C. LAMBERT, Major General, United States Army, The Adjutant General. PAUL D. STROOP Rear Admiral, United States Navy, Chief, Bureau of Naval Weapons. CURTIS E. LEMAY, Official: Chief of Staff, United States Air Force, R. J. PUGH, Colonel, United States Air Force, Director of Administrative Services. C. H. HAYES, Major General, U.S. Marine Corps, Deputy Chief of Staff (Plans). H DISTRIBUTION: ARMY: Active Army : DCSPER (1) Inf/Mech Div Co/Btry/Trp 7-2 44-112 ACSI (1) (5) except Arm/Abn Div 7- 44-236 52 DCSLOG (2) Co/Trp (1) 8- 44-237 137 DCSOPS(5) MDW (1) 8-500 (AA- 44-446 ACSRC (1) Svc Colleges (3) AH) 44447 CNGB (1) Br Svc Sch (5) except 10-201 44^536 -

L'arsenal De L'aéronautique
L’impressionnant bimoteur prototype VG 10-02 en cours de montage durant l’hiver 1944-1945. L’Arsenal de l’aéronautique Ce devait être une société laboratoire, un modèle. Ce ne fut qu’un constructeur de plus, mais ses ingénieurs avec l’assistance des Centre d’essais mirent au point toutes les techniques modernes. 1 Capable d’enterrer les meilleures idées et les projets les plus utiles, le corbillard de la mort est un vé- hicule commandé par trois forts leviers : la bêtise, la mollesse et la fainéantise. On repère le premier à son inscription : « je ne sais pas », le second porte la mention : « je ne veux pas », le troisième : « ce n’est pas à moi de la faire ». Gérard Hartmann, 33 ans d’expérience professionnelle. 2 Une société modèle Dans les années trente, les députés (qui votent les budgets) et les dirigeants militaires français réalisent que par suite de manque de concentration et de partage des compétences, l’industrie aéronautique nationale a pris du re- tard par rapport aux grandes nations étrangè- res, Allemagne, Italie, Russie, Etats-Unis, Grande-Bretagne. C’est pourquoi ils décident de doter la France des structures adéquates. Avant même l’arrivée au pouvoir du Front po- pulaire, le rapporteur du budget de l’Air, le député socialiste Pierre Renaudel (1871-1935) défend l’idée d’une « société d’étude et de construction aéronautique modèle » (d’Etat). Ce sera L’Arsenal de l’aéronautique. La Grande soufflerie de Chalais-Meudon, inaugurée en 1934. Le Centre d’Essais des Moteurs et des Hélices de l’aviation militaire française passe sous le contrôle du ministère de l’Air.