Che-Guevara-Jean-Cormier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

New York Transit Workers Vote to Authorize Strike
ICELAND KR200 · NEW ZEALAND $3.00 · SWEDEN KR15 · UK £1.00 · U.S. $1.50 I.ESSDNS FROM REVDUJTIDNARY HISTORY 'Marianas in Combat': women and the Cuban Revolution THE -PAGES6-7 A SOCIALIST NEWSWEEKLY PUBLISHED IN THE INTERESTS OF WORKING PEOPLE VOL. 66/NO. 48 DECEMBER 23, 2002 New York transit workers Washington releases vote to authorize strike plans for BY STU SINGER • • AND OLGA RODRIGUEZ NEW YORK-More than 10,000 work reservtsts tn ers on the New York City bus and subway system, members of the Transport Workers Union (TWU), met here in two separate shift waronlraq meetings and voted overwhelmingly to au- BY BRIAN WILLIAMS Putting in place the front-line and backup forces for an invasion of Iraq, Washington Support transit has released plans for an increased mobili zation ofNational Guard and Reserve troops. workers' fight Up to 10,000 such forces will be imme diately activated for "security duty" in the SEEPAGE 15 1'0!>('['"1"·. ~ United States and abroad. With an order to . L·\\1\IS invade, that number would increase to more thorize a strike after their contract expires than a quarter of a million troops stationed December 15. at airports, train stations, power plants, fac The December 7 meeting was marked by tories, and military bases. the determination of the transit workers to The number is in addition to the more than defend their working conditions, benefits, ealth Benef1t~ 2\P CLASS 50,000 reservists already mobilized through and wages in face of the offensive by the out the United States. The plans include wealthy rulers against the working people coastline patrols by Navy and Coast Guard Continued on Page 5 Participants in October------· 30 transit workers' rally state their demands in contract fight Reserve forces. -
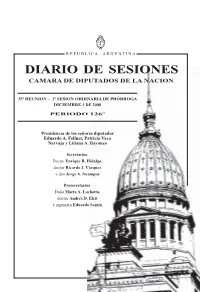
D I a R I O D E S E S I O N
R E P U B L I C A A R G E N T I N A D I A R I O D E S E S I O N E S CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 35ª REUNION – 2ª SESION ORDINARIA DE PRÓRROGA DICIEMBRE 3 DE 2008 PERIODO 126º Presidencia de los señores diputados Eduardo A. Fellner, Patricia Vaca Narvaja y Liliana A. Bayonzo Secretarios: Doctor Enrique R. Hidalgo, doctor Ricardo J. Vázquez y don Jorge A. Ocampos Prosecretarios: Doña Marta A. Luchetta, doctor Andrés D. Eleit e ingeniero Eduardo Santín 2 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Reunión 35ª DIPUTADOS PRESENTES: DELICH, Francisco José LUSQUIÑOS, Luis Bernardo ACOSTA, María Julia DEPETRI, Edgardo Fernando MACALUSE, Eduardo Gabriel ACUÑA, Hugo Rodolfo DI TULLIO, Juliana MARCONATO, Gustavo Ángel AGUAD, Oscar Raúl DÍAZ BANCALARI, José María MARINO, Adriana del Carmen AGUIRRE de SORIA, Hilda Clelia DÍAZ ROIG, Juan Carlos MARTIARENA, Mario Humberto ALBARRACÍN, Jorge Luis DIEZ, María Inés MARTÍN, María Elena ALBRISI, César Alfredo DONDA PÉREZ, Victoria Analía MARTÍNEZ GARBINO, Emilio Raúl ALCUAZ, Horacio Alberto DOVENA, Miguel Dante MARTÍNEZ ODDONE, Heriberto Agustín ALFARO, Germán Enrique ERRO, Norberto Pedro M ASSEI, Oscar Ermelindo ÁLVAREZ, Juan José FABRIS, Luciano Rafael MERCHÁN, Paula Cecilia ALVARO, Héctor Jorge FADEL, Patricia Susana MERLO, Mario Raúl AMENTA, Marcelo Eduardo FEIN, Mónica Haydé MONTERO, Laura Gisela ARBO, José Ameghino FELLNER, Eduardo Alfredo MORÁN, Juan Carlos ARDID, Mario Rolando FERNÁNDEZ BASUALDO, Luis María MORANDINI, Norma Elena ARETA, María Josefa FERNÁNDEZ, Marcelo Omar MORANTE, Antonio Orlando María -

Marx & Philosophy Review of Books » 2015 » Gaido: Che Wants to See You Ciro Roberto Bustos Che Wants to See You: the Untol
Marx & Philosophy Review of Books » 2015 » Gaido: Che Wants to See You Ciro Roberto Bustos Che Wants to See You: The Untold Story of Che in Bolivia Verso, London, 2013. 468pp., £25 hb ISBN 9781781680964 Reviewed by Daniel Gaido Comment on this review About the reviewer Daniel Gaido Daniel Gaido is a researcher at the National Research Council (Conicet), Argentina. He is author of The Formative Period of American Capitalism (Routledge, 2006) and co-editor, with Richard Day, of Witnesses to Permanent Revolution (Brill, 2009), Discovering Imperialism (Brill, 2009) and Responses to Marx's 'Capital' (Brill, forthcoming). More... Review The publication of these memoirs by one of Ernesto “Che” Guevara’s key men in Argentina and Bolivia is a major political and literary achievement. Politically, not because it shows the superiority of Che’s rural armed foco strategy and his peasant way to socialism over Marx’s strategy of building a revolutionary working-class political party, but because it provides a truthful account of Che’s guerrillas exploits, and in that sense it is the best homage that could have been paid to his memory. Artistically, because Bustos’ unique experiences are rendered in a lively and captivating style, which makes the reading of these at times brutal and traumatizing reminiscences an enjoyable experience. Ciro Bustos was born in Mendoza, Argentina, in 1932. A painter by profession, he studied at the School of Fine Arts of the National University of Cuyo, Mendoza. Attracted by the Cuban Revolution, in 1961 he travelled to Havana, where he met Che, who included him in the group he chose to carry out his revolutionary project in Argentina – part of Che’s wider “continental plan” to set up a guerrilla base in Northern Argentina and Southern Bolivia and Peru. -

El Período Histórico 1955 / 1976, Su Influencia En La Juventud De
Cuando se planteó la posibilidad de crear una página Web de homenaje a los compañeros Marplatenses desaparecidos del PST y la JSA, se concluyó que todas sus trayectorias era en cierto modo convergentes, a la vez que todos nosotros habíamos sido influenciados por el mismo entorno, que no era otro que aquel en el que vivimos. Pero si hay algo sobre lo que no hubo ninguna duda, fue que el punto de partida de nuestra historia y la de la mayoría de los 30.000 desaparecidos, era el último gobierno de Perón. El objetivo no es otro que sintetizar el período que va de mediados de los 50 hasta el golpe militar de 1976, utilizando como fuente fundamental de información la enciclopedia Wikipedia con sus enlaces. Al final de este resumen también se realiza una pequeña exposición de los acontecimientos acaecidos en la ciudad de Mar del Plata, a partir del asesinato de Silvia Filler, hecho este que propició “El Marplatazo”. Utilizando como fuente el libro de Carlos Bozzi “Luna Roja” se resume la espiral de violencia que se produjo en “La Ciudad Feliz” por el accionar de elementos de extrema derecha y paramilitares cuyo objetivo era anular la influencia, en el movimiento estudiantil y obrero, de las organizaciones de izquierda, contestando a su vez a las acciones, en su mayoría testimoniales, de los grupos guerrilleros, que alcanzaron su punto álgido con el asesinato del abogado Ernesto Piantoni, dirigente de la CNU. Un repaso a esa parte de la “Historia de Argentina”, que está a final del libro. Fuente mayoritaria: Wikipedia. -

Envío Incluido En Exploración
OSVALDO por otras voces BAYER Segunda edición, corregida y ampliada OSVALDO por otras voces BAYER Segunga edición, corregida y ampliada Julio Ferrer (coordinador) Ferrer, Julio Osvaldo Bayer por otras voces / Julio Ferrer; compilado por Julio Ferrer. - 2.º ed. - La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2011. 220 p. ; 21x16 cm. ISBN 978-950-34-0710-3 1. Entrevistas. 2. Osvaldo Bayer. I. Ferrer, Julio, comp. II. Título. CDD 070.4 OSVALDO BAYER por otras voces Segunda edición, corregida y ampliada Julio Ferrer (coordinador) Coordinación Editorial: Anabel Manasanch Corrección: María Eugenia López, María Virginia Fuente, Magdalena Sanguinetti y Marisa Schieda. Diseño y diagramación: Andrea López Osornio Imagen de tapa: REP Editorial de la Universidad de La Plata (Edulp) Calle 47 Nº 380 / La Plata B1900AJP / Buenos Aires, Argentina +54 221 427 3992 / 427 4898 [email protected] www.editorial.unlp.edu.ar Edulp integra la Red de Editoriales Universitarias (REUN) Segunda edición, 2011 ISBN N.º 978-950-34-0710-3 Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723 © 2011 - Edulp Impreso en Argentina A mi querida y bella hija Micaela Agradecimientos Agradezco profundamente a todos los hombres y mujeres de la cultura por su valioso y desinteresado aporte, que ha permitido el nacimiento de este libro. A la gente de la Editorial de la Universidad de La Plata: Julito, Mónica, Sebas- tián, María Inés, Ulises, por los buenos momentos. A su director, Leonardo González, por creer que este libro merecía volver a editarse. A Miguel Rep, por la generosa -

“Cuba's Revolutionary Armed Forces: How Revolutionary Have They
“Cuba’s Revolutionary Armed Forces: How Revolutionary Have They Been? How Revolutionary Are They Now?” Hal Klepak Professor Emeritus of Strategy and Latin American History Royal Military College of Canada “El Caribe en su Inserción Internacional” Conference of the Tulane University Center for Inter-American Policy and Research San José, Costa Rica 3-4 January 2009 Introduction This paper will argue that Cuba’s Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) have been, and to a great degree still are, ‘revolutionary’ in the contexts of what the armed forces of that country were before 1959, of what Latin American armed forces are and do traditionally, of what those forces normally think about themselves, and of those armed forces in regard to Cuba’s role in international affairs since the Revolution. These four elements will provide the threads for the argument to be made. Thus one will first address what these forces were and how they saw themselves in the years of the revolutionary struggle for power, and the structuring of them after 1959. We will then look at how their roles, structures and ways of seeing themselves changed over the years after their taking of Havana and installing the government of Fidel Castro in power. And finally we will assess their revolutionary credentials since the shattering experience of the Special Period and the subsequent major leadership changes the island has known in recent months. El Ejército Rebelde The army of Fidel Castro’s struggle in the mountains of Cuba’s then easternmost Oriente province, the Ejército Rebelde of now epic memory, takes for the date of its founding the day in November 1956 when the tiny force of 82 men on board the small yacht Granma disembarked to begin the long fight to rid the country of the dictatorship of Fulgencio Batista Zaldivar and bring about deep reform of the island’s political, economic and social system. -

1958 04 Entrevista De Jorge Masetti Con El Che En Sierra Maestra
Entrevista de Jorge Masetti con el Che en Sierra Maestra (Abril / mayo 1958) Jorge Ricardo Masetti fue el primer periodista argentino que ascendió a la Sierra Maestra, en Cuba, para lograr entrevistarse con Fidel Castro y el Che Guevara. En los meses de abril y mayo de 1958, Masetti vive toda una odisea humana y profesional para lograr su cometido. Entre los peligros que suponía andar por la Cuba de Batista en busca de los Rebeldes que combatían la tiranía y las dificultades naturales que ofrecían las montaсas cubanas, este periodista argentino tuvo que subir dos veces a encontrarse con los jefes revolucionarios porque la primera transmisión de las entrevistas no había llegado a destino. El contacto directo con los hechos, la cercanía directa con los combatientes revolucionarios y con los campesinos cubanos que sufrían en carne propia la represión batistiana, forjaron en Masetti una visión más subjetiva del proceso de lucha que se estaba llevando a cabo en la Isla. Su primer encuentro con el Che ocurre tras agotadoras jornadas de ascenso, matizadas con lluvias torrenciales, mulas empacadas y espinos por doquier. Al llegar al campamento del comandante guerrillero argentino-cubano, Masetti se entera que Che había salido con un grupo de hombres a intentar emboscar al temible Sánchez Mosquera. Cuando Guevara regresa se encuentra con el periodista argentino que lo estaba esperando. Luego de oír las explicaciones del motivo que traía para hacer las entrevistas, la intención de mostrar al mundo qué se encontraba detrás de la guerra que mantenían, el Che escuchó la primer pregunta de quien años después serнa parte de un proyecto de liberación continental más abarcador y concreto: - ”?Por qué estás aquí? - Estoy aquí, sencillamente, porque considero que la ъnica forma de liberar a Amйrica de dictadores es derribбndolos. -

Urban Guerilla Warfa
Chronology 1964 March 31-April 2 Revolution of March 31; military coup over throws populist regime of Joao Goulart. April 9 Institutional Act I institutes "revolutionary gov ernment." April-July Wholesale purges throughout military, unions, Congress, judiciary, civil service, state and local governments. April 16 General Castelo Branco elected president by Congress. May 9 Carlos Marighella injured in shootout with po lice. July Purges decline as regime consolidates; Carlos Lacerda, one of the initiators of the coup, goes into opposition. J O c t o b e r Leadership of Brazilian Communist Party ar rested; purge reinstituted. W^ N o v e m b e r 2 6 Coias Governor Borges ousted for subversion. N o v e m b e r 2 7 Two hundred jailed in Rio Grande do Sul for allegedly plotting leftist insurrection in conjunc tion with Borges and ex-deputy Leonel Brizola. 1965 March 17 New York Times reports 2,000 people in jail without charges. March 27 Guerrilla raid on barracks in Rio Grande do Sul. May 18 Bomb found in United States Embassy. O c t o b e r 2 7 Institutional Act II; Castelo Branco dissolves political parties, increases executive powers, decrees appointment of judges and indirect election of future presidents. ) I 1966 February 5 Bombing of home of United States consul in Porto Alegre. June 24 U.S.I.S. building in Brasilia bombed. July Bomb at Recife airport kills 3; assassination at tempt on General Costa e Silva; hundreds ar rested. September 15-23 Students demonstrate and clash with police in Rio. -

Cuban Revolutionary Women
Temas de nuestra américa N.° 50 ISSN 0259-2239 Cuban Revolutionary Women Aleia Guitan University of West Indies Trinidad and Tobago ,iVL`\Ê£äÉÓÉÓ䣣ÊUÊVi«Ì>`\Ê£xÉxÉÓ䣣 Resumen montañas de la Sierra, reclutó campe- sinos dispuestos a enfrentar la tiranía. Ché Guevara, Fidel y Raúl Castro Quienes fueron testigos de su plan, or- y Camilo Cienfuegos son los nom- ganización y elaboración de estrategias bres e imágenes asociados a la gue- y lucha en la Sierras, creen que en su rrilla cubana que derrocó la tiranía movimiento revolucionario estableció en Cuba. Celia Sánchez Manduley la base del éxito final de la “Revolución fue una clase de mujer cubana de de Castro”. Este artículo enfoca la obra clase media, bióloga de profesión, de las mujeres en el éxito de la revolu- comprometida en el cambio de la ción cubana, con frecuencia enfatizada situación social y económica de en los libros de historia y en las discu- los campesinos bajo el régimen de siones historiográficas, sin atender a los Fulgencio Batista. Ella inició y se eventos que, desde estas mujeres que par- fomentó una guerra de guerri- ticiparon tempranamente en ella, dieron llas en la Sierra Maestra, pues pie al éxito revolucionario estaba decidida a poner fin a la tiranía de Batista, la mafia Palabras claves : Revolución cubana, Cecilia y el gobierno de EE.UU., Sánchez Manduley, mujeres en la revolución, los cuales, ella creía, eran guerrilleras los responsables de la violación y del robo Abstract de la sociedad cuba- na. Refugiada en las Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro and Cami- lo Cienfuegos, these are the men whose images have always been associated with the Cuban Guerilla group which brought an end to the tyrannical leadership in Cuba. -

Salvador Allende- Notes on His Security Team: the Group of Personal Friends (Gap-Grupo De Amigos Personales)
STUDY SALVADOR ALLENDE- NOTES ON HIS SECURITY TEAM: THE GROUP OF PERSONAL FRIENDS (GAP-GRUPO DE AMIGOS PERSONALES) Cristián Pérez This article describes the formation and development of the first strictly revolutionary institution of the Socialist President Salvador Allende: his security team, known as the Group of Personal Friends or GAP, from its origins in 1970 to the fight at the Presidential Palace (La Moneda). In it I intend to trace the different phases of the organisation, the diversity of its functions and its intimate rela- tionships with, on the one hand, the parties and movements of the Chilean Left and, on the other, with Cuba. CRISTIÁN PÉREZ is studying for his Master´s degree at the University of Santia- go in Chile. Estudios Públicos, 79 (winter 2000). 2 ESTUDIOS PÚBLICOS “Salvador always goes everywhere with his personal bodyguards” (Laura Allende)1 INTRODUCTION2 A t one o´clock in the morning of Tuesday September 11th, the 20 young men who were on guard at the President´s rest house, known as El Cañaveral, in the upper class area of Santiago, were finishing their traditio- nal game of pool when they heard the voice of “Bruno”, the head of the President´s security team, who ordering them to go to their dormitories. The news that he brought about the national situation did not cause any undue anxiety, because over the past few months rumours of a coup against the Government had become almost routine, especially after June 29th, the day of the tanks or el tancazo as it was known.3 At the same time, some kilome- tres towards the centre of the capital, in the house at Tomas Moro No. -

Peru: Two Strategies
Nahuel Moreno Peru: Two Strategies The peasant rebellion headed by Hugo Blanco and the polemic with putschism (1961-1963) Ediciones Nahuel Moreno Nahuel Moreno: Peru Two Strategies First Spanish Edition: Estrategia, Buenos Aires, 1964 Second Spanish Edition: Ediciones Cehus, Buenos Aires, 2015 First English (Internet) Edition: Ediciones El Socialista, Buenos Aires, 2015 Other Papers: Fragments from Workers’ and Internationalist Trotskyism in Argentina, Ernesto Gonzalez (Coordinator), Editorial Antidoto, Part 3, Vol. 1, 1999. Annex: Hugo Blanco and the peasant uprising in the Cusco region (1961-1963), Hernan Camarero, Periphery; Social Science Journal No. 8, second half of 2000. English Translation: Daniel Iglesias Cover Design: Marcela Aguilar / Daniel Iglesias Interior Design: Daniel Iglesias www.nahuelmoreno.org www.uit-ci.org www.izquierdasocialista.org.ar Ediciones Index Foreword Miguel Sorans Nahuel Moreno and his fight against putschism in Trotskyism ........................................................................ 2 Peru: Two Strategies Nahuel Moreno Chapter I The peasant mobilisation is the engine of the Peruvian Revolution ................................................................ 9 Chapter ii Putsch or development of dual power? .................................................................................................................12 Chapter III Developing and centralising the agrarian revolution ........................................................................................23 Chapter IV The revolutionary -

Fidel Castro, Inc.: a Global Conglomerate
FIDEL CASTRO, INC.: A GLOBAL CONGLOMERATE Maria C. Werlau Since 1997, Forbes magazine has featured Fidel Cas- be under Castro’s control. In addition, Forbes’ calcu- tro in its annual Billionaires’ Edition as one of the lation of Castro’s net worth fails to take into account richest rulers in the world. Initially, Forbes assigned funds in bank accounts all over the world, large in- to Castro a share of Cuba’s reported GDP (gross do- ventories of assets inside Cuba, and real estate hold- mestic product) for the previous year, which yielded ings both in Cuba and overseas, all reported to be- a fortune of approximately $150 million. Since 2003, long to Castro. Yet, given the serious methodological however, it began using a method similar to that used flaws of Cuba’s GDP statistics,2 the new approach to estimate the fortunes of businesspeople and other might provide a sounder approximation to Castro’s royals and rulers. Using academic sources, Forbes wealth. At least, its basis is the market value of clearly identified several enterprises said to be controlled by designated assets, even when it may differ from Cas- Castro and determined their value by comparing tro’s actual holdings. them to similar publicly-traded companies. This has resulted in the more recent estimate of $500 million Not surprisingly, the Cuban government has long 1 for Castro’s fortune. disputed Forbes’ inclusion of Castro in their list.3 It Aside from the difficulties inherent in estimating the publicly responded for the first time in 2004 by issu- value of privately-held companies, Forbes’ calculation ing a statement clarifying that “the revenues of Cu- of Fidel Castro’s fortune is fraught with other prob- ban state companies are used exclusively for the bene- lems.