Cantata BWV 54
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

'{6$+• O°&Ó° Þè* V
557615bk Bach US 3/5/06 6:10 pm Page 5 Marianne Beate Kielland Cologne Chamber Orchestra Conductor: Helmut Müller-Brühl The Norwegian mezzo-soprano Marianne Beate Kielland studied at the Norwegian State Academy of Music in Oslo, graduating in the spring of 2000. She has quickly The Cologne Chamber Orchestra was founded in 1923 by Hermann Abendroth and gave established herself as one of Scandinavia’s foremost singers and regularly appears its first concerts in the Rhine Chamber Music Festival under the direction of Hermann with orchestras and in festivals throughout Europe, working with conductors of Abendroth and Otto Klemperer in the concert-hall of Brühl Castle. Three years later the international distinction. For the season 2001/02 she was a member of the ensemble ensemble was taken over by Erich Kraack, a pupil of Abendroth, and moved to at the Staatsoper in Hanover. Marianne Beate Kielland is especially sought after as a Leverkusen. In 1964 he handed over the direction of the Cologne Chamber Orchestra to J. S. BACH concert singer, with a wide repertoire ranging from the baroque to Berlioz, Bruckner, Helmut Müller-Brühl, who, through the study of philosophy and Catholic theology, as and Mahler. Her career has brought not only performances in Europe, but further well as art and musicology, had acquired a comprehensive theoretical foundation for the engagements as far afield as Japan. Her recordings include Bach’s St Mark and St interpretation of Baroque and Classical music, complemented through the early study of Matthew Passions, Mass in B minor, and the complete solo cantatas for alto, as well conducting and of the violin under his mentor Wolfgang Schneiderhahn. -

Bach and the Rationalist Philosophy of Wolff, Leibniz and Spinoza,” 60-71
Chapter 1 On the Musically Theological in Bach’s Cantatas From informal Internet discussion groups to specialized aca demic conferences and publications, an ongoing debate has raged on whether J. S. Bach ought to be considered a purely artistic or also a religious figure.^ A recently formed but now disbanded group of scholars, the Internationale Arbeitsgemeinschaft fiir theologische Bachforschung, made up mostly of German theologians, has made significant contributions toward understanding the religious con texts of Bach’s liturgical music.^ These writers have not entirely captured the attention or respect of the wider world of Bach 1. For the academic side, the most influential has been Friedrich Blume, “Umrisse eines neuen Bach-Bildes,” Musica 16 (1962): 169-176, translated as “Outlines of a New Picture of Bach,” Music and Letters 44 (1963): 214-227. The most impor tant responses include Alfred Durr, “Zum Wandel des Bach-Bildes: Zu Friedrich Blumes Mainzer Vortrag,” Musik und Kirche 32 (1962): 145-152; see also Friedrich Blume, “Antwort von Friedrich Blume,” Musik und Kirche 32 (1962): 153-156; Friedrich Smend, “Was bleibt? Zu Friedrich Blumes Bach-Bild,” DerKirchenmusiker 13 (1962): 178-188; and Gerhard Herz, “Toward a New Image of Bach,” Bach 1, no. 4 (1970): 9-27, and Bach 2, no. 1 (1971): 7-28 (reprinted in Essays on J. S. Bach [Ann Arbor: UMI Reseach Press, 1985], 149-184). 2. For a convenient list of the group’s main publications, see Daniel R. Melamed and Michael Marissen, An Introduction to Bach Studies (New York: Oxford University Press, 1998), 15. For a full bibliography to 1996, see Renate Steiger, ed., Theologische Bachforschung heute: Dokumentation und Bibliographie der Intemationalen Arbeitsgemeinschaft fiir theologische Bachforschung 1976-1996 (Glienicke and Berlin: Galda and Walch, 1998), 353-445. -

Doctor of Musical Arts
A Conductor’s Guide to J. S. Bach’s Quinquagesima Cantatas A document submitted to the Division of Graduate Studies and Research of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS in the Ensembles and Conducting Division of the College-Conservatory of Music 2012 by Jung Jin Baek B.M., Presbyterian College & Theological Seminary, 2001 M.M., University of Cincinnati, 2008 Committee Members: Earl Rivers, D.M.A. (Chair) Matthew Peattie, Ph.D. Brett L. Scott, D.M.A. ABSTRACT Johann Sebastian Bach’s cantatas occupy a significant portion of his output. This document focuses on his four cantatas written for the Quinquagesima Sunday in Leipzig. The first two cantatas (BWV 22 and BWV 23), which were audition pieces for the cantor position in Leipzig (1723), were performed again in the following year as part of his first cantata cycle. The other two surviving cantatas for this Sunday (BWV 127 and BWV 159) are found in his second (1724–25) and fourth (1728–29) cantata cycles. Not only for his audition, but also for the special context of the Quinquagesima Sunday, (the last major religious musical event in Leipzig before the Passion at the Good Friday Vespers), Bach carefully constructed these cantatas to display his considerable musical ability, his attention to text expression, and his knowledge of liturgical and theological issues for the preparation of the Lenten season. This document will provide a conductor’s guide to preparing and conducting these cantatas and examine how Bach achieves his goals of musical and liturgical function within the Lutheran tradition. -
The Bach Experience
Marsh Chapel at Boston University THE BACH EXPERIENCE Listeners’ Companion 2019|2020 placeholder THE BACH EXPERIENCE Listeners’ Companion 2019|2020 Notes by Brett Kostrzewski placeholder placeholder Contents Cantatas for the New Year v Law and Gospel in Martin Luther’s Theology vii September 29, 2019 Jesu, nun sei gepreiset BWV 41 1 November 10, 2019 Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende BWV 28 5 February 9, 2020 Herr Gott, dich loben wir BWV 16 9 April 26, 2020 Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 190 13 placeholder placeholder Cantatas for the New Year Brett Kostrzewski In contemporary society, New Year’s Eve and Day occasion two familiar thought processes: reflection of the year that has passed, and hopes for the year to come. For practicing Christians, the New Year’s holiday remains inextricably linked with the feast of Christmas one week before. In fact, even in secular terms, our “holiday season” implies an association between Christmas and New Year’s—an association that can never be fully obscured as long as we rely upon the Gregorian calendar. The liturgical Christmas season traditionally lasts for two weeks; the first of January, when the calendar year changes, sits in the middle of this season. For Bach, that day commemorated the Circumcision of Jesus, upon which he formally received his name and entered the community of Jewish believers. It was an important feast; Bach would compose two cantatas beyond the two that were part of his complete cycles, in addition to the cantatas needed for the Sunday after Christmas itself. This year’s Bach Experience features four cantatas related to the New Year: three for New Year’s Day (the Feast of the Circumcision) and one for the Sunday after Christmas, which that year fell on 30 December and inevitably carried with it the connotation of the New Year. -
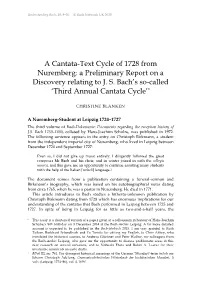
A Cantata-Text Cycle of 1728 from Nuremberg: a Preliminary Report on a Discovery Relating to J
Understanding Bach, 10, 9–30 © Bach Network UK 2015 A Cantata-Text Cycle of 1728 from Nuremberg: a Preliminary Report on a Discovery relating to J. S. Bach’s so-called ‘Third Annual Cantata Cycle’* CHRISTINE BLANKEN A Nuremberg-Student at Leipzig 1724–1727 The third volume of Bach-Dokumente: Documents regarding the reception history of J.S. Bach 1750–1800, collated by Hans-Joachim Schulze, was published in 1972. The following sentence appears in the entry on Christoph Birkmann, a student from the independent imperial city of Nuremberg, who lived in Leipzig between December 1724 and September 1727: Even so, I did not give up music entirely. I diligently followed the great composer Mr Bach and his choir, and in winter joined in with the collegia musica, and this gave me an opportunity to continue assisting many students with the help of the Italian [welsch] language.1 The document comes from a publication containing a funeral-sermon and Birkmann’s biography, which was based on his autobiographical notes dating from circa 1765, when he was a pastor in Nuremberg. He died in 1771. This article introduces to Bach studies a hitherto-unknown publication by Christoph Birkmann dating from 1728 which has enormous implications for our understanding of the cantatas that Bach performed in Leipzig between 1725 and 1727. In spite of being in Leipzig for as little as two-and-a-half years, the * This essay is a shortened version of a paper given at a colloquium in honour of Hans-Joachim Schulze’s 80th birthday on 3 December 2014 at the Bach-Archiv Leipzig. -

J.S. Bach's Church Cantatas and Church Music Today
Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan 20, no. 1 (2021): 137–152 pISSN: 1411-7649; eISSN: 2684-9194 DOI: https://doi.org/10.36421/veritas.v20i1.473 Submitted: 20 February 2021 / Revised: 25 April 2021 / Accepted: 26 April 2021 © 2021 by authors, licensee Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan. This article is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License J.S. Bach’s Church Cantatas and Church Music Today Mark A. Peters,1) Carolien E. Tantra2)* 1) Trinity Christian College, Palos Heights, Illinois, USA 2) Sekolah Tinggi Teologi SAAT, Malang, Indonesia *) E-mail: [email protected] Abstract: This article explores the church cantatas of German composer J.S. Bach (1685–1750) as models for how we can think about the practice of faithful worship in the Christian church today. The article begins with an overview of Bach’s vocation as a church musician, in which he served in various contexts throughout his life. The article focuses on Bach’s final calling as a church musician, as music director for the town of Leipzig for the final 27 years of his life. It explains the context of the main Sunday and feast day worship service in Leipzig, with particular attention to the role of the church cantata in this service. The article then presents a general overview of the characteristics of Bach’s church cantatas before exploring in-depth liturgy, text, and music in one particular example, Cantata 104, Du Hirte Israel, höre. It concludes by proposing that a study of J.S. Bach’s church cantatas can teach us lessons of three kinds—practical (how we do church music), creative (how we create art), and spiritual (for ourselves and our congregations)—that we can apply in our churches today. -

The Physiology of a Bach Cantata Downloaded from by Guest on 22 July 2020
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Apollo BETTINA VARWIG Heartfelt Musicking: The Physiology of a Bach Cantata Downloaded from http://online.ucpress.edu/representations/article-pdf/143/1/36/327910/rep_2018_143_1_36.pdf by guest on 22 July 2020 Le coeur a ses raisons que la raison ne connaıtˆ point: on le sait en mille choses. —Blaise Pascal, Pensees´ (1670) T HERE IS A NOTATIONAL ODDITY in the autograph score of Johann Sebastian Bach’s Cantata 199, ‘‘Mein Herze schwimmt im Blut’’ (My heart is swimming in blood). Instead of writing out the word ‘‘heart’’ every time it appears in the text, at several points the composer used the familiar heart symbol—not exactly shaped like the physical organ, but apparently as instantly recognizable then as it is now.1 In some instances, the abbreviation may have resulted from pragmatic considerations of space (fig. 1a), but in others clearly not (fig. 1b). Instead, perhaps Bach was invoking, in an incon- sequential and semi-private manner, the rich significatory potential of this pictogram. Already by the early seventeenth century, the heart image had come to appear frequently in a variety of contexts, from courtly chivalry and religious iconography to sets of playing cards, encompassing an extensive field of associations and meanings. Severed from the human body, the organ could be subjected to a dazzling variety of treatments, as in the extraordinary Emblemata sacra (1622) by the German Lutheran theologian Daniel Cramer. In this widely distributed -

AJQU No. 36
37<? AJQU No. 36£<TI v, I THE CHRISTMAS CANTATAS OF CHRISTOPH GRAUPNER (1683-1760) VOLUME ONE DISSERTATION Presented to the Graduate Council of the University of North Texas in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By Rene R. Schmidt, B.A., M.M. Denton, Texas August, 1992 37<? AJQU No. 36£<TI v, I THE CHRISTMAS CANTATAS OF CHRISTOPH GRAUPNER (1683-1760) VOLUME ONE DISSERTATION Presented to the Graduate Council of the University of North Texas in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By Rene R. Schmidt, B.A., M.M. Denton, Texas August, 1992 Schmidt, Rene, The Christmas Cantatas of Christoph Graupner fl683-1760). Doctor of Philosophy (Musicology), August 1992, 494 pp. text, 107 pp. music, 77 examples, 23 tables, 8 facsimiles, bibliography. An assessment of the contributions of Christoph Graupner's 1,418 extant church cantatas is enhanced by a study of his fifty-five surviving Christmas cantatas, written for the feasts of Christmas, St. Stephen's, St. John's, and the Sunday after Christmas. Graupner's training in Kirchberg, Reichenbach and at the Thomas School in Leipzig is recounted as well as his subsequent tenures in Hamburg and Darmstadt. Graupner's decision to seek the position of Kantor at Leipzig in 1722/23 probably was the result of deteriorating economic conditions in Darmstadt as well as tacit encouragement from the Leipzig Council. Georg Christian Lehms (1684-1717), Graupner's early librettist and the author of four Darmstadt Jahrgange, annual compilations of cantata texts, uses rhymed recitatives and arias, Biblical quotations, and chorales in his cantata poetry. -

Abstracts of Round Tables
Abstracts of round tables (as far as not listed as personal ones) Thursday 10-07, 9 am Christoph Graupner and the Cantata at the Court of Hesse-Darmstadt see Erdmann, Heyerick, Pegah, Kramer, Sorg Thursday 10-07, 2 pm Bach’s Thomaner – Results of a Research Project (Bach-Archiv Leipzig) see Bärwald, Koska, Maul Friday 11-07, 9 am From Philip V and Archduke Charles of Habsburg to the Borbonic Consolidation: Instrumental Music in the Iberian Peninsula and Areas of Mutual Influence (the Spanish Indies, Italy and Vienna) To the Spanish crown the War of Succession marked a change in musical paradigm, with the consolidation, following the introduction of a new dynasty, the growing and best supported reception of music and musicians from other European countries. The Peace of Utrecht meant in this sense a new international order, not only from a political point of view, but most particularly in regard to cultural transfers. The study of the historical-musical documentary heritage, preserved today in areas of the Iberian and Latin American context (often called panhispanic), increasingly throws new light on such exchanges and practices of this musical and cultural environment in which some prominent figures such as Domenico Scarlatti and José de Nebra are considered the bearers of a much broader and extended reality. see also Ezquerro Estebán, González Marín, Yáñez Navarro, Carvalho Mendes Dos Santos Saturday 12-07, 9.15 am Transalpine Geminiani Chair: Christopher Hogwood Participants: Enrico Careri, Peter Holman, Mark Kroll, Peter Walls In the introduction to Geminiani Studies (Bologna: Ut Orpheus, 2013), Christopher Hogwood noted: “Dilemmas and disagreements are also beginning to appear – a sign of health in research and a symptom of ‘cognitive discord’ to be encouraged. -

M. Suzuki & Bach Collegium Japan (BIS SACD)
Johann Sebastian Bach BACH COLLEGIUM JAPAN Masaaki Suzuki Rachel Nicholls Robin Blaze Gerd Türk Peter Kooij Herr Gott, dich loben wir BIS-SACD-1711 BIS-SACD-1711_f-b.indd 1 08-12-12 10.29.31 BIS-SACD-1711 Cantatas:booklet 11/12/08 14:01 Page 2 BACH, Johann Sebastian (1685–1750) Cantatas 42 · Leipzig 1726 Alles nur nach Gottes Willen, BWV 72 15'07 Kantate zum 3. Sonntag nach Epiphanias (27. Januar 1726) Text: Salomon Franck 1715; [6] Herzog Albrecht von Preußen 1547 Oboe I, II, Violino I, II, Viola, Soprano, Alto, Tenore, Basso, Continuo 1 1. [Chorus]. Alles nur nach Gottes Willen … 3'18 2 2. Recitativo (Alto). O selger Christ, der allzeit seinen Willen … 2'01 3 3. Aria (Alto). Mit allem, was ich hab und bin … 4'06 4 4. Recitativo (Basso). So glaube nun! … 0'59 5 5. Aria (Soprano). Mein Jesus will es tun … 3'28 6 6. Choral. Was mein Gott will, das g’scheh allzeit … 1'07 Liebster Jesu, mein Verlangen, BWV 32 · Concerto in Dialogo 22'46 Kantate zum 1. Sonntag nach Epiphanias (13. Januar 1726) Text: Georg Christian Lehms 1711; [6] Paul Gerhardt 1647 Oboe, Violino I, II, Viola, Soprano, Alto, Tenore, Basso, Continuo, Organo 7 1. Aria (Soprano). Liebster Jesu, mein Verlangen … 6'43 8 2. Recitativo (Basso). Was ists, dass du mich gesuchet? … 0'25 9 3. Aria (Basso). Hier, in meines Vaters Stätte … 6'32 10 4. Recitativo (Soprano, Basso). Ach! heiliger und großer Gott … 2'23 11 5. Aria Duetto (Soprano, Basso). Nun verschwinden alle Plagen … 5'33 12 6. -

Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. ProQuest Information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 UMI' THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE ALTO SOLO CANTATAS OF JOHANN SEBASTIAN BACH, AND THEIR APPROPRIATE APPLICATION TO CONTRALTO OR MEZZO-SOPRANO VOICE TYPES A DOCUMENT SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY In partial fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS By Cheryl A. Bubar Norman, Oklahoma 2003 UMI Number: 3082934 UMI UMI Microform 3082934 Copyright 2003 by ProQuest Information and Learning Company. All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest Information and Learning Company 300 North Zeeb Road P.O. -

BWV 199), Christoph Graupner
MUY590 Zager Trevor de Clercq 04/20/07 Transformation in Johann Sebastian Bach: Mein Herze schwimmt im Blut (BWV 199), Christoph Graupner, and Bach's Stylistic Development as a Cantata Composer INTRODUCTION In 1920, Friedrich Noack published a paper comparing Bach's cantata BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut, to an earlier cantata by Christoph Graupner set to the same text.1 In this article, Noack points out numerous similarities between the two cantatas. As a result, scholars have presumed that Bach had some familiarity with Graupner's piece.2 The main purpose of Noack's original article, however, does not appear to be an effort to fully address the extent that Graupner's composition potentially influenced Bach, nor does Noack attempt to analyze the two works beyond basically superficial details. Noack's agenda is rather to argue for further research into Graupner, an unfairly neglected Baroque master.3 Any insight into Bach's compositional history seems an unintended byproduct. Consequently, as recently as only a few years ago, Hans Bergmann, who was acquainted with Noack's article, asked the lingering question, "Did Bach know Graupner's cantata and did it influence his composition?"4 It is my desire, therefore, to more critically investigate the relationship between these two works, especially in light of recent scholarship. For one, Bach's techniques can be compared to those of a contemporary; both composers were around 29 years of age when they set this text. 1 Friedrich Noack, "Johann Sebastian Bach und Christoph Graupner: Mein Herze schwimmt in Blut," Archiv für Musikwissenschaft 2 (Jan., 1920): 85-98.