Carte Hydrogéologique Seraing
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Martin Maes, Champion Du Monde
Belgique Belgïe PP Liege x 9/1047 VéloVéloSprint SprintMagazineMagazine Editeur responsable : Fernand Lambert - Avenue du globe 49/1 - 1190 Bruxelles Lambert - Avenue : Fernand responsable Editeur MARTIN MAES, CHAMPION DU MONDE Mars 2014 N°6 HANDMADE IN BELGIUM Kit Maintenance oert à l'achat d'une paire de roues + + + + Une clé de réglage Une clé à écrous Une clé maintien rayon plat 6 rayons Aerolite Deux paires de patins supplémentaire jante carbone The onlineshop Édito Le cyclisme de demain s’imagine dès aujourd’hui ... Vous n’êtes probablement pas sans savoir qu’en ce moment, l’Union Européenne de Cyclisme (U.E.C.) met en chantier une étude en profondeur de nouvelles bases d’un cyclisme moderne. De son côté, avec son nouveau Président Brian Cookson, l’UCI lui emboîte le pas et, visiblement, est également en train de suivre cette même mouvance. Ce qui veut dire qu’à notre niveau, les structures mises en place lors de la création de la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles doivent également évoluer. Conservateur invétéré, le monde du cyclisme a Martin Maes, Champion du Monde Enduro©Sven Martin trop souvent été réticent aux changements. Le monde moderne avec ses profondes mutations le force pourtant à s’interroger sans cesse sur des évolutions indispensables, voire inéluctables. Avec l’aide des représentants des sections provinciales, très prochainement, nous allons lancer les bases d’une réforme fonctionnelle qui sera étudiée lors de diverses réunions de travail. Un échange avec les coureurs et responsables de clubs devrait pouvoir permettre d’élargir les réflexions. 4 • La famille Maes Ce Vélosprint constitue un premier élément de cette réforme et à cette occasion, je tiens à remercier 9 • Les clubs FCWB 2014 tous les bénévoles qui collaborent à l’élaboration de notre revue fédérale. -

LIEGE, V1 Legend Arnsberg Consequences Within the AOI Prov
GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR518 hr Noord-Brabant Ru Int. Charter Act. ID: N/A Product N.: 01LIEGE, v1 Legend Arnsberg Consequences within the AOI Prov. Liege - BELGIUM Crisis Information Hydrography Transportation Unit of measurement Affected Total in AOI Limburg Dusseldorf Flooded area ha 752.6 Antwerpen (NL) Flooded Area River Highway Estimated population Number of inhabitants 2 146 590 409 Prov. Flood - Situation as of 15/07/2021 Built-up Residential Buildings ha 7.0 15 317.5 General Information Stream Primary Road Office buildings ha 0.0 178.9 Limburg Netherlands Delineation - Overview map 01 Area of Interest Lake Secondary Road Wholesale and retail trade buildings ha 0.0 92.3 Prov. (BE) North Sea Industrial buildings ha 2.2 2 201.7 Vlaams-Brabant Detail map Land Subject to Inundation Physiography, Land Use, Land School, university and research buildings ha 0.0 215.3 ¼¼¼¼¼ Koln Cover and Built-Up area Hospital or institutional care buildings ha 0.0 40.6 Germany Administrative boundaries¼¼¼¼¼Natural Spring 01 ¼¼¼¼¼ Military ha 0.0 32.9 Prov. Brabant ^ Features available in the vector package !( Liège Brussels International Boundary ¼¼¼¼¼ Cemetery ha 0.0 198.5 Wallon Cartographic Information River Belgium Transportation Highways km 1.9 250.9 se Koblenz Region Facilities Primary Road km 0.0 194.9 Meu Prov. Liege n Full color A1, 200 dpi resolution Secondary Road km 0.6 310.6 P ro v. , Lah 1:130000 Placenames Dam Ha inaut France Ohm Facilities Dams km 0.0 2.0 e ll e R ! Placename Land use Arable land ha 80.2 8 013.9 s h o in 0 2.5 5 10 M e Permanent crops ha 0.0 346.1 , , Prov. -

Répertoire De L'aide Alimentaire En Wallonie
Répertoire de l'Aide Alimentaire en Wallonie L’objectif de ce répertoire est d’identifier les organismes actifs en Wallonie dans la distribution d’aide alimentaire, principalement pour les envoyeurs qui désirent orienter des personnes vers une aide alimentaire adéquate.Au total, 378 organismes sont répertoriés dont 274 distributions de colis alimentaires, 77 épiceries sociales et 27 restaurants sociaux. Avertissement Nous ne pouvons donner aucune garantie quant à la qualité du service rendu et des produits distribués par les organismes répertoriés.Les coordonnées ont été collectées sur base déclarative sans contrôle des pratiques méthodologiques, déontologiques, convictions philosophiques, etc.De même, nous ne pouvons donner aucune garantie quant au respect des normes en vigueur(AFSCA, etc.).Les organismes distributeurs sont responsables de leurs pratiques.Ce répertoire n’est pas exhaustif car nous n’avons pas la capacité d’identifier l’entièreté des organismes d’aide alimentaire et certains organismes ont explicitement demandé de ne pas figurer dans ce répertoire. Mode d'emploi Classement des coordonnées par: 1. Type d'aide (colis alimentaire / épicerie sociale / restaurant social) 2. Province 3. Code postal Choisissez d’abord le type d’aide recherché, puis identifiez la province et le code postal de la ville où vous voulez orienter la personne.Pour plus de rapidité, vous pouvez cliquer dans la table des matières et vous serez redirigé automatiquement. Contact préalable indispensable Avant d’envoyer quelqu’un vers une structure d’aide alimentaire, il est indispensable de prendre contact préalablement par téléphone(ou par mail) avec l’organisme sélectionné afin de connaitre ses modalités d’octroi ainsi que ses horaires d’accueil.Toutes ces informations n’ont pas été collectées ni publiées afin de limiter le risque d’obsolescence rapide des données. -

Liege-Bastogne-Liege « Elites »
LIEGE-BASTOGNE-LIEGE « ELITES » Dimanche 04 octobre 2020 (Version 12 juin 2020) LIEGE - LIEGE PROVINCE DE LIEGE Km fait Km à faire 38 Km/h 40 Km/h 42 Km/h caravane LIEGE Liège : DEPART EN CORTEGE 0 255,5 10:00:00 10:00:00 10:00:00 9:00:00 Place St Lambert, rue Joffre, à gauche rue de l'Université, Place du 20 août, tout droit quai Paul Van Hoegarden, bld. Frère Orban, av. Blonden, quai de Rome, à gauche pont de Fragnée, pont de Fétinne, à droite quai des Ardennes prendre la trémie quai des Ardennes, rue de la Station, bld de Beaufraipont, à gauche rue des Grands Près, à droite rue d'Embourg DEPART REEL N30 voie de l’Ardenne 0 255,5 10:15:00 10:15:00 10:15:00 9:15:00 CHAUDFONTAINE Embourg : N30 Voie de l’Ardenne 0,5 255 10 h 16 10 h 16 10 h 16 9 h 16 rond-point tout droit N30 1,7 253,8 10 h 18 10 h 18 10 h 17 9 h 18 terre-plein central 4,2 251,3 10 h 22 10 h 21 10 h 21 9 h 22 Beaufays : N30 Voie de l’Air Pur 4,6 250,9 10 h 22 10 h 22 10 h 22 9 h 22 rond-point tout droit N30 5,5 250 10 h 24 10 h 23 10 h 23 9 h 24 terre-plein central + balisettes 6 249,5 10 h 24 10 h 24 10 h 24 9 h 24 rond-point suivre à gauche dir. -

Liège Vue Du Ciel
intro La tradition de réaliser des vues aériennes de la Ville de Liège se poursuit depuis plusieurs décennies. C’est le moyen de suivre et documenter le développement de la Cité, ce qui suscite aussi souvent l’in- térêt des citoyens. Les 21 clichés réunis dans la présente édition ont été réalisés en 2018. Ils s’organisent au « fil de l’eau », sui- vant la vallée de la Meuse du Sud au Nord, de Sclessin à l’île Monsin, et longeant également le parcours du tram dont la mise en service est prévue pour 2022. Ainsi, l’observateur peut découvrir la morphologie de la ville juste avant une période de transformation majeure, non seulement en termes de mobilité, mais également en termes urbanistique. Le tram n’est pas qu’un enjeu de transport, ni de marketing urbain. Il est en effet, surtout, un enjeu de ville. D’une part, il va desservir de grands projets territoriaux structurants et identitaires : reconversion de l’ancien campus universitaire du Val Benoît, développement du nouvel axe « métropolitain » entre la gare TGV et le musée Boverie, renforcement du centre-ville (piétonisation, Opéra, Cité administrative, musée Curtius, etc.), création de l’éco-quartier de Coronmeuse, transforma- tion de la cité de Droixhe et de la plaine de Bressoux. D’autre part, il va également s’accompagner du réaménagement de près de 50 hectares d’espaces publics et contribuer à régénérer le cadre de vie. C’est un véritable accélérateur de transformation. « Liège vue du ciel », et au fil de l’eau, permet aussi de poser un regard sur le paysage, formidable et prégnant, de notre Cité : vallée sinueuse, omniprésence de l’eau, confluence, masse boisée des coteaux, chaîne des terrils, ouvrages d’art, monuments et patrimoine, réseau de parcs, etc. -

Liste Triee Par Noms
04/03/2020 LISTE TRIEE PAR NOMS LISTE TRIEE PAR NOMS Nom de famille Prénom Adresse N° Code postal Commune ABATE EKOLLO Joëlle de Zoum Rue Naniot 277 4000 LIEGE ABATI Angelo Rue Dos Fanchon 37-39 4020 LIEGE ABAYO Jean-Pascal Montagne Saint-Walburge 167 4000 LIEGE ABBATE Danielo Rue du Petit Chêne 2 4000 LIEGE ABBATE Damien Rue du Petit Chêne 2 4000 LIEGE ABCHAR Tarek Avenue Emile Digneffe 2 4000 LIEGE ABDELEMAM ABDELAZIZ Ahmed Farid Lisdaran Cavan 2R212 2 R212 Irlande ABOUD Imad Bd de Douai 109 4030 LIEGE ABRAHAM Françoise Rue de Hesbaye 75 4000 LIEGE ABRASSART Charles Avenue Grégoire 36 4500 HUY ABSIL Gilles Rue de la Mardelle, Heinsch 6 6700 ARLON ABSIL Gabriel Grand'Rue 45 4845 SART-LEZ-SPA ABU SERIEH Rami Rue Devant Les Religieuses 2 4960 Malmedy ACAR Ayse Rue Peltzer de Clermont 73 4800 VERVIERS ACHARD Julie Quai de COmpiègne 52 4500 HUY ACIK Mehtap Rue Fond Pirette 3B 4000 LIEGE ACKAERT Alain Rue du Long Thier 50/SS 4500 HUY ADAM Aurélie Boulevard du 12ième de Ligne 1 4000 LIEGE ADAM Christelle Rue Pré de la Haye 6 4680 OUPEYE 1/301 LISTE TRIEE PAR NOMS Nom de famille Prénom Adresse N° Code postal Commune ADAM Laurence Avenue de la Closeraie 2-16 4000 LIEGE (ROCOURT) ADAM Stéphanie Rue Professeur Mahaim 84 4000 LIEGE ADAM Youri Biche Les Prés 12 4870 TROOZ ADANT Jean-Philippe Rue Aux Houx 41 D 4480 CLERMONT-SOUS-HUY ADANT Jean-François Rue Provinciale 499 4458 FEXHE-SLINS ADASY ALMOUKID Marc Avenue Martin Luther King 2 87042 LIMOGES ADEDJOUMO Moïbi Rue du Parc 29 4800 VERVIERS ADJAMAGBO Hubert ADLJU Arsalan Rue des déportés 3 4840 -

Landmarks in Liège Editor: Paul Muljadi
Landmarks in Liège Editor: Paul Muljadi PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Tue, 13 Dec 2011 21:08:05 UTC Contents Articles Liège 1 Cointe Observatory 10 Collège en Isle (Liège) 11 Collège Saint-Servais (Liège) 12 Cornillon Abbey 12 Curtius Museum 13 Liège Airport 14 Liège Cathedral 18 Liège Science Park 19 Liège-Guillemins railway station 20 Meuse (river) 24 Pont de Wandre 30 Prince-Bishops' Palace (Liège) 31 Royal Conservatory of Liège 33 St Bartholomew's Church, Liège 34 St. Lambert's Cathedral, Liège 35 University of Liège 38 References Article Sources and Contributors 42 Image Sources, Licenses and Contributors 43 Article Licenses License 45 Liège 1 Liège Liège Flag Coat of arms Liège Location in Belgium Coordinates: 50°38′N 05°34′E Country Belgium Region Wallonia Community French Community Province Liège Arrondissement Liège Government • Mayor Willy Demeyer (PS) • Governing party/ies PS – cdH Area • Total 69.39 km2 (26.8 sq mi) Liège 2 [1] Population (1 January 2010) • Total 192504 • Density 2774.2/km2 (7185.2/sq mi) Demographics • Foreigners 16.05% (7 January 2005) Postal codes 4000–4032 Area codes 04 [2] Website www.liege.be Liège (French pronunciation: [ljɛːʒ]; Dutch: Luik, Dutch pronunciation: [lœyk] ( listen); Walloon: Lidje; German: Lüttich; Latin: Leodium; Luxembourgish: Leck; until 17 September 1946[3] [4] [5] the city's name was written Liége, with the acute accent instead of a grave accent) is a major city and municipality of Belgium located in the province of Liège, of which it is the economic capital, in Wallonia, the French-speaking region of Belgium. -

1. Ordre Du Jour Actualisé
Conseil provincial Palais provincial Place Saint-Lambert, 18A 4000 LIEGE N° d'entreprise : 0207.725.104 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2019 M. Jean-Claude JADOT, Président, ouvre la séance à 16h35’. M. Irwin GUCKEL et Mme Anne THANS-DEBRUGE siègent au Bureau en qualité de Secrétaires. M. le Gouverneur et Mme la Directrice générale provinciale assistent à la séance. Il est constaté par la liste de présence que 54 membres assistent à la séance. Présents : Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), M. Mustafa BAGCI (PS), Mme Astrid BASTIN (CDH-CSP), Mme Muriel BRODURE-WILLAIN (PS), M. Serge CAPPA (PS), Mme Julie CHANSON (ECOLO), M. Thomas CIALONE (MR), Mme Deborah COLOMBINI (PS), Mme Catharina CRAEN (PTB), M. Alain DECERF (PS), Mme Virginie DEFRANG-FIRKET (MR), M. Maxime DEGEY (MR), M. Marc DELREZ (PTB), M. André DENIS (MR), M. Yves DERWAHL (PFF-MR), M. Guy DUBOIS (MR), Mme Marion DUBOIS (MR), M. Serge ERNST (CDH- CSP), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET (MR), Mme Eva FRANSSEN (ECOLO), Mme Murielle FRENAY (ECOLO), Mme Sandrina GAILLARD (ECOLO), M. Luc GILLARD (PS), M. Irwin GUCKEL (PS), M. Pol HARTOG (MR), Mme Catherine HAUREGARD (ECOLO), M. Alexis HOUSIAUX (PS), M. Jean- Claude JADOT (MR), M. Claude KLENKENBERG (PS), Mme Catherine LACOMBLE (PTB), Mme Caroline LEBEAU (ECOLO), M. Jean-Denis LEJEUNE (CDH-CSP), M. Luc LEJEUNE (CDH-CSP), M. Laurent LÉONARD (PS), M. Roland LÉONARD (PS), M. Eric LOMBA (PS), Mme Valérie LUX (MR), Mme Nicole MARÉCHAL (ECOLO), M. Robert MEUREAU (PS), M. Jean-Claude MEURENS (MR), Mme Marie MONVILLE (CDH-CSP), Mme Assia MOUKKAS (ECOLO), Mme Sabine NANDRIN (MR), M. -
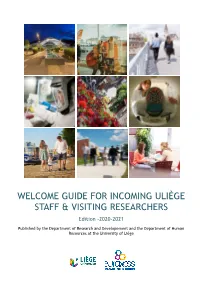
Welcome Guide for Incoming Uliège Staff & Visiting
WELCOME GUIDE FOR INCOMING ULIÈGE STAFF & VISITING RESEARCHERS Edition -2020-2021 Published by the Department of Research and Developement and the Department of Human Resources at the University of Liège SUMMARY Welcome Guide for incoming ULiège staff & visiting researchers .................................................... 1 A Word of Welcome ..................................................................................................................... 1 1. Belgium &Wallonia ............................................................................................................... 2 1.1. The federal state ...................................................................................................................... 3 1.2. Languages ................................................................................................................................ 3 1.3. Weather ................................................................................................................................... 3 1.4. Customs ................................................................................................................................... 3 2. Research at ULiège ................................................................................................................ 4 3. Preparing your departure ...................................................................................................... 6 3.1. Preparing your application .......................................................................................................... -

Bressoux Grivegnee Angleur
4ème Edition - Novembre 2002 TERMINUS CENTRAUX RESEAU DU TEC LIEGE-VERVIERS SAINT-LAMBERT LIEGE - CENTRE 12 19 53 61 70 70 71 71 72 73 74 75 75 Concept. et réalisat. : BRAT sprl C H ROCOURT -71 . 71 D 80 81 81 82 83 84 85 88 90 94 E HAY T 70-70-73-74 RA C O G TEC Liège-Verviers N SSE G FO R LEOPOLD E VOTTEM 71-71 S ARD JAMBE-DE-BOIS LEV BOU CIMETIERE B GARE HOPITAL EGLISE 5 6 10 13 18 34b 60 67 68 69 76 78 79 VOTTEM 24 E D L THIER A LIEGE I MC W MAISON COMMUNALE THEATRE ECOLES DE BRY TOURISME INFO. E D . MOLINVAUX J T Ste WALBURGE R B U E 2 3 26 26 29 31 33 35 D RUE O U C. G C R O O TH 3 IE 24 R E R 2 COTILLAGES J. DE WILDE CATHEDRALE R N E E D S R. S E F HERSTAL ON T THIER HORION D W DE 20 21 22 23 24 30 30 E S 7 A TAW RUELLE U T ES A LIEGE R 5-6-7-34b SAINTE-WALBURGE S R O U S FOND OPERA L E EGLISE E E V 76-78-79 A N SEELIGER V S D I A T DES TAWES A Y V E H I -W 2 2 S C 3 E 7 C R T A U A L L 24 3 U O B R 9 25 27 48 64 65 65 377 CORONMEUSE 2 E R U E VOLGOGRAD T R D NEST SOLVAY G 7 72 BD ER U 1 A H E - H U 7 G 1 E GUILLEMINS S O U 2 E R 7 D PONT DES BAYARDS BORGNET TIR 1 D PLATEAU ES 1 B LEFER D 1 8 17 34b 40a 40b ES E STEPP B UE RUE D D R RD ONA D T - LE VICTOR HUGO U G E SAIN LA RU CORONMEUSE C VIVEGNIS E R BAYARDS 1 TIR I L U E S L E S PARC DE E U 1 V D E 2 e E M U BORGNET N S O PALAIS DES D LA CITADELLE O E 9 R 7 BONNE N 7 O 2 - C SPORTS E RUE AUX 6 E NOUVELLE 7 D HALLES N B AI FOND PIRETTE L N A CHEVAUX U I G O Y Q DES FOIRES B A N R E DONY E D U S K R PARC ASTRID CAMPINE 154 RC 7 XHOVEMONT MA LA D IE PLAINE DES SAINTE NAR ON E RUE LEO ALL SPORT N W I ELISABETH JONRUELLE 24 T - I DE P 23 CITADELLE AIN UA M S Q A E E C G U 4 N R 7 R I Ste FOY - U H PONT ATLAS BATTERIE 3 B L G St LEONARD 7 - A A 2 1 W M GOSWIN E 7 - 7 - E D - 1 T GENDARMERIE P 0 RUE MAGHIN T 7 S t U ANS-St NICOLAS E A 7 A F U - E 4 UF 2 T R R 0 N T MARENGO b L 7 G E 34 12-19-75-75 LIEGE 6- A A U 5- . -

Enseignement Specialise
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE SPECIALISE DIRECTIVES ET RECOMMANDATIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2007-2008 (*) VOLUME III * Ce document annule et remplace les dispositions antérieures - 0 - Ministère de la Communauté française CIRCULAIRE N° 1996 DATE 22/08/2007 Objet : CIRCULAIRE RELATIVE A L’ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE VOLUME III Réseau : Tous Niveau : Fondamental et secondaire spécialisé Période : Année scolaire : 2007-2008 A Madame la Ministre-Présidente - Membre du Collège de la Commission communautaire chargé de l’enseignement A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Messieurs et Mesdames les Bourgmestres, Aux Pouvoirs organisateurs des établissements d’enseignement spécialisé libres subventionnés, Aux Chefs des établissements internats et homes d’accueil d'enseignement spécialisé, organisés par la Communauté française, Aux Chefs des établissements officiels et libres d'enseignement spécialisé subventionnés par la Communauté française. Aux Présidents et Secrétaires des Commissions Consultatives de l’Enseignement spécialisé Pour information : Aux Membres de l'Inspection de l'enseignement spécialisé, Aux Vérificateurs de l'enseignement spécialisé, Aux Directeurs des Centres Psycho Médico-Sociaux. Organisés et subventionnés par la Communauté française, Aux Associations de parents, Aux Organisations syndicales, Aux Membres du Conseil Supérieur de l'enseignement spécialisé. Aux Membres du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. Circulaire Informative Administrative Projet -

Liège Bastogne Liège 41 Kph 39 Kph 37 Kph
107th EDITION LIÈGE SUNDAY BASTOGNE 25th APRIL LIÈGE 2021 © A.S.O. 2021. PHOTOS : (G. DEMOUVEAUX). LIEGE-BASTOGNE-LIEGE.BE @LIEGEBASTOGNEL #LBL ROADBOOK SUMMARY OFFICIALS . 2 TEAMS . 3 RACE HEADQUARTERS . 4 TV BROADCASTING . 4 HOSPITALS . 4 FOLLOWERS . 5 PICTOGRAMS . 5 GENERAL SITUATION PLAN . 6 ROUTE . 7 LIÈGE . 8 ACCESS & START . 9 ITINERARY TIMETABLE . 10 – 11 PROFILES AND CLIMBS . .12 - 13 LAST KILOMETRES & FINISH . 14 SPECIFIC REGULATIONS . 15 PARTNERS . 16 – 19 PRIZE WINNERS . 20 1 OFFICIALS DIRECTION MEDICAL SERVICE A.S.O. Simon Clariot, Jean Doudou, Xavier Schwartz, Gilbert Versier Director of cycling: Christian Prudhomme R.C.P.C.L CONTACTS FOR LOCAL AUTHORITIES President: Fernand Lambert Fabienne Dalla Serra, Cyrille Tricart General secretary: Alain Bourse PUBLIC RELATIONS EVENT TEAM Élise Bardaine Event director: Thierry Gouvenou Assistant director: Jean-Michel Monin Regulators: Cédric Coutouly, Franck Perque ANIMATIONS Race Headquarters: Marie-Noëlle Féron Cédric Marsault Speakers: Marc Chavet, Michel Gélizé Radio-Tour Speaker: Marc Bollen MEDIA Press relations: Fabrice Tiano Event safety manager: Jean-Michel Monin TV coordination: Jérôme Bailly Social networks: Clément Duriez Web editor: Louis Doucet SITES MANAGERS Start: Julien Van Theemsche COMMERCIAL & PARTNERSHIPS Finish: Romain Caubin Anna Godzinski, Richard Sant BOARD OF COMMISSIONERS LOGISTICS Jury president: Pierre Curchod (UCI, Sui) Romain Genaix, Hugo Marquet, Thomas Montagnac, Vincent Poinsot, Jury members: Francesco Xabier Bilbao Zabala (UCI, Esp), Thierry Guillaume de Prémont, Diederen (UCI, Bel), Guy Dobbelaere (UCI, Bel), Jean-Michel Voets (BC) Vehicle fleet: Manuel Roriz Finishline judge commissioner: Bernard Tonglet (BC) Motorcycle commissioners: Laurent Genetelli (BC), Laurent Mairlot (BC), Romain Smeets (BC), Cédric Willems (BC) © A.S.O. - G.