L'art D'être Pirogues De Voyage En Océanie Insulaire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tātou O Tagata Folau. Pacific Development Through Learning Traditional Voyaging on the Waka Hourua, Haunui
Tātou o tagata folau. Pacific development through learning traditional voyaging on the waka hourua, Haunui. Raewynne Nātia Tucker 2020 School of Social Sciences and Public Policy, Faculty of Culture and Society A thesis submitted to Auckland University of Technology in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy Table of Contents Table of Contents .......................................................................................................... i Abstract ........................................................................................................................ v List of Figures .............................................................................................................. vi List of Tables ............................................................................................................... vii List of Appendices ...................................................................................................... viii List of Abbreviations .................................................................................................... ix Glossary ....................................................................................................................... x Attestation of Authorship ............................................................................................. xiii Acknowledgements ..................................................................................................... xiv Chapter 1: Introduction ................................................................................................ -
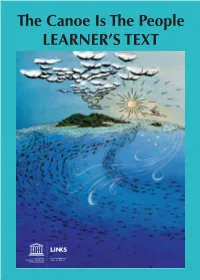
The Canoe Is the People LEARNER's TEXT
The Canoe Is The People LEARNER’S TEXT United Nations Local and Indigenous Educational, Scientific and Knowledge Systems Cultural Organization Learnerstxtfinal_C5.indd 1 14/11/2013 11:28 The Canoe Is the People educational Resource Pack: Learner’s Text The Resource Pack also includes: Teacher’s Manual, CD–ROM and Poster. Produced by the Local and Indigenous Knowledge Systems (LINKS) Programme, UNESCO www.unesco.org/links Published in 2013 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France ©2013 UNESCO All rights reserved The designations employed and the presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The ideas and opinions expressed in this publication are those of the authors; they are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization. Coordinated by Douglas Nakashima, Head, LINKS Programme, UNESCO Author Gillian O’Connell Printed by UNESCO Printed in France Contact: Douglas Nakashima LINKS Programme UNESCO [email protected] 2 The Canoe Is the People: Indigenous Navigation in the Pacific Learnerstxtfinal_C5.indd 2 14/11/2013 11:28 contents learner’s SECTIONTEXT 3 The Canoe Is the People: Indigenous Navigation in the Pacific Learnerstxtfinal_C5.indd 3 14/11/2013 11:28 Acknowledgements The Canoe Is the People Resource Pack has benefited from the collaborative efforts of a large number of people and institutions who have each contributed to shaping the final product. -

Pacific Colonisation and Canoe Performance: Experiments in the Science of Sailing
PACIFIC COLONISATION AND CANOE PERFORMANCE: EXPERIMENTS IN THE SCIENCE OF SAILING GEOFFREY IRWIN University of Auckland RICHARD G.J. FLAY University of Auckland The voyaging canoe was the primary artefact of Oceanic colonisation, but scarcity of direct evidence has led to uncertainty and debate about canoe sailing performance. In this paper we employ methods of aerodynamic and hydrodynamic analysis of sailing routinely used in naval architecture and yacht design, but rarely applied to questions of prehistory—so far. We discuss the history of Pacific sails and compare the performance of three different kinds of canoe hull representing simple and more developed forms, and we consider the implications for colonisation and later inter-island contact in Remote Oceania. Recent reviews of Lapita chronology suggest the initial settlement of Remote Oceania was not much before 1000 BC (Sheppard et al. 2015), and Tonga was reached not much more than a century later (Burley et al. 2012). After the long pause in West Polynesia the vast area of East Polynesia was settled between AD 900 and AD 1300 (Allen 2014, Dye 2015, Jacomb et al. 2014, Wilmshurst et al. 2011). Clearly canoes were able to transport founder populations to widely-scattered islands. In the case of New Zealand, modern Mäori trace their origins to several named canoes, genetic evidence indicates the founding population was substantial (Penney et al. 2002), and ancient DNA shows diversity of ancestral Mäori origins (Knapp et al. 2012). Debates about Pacific voyaging are perennial. Fifty years ago Andrew Sharp (1957, 1963) was sceptical about the ability of traditional navigators to find their way at sea and, more especially, to find their way back over long distances with sailing directions for others to follow. -

Here Is Plenty of All in All , While I Do Not Confess Never Sailed a Catam Aran Before
The sea People Scott Brow n's Magazine of the ' ' . W orld-wl*de Polynesian . ' . * catamaran . harram ASSOCiZ IOZ ê Brokerage Carbeile M ill Oc PCA 1999 Torpoint cornwall PLII 2NW Contents Tel: +44 (0) 1752 812777 Fax: +44 (O) 1752 812888 T e Kscott.Brown@ multihulls.uk. angaroa - Skipjack 3 Hitia 17 :1,750 Melanesia '.- lbiza 6 Hjna specialtproject) E1,750 Tiki 31 Morgenwind 8 Hinemoa E3.500 yi.(y'L. '?Aj; -zzj. <;j% vl-rane, Greece E3.500 k.ljjjy, Narai IV - Havai ki 1 0 . Tiki 2 1 (GRP) :4 ,000 C.# f 1 .,2g . .. -u . , t . ' Tane E4,600 ' Tiki 38 - Australia 1 1 Tiki 21 , Germany :5,300 Pahi 42 - Mahuini 12 Tangaroa Mk1 E5.950 Tiki 21 (GRP) E6.250 Pahi 63 - Moana Pahi 14 pahi 26 c. E5 000 Cat Corner Tiki 26 (GRP) E9,750 -- Podugal 1 8 T'iki 26 (monocoque) f7.500 1 999 Eclipse Meet 19 Tiki 26 (GRP) E10.000 Tiki 26 *2 (GRP) E10.500 Hinemoa - Ow1 20 Tane E12,000 Building in Tasmania 22 Tangaroa Mk1 DFL50.000 Tiki 28, France :18.500 French Summer Meet 23 pahi 42 Portugal E29,000 Oro E34.000 SW UK Meet Repod 24 Pahi 42, Turkey :38,000 Scottish Meet Report 26 Pahi 42 :39,500 Pahi 42. N1 :44,000 Solent Meet Repod 27 Narai Mk4 so ()00 tjs . US $ , Book Review 27 Yard Facilities Editorial Team : Steve & Scott Space to build, fit out. store & launch. Assisted By: Sandy Hard standing, suit trailer sailors' good security, good com pany! Editorial Address: Front cover Photo. -
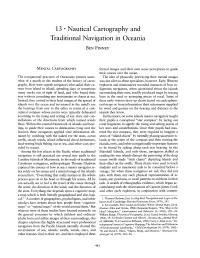
Nautical Cartography and Traditional Navigation in Oceania
13 · Nautical Cartography and Traditional Navigation in Oceania BEN FINNEY MENTAL CARTOGRAPHY formal images and their own sense perceptions to guide their canoes over the ocean. The navigational practices of Oceanians present some The idea of physically portraying their mental images what of a puzzle to the student of the history of carto was not alien to these specialists, however. Early Western graphy. Here were superb navigators who sailed their ca explorers and missionaries recorded instances of how in noes from island to island, spending days or sometimes digenous navigators, when questioned about the islands many weeks out of sight of land, and who found their surrounding their own, readily produced maps by tracing way without consulting any instruments or charts at sea. lines in the sand or arranging pieces of coral. Some of Instead, they carried in their head images of the spread of these early visitors drew up charts based on such ephem islands over the ocean and envisioned in the mind's eye eral maps or from information their informants supplied the bearings from one to the other in terms of a con by word and gesture on the bearing and distance to the ceptual compass whose points were typically delineated islands they knew. according to the rising and setting of key stars and con Furthermore, on some islands master navigators taught stellations or the directions from which named winds their pupils a conceptual "star compass" by laying out blow. Within this mental framework of islands and bear coral fragments to signify the rising and setting points of ings, to guide their canoes to destinations lying over the key stars and constellations. -

Forschergruppe CSG-II W O R K S H P Freitag, 18
Wissen Forschergruppe CSG-II W O R K S H P Freitag, 18. März 2011 9:30 Rebekka Ladewig Glauben – Können – Wissen: Passagen des Impliziten bei Michael Polanyi 10:30 Kathrin Thiele Henri Bergson: Intuition und Spekulation 11:30 – Kaffeepause – 12:00 Melanie Sehgal Wissen als Glauben bei William James 13:00 – Mittagspause – 14:00 Martin Thiering Mentale Modelle: Schnittmenge ORT zwischen implizitem und explizitem Wissen? Topoi Haus Mitte Seminarraum 15:00 Iris Därmann Hannoversche Str. 6 Wirksame Handlungen: 10115 Berlin Die Techniken des Körpers KONTAKT 16:00 – Kaffeepause – Rebekka Ladewig 16:30 Colin G. King Exzellenzcluster TOPOI Der aristotelische Hexis-Begriff Hannoversche Str. 6 10115 Berlin 17:30 Anna Echterhölter [email protected] Feldhaftung: Bourdieus Habitus- Konzept und die Ordnung der www.topoi.org Körper The Body-Mind Relation [Michael Polanyi's "The Body-Mind Relation" was a paper delivered at a 1966 conference sponsored by the Western Behavioral Sciences Institute, the Salk Institute for Biological Sciences and the University of California, San Diego .. The conference and the book that grew out of it, Man and the Sciences of Man, edited by William R. Coulson and Carl R. Rogers (Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1968) in which "The Body- Mind Relation was published, were part of the Western Behavioral Science Institute's project investigating the philosophy of the behavioral sciences. "The Body-Mind Relation" is posted on the Polanyi Society web site with the permission of William R.Coulson and John C. Polanyi.] When I point my finger at the wall and call out: "Look at this!" all eyes turn to the wall, away from my finger. -

Multihull Pioneer James Wharram Is Still Preaching the Gospel
CAT MAN Multihull pioneer James Wharram is still preaching the gospel BY SAM FORTESCUE ext time you climb on board a Lagoon in the Caribbean or spy a Prout bobbing in the harbor, spare a thought for James Wharram. Though this somewhat froward Englishman won’t thank Nme for saying so, he is partly responsible for both—and indeed, all the other modern catamarans now sprouting like Sargasso weed among the world’s warm-water cruising grounds. As a designer of Polynesian double-hulled sailing craft (he hates the word “catamaran”) with more than 10,000 sets of design drawings sold, he has arguably done more to popularize the multihull than anyone else. His distinctive home-build boats can be spotted on the water from Maine to Melbourne, but at the tail end of a career spanning more than 60 years, he is at last starting to slow down—as I learn when I catch up with him at his home on Devoran Creek, Cornwall, where we naturally start with a cup of tea. “Never get involved with young women, because they grow up and dominate you,” he warns me with a twinkle in his eye. As he imparts this sage advice in a hearty Lancashire accent, his partner of 50 years, Hanneke Boon, is clattering about in the kitchen next door, looking for some cake. He wriggles his toes in thick woollen socks, resting his long legs on a low table in the sitting room. Through the windows behind him, the twin hulls of Mana, his latest design, bob gently on the chop. -

Riesenberg 1972 the Organisation of Navigational Knowledge on Puluwat
THE ORGANISATION OF NAVIGATIONAL KNOWLEDGE ON PULUWAT Author(s): Saul H. Riesenberg Source: The Journal of the Polynesian Society, Vol. 81, No. 1 (MARCH 1972), pp. 19-56 Published by: The Polynesian Society Stable URL: https://www.jstor.org/stable/20704826 Accessed: 08-10-2018 13:49 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms The Polynesian Society is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Journal of the Polynesian Society This content downloaded from 74.93.217.178 on Mon, 08 Oct 2018 13:49:56 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms THE ORGANISATION OF NAVIGATIONAL KNOWLEDGE ON PULUWAT Saul H. Riesenberg Smithsonian Institution This article describes some of the mnemonic devices and systems of classification employed by the navigators of the atoll of Puluwat (Central Caroline Islands) to arrange their knowledge of geography and of star courses into organised bodies of data. The word geography is used here in a very broad sense, to include both natural and mythical phenomena, and animate beings as well, when they are part of those bodies of data and are used as reference points by navigators in finding their way on the high seas. -

Primary Urban Center Development Plan Area
i)EvEIoPMENT PLANS PRIMARY URBAN CENTER DEVELOPMENT PLAN Exhibit A4, May 2004 Department of Planning and Permitting City and County of Honolulu Jeremy Harris, Mayor City Clerk, Eff. Date: 6-21-04 \. 24-23 ( k)I1OI1I Iii S[I1p. 5. 8—04) . a . I)[:vFL,opMENr PLx’cs PUC DE\E:LoP\IENT PL.N TABLE OF CONTENTS PREFACE 24-29 EXECUTIVE SUMMARY 24-30.2 THE ROLE OF THE PRIMARY URBAN CENTER IN OAHU’S DEVELOPMENT PATTERN 24-30.8 2. THE VISION FOR THE PUC’S FUTIJRF 24-30.10 2.1 Honolulu’s Natural, Cultural and Scenic Resources are Protected and Enhanced 24-30.10 2.2 Livable Neighborhoods Have Business Districts, Parks and Plazas, and Walkable Streets 24-30.10 2.3 The PUC Offers In-Town Housing Choices for People of All Ages and Incomes 24-30.12 2.4 Honolulu is the Pacific’s Leading City and Travel Destination 24-30.12 2.5 A Balanced Transportation System Provides Mobility 24-30.14 3. LAND USE AND TRANSPORTATION 24-30.15 3.1 Protecting and Enhancing Natural, Cultural, and Scenic Resources 24-30.15 3.1.1 Existing Conditions, Issues and Trends 24-30.15 3.1.2 Policies 24-30.23 3.1.3 Guidelines 24-30.23 24-30.26 3.1 .4 Relation to Views and Open Space Map (A. I and A.2) 3.2 Neighborhood Planning and Improvement 24-30.26 3.2.! Existing Conditions. Issues and Trends 24-30.27 3.2.2 Policies 24-30.33 3.2.3 Relation to Land Use Maps (A.4-A.6) and Zoning 24-30.36 3.3 In-Town Housing Choices 24-30.39 3.3.1 Existing (‘onditions. -

Seapeople-038.Pdf
The Sea People ScoW Brown X ultihulls MaPgoalzmlnes olafn t h@ . orld-wide catamaMn . * Assoclatlon harrcm Oc PCA 1999 curbeile Mill m. ,; r, .x, j ,# Contents , .?: !. ) ' .c , ;.,.uwaIl PL' 11 2NW , .. :. a . ., . .! . ' , . ' !4f' l'.i .'.'-' '. ' xk (t .'ht: ,yyj: ;' ' ë. ' J tk - - . ) - . ;L9 . .# ' .. r ? .z., . k) ' ftM Dt?: . ' .j I:.j j. jI,. l(ë .qyt j r.j'tgk. , kgjy .z,1. Jim 's Colum n 3 .ï '' J tl- j:'j y;j, :1!<r . y,' ' . ljzj '- .< TIKI 31 - Seigel 6 TIKI 26 - Modiscation 8 PAHI 42 -- Kaimalolo 10 Ctlrren't BOCAS for Sale The Boatyard 14 Hinemoa 2 f 2,500 C n ngaroa 4 inupls 1 (pclr) f 3 000 at Corner 16 ' Tiki 21's 3 6.3,9k to f 5.3k PAHI 42 - Build 18 n ne 1 HITIA 14 -- Philippines 20 puhi 26 a 64 25o & E5k Book Review 21 Tlkl 26.s 5 f, 7.5k to f, 11.5k T'kl 28 1 6,18,500 Diqy Bag 21 -u ne 1 Eozaoo TIKI 31 - Maui 22 p ahl al 1 E8,5oo stern End 23 n nw rocl 4 1 Ej9,5oo Tips Hints and Gadgets 24 Ncrql 1 1 f 18,000 cruising - Iceland 26 hurai 4 1 $45,000 puh, 42's 6 Eagk to E45k Editorial Team: Adrian Yard Facilities Assisted By: scott & steve space to build. fit out, store & Iaunch. Edltorial Address: Front cover Photo: Hard Standing, suit trailer sailors. PCA Boa Gente, Tangaroa Mk1 , 0OOd SOCLI/W, gOOd O mpany! T@@ rcpaorlbnet lle MIII zsaimilianbga obnw Lea. -

Living in a Post-Settlement World I New Tuahiwi Whare Raumati/Summer 2012 56
ABOUT NGāi Tahu—ABOUT NEW ZEALAND—ABOUT YOU RAUMAti/SUMMER 2012 $7.95 56 LIVING IN A POST-SETTLEMENT WORLD ı NEW TUAHIWI WHARE RAUMAti/SUMMER 2012 56 Hui-ā-IWI With a new name and new look, Ngāi Tahu staged its inaugural Hui-ā-Iwi, attracting Ngāi Tahu whānau from all over Aotearoa. 24 24 NGĀ HAU E whā FROM THE EDITOR It seems like only a moment ago that we were welcoming our new chief executive, Arihia Bennett to Te Rūnanga o Ngāi Tahu. Since then, Hui-ā-Iwi ran over three days at the Lincoln Events Centre and was widely hailed as a success, and Ngāi Tūāhuriri opened their new wharenui, Maahunui II. And now it’s almost Christmas. So much to do, so little time seems like it’s a constant refrain in the modern world for most of us. I kept getting overtaken by events in planning this issue. No sooner would I get news of someone doing something pretty cool, then my attention would be drawn elsewhere for the same reason. Mawera Karetai was named Māori Entrepreneur at the Eastern Bay of Plenty Business Excellence Awards for her work in building a brilliant business online. Read her story on page 6. And now A3 Kaitiaki has won the Māori business category at the Otago Chamber MaaHUNUI II of Commerce Business Excellence Awards. After 10 months of building, Ngāi Tūāhuriri has a new wharenui that should stand Look out for their story in the next issue. for the next seven generations. 10 Ngāi Tahu journalist Alan Solomon this year gained his journalism diploma from FOLLOW THE LEADER Waiariki Institute of Technology in Rotorua How do Ngāi Tahu leaders emerge? How will Ngāi Tahu rangatahi learn the and broke the record for the number of old teachings that they can apply to the future? Questions of leadership abound stories published while doing the course. -

Carolinian Voyaging in the New Millennium
MICRONESIAN JOURNAL OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Vol. 5, nº 1/2 Combined Issue November 2006 CAROLINIAN VOYAGING IN THE NEW MILLENNIUM Eric Metzgar Triton Films, Camarillo, CA A holistic view of the Carolinian voyaging movement to date, highlighting major voyaging achievements as well as the master navigators (palu) who have made significant contributions. The reinvigorization of long-distance voyaging has expanded beyond the Carolininan-Marianas voyaging renaissance into a pan-Carolinian movement with navigators using traditionally-made canoes to make two-way voyages from Yap to Palau in the west and from Polowat to Pohnpei in the east. Using ancient knowledge of non-instrument tion traditions. Many of these navigators have wayfinding that had been handed down for been recognized previously in published arti- generations, master navigators (palu) from cles but some have not, either because they Polowat and Satawal in the later part of the last were formerly apprentices who only recently century rediscovered the 500-mile1 sea route came of age as palu master navigators or the from their islands in the central Carolines2 to nature of their contribution has been that of Saipan and Guam in the Marianas archipelago. teacher more than voyager. In addition, there In so doing they sparked a renaissance of Caro- are many others in “the background” who have linian-Marianas voyaging that continues today. participated in significant ways to the re- First to rediscover the passage from the Caro- invigorization of the Carolinian voyaging line Islands to the Mariana Islands were Hipour movement — both men and women — whose (from Polowat) in 1969, Repunglap and Re- storied achievements and contributions have punglug (from Satawal) in 1970, and Ikuliman yet to come to light.